Fractures Fémorales Proximales : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
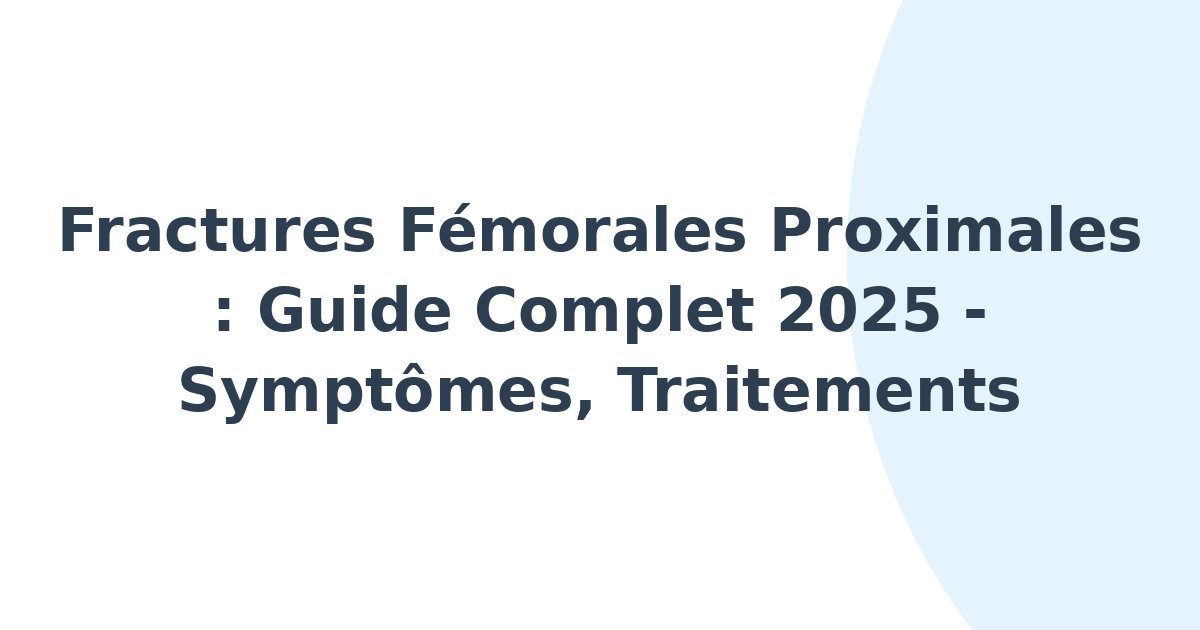
Les fractures fémorales proximales représentent une urgence orthopédique majeure touchant principalement les personnes âgées. Ces fractures, qui concernent la partie haute du fémur près de la hanche, constituent un enjeu de santé publique considérable en France. Avec plus de 75 000 cas annuels selon les dernières données épidémiologiques [1,8], cette pathologie nécessite une prise en charge rapide et spécialisée pour optimiser les chances de récupération fonctionnelle.
Téléconsultation et Fractures fémorales proximales
Téléconsultation non recommandéeLes fractures fémorales proximales constituent une urgence orthopédique nécessitant un diagnostic radiologique immédiat et une prise en charge chirurgicale rapide. L'examen clinique en présentiel est indispensable pour évaluer la déformation, la mobilité et les complications vasculo-nerveuses. La téléconsultation ne peut remplacer l'imagerie médicale obligatoire pour confirmer le diagnostic et planifier le traitement.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil des circonstances du traumatisme et du mécanisme lésionnel, évaluation de l'intensité douloureuse et de son évolution, analyse des antécédents orthopédiques et des facteurs de risque de fracture, orientation initiale vers les services d'urgence appropriés, suivi post-opératoire à distance de la cicatrisation et de la rééducation.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen clinique orthopédique complet avec recherche de déformation et de raccourcissement du membre, radiographies du bassin et de la hanche de face et de profil indispensables au diagnostic, évaluation des complications vasculo-nerveuses, prise en charge chirurgicale urgente par ostéosynthèse ou prothèse.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Toute suspicion de fracture fémorale proximale nécessite une consultation en urgence pour confirmation radiologique, impossibilité d'appui ou de marche nécessitant un examen orthopédique immédiat, déformation visible du membre inférieur, douleur intense de la hanche après traumatisme même mineur chez une personne âgée.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Fracture déplacée avec déformation majeure du membre, complications vasculo-nerveuses avec troubles sensitifs ou circulatoires, syndrome des loges, fracture ouverte avec plaie cutanée en regard.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Impossibilité totale de marcher ou de supporter le poids du corps après un traumatisme
- Déformation visible du membre inférieur avec raccourcissement et rotation externe
- Douleur intense de la hanche et de l'aine persistant au repos
- Troubles sensitifs ou circulatoires du membre inférieur (pied froid, pâle ou insensible)
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Chirurgien orthopédiste — consultation en présentiel indispensable
Les fractures fémorales proximales relèvent exclusivement de la chirurgie orthopédique et nécessitent une prise en charge hospitalière urgente. Une consultation en présentiel est indispensable pour l'examen clinique, l'imagerie et la planification chirurgicale.
Fractures fémorales proximales : Définition et Vue d'Ensemble
Une fracture fémorale proximale désigne une rupture de l'os au niveau de l'extrémité supérieure du fémur, près de l'articulation de la hanche. Cette zone anatomique comprend le col fémoral, la région trochantérienne et la zone sous-trochantérienne [14,15].
Concrètement, imaginez le fémur comme une clé anglaise : la partie qui s'articule avec le bassin (la tête fémorale) et son "manche" (le col) constituent les zones les plus vulnérables. Ces fractures se divisent en deux grandes catégories selon leur localisation précise [16].
Les fractures du col fémoral touchent la partie étroite reliant la tête à la diaphyse fémorale. D'ailleurs, elles représentent environ 45% de toutes les fractures fémorales proximales [7]. Les fractures trochantériennes, quant à elles, affectent la région située juste en dessous du col, là où s'insèrent de puissants muscles.
Bon à savoir : ces fractures surviennent majoritairement chez les personnes de plus de 65 ans, mais peuvent également toucher des sujets plus jeunes lors de traumatismes à haute énergie [8,9].
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les chiffres français révèlent l'ampleur de cette pathologie. En 2024, on dénombre environ 75 000 fractures fémorales proximales par an en France, soit une incidence de 112 cas pour 100 000 habitants [1,8]. Cette incidence augmente dramatiquement avec l'âge : elle passe de 20/100 000 chez les 50-59 ans à plus de 1 500/100 000 après 85 ans [8].
L'évolution démographique française préoccupe les autorités sanitaires. D'ici 2030, les projections estiment une augmentation de 25% du nombre de cas, principalement due au vieillissement de la population [1]. Les femmes sont particulièrement touchées, représentant 75% des cas après 70 ans [8,9].
Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne haute avec des taux similaires à l'Allemagne et au Royaume-Uni. Cependant, les pays nordiques affichent des incidences supérieures de 15 à 20% [8]. Cette différence s'explique notamment par des facteurs génétiques et environnementaux.
L'impact économique est considérable : chaque fracture coûte en moyenne 15 000 euros au système de santé français, incluant l'hospitalisation, la chirurgie et la rééducation [1]. Cela représente un coût total annuel dépassant le milliard d'euros.
Les Causes et Facteurs de Risque
L'ostéoporose constitue le facteur de risque majeur des fractures fémorales proximales. Cette maladie osseuse, qui diminue la densité et la qualité de l'os, touche 30% des femmes ménopausées [6]. En fait, la relation entre densité minérale osseuse et instabilité fracturaire a été clairement établie par des études récentes [6].
Mais l'âge reste le déterminant principal. Après 50 ans, le risque double tous les 10 ans chez la femme et tous les 15 ans chez l'homme [7,8]. Cette augmentation s'explique par la diminution progressive de la masse osseuse et l'altération de l'architecture trabéculaire.
D'autres facteurs contribuent significativement au risque. Les chutes répétées représentent le mécanisme déclencheur dans 95% des cas chez les personnes âgées [9]. Les troubles de l'équilibre, la polymédication, les troubles visuels et la sarcopénie augmentent considérablement ce risque de chute.
Certaines morphologies fémorales prédisposent également aux fractures. Le "neck shaft ratio" et l'angle cervico-diaphysaire influencent la résistance mécanique de l'os [7]. Les recherches 2024 ont permis d'identifier des profils anatomiques à risque, ouvrant la voie à une prévention personnalisée.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
La douleur intense au niveau de l'aine ou de la hanche constitue le symptôme cardinal d'une fracture fémorale proximale. Cette douleur survient brutalement, souvent après une chute, et s'aggrave à tout mouvement [15,16]. Contrairement à une simple contusion, elle ne s'améliore pas au repos.
L'impossibilité de marcher ou de supporter le poids du corps sur la jambe atteinte représente un signe d'alarme majeur. Vous pourriez également observer une déformation visible de la jambe, qui apparaît raccourcie et tournée vers l'extérieur [15]. Cette rotation externe caractéristique résulte de l'action des muscles qui tirent sur les fragments osseux.
Attention cependant : certaines fractures, notamment celles du col fémoral non déplacées, peuvent présenter des symptômes plus discrets. La douleur peut être modérée et la marche parfois encore possible, ce qui retarde malheureusement le diagnostic [16].
D'autres signes doivent vous alerter : un hématome important au niveau de la hanche, une sensation de "craquement" lors de la chute, ou une douleur qui irradie vers le genou. En cas de doute, il est crucial de consulter rapidement, car un retard diagnostique peut compromettre le pronostic fonctionnel.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic d'une fracture fémorale proximale débute par un examen clinique minutieux. Le médecin évalue d'abord les circonstances de la chute, recherche les facteurs de risque et examine la mobilité de la hanche [15,16]. Cette première étape permet d'orienter rapidement vers une suspicion de fracture.
La radiographie standard reste l'examen de référence pour confirmer le diagnostic. Elle doit inclure des clichés de face du bassin et de profil de la hanche concernée [14,15]. Ces images permettent de visualiser la fracture, d'évaluer son déplacement et de planifier le traitement chirurgical.
Cependant, environ 5% des fractures du col fémoral peuvent échapper à la radiographie initiale, particulièrement les fractures non déplacées [16]. Dans ces cas, l'IRM ou le scanner s'avèrent indispensables pour poser le diagnostic. L'IRM présente l'avantage de détecter les fractures occultes et d'évaluer l'état des tissus mous environnants.
Parallèlement au diagnostic de fracture, une évaluation globale du patient s'impose. Elle comprend un bilan biologique complet, une évaluation cardiaque et anesthésique, ainsi qu'une recherche de complications associées [8,9]. Cette approche multidisciplinaire optimise la prise en charge périopératoire.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement des fractures fémorales proximales est quasi exclusivement chirurgical. Le choix de la technique dépend de plusieurs facteurs : type de fracture, âge du patient, qualité osseuse et niveau d'activité [10,12]. Cette décision thérapeutique nécessite une expertise orthopédique spécialisée.
Pour les fractures du col fémoral, deux approches principales existent. Chez les patients jeunes avec un os de bonne qualité, l'ostéosynthèse par vis ou plaque permet de préserver l'articulation native [4,10]. En revanche, chez les personnes âgées, la prothèse de hanche (partielle ou totale) offre de meilleurs résultats fonctionnels [1,4].
Les fractures trochantériennes bénéficient généralement d'une ostéosynthèse par clou gamma ou plaque-vis [10,12]. Ces implants modernes permettent une mobilisation précoce et réduisent les complications liées à l'alitement prolongé. L'innovation récente des plaques de verrouillage améliore la stabilité, particulièrement chez les patients ostéoporotiques [4].
La prise en charge ne se limite pas à la chirurgie. Un programme de rééducation précoce débute dès le lendemain de l'intervention [9]. Cette mobilisation rapide prévient les complications thromboemboliques et favorise la récupération fonctionnelle. L'important à retenir : plus la rééducation commence tôt, meilleur est le pronostic.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans la prise en charge des fractures fémorales proximales. Le remplacement fémoral proximal avec plaque de verrouillage représente une innovation majeure pour les fractures complexes [4]. Cette technique combine les avantages de la prothèse et de l'ostéosynthèse, offrant une stabilité optimale même en cas d'os très fragile.
Les recherches présentées au congrès SOFCOT 2024 révèlent des avancées prometteuses [2]. Notamment, l'utilisation de biomatériaux innovants et de techniques de régénération osseuse améliore significativement la consolidation chez les patients ostéoporotiques. Ces approches réduisent le taux d'échec de 15% selon les premières études [2,3].
L'intelligence artificielle fait également son entrée dans ce domaine. Des algorithmes prédictifs permettent désormais d'identifier les patients à risque de complications et d'adapter le traitement en conséquence [5]. Cette approche personnalisée de la médecine orthopédique ouvre de nouvelles perspectives thérapeutiques.
Parallèlement, les traitements endovasculaires des complications post-opératoires se développent . Ces techniques mini-invasives réduisent la morbidité des reprises chirurgicales et améliorent la qualité de vie des patients. L'avenir s'annonce prometteur avec ces innovations qui révolutionnent progressivement la prise en charge.
Vivre au Quotidien avec une Fracture Fémorale Proximale
La récupération après une fracture fémorale proximale s'étale généralement sur plusieurs mois. Les premières semaines nécessitent souvent des aides techniques : déambulateur, cannes, rehausseur de toilettes [11]. Ces équipements, bien que temporaires, facilitent grandement les gestes du quotidien et sécurisent vos déplacements.
L'adaptation du domicile devient cruciale pour prévenir les rechutes. Éliminez les tapis glissants, installez des barres d'appui dans la salle de bain, améliorez l'éclairage des escaliers [9]. Ces modifications simples réduisent considérablement le risque de nouvelle chute.
Sur le plan psychologique, il est normal de ressentir une appréhension lors des premiers pas. Cette peur de tomber à nouveau touche 60% des patients selon les études récentes [11]. N'hésitez pas à en parler avec votre équipe soignante : des solutions existent pour retrouver confiance progressivement.
La reprise des activités se fait graduellement. La conduite automobile peut généralement reprendre après 6 à 8 semaines, selon le côté opéré et le type de transmission [11]. Pour les activités sportives, comptez 3 à 6 mois selon l'intensité pratiquée. L'important est de respecter votre rythme et d'écouter votre corps.
Les Complications Possibles
Bien que la chirurgie des fractures fémorales proximales soit généralement sûre, certaines complications peuvent survenir. Les plus fréquentes concernent les problèmes de consolidation : retard de cicatrisation osseuse, pseudarthrose ou nécrose de la tête fémorale [10,13]. Ces complications touchent environ 5 à 10% des patients selon le type de fracture.
Les complications infectieuses représentent un risque majeur, particulièrement chez les patients fragiles. L'infection profonde de prothèse nécessite souvent une reprise chirurgicale complexe [10]. Heureusement, les protocoles d'antibioprophylaxie modernes ont considérablement réduit ce risque à moins de 2%.
D'autres complications peuvent survenir à distance de l'intervention. Les fractures péri-prothétiques, c'est-à-dire autour de l'implant, concernent 2 à 5% des patients dans les 10 ans suivant la chirurgie [13]. Ces fractures particulières nécessitent une expertise spécialisée pour leur traitement.
Enfin, les complications générales liées à l'âge avancé des patients ne doivent pas être négligées : troubles cognitifs post-opératoires, complications cardio-pulmonaires, thromboses veineuses [5,9]. Une surveillance attentive et une prise en charge multidisciplinaire permettent de minimiser ces risques.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des fractures fémorales proximales dépend largement de l'âge du patient et de son état général avant la fracture. Chez les personnes de moins de 65 ans, la récupération est généralement excellente avec un retour complet aux activités antérieures dans 85% des cas [8,11].
Pour les patients plus âgés, les résultats varient davantage. Environ 70% retrouvent leur niveau de marche antérieur, mais seulement 50% récupèrent leur autonomie complète [8,9]. Ces chiffres soulignent l'importance d'une prise en charge précoce et d'une rééducation intensive.
Le concept de "Patient Acceptable Symptom State" (PASS) aide à évaluer la satisfaction des patients après traitement [11]. Cette approche montre que même si la récupération n'est pas parfaite, la majorité des patients considèrent leur état comme acceptable pour leurs activités quotidiennes.
L'impact sur la mortalité reste préoccupant : le taux de décès à un an atteint 15 à 20% chez les personnes très âgées [5,8]. Cependant, cette surmortalité est souvent liée aux comorbidités préexistantes plutôt qu'à la fracture elle-même. D'où l'importance d'une évaluation globale de la fragilité avant l'intervention [5].
Peut-on Prévenir les Fractures Fémorales Proximales ?
La prévention des fractures fémorales proximales repose sur une approche multifactorielle. La prévention de l'ostéoporose constitue le pilier principal : supplémentation en vitamine D et calcium, activité physique régulière, arrêt du tabac [6,7]. Ces mesures simples peuvent réduire le risque de fracture de 30 à 40%.
La prévention des chutes représente l'autre volet essentiel. Cela passe par l'aménagement du domicile, la révision des traitements médicamenteux, la correction des troubles visuels et auditifs [9]. Les programmes d'exercices d'équilibre et de renforcement musculaire montrent une efficacité prouvée.
Les nouvelles recherches sur la morphologie fémorale ouvrent des perspectives préventives personnalisées [7]. L'identification des patients à risque par l'analyse du "neck shaft ratio" pourrait permettre une surveillance renforcée et des mesures préventives ciblées.
Enfin, le dépistage et le traitement précoce de l'ostéoporose chez les personnes à risque s'avèrent cruciaux. Les traitements anti-ostéoporotiques modernes peuvent réduire le risque de fracture de 50 à 70% chez les patients bien sélectionnés [6]. La prévention reste donc notre meilleure arme contre cette pathologie.
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024 des recommandations actualisées concernant la prise en charge des fractures fémorales proximales [1]. Ces guidelines insistent sur la nécessité d'une chirurgie dans les 48 heures suivant l'admission, sauf contre-indication majeure. Ce délai optimal améliore significativement le pronostic fonctionnel et vital.
Les recommandations européennes convergent vers une approche standardisée. L'utilisation d'implants sans ciment est désormais privilégiée chez les patients ostéoporotiques [1]. Cette technique réduit les complications péri-opératoires et améliore la fixation à long terme de la prothèse.
La HAS préconise également une évaluation gériatrique systématique pour tous les patients de plus de 75 ans [1]. Cette approche multidisciplinaire permet d'optimiser l'état général avant la chirurgie et de planifier la sortie d'hospitalisation. Elle réduit la durée de séjour et améliore les résultats fonctionnels.
Concernant la prévention secondaire, les autorités recommandent un bilan osseux complet et l'instauration d'un traitement anti-ostéoporotique chez tous les patients ayant présenté une fracture de fragilité [1]. Cette démarche préventive peut éviter jusqu'à 50% des fractures ultérieures.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations françaises accompagnent les patients atteints de fractures fémorales proximales. L'Association Française de Lutte Anti-Rhumatismale (AFLAR) propose des programmes d'éducation thérapeutique et des groupes de soutien. Ces ressources s'avèrent précieuses pour comprendre la maladie et échanger avec d'autres patients.
La Fondation Internationale de l'Ostéoporose (IOF) met à disposition de nombreux outils pédagogiques en français. Leur site web contient des guides pratiques pour la prévention des chutes et l'adaptation du domicile. Ces ressources gratuites complètent utilement l'information médicale.
Au niveau local, de nombreux centres hospitaliers organisent des écoles de la fracture. Ces programmes éducatifs abordent tous les aspects de la prise en charge : chirurgie, rééducation, prévention des récidives. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre équipe soignante.
Les réseaux sociaux hébergent également des communautés de patients très actives. Ces groupes d'entraide permettent de partager expériences et conseils pratiques. Attention cependant à toujours vérifier les informations médicales avec votre médecin traitant.
Nos Conseils Pratiques
Pour optimiser votre récupération, respectez scrupuleusement les consignes de mise en charge progressive. Votre chirurgien vous indiquera précisément le poids que vous pouvez appliquer sur votre jambe opérée. Cette progression graduelle favorise la consolidation osseuse et prévient les complications [9,11].
Investissez dans des chaussures adaptées : semelles antidérapantes, maintien de la cheville, fermeture facile. Évitez absolument les chaussons, pantoufles et chaussures à talons pendant les premiers mois. Ces précautions simples réduisent considérablement le risque de chute.
Organisez votre domicile pour faciliter les gestes quotidiens. Placez les objets usuels à portée de main, éliminez les obstacles au sol, installez un éclairage suffisant [9]. Pensez également à préparer vos repas à l'avance et à organiser l'aide à domicile si nécessaire.
N'interrompez jamais votre traitement anti-ostéoporotique sans avis médical. Ces médicaments, même s'ils peuvent avoir des effets secondaires, réduisent drastiquement le risque de nouvelle fracture [6]. En cas de problème, parlez-en avec votre médecin qui pourra adapter le traitement.
Quand Consulter un Médecin ?
Consultez immédiatement si vous ressentez une douleur intense à la hanche après une chute, même apparemment bénigne. N'attendez pas que la douleur s'aggrave : plus le diagnostic est précoce, meilleur sera le pronostic [15,16]. Les services d'urgences sont équipés pour prendre en charge rapidement ces situations.
Après l'intervention, certains signes doivent vous alerter. Une fièvre persistante, un écoulement au niveau de la cicatrice, une douleur qui s'aggrave brutalement nécessitent une consultation rapide [10]. Ces symptômes peuvent révéler une complication infectieuse nécessitant un traitement urgent.
Dans les mois suivant la chirurgie, surveillez l'évolution de votre récupération. Si vous constatez une diminution de la mobilité, une boiterie qui s'aggrave ou des douleurs nouvelles, n'hésitez pas à consulter votre chirurgien [11]. Ces signes peuvent révéler un problème de consolidation ou de positionnement de l'implant.
Enfin, planifiez un suivi régulier avec votre médecin traitant pour la prévention des récidives. Un contrôle annuel avec radiographie et bilan osseux permet de détecter précocement d'éventuels problèmes [1]. Cette surveillance préventive est essentielle pour votre santé osseuse à long terme.
Actes médicaux associés
Les actes CCAM suivants peuvent être pratiqués dans le cadre de Fractures fémorales proximales :
Questions Fréquentes
Combien de temps dure l'hospitalisation après une fracture fémorale proximale ?
La durée moyenne d'hospitalisation est de 7 à 10 jours, selon votre état général et le type d'intervention. Les patients jeunes et en bonne santé peuvent parfois sortir plus tôt, vers le 5ème jour.
Puis-je reprendre le sport après une fracture fémorale proximale ?
Oui, dans la plupart des cas. Les sports à faible impact (natation, vélo, marche) peuvent être repris après 3 mois. Pour les sports plus intenses, comptez 6 mois minimum avec accord de votre chirurgien.
Le matériel chirurgical doit-il être retiré ?
Non, généralement pas. Les prothèses et implants modernes sont conçus pour rester en place définitivement. Seules certaines complications peuvent nécessiter une reprise chirurgicale.
Vais-je déclencher les portiques de sécurité avec ma prothèse ?
Oui, les implants métalliques déclenchent les détecteurs. Conservez votre carte d'implant et prévenez les agents de sécurité. La plupart des aéroports disposent de procédures adaptées.
Puis-je passer une IRM avec ma prothèse de hanche ?
Oui, les prothèses modernes sont compatibles IRM. Informez toujours le radiologue de la présence de votre implant avant l'examen.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] ACOR (sans ciment). HAS. 2024-2025.Lien
- [2] Traitement endovasculaire des syndromes post-thrombotiques veineux. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [3] 2024 SOFCOT Paris 98e Programme Congrès. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [4] THESE Par M. OULD MOHAMED Aboubacrine. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] Proximal femoral replacement with locking plate. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] Frailty as a determinant of mortality, surgical timing. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [7] T Kanazawa, T Ohmori. Relation entre la densité minérale osseuse du fémur proximal et l'instabilité des fractures fémorales proximales. 2023.Lien
- [8] G Rougereau, JA Bourdier. Morphologie fémorale à risque de fracture cervicale ou pertrochantérienne. 2024.Lien
- [9] A Ould Mohamed. Aspects épidémiologiques, cliniques, et thérapeutiques des fractures de l'extrémité proximale du fémur. 2024.Lien
- [10] Gestion périopératoire des fractures de l'extrémité proximale du fémur chez les sujets âgés.Lien
- [11] M Guenbdar. Traitement des fractures fémorales péri-prothétiques de la hanche post-opératoires. 2023.Lien
- [12] M Wiklund, A Gras. Le Patient acceptable symptom state après arthroplastie de résection fémorale proximale. 2024.Lien
- [13] G Piétu. L'ostéosynthèse des fractures diaphysaires après 80 ans a-t-elle des spécificités? 2024.Lien
- [14] F Egrise, O Gastaud. Identification et traitement d'une fracture péri-prothétique Vancouver B. 2022.Lien
- [15] Les fractures proximales du fémur. Revue Médicale Suisse.Lien
- [16] Fractures de hanche - Blessures; empoisonnement. MSD Manuals.Lien
- [17] Fractures du Col du Fémur : Diagnostic, Classification et Traitements.Lien
Publications scientifiques
- Relation entre la densité minérale osseuse du fémur proximal et l'instabilité des fractures fémorales proximales: étude rétrospective (2023)
- Existe-t-il une morphologie fémorale à risque de fracture cervicale ou pertrochantérienne? Description et validation du «Neck shaft ratio» et du «Intertrochanteric distal … (2024)
- Aspects épidémiologiques, cliniques, et thérapeutiques des fractures de l'extrémité proximale du fémur chez l'adulte au CHU Gabriel touré (2024)[PDF]
- [PDF][PDF] Gestion périopératoire des fractures de l'extrémité proximale du fémur chez les sujets âgés au Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou [PDF]
- [PDF][PDF] TRAITEMENT DES FRACTURES FEMORALES PERI-PROTHETIQUES DE LA HANCHE POST-OPERATOIRES: A PROPOS DE 20 CAS (2023)[PDF]
Ressources web
- Les fractures proximales du fémur (revmed.ch)
Diagnostic différentiel. Classiquement, une chute, une impotence fonctionnelle et une difficulté ou des douleurs à la mobilisation de la hanche font penser à ...
- Fractures de hanche - Blessures; empoisonnement (msdmanuals.com)
Le diagnostic de suspicion de fracture de hanche commence par une radiographie du bassin en incidence antéropostérieure et une incidence latérale transversale.
- Fractures du Col du Fémur : Diagnostic, Classification et ... (prothese-hanche-toulon.fr)
23 janv. 2025 — Douleur intense à la hanche ou à l'aine. · Incapacité de se tenir debout ou de marcher. · Rotation externe et raccourcissement de la jambe.
- Symptômes et diagnostic d'une fracture du col du fémur ou ... (ameli.fr)
La fracture du col fémoral ou du trochanter entraîne des douleurs importantes et l'impossibilité de se relever ou de s'appuyer sur la jambe.
- Fracture du fémur (et ses séquelles) (deuxiemeavis.fr)
Quels sont les symptômes d'une fracture du fémur ? ; fracture du fémur se traduit par une forte ; douleur à la jambe, à la hanche et au genou, mais aussi par une ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
