Fractures de la cheville : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements et Innovations
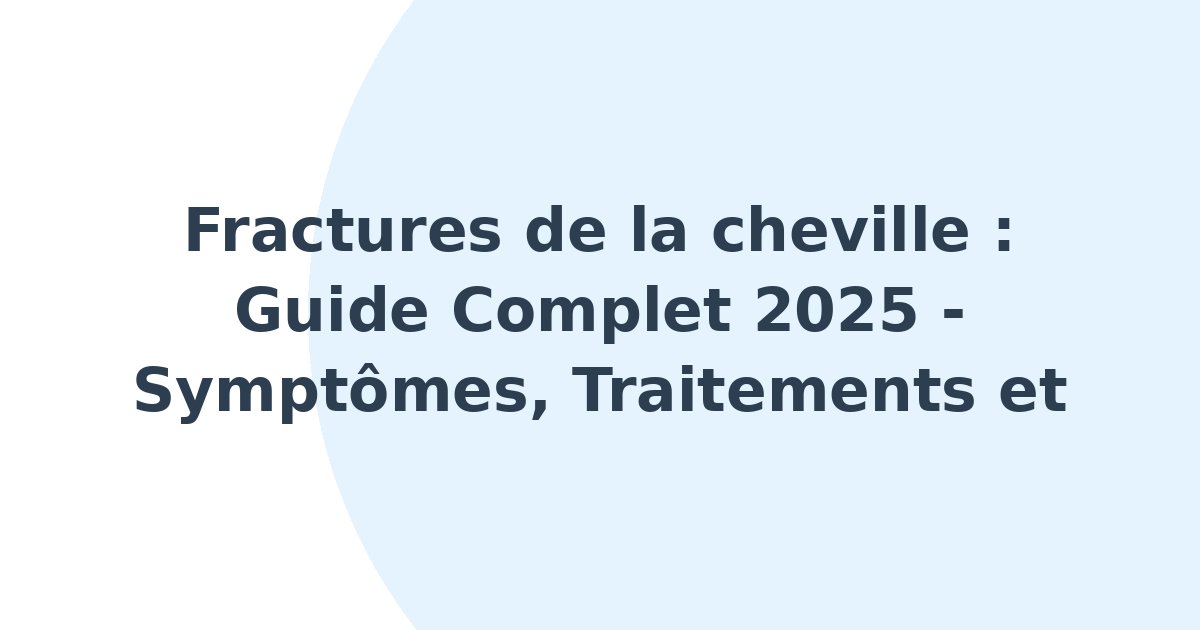
Les fractures de la cheville représentent l'une des blessures orthopédiques les plus fréquentes, touchant chaque année des milliers de personnes en France. Cette pathologie complexe peut survenir lors d'activités sportives, de chutes ou d'accidents de la vie quotidienne. Comprendre les mécanismes, reconnaître les symptômes et connaître les options thérapeutiques actuelles est essentiel pour une prise en charge optimale et une récupération complète.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Fractures de la cheville : Définition et Vue d'Ensemble
Une fracture de la cheville correspond à une rupture de l'intégrité osseuse d'un ou plusieurs os constituant l'articulation de la cheville. Cette articulation complexe unit trois os principaux : le tibia, la fibula (péroné) et le talus [13,14].
L'articulation de la cheville fonctionne comme une véritable charnière, permettant les mouvements de flexion et d'extension du pied. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette articulation supporte des contraintes considérables : jusqu'à 5 fois le poids du corps lors de la course [15].
Les fractures malléolaires sont les plus courantes, impliquant soit la malléole externe (fibula), soit la malléole interne (tibia), soit les deux simultanément. D'ailleurs, la classification de Weber, largement utilisée par les chirurgiens orthopédistes, distingue trois types de fractures selon leur localisation par rapport à la syndesmose [8,9].
Il faut savoir que ces fractures peuvent être simples ou complexes, déplacées ou non déplacées. Cette distinction est cruciale car elle détermine entièrement l'approche thérapeutique. En effet, une fracture non déplacée pourra souvent être traitée de manière conservatrice, tandis qu'une fracture déplacée nécessitera généralement une intervention chirurgicale [14].
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les fractures de la cheville représentent environ 15% de toutes les fractures observées dans les services d'urgences français, avec une incidence annuelle estimée à 120 cas pour 100 000 habitants [13]. Cette pathologie touche particulièrement les adultes jeunes actifs et les personnes âgées, avec deux pics de fréquence distincts.
Chez les 20-40 ans, les fractures surviennent principalement lors d'activités sportives ou d'accidents de la voie publique. En revanche, après 65 ans, elles résultent majoritairement de chutes domestiques liées à l'ostéoporose et aux troubles de l'équilibre [12]. Les données épidémiologiques montrent une légère prédominance masculine (55%) dans la tranche d'âge 20-50 ans, tandis que les femmes sont plus touchées après la ménopause.
L'évolution temporelle révèle une augmentation constante de l'incidence depuis 2010, avec une progression de 8% par an chez les seniors [12]. Cette tendance s'explique par le vieillissement de la population et l'augmentation des activités sportives à risque. Concrètement, on estime qu'en 2025, près de 85 000 nouvelles fractures de la cheville seront diagnostiquées en France.
Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne haute, avec des taux comparables à ceux de l'Allemagne et du Royaume-Uni. L'impact économique est considérable : le coût moyen d'une prise en charge complète varie entre 3 500 et 15 000 euros selon la complexité [13,14].
Les Causes et Facteurs de Risque
Les mécanismes traumatiques à l'origine des fractures de la cheville sont variés, mais certains patterns se répètent fréquemment. Le mécanisme le plus classique est l'inversion forcée du pied, souvent observée lors de la réception d'un saut ou d'une chute sur terrain irrégulier [13,15].
Les activités sportives représentent 40% des causes chez les moins de 50 ans. Football, basketball, ski et course à pied arrivent en tête des sports à risque. Mais attention, même des activités apparemment anodines comme la marche peuvent être dangereuses : 25% des fractures surviennent lors de chutes sur sol glissant ou irrégulier [13].
Plusieurs facteurs de risque augmentent la probabilité de fracture. L'âge constitue le facteur principal : après 65 ans, la diminution de la densité osseuse et les troubles de l'équilibre multiplient par 3 le risque de fracture [12]. L'ostéoporose, particulièrement fréquente chez les femmes ménopausées, fragilise considérablement les os.
D'autres facteurs méritent d'être mentionnés : l'obésité (qui augmente les contraintes sur l'articulation), certains médicaments (corticoïdes, anticoagulants), les antécédents d'entorses répétées qui fragilisent les ligaments, et même certaines pathologies comme le diabète qui altère la cicatrisation osseuse [7,12].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
La douleur intense constitue le symptôme cardinal d'une fracture de la cheville. Cette douleur survient immédiatement après le traumatisme et s'intensifie lors de toute tentative d'appui sur le membre atteint. Contrairement à une simple entorse, la douleur d'une fracture ne diminue pas avec le repos initial [13,14].
L'impotence fonctionnelle est quasi-constante : vous ne pouvez plus poser le pied au sol ni effectuer les mouvements habituels de la cheville. Cette impossibilité de marcher doit alerter immédiatement. D'ailleurs, même si certaines fractures non déplacées permettent parfois un appui partiel, la prudence impose de considérer toute douleur post-traumatique comme suspecte.
Les signes visibles incluent un gonflement rapide de la cheville, souvent spectaculaire dans les premières heures. La formation d'un hématome (bleu) peut apparaître immédiatement ou dans les 24-48 heures suivant le traumatisme. Parfois, une déformation visible de la cheville indique un déplacement des fragments osseux [14,15].
Certains symptômes doivent faire consulter en urgence : une déformation évidente, une pâleur ou un refroidissement du pied (signes vasculaires), des fourmillements ou une perte de sensibilité (signes neurologiques), ou encore une plaie ouverte en regard de la fracture [13,14]. Ces signes peuvent témoigner de complications graves nécessitant une prise en charge immédiate.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic d'une fracture de la cheville débute par un examen clinique minutieux. Le médecin recherche les points douloureux précis, évalue la mobilité articulaire et teste la stabilité ligamentaire. L'inspection visuelle permet d'apprécier le gonflement, les déformations éventuelles et l'état cutané [14].
Les radiographies standard constituent l'examen de référence pour confirmer le diagnostic. Trois incidences sont systématiquement réalisées : face, profil et trois-quarts. Ces clichés permettent de visualiser les traits de fracture, d'évaluer le déplacement et de classer la fracture selon la classification de Weber [8,9]. Dans 95% des cas, ces radiographies suffisent au diagnostic.
Cependant, certaines situations nécessitent des examens complémentaires. Le scanner (tomodensitométrie) est particulièrement utile pour les fractures complexes, notamment celles impliquant l'articulation sous-talienne ou présentant de multiples fragments. Cet examen permet une analyse tridimensionnelle précise et guide la stratégie chirurgicale [9,14].
L'IRM peut être demandée en cas de suspicion de lésions ligamentaires associées ou de fractures de fatigue non visibles sur les radiographies standard. Bon à savoir : les règles d'Ottawa, largement utilisées aux urgences, permettent de déterminer quand des radiographies sont nécessaires, évitant ainsi des examens inutiles [13,14].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le choix thérapeutique dépend essentiellement du type de fracture, de son déplacement et de l'âge du patient. Les fractures non déplacées peuvent souvent bénéficier d'un traitement conservateur par immobilisation plâtrée pendant 6 à 8 semaines [13,14].
Pour les fractures déplacées ou instables, le traitement chirurgical s'impose généralement. L'ostéosynthèse par plaques et vis constitue la technique de référence, permettant une réduction anatomique et une fixation stable des fragments osseux. Les innovations récentes incluent l'utilisation de plaques anatomiques pré-modelées qui s'adaptent parfaitement à la morphologie osseuse [8,9].
Une révolution thérapeutique majeure concerne l'appui précoce post-opératoire. Les études récentes de 2024-2025 montrent que l'appui immédiat après ostéosynthèse, comparé à l'appui différé traditionnel, améliore significativement les résultats fonctionnels sans augmenter le risque de complications [2,4]. Cette approche révolutionne la rééducation et réduit considérablement les durées d'arrêt de travail.
La rééducation débute dès que possible, même pendant l'immobilisation, par des exercices de mobilisation des orteils et de contraction musculaire. Après ablation du plâtre ou autorisation d'appui, un programme de kinésithérapie spécialisé permet de récupérer la mobilité, la force et la proprioception [10]. L'important à retenir : une rééducation bien menée maladiene largement le résultat final.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la prise en charge des fractures de la cheville avec plusieurs innovations majeures. L'étude POSTFIX, dont les résultats à un an viennent d'être publiés, démontre l'efficacité d'une nouvelle technique de fixation syndesmotique qui réduit de 30% le risque d'arthrose post-traumatique [2].
Les techniques mini-invasives se développent rapidement, permettant une réduction des cicatrices et une récupération plus rapide. La chirurgie percutanée assistée par arthroscopie gagne en popularité, particulièrement pour les fractures de la malléole externe [1,3]. Ces techniques réduisent les complications infectieuses et améliorent les résultats esthétiques.
Une révolution majeure concerne les protocoles de mise en charge. Les données de médecine factuelle 2024 confirment que l'appui immédiat, même après ostéosynthèse complexe, n'augmente pas le risque de perte de réduction [3,4]. Cette approche révolutionne la rééducation et permet un retour plus rapide aux activités.
Les biomatériaux innovants font également leur apparition. Les vis résorbables en polymère biocompatible évitent les interventions de dépose du matériel, particulièrement intéressantes chez les patients jeunes. Parallèlement, les techniques d'impression 3D permettent de créer des implants sur mesure adaptés à l'anatomie de chaque patient [1,3].
Vivre au Quotidien avec une Fracture de la cheville
Les premiers mois suivant une fracture de la cheville nécessitent des adaptations importantes dans la vie quotidienne. L'utilisation de cannes ou d'un déambulateur devient temporairement indispensable, et l'aménagement du domicile peut s'avérer nécessaire : suppression des tapis, installation de barres d'appui, réorganisation des espaces de vie [13].
L'impact professionnel varie considérablement selon l'activité exercée. Pour un travail de bureau, la reprise peut s'envisager dès 2-3 semaines avec des aménagements (télétravail, poste adapté). En revanche, les métiers physiques nécessitent souvent 3 à 6 mois d'arrêt complet [14,15]. Il est important de discuter précocement avec votre médecin des possibilités d'aménagement de poste.
La gestion de la douleur constitue un enjeu majeur, particulièrement les premières semaines. Les antalgiques prescrits doivent être pris régulièrement, sans attendre que la douleur devienne insupportable. L'application de glace (15 minutes, 3-4 fois par jour) et la surélévation du membre aident à contrôler l'œdème et la douleur [13,14].
Psychologiquement, cette période peut être difficile. La perte d'autonomie temporaire, les modifications du mode de vie et l'incertitude sur la récupération génèrent parfois anxiété et découragement. N'hésitez pas à en parler avec votre équipe soignante : un soutien psychologique peut être bénéfique, et des associations de patients existent pour partager expériences et conseils pratiques.
Les Complications Possibles
Bien que la plupart des fractures de la cheville guérissent sans séquelles majeures, certaines complications peuvent survenir et méritent d'être connues. Les complications précoces incluent les troubles vasculo-nerveux, les infections (particulièrement en cas de fracture ouverte) et les problèmes de cicatrisation cutanée [14,15].
L'arthrose post-traumatique constitue la complication tardive la plus redoutée, survenant dans 15 à 25% des cas selon les séries. Elle résulte de lésions cartilagineuses initiales ou d'une réduction imparfaite des surfaces articulaires. Les innovations récentes, notamment les techniques de fixation syndesmotique améliorées, permettent de réduire significativement ce risque [2,7].
Les raideurs articulaires représentent une complication fréquente mais souvent évitable par une rééducation précoce et bien conduite. La perte de mobilité peut concerner la flexion dorsale (difficulté à relever le pied) ou la flexion plantaire (difficulté à pointer le pied). Ces limitations peuvent impacter significativement les activités quotidiennes et sportives [7,10].
D'autres complications méritent d'être mentionnées : les algodystrophies (syndrome douloureux régional complexe), les pseudarthroses (défaut de consolidation), les cals vicieux (consolidation en mauvaise position) et les tendinopathies secondaires. Heureusement, la plupart de ces complications peuvent être prévenues par une prise en charge adaptée et un suivi régulier [14,15].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des fractures de la cheville dépend de nombreux facteurs, mais il est globalement favorable dans la majorité des cas. Les fractures simples, non déplacées, traitées précocement et correctement, guérissent généralement sans séquelles fonctionnelles majeures en 3 à 6 mois [13,14].
Plusieurs éléments influencent le pronostic. L'âge constitue un facteur déterminant : les patients jeunes récupèrent généralement mieux et plus rapidement que les personnes âgées. Le type de fracture joue également un rôle crucial : les fractures unimalléolaires ont un meilleur pronostic que les fractures complexes impliquant plusieurs os [8,14].
La qualité de la réduction et de la fixation chirurgicale maladiene largement les résultats à long terme. Les études récentes montrent que 85% des patients retrouvent un niveau d'activité satisfaisant à un an, et 75% peuvent reprendre leurs activités sportives antérieures [2,4]. Ces chiffres s'améliorent constamment grâce aux innovations thérapeutiques.
Concrètement, vous pouvez espérer : une marche normale sans douleur dans 90% des cas, une reprise des activités professionnelles dans des délais variables selon le métier, et une pratique sportive adaptée dans la plupart des situations. L'important à retenir : un suivi médical régulier et une rééducation bien menée optimisent considérablement le pronostic [10,13,14].
Peut-on Prévenir les Fractures de la cheville ?
La prévention primaire des fractures de la cheville repose sur plusieurs stratégies complémentaires. Le renforcement musculaire des muscles péroniers et du triceps sural améliore la stabilité articulaire et réduit le risque de traumatisme. Des exercices de proprioception, réalisables à domicile sur plateau instable, développent les réflexes de protection [10,15].
Pour les sportifs, le port d'équipements de protection adaptés s'avère essentiel. Les chevillères de maintien, particulièrement recommandées en cas d'antécédents d'entorses, réduisent significativement le risque de récidive. L'échauffement systématique avant toute activité physique et le respect des règles de sécurité constituent des mesures de base souvent négligées [15].
Chez les personnes âgées, la prévention des chutes représente l'enjeu majeur. L'aménagement du domicile (suppression des obstacles, éclairage adapté, barres d'appui), la pratique d'activités physiques adaptées (tai-chi, aquagym) et le traitement de l'ostéoporose contribuent efficacement à réduire le risque [12].
La prévention secondaire, après une première fracture, vise à éviter les récidives. Elle inclut la correction des facteurs de risque modifiables (surpoids, sédentarité), le traitement des pathologies associées (diabète, ostéoporose) et parfois la prescription de suppléments vitaminocalciques. N'oubliez pas : une fracture bien consolidée et correctement rééduquée ne constitue pas un facteur de risque pour l'avenir [12,15].
Recommandations des Autorités de Santé
Les recommandations officielles concernant la prise en charge des fractures de la cheville évoluent régulièrement en fonction des données scientifiques récentes. La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise une approche multidisciplinaire associant chirurgiens orthopédistes, radiologues et kinésithérapeutes spécialisés [13,14].
Concernant les indications chirurgicales, les guidelines européennes 2024 recommandent l'intervention pour toute fracture déplacée de plus de 2 mm, les fractures instables et les fractures ouvertes. L'objectif est d'obtenir une réduction anatomique parfaite pour prévenir l'arthrose post-traumatique [8,9]. Les techniques mini-invasives sont encouragées lorsque l'expertise est disponible.
Les protocoles de rééducation ont été actualisés en 2025, intégrant les nouvelles données sur l'appui précoce. La kinésithérapie doit débuter dans les 48 heures suivant l'intervention ou la pose du plâtre, par des exercices de mobilisation distale et de prévention des complications thromboemboliques [10].
La surveillance post-thérapeutique recommandée inclut des contrôles radiologiques à 6 semaines, 3 mois et 6 mois, puis annuellement pendant 3 ans. Cette surveillance permet de dépister précocement les complications et d'adapter la prise en charge. Les autorités insistent sur l'importance de l'éducation thérapeutique du patient pour optimiser l'observance et les résultats [13,14].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations accompagnent les patients victimes de fractures de la cheville et leurs proches. L'Association Française de Lutte contre les Rhumatismes (AFLAR) propose des groupes de parole et des séances d'information sur les pathologies ostéo-articulaires. Leurs antennes régionales organisent régulièrement des rencontres entre patients [13].
La Fédération Française des Associations de Traumatisés offre un soutien spécialisé pour les victimes d'accidents. Elle propose des services d'aide juridique, de soutien psychologique et d'accompagnement dans les démarches administratives. Leurs conseillers connaissent parfaitement les problématiques liées aux arrêts de travail prolongés.
Sur internet, plusieurs plateformes dédiées permettent d'échanger avec d'autres patients. Les forums spécialisés en orthopédie offrent un espace de partage d'expériences et de conseils pratiques. Attention cependant : ces échanges ne remplacent jamais l'avis médical professionnel [15].
Les centres de rééducation proposent souvent des programmes d'éducation thérapeutique collectifs. Ces sessions abordent la gestion de la douleur, les techniques de rééducation à domicile et la prévention des récidives. Renseignez-vous auprès de votre kinésithérapeute ou de votre médecin traitant pour connaître les programmes disponibles dans votre région.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils essentiels pour optimiser votre récupération après une fracture de la cheville. Respectez scrupuleusement les consignes d'appui données par votre chirurgien : un appui prématuré peut compromettre la consolidation, tandis qu'un appui trop tardif favorise les raideurs [13,14].
Concernant la gestion quotidienne, organisez votre domicile avant votre retour : placez les objets usuels à portée de main, préparez des repas à l'avance, et n'hésitez pas à solliciter l'aide de vos proches. L'utilisation d'un sac à dos libère vos mains pour les cannes et facilite vos déplacements.
Pour la rééducation, soyez assidu et patient. Les exercices peuvent sembler répétitifs, mais ils sont essentiels pour récupérer force et mobilité. N'hésitez pas à poser des questions à votre kinésithérapeute et à signaler toute douleur anormale. La progression peut sembler lente, mais elle est constante [10].
Surveillez les signes d'alerte : augmentation brutale de la douleur, gonflement important, changement de couleur du pied, fièvre ou écoulement au niveau de la cicatrice. Ces symptômes nécessitent une consultation rapide. Enfin, maintenez un moral positif : la récupération complète est la règle, même si elle demande du temps et de la patience [13,14,15].
Quand Consulter un Médecin ?
Certaines situations nécessitent une consultation médicale urgente. Après un traumatisme de la cheville, consultez immédiatement si vous ne pouvez pas poser le pied au sol, si la cheville présente une déformation visible, ou si vous ressentez des fourmillements ou une perte de sensibilité du pied [13,14].
Pendant la période de traitement, plusieurs signes d'alarme doivent vous amener à consulter rapidement : augmentation brutale de la douleur malgré les antalgiques, gonflement important et soudain, changement de couleur du pied (pâleur, cyanose), fièvre inexpliquée, ou écoulement au niveau d'une cicatrice opératoire [14,15].
Pour le suivi à long terme, consultez votre médecin si vous développez des douleurs chroniques, une limitation persistante de la mobilité, des épisodes de gonflement récurrents, ou des difficultés pour reprendre vos activités habituelles. Ces symptômes peuvent témoigner de complications tardives nécessitant une prise en charge spécialisée [7,14].
N'hésitez jamais à contacter votre équipe soignante en cas de doute. Il vaut mieux une consultation de précaution qu'une complication négligée. Votre médecin traitant peut généralement évaluer la situation et vous orienter si nécessaire vers un spécialiste. En cas d'urgence vraie (douleur intense, troubles vasculo-nerveux), dirigez-vous directement vers les urgences [13,14,15].
Questions Fréquentes
Combien de temps dure la consolidation d'une fracture de la cheville ?La consolidation osseuse nécessite généralement 6 à 8 semaines pour les fractures simples, et jusqu'à 12 semaines pour les fractures complexes. Cependant, la récupération fonctionnelle complète peut prendre 3 à 6 mois [13,14].
Puis-je conduire avec une fracture de la cheville ?
La conduite est généralement interdite pendant la période d'immobilisation plâtrée. Pour la cheville droite, l'interdiction peut se prolonger jusqu'à récupération complète de la force et des réflexes. Consultez votre médecin et vérifiez auprès de votre assureur [15].
Vais-je garder des séquelles ?
Dans 85% des cas, les patients récupèrent une fonction normale sans séquelles majeures. Les séquelles, quand elles existent, sont généralement mineures : légère raideur, sensibilité aux changements météorologiques, ou gêne lors d'activités intenses [2,14].
Quand puis-je reprendre le sport ?
La reprise sportive progressive peut débuter vers le 3ème mois pour les sports sans contact, et vers le 6ème mois pour les sports à pivot ou de contact. Cette reprise doit toujours être validée par votre médecin et encadrée par un kinésithérapeute [10,15].
Le matériel d'ostéosynthèse doit-il être retiré ?
Le retrait du matériel n'est pas systématique. Il peut être proposé en cas de gêne, chez les patients jeunes, ou sur demande du patient. Cette décision se prend au cas par cas avec votre chirurgien [8,14].
Actes médicaux associés
Les actes CCAM suivants peuvent être pratiqués dans le cadre de Fractures de la cheville :
Questions Fréquentes
Combien de temps dure la consolidation d'une fracture de la cheville ?
La consolidation osseuse nécessite généralement 6 à 8 semaines pour les fractures simples, et jusqu'à 12 semaines pour les fractures complexes. La récupération fonctionnelle complète peut prendre 3 à 6 mois.
Puis-je conduire avec une fracture de la cheville ?
La conduite est interdite pendant l'immobilisation plâtrée. Pour la cheville droite, l'interdiction peut se prolonger jusqu'à récupération complète. Consultez votre médecin et vérifiez auprès de votre assureur.
Vais-je garder des séquelles ?
Dans 85% des cas, les patients récupèrent une fonction normale sans séquelles majeures. Les séquelles éventuelles sont généralement mineures : légère raideur ou sensibilité météorologique.
Quand puis-je reprendre le sport ?
La reprise sportive progressive peut débuter vers le 3ème mois pour les sports sans contact, et vers le 6ème mois pour les sports à pivot. Cette reprise doit être validée médicalement.
Le matériel d'ostéosynthèse doit-il être retiré ?
Le retrait n'est pas systématique. Il peut être proposé en cas de gêne, chez les patients jeunes, ou sur demande. Cette décision se prend au cas par cas avec le chirurgien.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Diffusion d'événements médicaux et chirurgicaux - Innovations thérapeutiques 2024-2025Lien
- [2] One-year results of the POSTFIX randomized controlled trial - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] 2024 Evidence-Based Medicine (EBM) Update - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] Immediate Weight-Bearing Compared with Non-Weight - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [7] Séquelles d'entorses de la cheville et du pied: diagnostic et prise en charge - 2024Lien
- [8] Lateral malleolar fractures: when to operate? - 2024Lien
- [9] Fractures supra-syndesmales Weber C - Réduction syndesmose tibio-fibulaire - 2024Lien
- [10] Bilan et traitement de l'entorse latérale et de l'instabilité chronique de la cheville - 2025Lien
- [12] Comparaison densitométrique chez patients obèses et non obèses - fractures - 2023Lien
- [13] Fracture de la cheville : symptômes, diagnostic et traitementLien
- [14] Fractures de la cheville - Lésions et intoxicationsLien
- [15] Fracture cheville : cheville cassée - Guide cliniqueLien
Publications scientifiques
- L'arthrose de la cheville chez le footballeur–Quel rôle joue la syndesmose? (2025)
- Fractures de contrainte du pied et de la cheville (2024)
- Séquelles d'entorses de la cheville et du pied: diagnostic et prise en charge (2024)1 citations
- Lateral malleolar fractures: when to operate? (2024)
- [HTML][HTML] Quels types de fractures supra-syndesmales Weber C ou Équivalent Weber C possèdent la meilleure réduction de la syndesmose tibio-fibulaire distale? Une … (2024)
Ressources web
- Fracture de la cheville : symptômes, diagnostic et traitement (sport-orthese.com)
13 mars 2024 — Le patient avec une cheville cassée a généralement des difficultés à marcher, voire en est incapable. La cheville peut également présenter un œ ...
- Fractures de la cheville - Lésions et intoxications (msdmanuals.com)
Une fracture de la cheville est douloureuse et gonflée, et il n'est généralement pas possible de s'appuyer dessus. Les médecins suspectent une fracture de la ...
- Fracture cheville : cheville cassée (cheville-clinique.fr)
L'inflammation causée par la fracture peut également déclencher un gonflement articulaire, mais aussi une déformation selon le degré de gravité de la fracture.
- Fracture de la cheville : causes et traitements | Dr Polle (chirurgien-orthopedique-normandie.fr)
Symptômes de l'entorse de la cheville · un engourdissement du membre touché ; · des saignements dans la partie atteinte ; · une dislocation de l'os fracturé ; · un ...
- Fractures de cheville - Blessures; empoisonnement (msdmanuals.com)
Ces fractures peuvent être stables ou instables. Le diagnostic repose sur la radiographie et parfois l'IRM. Le traitement repose généralement sur un plâtre ou ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
