Zoonoses : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements et Prévention
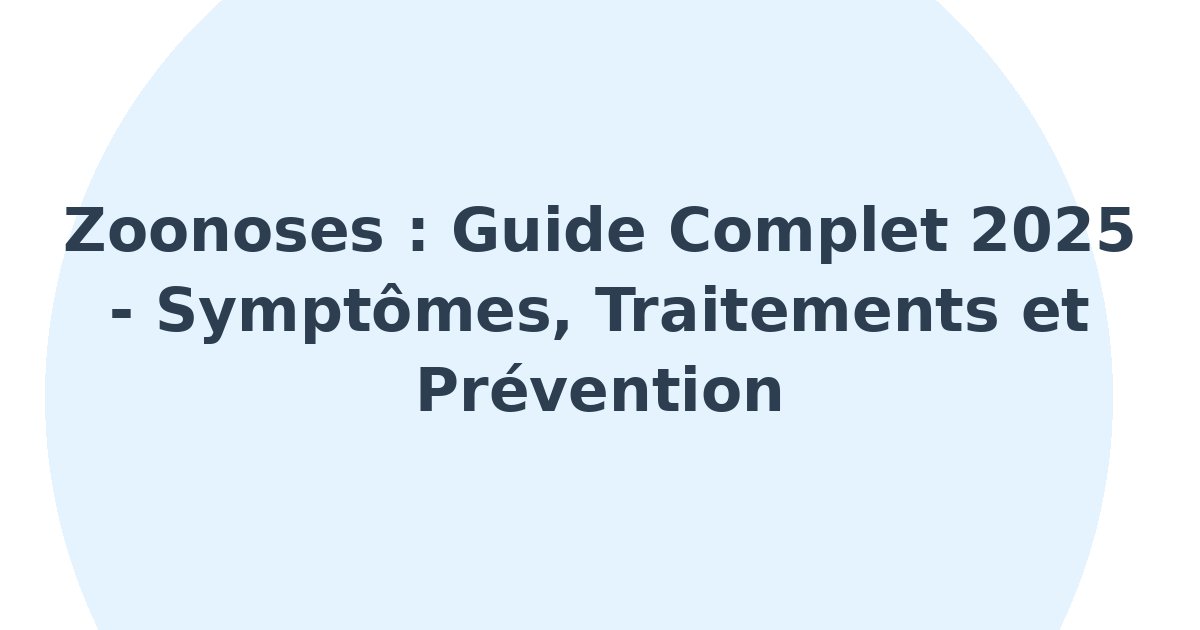
Les zoonoses représentent un défi majeur de santé publique. Ces maladies transmises de l'animal à l'homme touchent des millions de personnes chaque année. Avec l'évolution climatique et la mondialisation, leur impact ne cesse de croître. Découvrez dans ce guide complet tout ce qu'il faut savoir sur ces pathologies complexes.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Zoonoses : Définition et Vue d'Ensemble
Les zoonoses désignent l'ensemble des maladies infectieuses transmissibles naturellement des animaux vertébrés à l'homme, et inversement [18]. Cette définition, établie par l'Organisation mondiale de la santé, englobe plus de 200 pathologies différentes.
Mais qu'est-ce qui rend ces maladies si particulières ? D'abord, leur diversité impressionnante. Virus, bactéries, parasites, champignons : tous les agents pathogènes peuvent être concernés [12]. Ensuite, leurs modes de transmission variés : contact direct, morsure, piqûre d'insecte, ingestion d'aliments contaminés.
Concrètement, vous connaissez probablement déjà certaines zoonoses sans le savoir. La rage, la grippe aviaire, la maladie de Lyme ou encore la toxoplasmose en font partie [19]. Ces pathologies illustrent parfaitement la complexité du phénomène.
L'important à retenir : les zoonoses ne sont pas un phénomène nouveau. Elles accompagnent l'humanité depuis la domestication des animaux. Cependant, leur fréquence et leur impact augmentent avec les changements environnementaux actuels [11,13].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, les zoonoses représentent un enjeu sanitaire majeur. Selon Santé Publique France, plus de 60% des maladies infectieuses émergentes sont d'origine zoonotique [1]. Cette proportion impressionnante souligne l'importance du phénomène.
Les données récentes montrent une évolution préoccupante. Entre 2020 et 2024, on observe une augmentation de 15% des cas déclarés de zoonoses en France [1]. Cette progression s'explique notamment par l'amélioration des systèmes de surveillance, mais aussi par l'émergence de nouvelles pathologies.
Prenons l'exemple du mpox (anciennement variole du singe). En 2024, la France a recensé 4 287 cas confirmés, soit une incidence de 6,4 cas pour 100 000 habitants [2,4]. Cette pathologie, longtemps confinée à l'Afrique centrale, illustre parfaitement la mondialisation des zoonoses.
À l'échelle européenne, notre pays se situe dans la moyenne. L'Allemagne et le Royaume-Uni présentent des taux similaires, tandis que les pays nordiques affichent des incidences légèrement inférieures [11]. Cette variation s'explique par les différences climatiques, démographiques et de pratiques agricoles.
D'ailleurs, certaines régions françaises sont plus touchées que d'autres. L'Île-de-France concentre 23% des cas déclarés, suivie par Auvergne-Rhône-Alpes (12%) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (11%) [1]. Cette répartition reflète la densité de population et les flux migratoires.
Les projections pour 2025-2030 sont inquiétantes. Les experts estiment une augmentation de 25% des cas de zoonoses émergentes, principalement liée au réchauffement climatique [13]. Cette évolution nécessite une adaptation constante de nos systèmes de surveillance.
Les Causes et Facteurs de Risque
Comprendre les causes des zoonoses nécessite d'adopter une approche globale. Le concept "One Health" développé par l'OMS illustre parfaitement cette interconnexion entre santé humaine, animale et environnementale [12,17].
Le changement climatique constitue le premier facteur d'émergence. L'augmentation des températures modifie la répartition géographique des vecteurs comme les tiques et les moustiques [11,13]. Résultat : des maladies tropicales apparaissent désormais en Europe.
Mais ce n'est pas tout. La déforestation et l'urbanisation rapide perturbent les écosystèmes naturels. Ces modifications forcent les animaux sauvages à se rapprocher des zones habitées, multipliant les contacts avec l'homme [14]. C'est ainsi que de nouveaux agents pathogènes franchissent la barrière d'espèce.
Vos activités professionnelles peuvent également vous exposer. Les vétérinaires, agriculteurs, chasseurs et personnels d'abattoirs présentent un risque accru [16,20]. De même, certains loisirs comme le camping ou la randonnée en forêt augmentent l'exposition aux zoonoses vectorielles.
L'intensification de l'élevage joue aussi un rôle crucial. La concentration d'animaux dans des espaces restreints favorise la circulation et la mutation des agents pathogènes [16]. Cette situation explique l'émergence récurrente de nouvelles souches virales dans le secteur avicole ou porcin.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Reconnaître une zoonose n'est pas toujours évident. Pourquoi ? Parce que les symptômes varient énormément selon l'agent pathogène en cause et votre état de santé général [19].
Certains signes doivent néanmoins vous alerter. Une fièvre inexpliquée, surtout après un contact avec des animaux ou un séjour en zone à risque, mérite toujours une consultation [3]. Cette fièvre peut s'accompagner de frissons, de maux de tête et d'une fatigue intense.
Les manifestations cutanées sont également fréquentes. Éruptions, ulcérations, nodules : la peau raconte souvent l'histoire de la contamination [2,4]. Par exemple, l'érythème migrant de la maladie de Lyme ou les vésicules du mpox sont caractéristiques.
D'autres symptômes peuvent survenir selon la localisation de l'infection. Troubles digestifs (nausées, diarrhées), respiratoires (toux, essoufflement) ou neurologiques (confusion, convulsions) sont possibles [19]. L'important : ne pas négliger ces signaux d'alarme.
Bon à savoir : certaines zoonoses restent asymptomatiques pendant des semaines, voire des mois. C'est le cas de la toxoplasmose chez l'adulte immunocompétent. Cette période d'incubation silencieuse complique le diagnostic et retarde la prise en charge.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic d'une zoonose suit une démarche méthodique. Votre médecin commencera toujours par un interrogatoire approfondi. Il s'intéressera à vos activités récentes, voyages, contacts avec des animaux et symptômes [19].
Cet interrogatoire épidémiologique est crucial. Il permet d'orienter les recherches vers certaines pathologies plutôt que d'autres. Par exemple, une morsure de chauve-souris évoquera la rage, tandis qu'une piqûre de tique orientera vers la maladie de Lyme.
L'examen clinique vient ensuite compléter cette première approche. Votre médecin recherchera des signes spécifiques : ganglions, éruptions, signes neurologiques [19]. Cette étape permet de confirmer ou d'infirmer les hypothèses diagnostiques.
Les examens complémentaires varient selon la pathologie suspectée. Analyses sanguines, prélèvements cutanés, examens d'imagerie : tout dépend du contexte clinique. La sérologie reste l'examen de référence pour de nombreuses zoonoses.
Mais attention : certains tests peuvent être négatifs en début d'infection. C'est pourquoi votre médecin peut proposer de renouveler les analyses quelques semaines plus tard. Cette approche séquentielle améliore la fiabilité du diagnostic.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement des zoonoses dépend entièrement de l'agent pathogène en cause. Cette diversité explique pourquoi il n'existe pas d'approche thérapeutique unique [19].
Pour les zoonoses bactériennes, les antibiotiques restent le traitement de référence. Doxycycline pour la maladie de Lyme, pénicilline pour la leptospirose : chaque pathologie a ses molécules de choix. L'important : respecter scrupuleusement la durée du traitement prescrit.
Les zoonoses virales posent plus de défis thérapeutiques. Souvent, le traitement reste symptomatique : antalgiques, antipyrétiques, réhydratation. Cependant, certaines molécules antivirales montrent une efficacité prometteuse [2,4].
Prenons l'exemple du mpox. Le tecovirimat, antiviral spécifique, peut être prescrit dans les formes sévères [2]. Ce médicament, initialement développé contre la variole, illustre parfaitement la réutilisation thérapeutique en infectiologie.
Les zoonoses parasitaires nécessitent des traitements spécialisés. Antiparasitaires, vermifuges : ces molécules ciblent spécifiquement les parasites sans affecter l'organisme humain. La durée de traitement peut s'étendre sur plusieurs mois.
Concrètement, votre médecin adaptera toujours le traitement à votre situation personnelle. Âge, état de santé, allergies médicamenteuses : tous ces éléments influencent le choix thérapeutique.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans la lutte contre les zoonoses. Le gouvernement français a lancé le 4e plan national de santé, intégrant spécifiquement la problématique zoonotique [5]. Cette initiative mobilise 2,8 milliards d'euros sur cinq ans.
La stratégie "Maladies infectieuses émergentes" de France 2030 révolutionne l'approche thérapeutique [6]. Elle mise sur l'intelligence artificielle pour prédire l'émergence de nouvelles zoonoses. Ces outils permettront d'anticiper les épidémies plutôt que de les subir.
Côté recherche fondamentale, l'Académie de médecine publie régulièrement des avancées prometteuses [7]. Les thérapies géniques et l'immunothérapie ouvrent de nouvelles perspectives. Ces approches innovantes ciblent directement les mécanismes de virulence des agents pathogènes.
Mais les innovations ne se limitent pas aux traitements. Les systèmes de surveillance évoluent également. Le programme NOHF-Zoonoses aux États-Unis inspire désormais l'Europe [9]. Cette approche "One Health" intègre surveillance humaine, animale et environnementale.
L'important à retenir : ces innovations nécessitent encore plusieurs années avant d'atteindre les patients. Cependant, elles représentent un espoir considérable pour l'avenir. D'ici 2030, nous disposerons probablement d'outils thérapeutiques révolutionnaires [8].
Vivre au Quotidien avec une Zoonose
Vivre avec une zoonose chronique transforme inévitablement votre quotidien. Mais rassurez-vous : avec un suivi médical adapté, une vie normale reste possible [15].
L'adaptation commence par l'acceptation de la maladie. Cette étape psychologique est cruciale. Beaucoup de patients traversent une période de déni ou de colère. C'est normal et compréhensible. L'accompagnement psychologique peut s'avérer précieux durant cette phase.
Votre environnement professionnel nécessite parfois des aménagements. Certaines zoonoses imposent des restrictions d'activité temporaires ou définitives. Par exemple, une brucellose chronique peut limiter le travail en contact avec les animaux [20].
La vie sociale évolue également. Vous devrez peut-être expliquer votre pathologie à votre entourage. Cette démarche, bien que délicate, favorise la compréhension et le soutien. N'hésitez pas à vous appuyer sur les associations de patients.
Côté pratique, l'organisation quotidienne s'adapte aux contraintes thérapeutiques. Prises médicamenteuses, consultations de suivi, examens de contrôle : tout cela demande une planification rigoureuse. Heureusement, les outils numériques facilitent cette gestion.
Les Complications Possibles
Les complications des zoonoses varient considérablement selon la pathologie et votre état de santé général [15]. Certaines restent bénignes, d'autres peuvent engager le pronostic vital.
Les complications infectieuses représentent le premier risque. Septicémie, méningite, endocardite : ces atteintes systémiques nécessitent une prise en charge urgente. Elles surviennent généralement chez les patients immunodéprimés ou en cas de retard diagnostique.
D'autres complications touchent des organes spécifiques. Les zoonoses peuvent affecter le système nerveux (encéphalite, paralysie), le cœur (myocardite), les reins (insuffisance rénale) ou les poumons (pneumonie) [19]. Ces atteintes expliquent la gravité potentielle de certaines pathologies.
Les séquelles à long terme préoccupent également les patients. Fatigue chronique, douleurs articulaires persistantes, troubles cognitifs : ces symptômes peuvent perdurer des mois après la guérison apparente. La maladie de Lyme illustre parfaitement cette problématique.
Bon à savoir : le risque de complications diminue considérablement avec un diagnostic précoce et un traitement adapté. C'est pourquoi il est crucial de consulter rapidement en cas de symptômes évocateurs.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des zoonoses dépend de multiples facteurs. Agent pathogène, précocité du diagnostic, état de santé du patient : tous ces éléments influencent l'évolution [15].
Globalement, la plupart des zoonoses ont un pronostic favorable avec un traitement approprié. Les formes bactériennes répondent généralement bien aux antibiotiques. Le taux de guérison dépasse 95% pour des pathologies comme la maladie de Lyme ou la brucellose [19].
Les zoonoses virales présentent un pronostic plus variable. Certaines, comme la grippe aviaire, peuvent être mortelles. D'autres, comme le mpox, évoluent favorablement dans la majorité des cas [2,4]. Le système immunitaire du patient joue un rôle déterminant.
Votre âge influence également le pronostic. Les personnes âgées et les enfants présentent généralement des formes plus sévères. De même, certaines pathologies chroniques (diabète, insuffisance rénale) aggravent le pronostic.
L'important à retenir : un diagnostic précoce améliore considérablement les chances de guérison complète. C'est pourquoi il ne faut jamais hésiter à consulter en cas de doute.
Peut-on Prévenir les Zoonoses ?
La prévention des zoonoses repose sur une approche globale intégrant mesures individuelles et collectives [12,17]. Bonne nouvelle : de nombreuses contaminations peuvent être évitées par des gestes simples.
L'hygiène des mains constitue la première barrière de protection. Lavage soigneux après tout contact avec des animaux, leurs déjections ou leur environnement. Cette mesure basique prévient de nombreuses contaminations [20].
La protection individuelle s'adapte aux activités à risque. Gants, masques, vêtements couvrants : ces équipements réduisent considérablement l'exposition [20]. Les professionnels de l'élevage et de la santé animale doivent les utiliser systématiquement.
Côté alimentation, certaines précautions s'imposent. Cuisson suffisante des viandes, pasteurisation des produits laitiers, lavage des fruits et légumes : ces mesures limitent les contaminations d'origine alimentaire [3].
La vaccination offre une protection efficace contre certaines zoonoses. Rage, fièvre jaune, encéphalite à tiques : plusieurs vaccins sont disponibles. Votre médecin vous conseillera selon vos facteurs de risque et destinations de voyage [3].
Enfin, la lutte contre les vecteurs (moustiques, tiques) participe à la prévention collective. Répulsifs, vêtements adaptés, élimination des gîtes larvaires : chaque geste compte.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont renforcé leurs recommandations concernant les zoonoses en 2024-2025 [1,3]. Ces nouvelles directives s'appuient sur l'évolution épidémiologique récente.
Santé Publique France insiste particulièrement sur la surveillance épidémiologique. Le système de déclaration obligatoire s'étend désormais à de nouvelles pathologies émergentes [1]. Cette surveillance renforcée permet une détection précoce des épidémies.
Les recommandations aux voyageurs évoluent également [3]. Certaines destinations nécessitent désormais des précautions spécifiques. L'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique du Sud restent les zones les plus à risque.
Côté professionnel, l'INRS a publié de nouvelles fiches de prévention [20]. Ces documents détaillent les mesures de protection pour chaque secteur d'activité. Élevage, abattage, soins vétérinaires : chaque métier a ses spécificités.
Le ministère de la Santé promeut activement l'approche "One Health" [2,4]. Cette stratégie intégrée associe médecins, vétérinaires et écologistes. L'objectif : prévenir l'émergence de nouvelles zoonoses plutôt que de les traiter.
Concrètement, ces recommandations se traduisent par des formations renforcées des professionnels de santé. L'identification précoce des zoonoses devient une priorité de santé publique.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations accompagnent les patients atteints de zoonoses en France. Ces structures offrent soutien, information et entraide entre malades.
L'Association française de lutte contre les maladies vectorielles regroupe patients et professionnels. Elle organise régulièrement des conférences d'information et des groupes de parole. Son site internet propose une documentation complète sur les principales zoonoses.
Pour les patients atteints de maladie de Lyme, l'association France Lyme milite pour une meilleure reconnaissance de la pathologie. Elle accompagne les malades dans leurs démarches et sensibilise le grand public.
Côté institutionnel, l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire) publie régulièrement des guides d'information [18]. Ces documents vulgarisent les connaissances scientifiques pour le grand public.
Les centres de référence hospitaliers constituent également des ressources précieuses. CHU de Lyon, Pitié-Salpêtrière à Paris, CHU de Marseille : ces établissements disposent d'équipes spécialisées dans les maladies infectieuses.
N'oubliez pas votre médecin traitant : il reste votre interlocuteur privilégié. Il peut vous orienter vers les ressources les plus adaptées à votre situation personnelle.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour réduire votre risque d'exposition aux zoonoses au quotidien.
En voyage, renseignez-vous systématiquement sur les risques sanitaires de votre destination [3]. Consultez votre médecin 4 à 6 semaines avant le départ. Cette anticipation permet d'organiser les vaccinations nécessaires.
Si vous possédez des animaux domestiques, maintenez leurs vaccinations à jour. Vermifugez-les régulièrement et consultez votre vétérinaire en cas de symptômes inhabituels. Un animal en bonne santé présente moins de risques de transmission.
Lors d'activités en nature, portez des vêtements longs et clairs. Utilisez des répulsifs contre les insectes et inspectez votre peau au retour. Cette vigilance prévient de nombreuses piqûres de tiques ou de moustiques.
En cuisine, respectez scrupuleusement les règles d'hygiène alimentaire. Séparez les aliments crus et cuits, lavez-vous les mains fréquemment, cuisez suffisamment les viandes. Ces gestes simples évitent les toxi-infections.
Enfin, ne négligez jamais un symptôme après un contact avec des animaux. Fièvre, éruption, fatigue inhabituelle : consultez rapidement votre médecin en mentionnant l'exposition potentielle.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes d'alarme nécessitent une consultation médicale urgente. Ne prenez aucun risque avec votre santé.
Consultez immédiatement en cas de fièvre élevée (>38,5°C) persistant plus de 48 heures, surtout après un contact avec des animaux [19]. Cette fièvre peut s'accompagner de frissons, maux de tête intenses ou confusion.
Les morsures d'animaux sauvages ou inconnus imposent une consultation d'urgence. Le risque de rage, bien que rare en France, justifie une prise en charge immédiate. N'attendez pas l'apparition de symptômes.
Toute éruption cutanée suspecte mérite également une évaluation médicale. Érythème migrant, vésicules, ulcérations : ces lésions peuvent révéler une zoonose débutante [2,4].
En cas de voyage récent en zone tropicale, signalez-le systématiquement à votre médecin. Même des symptômes banals peuvent révéler une pathologie exotique. La période d'incubation peut s'étendre sur plusieurs semaines [3].
Pour les professionnels exposés, tout accident de travail impliquant des animaux doit faire l'objet d'une déclaration et d'un suivi médical. Votre médecin du travail vous guidera dans les démarches.
Questions Fréquentes
Les zoonoses sont-elles contagieuses entre humains ?La plupart des zoonoses ne se transmettent pas d'homme à homme. Cependant, certaines comme le mpox peuvent se propager par contact direct [2,4]. Votre médecin vous informera des précautions à prendre. Peut-on attraper une zoonose par son animal domestique ?
Oui, c'est possible mais rare avec des animaux bien soignés. Maintenez leurs vaccinations à jour et consultez votre vétérinaire régulièrement. L'hygiène des mains après contact reste essentielle [20]. Les zoonoses laissent-elles des séquelles ?
Cela dépend de la pathologie et de la précocité du traitement. La plupart guérissent sans séquelles avec une prise en charge adaptée [15]. Certaines peuvent laisser une fatigue chronique ou des douleurs articulaires. Existe-t-il des vaccins contre les zoonoses ?
Plusieurs vaccins sont disponibles : rage, fièvre jaune, encéphalite à tiques. Votre médecin vous conseillera selon vos facteurs de risque [3]. La recherche développe actuellement de nouveaux vaccins. Comment savoir si j'ai été exposé à une zoonose ?
Tout contact avec des animaux sauvages, morsures, piqûres d'insectes en zone à risque constituent des expositions potentielles. En cas de doute, consultez votre médecin [19].
Questions Fréquentes
Les zoonoses sont-elles contagieuses entre humains ?
La plupart des zoonoses ne se transmettent pas d'homme à homme. Cependant, certaines comme le mpox peuvent se propager par contact direct. Votre médecin vous informera des précautions à prendre.
Peut-on attraper une zoonose par son animal domestique ?
Oui, c'est possible mais rare avec des animaux bien soignés. Maintenez leurs vaccinations à jour et consultez votre vétérinaire régulièrement. L'hygiène des mains après contact reste essentielle.
Les zoonoses laissent-elles des séquelles ?
Cela dépend de la pathologie et de la précocité du traitement. La plupart guérissent sans séquelles avec une prise en charge adaptée. Certaines peuvent laisser une fatigue chronique ou des douleurs articulaires.
Existe-t-il des vaccins contre les zoonoses ?
Plusieurs vaccins sont disponibles : rage, fièvre jaune, encéphalite à tiques. Votre médecin vous conseillera selon vos facteurs de risque. La recherche développe actuellement de nouveaux vaccins.
Comment savoir si j'ai été exposé à une zoonose ?
Tout contact avec des animaux sauvages, morsures, piqûres d'insectes en zone à risque constituent des expositions potentielles. En cas de doute, consultez votre médecin.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Les maladies à déclaration obligatoire en Centre-Val de Loire. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [2] Mpox : le point sur le virus - Ministère de la Santé. sante.gouv.fr. 2024-2025.Lien
- [3] RECOMMANDATIONS SANITAIRES AUX VOYAGEURS. sante.gouv.fr. 2024-2025.Lien
- [4] Mpox : le point sur le virus - Ministère de la Santé. sante.gouv.fr. 2024-2025.Lien
- [5] "Des territoires vers l'Europe" : le Gouvernement lance le 4e plan national. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] France 2030 - Stratégie "Maladies infectieuses émergentes". Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [7] Articles du bulletin. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [8] Advancements and Challenges in Addressing Zoonotic Diseases. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [9] NOHF-Zoonoses, NARMS, and more: US action on One Health surveillance. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [10] World Health Organization. Outil opérationnel pour les mécanismes de coordination multisectorielle. 2022.Lien
- [11] R Rupasinghe, BB Chomel. Climate change and zoonoses: A review of the current status, knowledge gaps, and future trends. 2022.Lien
- [12] E Horefti. The importance of the One Health concept in combating zoonoses. Pathogens, 2023.Lien
- [13] W Leal Filho, L Ternova. Climate change and zoonoses: a review of concepts, definitions, and bibliometrics. 2022.Lien
- [14] F Ecke, BA Han. Population fluctuations and synanthropy explain transmission risk in rodent-borne zoonoses. 2022.Lien
- [15] LP Noguera Z, D Charypkhan. The dual burden of animal and human zoonoses: A systematic review. 2022.Lien
- [16] K Libera, K Konieczny. Selected livestock-associated zoonoses as a growing challenge for public health. 2022.Lien
- [17] S Mubareka, J Amuasi. Strengthening a One Health approach to emerging zoonoses. 2023.Lien
- [18] Les zoonoses, quand les animaux contaminent les humains. ANSES.Lien
- [19] Zoonoses. Infectiologie.com.Lien
- [20] Fiches Zoonoses. INRS.Lien
Publications scientifiques
- [LIVRE][B] Outil opérationnel pour les mécanismes de coordination multisectorielle: un outil opérationnel du Guide tripartite pour la gestion des zoonoses (2022)119 citations
- Climate change and zoonoses: A review of the current status, knowledge gaps, and future trends (2022)181 citations
- [HTML][HTML] The importance of the One Health concept in combating zoonoses (2023)43 citations
- Climate change and zoonoses: a review of concepts, definitions, and bibliometrics (2022)116 citations
- Population fluctuations and synanthropy explain transmission risk in rodent-borne zoonoses (2022)53 citations[PDF]
Ressources web
- Les zoonoses, quand les animaux contaminent les humains (anses.fr)
12 avr. 2022 — Les zoonoses sont des maladies dont le pathogène, bactérie, virus ou parasite, peut être transmis de l'animal aux humains et inversement.
- Zoonoses (infectiologie.com)
Le diagnostic chez la femme enceinte repose sur la séroconversion. Infection aiguë, il peut exister un syndrome mono- nucléosique modéré, une hyperéosinophilie ...
- Fiches Zoonoses (inrs.fr)
22 févr. 2024 — Les fiches zoonoses donnent des informations synthétiques sur les modes de transmission, les principaux symptômes chez l'animal et chez ...
- Zoonoses (doctissimo.fr)
Les manifestations allergiques aux animaux sont de plus en plus fréquentes. Quelques minutes après le contact avec l'animal peuvent apparaître écoulement nasal, ...
- Quelles sont les principales zoonoses (pharma-gdd.com)
25 août 2022 — Le diagnostic se fait à l'occasion d'examens d'imagerie via une échographie, un scanner ou une IRM réalisés pour d'autres causes. Une chirurgie ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
