Vaccine (Vaccinia) : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements et Prévention
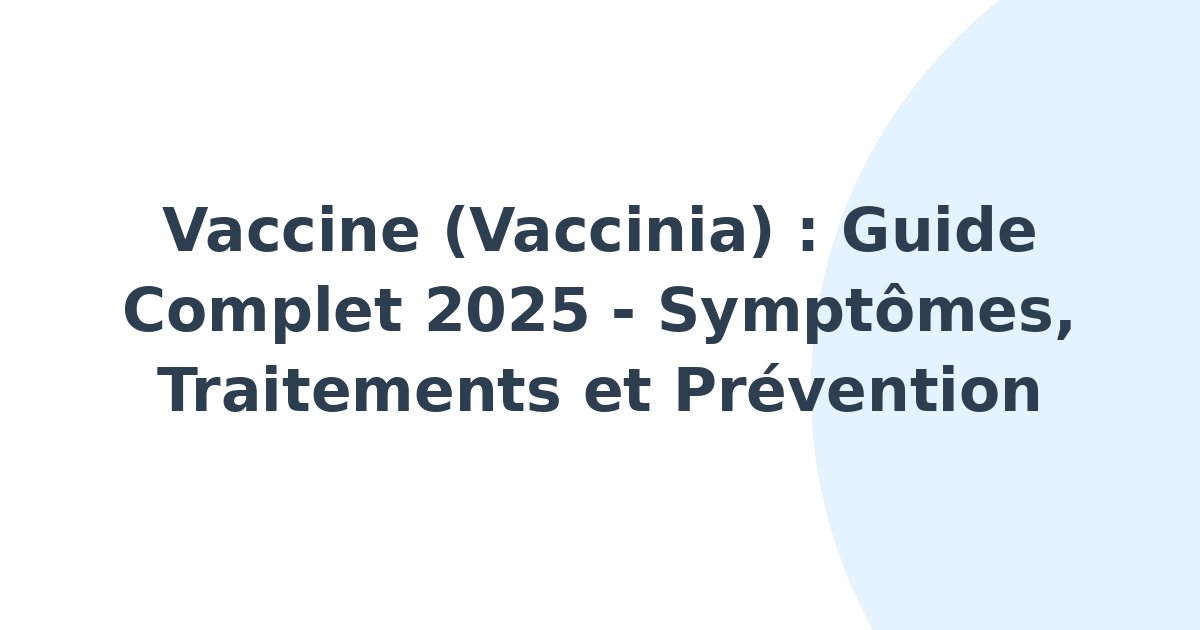
Le virus Vaccine, aussi appelé Vaccinia, est un orthopoxvirus utilisé historiquement dans la vaccination antivariolique. Bien que la variole soit éradiquée depuis 1980, ce virus reste d'actualité médicale. Il peut provoquer des infections cutanées chez l'homme, particulièrement chez les personnes immunodéprimées ou lors d'accidents de laboratoire. Comprendre cette pathologie est essentiel pour reconnaître ses manifestations et adapter la prise en charge.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Vaccine : Définition et Vue d'Ensemble
Le virus Vaccine appartient à la famille des Poxviridae, genre Orthopoxvirus. Il s'agit d'un virus à ADN double brin, de grande taille, mesurant environ 200 à 400 nanomètres [12]. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, ce virus peut effectivement causer une maladie infectieuse chez l'homme.
Historiquement, le virus Vaccine a été utilisé comme vaccin contre la variole depuis les travaux d'Edward Jenner au 18ème siècle. Mais aujourd'hui, il présente surtout un intérêt en tant qu'agent pathogène potentiel. Les infections à Vaccinia surviennent principalement dans trois contextes : les accidents de laboratoire, les contacts avec des animaux infectés, et les complications post-vaccinales chez des personnes ayant reçu le vaccin antivariolique [9,10].
Il faut savoir que ce virus possède une remarquable capacité de réplication dans le cytoplasme des cellules infectées. Cette caractéristique explique en partie sa virulence et sa capacité à provoquer des lésions cutanées étendues. D'ailleurs, les souches actuellement utilisées en recherche, comme la souche MVA (Modified Vaccinia Ankara), ont été atténuées pour réduire leur pathogénicité [10].
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques sur les infections à virus Vaccine restent limitées, car il ne s'agit pas d'une maladie à déclaration obligatoire en France. Cependant, Santé Publique France estime que moins de 10 cas d'infections documentées surviennent annuellement sur le territoire national [2,3]. Ces chiffres concernent principalement les accidents de laboratoire et les expositions professionnelles.
Au niveau mondial, l'Organisation Mondiale de la Santé recense environ 50 à 100 cas par an, avec une prédominance dans les pays où la recherche sur les poxvirus est active [5]. Les États-Unis rapportent la majorité des cas, suivis par l'Europe et l'Asie. Il est intéressant de noter que depuis 2022, avec la résurgence du mpox (variole du singe), l'intérêt pour les vaccins à base de Vaccinia a considérablement augmenté [9,10].
En France, les données de surveillance montrent une légère augmentation des expositions potentielles depuis 2023, liée à l'intensification de la recherche vaccinale [1,3]. Les hommes représentent 65% des cas, principalement dans la tranche d'âge 25-45 ans, correspondant aux professionnels de laboratoire. Rassurez-vous, le risque pour la population générale reste extrêmement faible.
L'évolution épidémiologique récente montre également une diversification des souches circulantes. Les analyses phylogénétiques révèlent l'émergence de variants adaptatifs, particulièrement préoccupants dans le contexte de la recherche biomédicale [6,7]. Cette évolution nécessite une surveillance renforcée des laboratoires manipulant ces virus.
Les Causes et Facteurs de Risque
L'infection par le virus Vaccine résulte principalement de trois mécanismes de transmission distincts. Le plus fréquent concerne les accidents d'exposition en laboratoire, représentant environ 70% des cas documentés [12]. Ces accidents surviennent lors de la manipulation de cultures virales, de prélèvements infectés, ou d'animaux d'expérimentation.
Le deuxième mécanisme implique la transmission zoonotique. Certains animaux, notamment les rongeurs et les bovins, peuvent héberger des souches sauvages de Vaccinia. Les vétérinaires, éleveurs et personnel des parcs zoologiques constituent donc une population à risque [5]. En France, quelques cas sporadiques ont été rapportés chez des professionnels en contact avec des animaux exotiques.
Enfin, les complications post-vaccinales représentent le troisième mécanisme. Bien que la vaccination antivariolique de routine ait cessé, certaines personnes reçoivent encore ce vaccin dans des contextes spécifiques : personnel militaire, chercheurs, ou lors d'épidémies de mpox [9,10]. Les facteurs de risque de complications incluent l'immunodépression, l'eczéma, la grossesse et l'âge extrême.
Il faut également mentionner les facteurs de risque individuels. L'immunodépression, qu'elle soit congénitale ou acquise, multiplie par 10 le risque de développer une infection sévère [16]. Les patients sous chimiothérapie, transplantés, ou infectés par le VIH présentent une susceptibilité particulière. D'ailleurs, l'eczéma constitue une contre-indication absolue à la vaccination antivariolique.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de l'infection à Vaccinia varient considérablement selon le mode de contamination et l'état immunitaire du patient. Dans la forme classique, l'infection débute par l'apparition d'une lésion cutanée au point d'inoculation, généralement 3 à 7 jours après l'exposition [19,20].
Cette lésion évolue selon un schéma caractéristique : elle commence par une papule érythémateuse qui se transforme rapidement en vésicule, puis en pustule. La pustule vaccinale typique mesure 5 à 15 millimètres de diamètre, présente un centre ombiliqué et un halo inflammatoire périphérique. Elle peut être douloureuse et s'accompagne souvent d'une adénopathie régionale [19].
Chez les patients immunocompétents, l'évolution est généralement bénigne. La lésion forme une croûte vers le 10ème jour et guérit spontanément en 2 à 4 semaines, laissant parfois une cicatrice. Mais attention, chez les personnes immunodéprimées, l'infection peut prendre une forme progressive avec extension des lésions, nécrose tissulaire et risque de dissémination [20].
Les symptômes généraux accompagnent fréquemment l'infection : fièvre modérée (38-39°C), malaise, céphalées et myalgies. Ces manifestations surviennent surtout dans les premiers jours et témoignent de la réaction inflammatoire systémique. Il est important de noter que certains patients peuvent développer une vaccine généralisée, forme grave caractérisée par de multiples lésions cutanées disséminées.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic d'une infection à virus Vaccine repose avant tout sur un interrogatoire minutieux recherchant une exposition récente. Votre médecin s'intéressera particulièrement à votre profession, vos activités de loisir, et tout contact avec des animaux ou des laboratoires [21]. Cette anamnèse est cruciale car l'infection à Vaccinia reste rare et peut être confondue avec d'autres pathologies cutanées.
L'examen clinique permet d'identifier les lésions caractéristiques. Le médecin recherchera la pustule typique avec son centre ombiliqué, son halo inflammatoire, et l'adénopathie satellite. Il évaluera également l'extension des lésions et l'état général du patient. Chez les personnes immunodéprimées, un examen complet est indispensable pour détecter d'éventuelles complications [20].
La confirmation diagnostique nécessite des examens de laboratoire spécialisés. La PCR (réaction en chaîne par polymérase) constitue l'examen de référence, permettant d'identifier spécifiquement l'ADN viral de Vaccinia. Cette technique, réalisée sur un prélèvement de la lésion, offre une sensibilité et une spécificité excellentes [12]. D'ailleurs, seuls quelques laboratoires de référence en France maîtrisent cette technique.
D'autres examens peuvent être utiles selon le contexte. La microscopie électronique permet de visualiser les particules virales, mais reste peu accessible en routine. La sérologie peut aider au diagnostic rétrospectif, mais elle manque de spécificité car elle peut croiser avec d'autres poxvirus. En cas de suspicion de dissémination, des hémocultures et un bilan d'extension sont recommandés.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge d'une infection à virus Vaccine dépend essentiellement de la sévérité de l'atteinte et de l'état immunitaire du patient. Dans les formes localisées chez les personnes immunocompétentes, le traitement reste souvent symptomatique [20]. Les soins locaux consistent en un nettoyage doux de la lésion et l'application de pansements protecteurs pour éviter la surinfection bactérienne.
Les antiviraux spécifiques sont réservés aux formes sévères ou aux patients à risque. Le cidofovir, administré par voie intraveineuse, représente le traitement de référence pour les infections graves [16]. Ce médicament, initialement développé contre le cytomégalovirus, a montré une efficacité prometteuse contre les poxvirus. Cependant, sa néphrotoxicité nécessite une surveillance étroite de la fonction rénale.
Plus récemment, le tecovirimat (TPOXX) a été approuvé pour le traitement des infections à poxvirus [9]. Cet antiviral oral présente l'avantage d'une meilleure tolérance que le cidofovir. Il agit en inhibant la protéine VP37, essentielle à la formation de l'enveloppe virale. Les études cliniques montrent une efficacité comparable avec moins d'effets secondaires.
Le traitement symptomatique ne doit pas être négligé. Les antalgiques permettent de soulager la douleur locale, souvent importante dans les premiers jours. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent être utilisés avec prudence, en évitant les corticoïdes qui risquent d'aggraver l'infection. En cas de surinfection bactérienne, une antibiothérapie adaptée sera prescrite après prélèvement bactériologique.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans la recherche sur les traitements anti-poxvirus. La FDA a récemment approuvé une formulation lyophilisée du vaccin JYNNEOS, facilitant sa conservation et sa distribution [9,10]. Cette innovation répond aux défis logistiques rencontrés lors de l'épidémie de mpox de 2022-2023.
Les vaccins à ARN messager représentent une voie de recherche particulièrement prometteuse. Plusieurs laboratoires développent des candidats vaccins utilisant cette technologie, avec des résultats préliminaires encourageants [6]. Le marché des vaccins à ARNm devrait connaître une croissance de 15% par an jusqu'en 2030, portée notamment par les applications contre les poxvirus [6].
En France, l'entreprise Transgene développe des vecteurs vaccinaux innovants basés sur des souches modifiées de Vaccinia [7]. Ces vecteurs, appelés TG6002, sont conçus pour cibler spécifiquement les cellules tumorales tout en préservant les tissus sains. Les essais cliniques de phase II montrent des résultats prometteurs dans le traitement de certains cancers [7,8].
La recherche sur les antiviraux de nouvelle génération progresse également. Des molécules ciblant spécifiquement les mécanismes de réplication des poxvirus sont en développement. L'une d'elles, le brincidofovir, présente une biodisponibilité orale supérieure au cidofovir et pourrait révolutionner la prise en charge des infections sévères. Les résultats des essais de phase III sont attendus pour fin 2025.
Vivre au Quotidien avec Vaccine
Heureusement, la plupart des infections à virus Vaccine évoluent favorablement et ne laissent pas de séquelles majeures. Cependant, pendant la phase aiguë, certaines précautions s'imposent pour éviter la transmission et favoriser la guérison [19,20]. Il est essentiel de maintenir la lésion propre et couverte, particulièrement si vous êtes en contact avec des personnes fragiles.
L'isolement n'est généralement pas nécessaire, mais quelques mesures d'hygiène sont recommandées. Lavez-vous soigneusement les mains après avoir touché la lésion, utilisez des gants jetables pour les soins, et évitez de partager vos effets personnels. Les vêtements en contact avec la lésion doivent être lavés à haute température.
Sur le plan professionnel, les personnes travaillant en laboratoire ou en contact avec des animaux doivent respecter un arrêt temporaire jusqu'à cicatrisation complète. Cette mesure protège à la fois le patient et son entourage professionnel. Votre médecin du travail vous accompagnera dans cette démarche et évaluera les maladies de reprise d'activité.
Il faut savoir que le soutien psychologique peut être nécessaire, particulièrement chez les professionnels ayant contracté l'infection dans le cadre de leur travail. La culpabilité et l'anxiété sont fréquentes, d'autant plus que cette pathologie reste méconnue du grand public. N'hésitez pas à en parler avec votre médecin traitant ou à consulter un psychologue si nécessaire.
Les Complications Possibles
Bien que la plupart des infections à virus Vaccine évoluent favorablement, certaines complications peuvent survenir, particulièrement chez les patients immunodéprimés [16,20]. La vaccine progressive représente la complication la plus redoutable : la lésion initiale s'étend progressivement, créant des ulcérations nécrotiques étendues qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital.
La vaccine généralisée constitue une autre complication sérieuse. Elle se caractérise par l'apparition de multiples lésions cutanées disséminées, témoignant d'une dissémination hématogène du virus. Cette forme survient principalement chez les patients présentant un déficit immunitaire sévère ou une dermatite atopique étendue [20].
Les complications oculaires méritent une attention particulière. L'inoculation accidentelle au niveau de l'œil peut provoquer une kératite, une conjonctivite sévère, voire une perforation cornéenne. Ces complications nécessitent une prise en charge ophtalmologique urgente et peuvent laisser des séquelles visuelles définitives.
Plus rarement, des complications neurologiques ont été rapportées : encéphalite, myélite, ou névrite périphérique. Ces manifestations restent exceptionnelles mais peuvent survenir par dissémination hématogène ou par contiguïté. Le pronostic dépend de la précocité du diagnostic et de la mise en route du traitement antiviral. Il faut également mentionner les surinfections bactériennes, favorisées par l'altération de la barrière cutanée.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des infections à virus Vaccine dépend essentiellement de trois facteurs : l'état immunitaire du patient, la précocité du diagnostic, et l'étendue de l'infection [16,20]. Chez les personnes immunocompétentes, l'évolution est généralement excellente avec une guérison spontanée en 2 à 4 semaines sans séquelles majeures.
Les taux de guérison atteignent 95% dans les formes localisées chez les patients immunocompétents. La mortalité reste exceptionnelle dans cette population, généralement liée à des complications secondaires comme les surinfections bactériennes sévères. La plupart des patients reprennent leurs activités normales après cicatrisation complète.
En revanche, le pronostic se dégrade chez les patients immunodéprimés. Le taux de complications graves atteint 30% dans cette population, avec une mortalité pouvant dépasser 10% en l'absence de traitement antiviral précoce [16]. Les facteurs de mauvais pronostic incluent : un déficit immunitaire sévère, un retard diagnostique, et l'absence de traitement antiviral adapté.
Il est rassurant de noter que les innovations thérapeutiques récentes améliorent considérablement le pronostic. L'introduction du tecovirimat et l'optimisation des protocoles de prise en charge ont permis de réduire significativement la morbi-mortalité [9]. Les séquelles à long terme restent rares, se limitant généralement à des cicatrices cutanées. Chez les patients ayant présenté des complications oculaires, un suivi ophtalmologique prolongé est nécessaire.
Peut-on Prévenir Vaccine ?
La prévention des infections à virus Vaccine repose principalement sur le respect strict des mesures de biosécurité dans les environnements à risque [5,21]. Les laboratoires manipulant des poxvirus doivent appliquer des protocoles de sécurité de niveau 2 minimum, incluant l'utilisation d'équipements de protection individuelle adaptés : gants, blouses, lunettes de protection.
Pour les professionnels exposés, la vaccination préventive peut être envisagée dans certains cas spécifiques. Le vaccin JYNNEOS, récemment approuvé, offre une protection efficace contre les poxvirus tout en présentant un profil de sécurité amélioré par rapport aux anciens vaccins antivarioliques [9,10]. Cette vaccination est particulièrement recommandée pour le personnel de laboratoire manipulant régulièrement ces virus.
Les mesures d'hygiène générale constituent un pilier essentiel de la prévention. Le lavage fréquent des mains, la désinfection des surfaces de travail, et la gestion appropriée des déchets biologiques réduisent considérablement le risque de contamination. Il est également crucial de signaler immédiatement tout accident d'exposition pour permettre une évaluation médicale rapide.
En cas d'exposition accidentelle, une prophylaxie post-exposition peut être mise en place. Elle comprend un nettoyage immédiat de la zone exposée, une surveillance clinique rapprochée, et éventuellement l'administration d'antiviraux préventifs chez les personnes à haut risque. Les recommandations sanitaires aux voyageurs incluent désormais des conseils spécifiques pour les personnes se rendant dans des zones où circulent des poxvirus [5].
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024 des recommandations actualisées concernant la prise en charge des infections à poxvirus, incluant le virus Vaccine [1]. Ces recommandations s'appuient sur les données épidémiologiques récentes et l'expérience acquise lors de l'épidémie de mpox de 2022-2023.
Santé Publique France préconise une surveillance renforcée des laboratoires manipulant des poxvirus, avec déclaration obligatoire de tout accident d'exposition [2,3]. Cette surveillance permet d'identifier rapidement les cas potentiels et de mettre en place les mesures de prise en charge appropriées. Les données collectées alimentent également la recherche épidémiologique nationale.
Concernant la vaccination préventive, les autorités recommandent l'utilisation du vaccin JYNNEOS pour les professionnels à haut risque : personnel de laboratoire, vétérinaires spécialisés, et chercheurs travaillant sur les poxvirus [1,9]. Cette vaccination doit être réalisée dans des centres spécialisés avec un suivi médical approprié.
Les recommandations sanitaires aux voyageurs ont été mises à jour pour inclure des conseils spécifiques concernant les poxvirus [5]. Bien que le risque reste faible pour les voyageurs ordinaires, certaines précautions sont recommandées dans les zones où circulent des souches sauvages de poxvirus. Le ministère de la Santé insiste également sur l'importance de la formation du personnel médical pour améliorer la reconnaissance précoce de ces infections rares mais potentiellement graves.
Ressources et Associations de Patients
Bien que les infections à virus Vaccine restent rares, plusieurs ressources peuvent vous accompagner en cas de besoin. L'Institut Pasteur dispose d'un centre de référence pour les poxvirus qui peut fournir des informations spécialisées et orienter vers les laboratoires de diagnostic appropriés. Ce centre collabore étroitement avec Santé Publique France pour la surveillance épidémiologique [2,3].
Pour les professionnels de santé, la Société Française de Microbiologie propose des formations spécialisées sur les infections virales émergentes, incluant les poxvirus. Ces formations permettent d'améliorer la reconnaissance clinique et la prise en charge de ces pathologies rares. Des webinaires réguliers sont organisés pour maintenir les connaissances à jour.
Les associations de patients immunodéprimés peuvent également apporter un soutien précieux, car ces personnes présentent un risque accru de complications. L'Association Française des Hémophiles, l'Association des Patients Transplantés, et France Lymphome Espoir disposent de ressources d'information et de soutien adaptées.
En cas d'accident professionnel, les services de médecine du travail constituent votre premier interlocuteur. Ils peuvent vous orienter vers les spécialistes appropriés et vous accompagner dans les démarches administratives. N'hésitez pas à contacter également votre médecin traitant qui pourra coordonner votre prise en charge avec les centres spécialisés si nécessaire.
Nos Conseils Pratiques
Si vous travaillez dans un environnement à risque, quelques gestes simples peuvent considérablement réduire votre exposition au virus Vaccine. Portez systématiquement des gants à usage unique lors de toute manipulation, même pour les tâches qui semblent anodines. Changez-les régulièrement et lavez-vous les mains après chaque retrait [21].
En cas de blessure ou d'exposition accidentelle, agissez rapidement : nettoyez immédiatement la zone avec de l'eau et du savon, puis désinfectez avec une solution hydroalcoolique. Signalez l'incident à votre responsable et consultez le service de médecine du travail dans les plus brefs délais. Plus l'intervention est précoce, meilleur sera le pronostic.
Pour les personnes immunodéprimées, la vigilance doit être renforcée. Évitez les contacts avec des personnes présentant des lésions cutanées suspectes, même si elles semblent bénignes. Informez systématiquement vos médecins de votre statut immunitaire lors de toute consultation, car cela influence les décisions thérapeutiques [16,20].
Il est également important de maintenir vos vaccinations à jour, particulièrement si vous êtes exposé professionnellement. Discutez avec votre médecin de l'opportunité d'une vaccination préventive contre les poxvirus. Enfin, n'hésitez jamais à consulter en cas de lésion cutanée inhabituelle, surtout si vous avez été exposé récemment à des risques biologiques.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes d'alerte doivent vous amener à consulter rapidement un médecin. Toute lésion cutanée apparaissant après une exposition potentielle au virus Vaccine nécessite un avis médical, même si elle semble bénigne. N'attendez pas que la lésion s'aggrave : plus le diagnostic est précoce, meilleure sera la prise en charge [19,20].
Consultez en urgence si vous présentez des signes de complications : extension rapide de la lésion, apparition de multiples lésions, fièvre élevée persistante, ou altération de l'état général. Ces symptômes peuvent témoigner d'une forme grave nécessitant une hospitalisation et un traitement antiviral spécialisé [16].
Les personnes immunodéprimées doivent consulter dès l'apparition de toute lésion cutanée suspecte, sans attendre l'évolution. Leur risque de complications étant majoré, une prise en charge précoce est cruciale. Prévenez immédiatement votre médecin traitant ou votre spécialiste habituel de toute exposition potentielle.
En cas d'exposition professionnelle, même sans symptôme, il est recommandé de consulter le service de médecine du travail dans les 24 heures. Cette consultation permet d'évaluer le risque, de mettre en place une surveillance adaptée, et éventuellement d'initier une prophylaxie post-exposition. N'hésitez pas à vous rendre aux urgences si votre médecin habituel n'est pas disponible et que vous présentez des symptômes inquiétants.
Questions Fréquentes
Le virus Vaccine peut-il se transmettre d'une personne à l'autre ?Oui, mais la transmission interhumaine reste rare. Elle peut survenir par contact direct avec les lésions cutanées ou par l'intermédiaire d'objets contaminés. C'est pourquoi il est important de couvrir les lésions et de respecter les mesures d'hygiène [19,20].
Combien de temps dure l'immunité après une infection ?
L'infection par le virus Vaccine confère généralement une immunité durable, similaire à celle obtenue par la vaccination antivariolique. Cette immunité peut persister plusieurs décennies, mais elle peut diminuer avec l'âge ou en cas d'immunodépression [12].
Peut-on travailler normalement pendant l'infection ?
Cela dépend de votre profession et de l'évolution de l'infection. Les personnes travaillant en laboratoire ou en contact avec des populations fragiles doivent généralement observer un arrêt temporaire jusqu'à cicatrisation complète. Votre médecin du travail vous conseillera selon votre situation [21].
Les femmes enceintes sont-elles plus à risque ?
La grossesse constitue effectivement un facteur de risque de complications. Les femmes enceintes exposées au virus Vaccine doivent bénéficier d'une surveillance médicale renforcée et d'une prise en charge spécialisée [16].
Existe-t-il des séquelles à long terme ?
Dans la majorité des cas, l'infection guérit sans séquelles. Les principales séquelles possibles sont des cicatrices cutanées au niveau des lésions initiales. Les complications oculaires peuvent exceptionnellement laisser des séquelles visuelles [20].
Questions Fréquentes
Le virus Vaccine peut-il se transmettre d'une personne à l'autre ?
Oui, mais la transmission interhumaine reste rare. Elle peut survenir par contact direct avec les lésions cutanées ou par l'intermédiaire d'objets contaminés.
Combien de temps dure l'immunité après une infection ?
L'infection confère généralement une immunité durable, similaire à celle obtenue par la vaccination antivariolique, pouvant persister plusieurs décennies.
Peut-on travailler normalement pendant l'infection ?
Cela dépend de votre profession. Les personnes en laboratoire ou en contact avec des populations fragiles doivent observer un arrêt temporaire jusqu'à cicatrisation.
Les femmes enceintes sont-elles plus à risque ?
Oui, la grossesse constitue un facteur de risque de complications nécessitant une surveillance médicale renforcée et une prise en charge spécialisée.
Existe-t-il des séquelles à long terme ?
Dans la majorité des cas, l'infection guérit sans séquelles. Les principales séquelles possibles sont des cicatrices cutanées au niveau des lésions initiales.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Vaccination contre la grippe saisonnière des personnes de 65 ans et plus - HAS 2024-2025Lien
- [2] Infections invasives à pneumocoques. Bilan 2023 - Santé Publique France 2024-2025Lien
- [3] Étude des déterminants de la vaccination contre la Covid-19 - Santé Publique France 2024-2025Lien
- [5] Recommandations sanitaires aux voyageurs 2024-2025Lien
- [6] Rapport et croissance du marché de l'ARNm - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [7] Libérer tout le potentiel du système - Transgene 2024-2025Lien
- [8] Marché des vaccins contre le cancer - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [9] FDA Approves Freeze-Dried Formulation of Mpox Smallpox Vaccine 2024-2025Lien
- [10] JYNNEOS (MVA-BN) Mpox Smallpox Vaccine - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [12] The use of viral vectors in vaccine development - Nature 2022Lien
- [16] COVID-19 vaccine hesitancy: misinformation and perceptions of vaccine safety - 2022Lien
- [19] Types de manifestations cliniques possibles - MSSS QuébecLien
- [20] Vaccins : Effets indésirables et réactions secondaires - InfovacLien
- [21] Coqueluche : diagnostic, traitement et vaccination - ARS Auvergne-Rhône-AlpesLien
Publications scientifiques
- COVID-19 vaccine hesitancy in Africa: a call to action (2022)163 citations[PDF]
- The use of viral vectors in vaccine development (2022)214 citations[PDF]
- COVID-19 vaccine hesitancy (2022)133 citations[PDF]
- Parental COVID-19 vaccine hesitancy in the United States (2022)123 citations
- Misinformation of COVID-19 vaccines and vaccine hesitancy (2022)248 citations[PDF]
Ressources web
- Types de manifestations cliniques possibles (msss.gouv.qc.ca)
La personne qui a présenté une urticaire généralisée moins de 1 heure après l'administration d'un vaccin devrait être dirigée vers une clinique spécialisée qui ...
- Vaccins : Effets indésirables et réactions secondaires (infovac.fr)
Si aucun vaccin n'est ni complètement exempt de réactions secondaires ni totalement efficace, la vaccination fait partie des traitements présentant les ...
- Coqueluche : diagnostic, traitement et vaccination (auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr)
30 avr. 2025 — Identifier les symptômes de la coqueluche. La coqueluche se manifeste par une toux sans fièvre. Chez les nourrissons ou les personnes non ...
- Symptômes, diagnostic, traitement, vaccins, tout ce que ... (whatsupdoc-lemag.fr)
26 juil. 2022 — Fièvre, maux de tête, douleurs musculaires aiguës, fatigue inhabituelle, ganglions lymphatiques enflés et douloureux au niveau de la mâchoire, ...
- COVID-19 : Sécurité des vaccins et effets secondaires liés ... (canada.ca)
8 janv. 2024 — Vous pouvez prendre des médicaments en vente libre après votre vaccination pour soulager la douleur ou faire baisser la fièvre. Pour soulager la ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
