Infections à Coronavirus : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
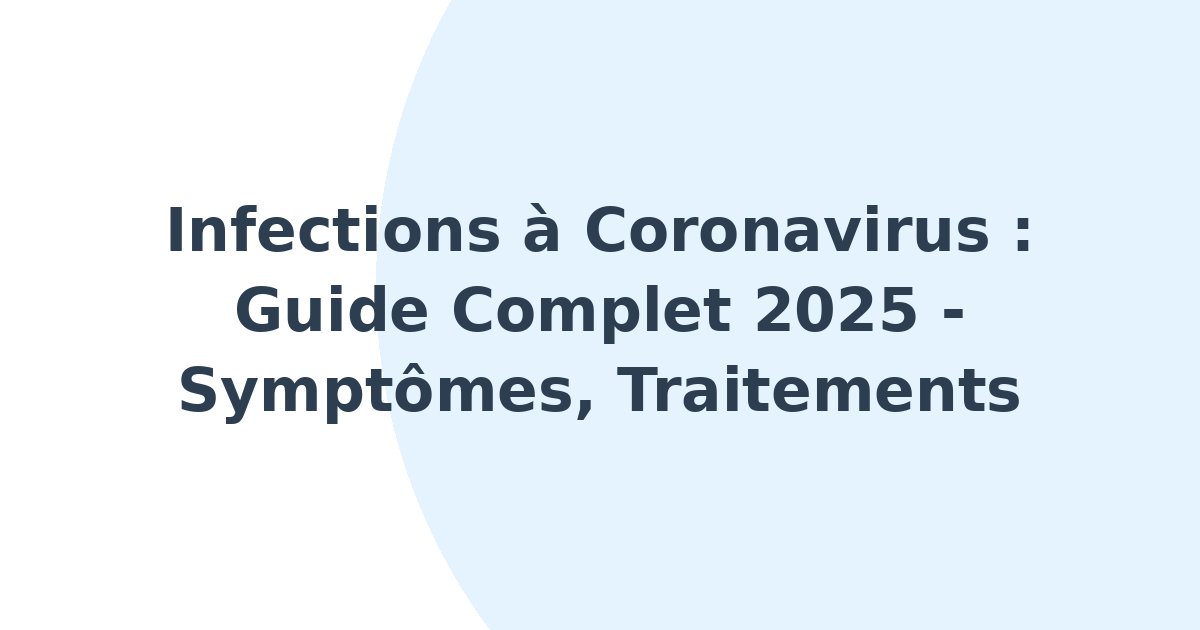
Les infections à coronavirus représentent un défi majeur de santé publique qui a profondément marqué notre époque. Ces pathologies virales, causées par différents types de coronavirus, touchent des millions de personnes chaque année dans le monde. Bien que le SARS-CoV-2 soit le plus connu depuis 2020, d'autres coronavirus circulent également et peuvent provoquer des infections respiratoires. Comprendre ces maladies, leurs symptômes et les traitements disponibles est essentiel pour mieux les prévenir et les gérer.
Téléconsultation et Infections à coronavirus
Partiellement adaptée à la téléconsultationLes infections à coronavirus sont partiellement adaptées à la téléconsultation car l'évaluation des symptômes respiratoires et généraux peut être réalisée à distance. Cependant, l'examen clinique peut être nécessaire pour évaluer la gravité respiratoire et exclure des complications, particulièrement chez les patients à risque.
Ce qui peut être évalué à distance
Évaluation des symptômes respiratoires (toux, dyspnée, douleur thoracique), analyse de la fièvre et des signes généraux, évaluation de l'anosmie et de l'agueusie caractéristiques, orientation diagnostique selon les symptômes décrits, suivi de l'évolution clinique chez les patients stables.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen pulmonaire par auscultation pour évaluer l'atteinte respiratoire, mesure de la saturation en oxygène, évaluation clinique chez les patients à risque de forme grave, prescription d'examens complémentaires si nécessaire (scanner thoracique, biologie).
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Préparer votre téléconsultation
Pour que votre téléconsultation soit la plus efficace possible, préparez les éléments suivants :
- Symptômes et durée : Noter précisément les symptômes respiratoires (toux sèche ou productive, essoufflement, douleur thoracique), la présence et l'intensité de la fièvre, la perte d'odorat et de goût, les signes digestifs éventuels, et indiquer depuis combien de jours ces symptômes sont présents.
- Traitements en cours : Mentionner tous les traitements actuels, particulièrement les immunosuppresseurs, corticoïdes, anticoagulants, et tout traitement pour pathologies chroniques (diabète, hypertension, pathologies respiratoires chroniques).
- Antécédents médicaux pertinents : Antécédents de pathologies respiratoires chroniques (asthme, BPCO), maladies cardiovasculaires, diabète, immunodépression, obésité, âge avancé, antécédents de COVID-19 et statut vaccinal.
- Examens récents disponibles : Résultats de tests COVID-19 récents (PCR, antigéniques), radiographie pulmonaire si réalisée, bilan biologique récent, mesures de saturation en oxygène si disponibles.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Dyspnée importante ou aggravation respiratoire nécessitant un examen pulmonaire, patients à haut risque de forme grave nécessitant une évaluation clinique complète, suspicion de pneumonie ou de complications pulmonaires, nécessité de prescription d'oxygénothérapie ou de surveillance hospitalière.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Détresse respiratoire aiguë avec dyspnée de repos, douleur thoracique intense, altération importante de l'état général avec confusion ou malaise, saturation en oxygène inférieure à 95%.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Difficultés respiratoires importantes ou essoufflement au repos
- Douleur thoracique intense ou oppression thoracique
- Saturation en oxygène inférieure à 95% (si oxymètre disponible)
- Altération de l'état de conscience, confusion ou malaise important
- Fièvre très élevée persistante avec altération importante de l'état général
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Généraliste — consultation en présentiel recommandée
Le médecin généraliste peut évaluer initialement les infections à coronavirus en téléconsultation, mais une consultation en présentiel est souvent recommandée pour l'examen clinique complet, particulièrement l'auscultation pulmonaire et l'évaluation de la gravité.

- Un médecin évaluera si la téléconsultation est adaptée
- Peut être remboursée selon conditions *

Infections à coronavirus : Définition et Vue d'Ensemble
Les infections à coronavirus sont des maladies virales causées par une famille de virus appelés Coronaviridae. Ces virus tirent leur nom de leur apparence caractéristique en couronne lorsqu'ils sont observés au microscope électronique [14].
Il existe plusieurs types de coronavirus qui peuvent infecter l'homme. Les plus courants provoquent des rhumes bénins, mais certains peuvent causer des maladies plus graves. Le SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, est devenu le plus préoccupant depuis 2020 [1,13]. D'autres coronavirus pathogènes incluent le SARS-CoV-1 et le MERS-CoV, qui ont causé des épidémies localisées par le passé.
Ces virus s'attaquent principalement au système respiratoire, mais peuvent également affecter d'autres organes. Leur capacité de transmission varie selon le type, certains étant hautement contagieux comme le SARS-CoV-2 [14,15]. La compréhension de ces pathologies a considérablement évolué ces dernières années grâce aux recherches intensives menées depuis la pandémie.
Bon à savoir : tous les coronavirus ne sont pas dangereux. En fait, quatre types de coronavirus circulent couramment et ne causent que des symptômes de rhume léger chez la plupart des personnes [13,14].
Épidémiologie en France et dans le Monde
L'épidémiologie des infections à coronavirus a été bouleversée par l'émergence du SARS-CoV-2. En France, Santé Publique France rapporte que plus de 38 millions de cas de COVID-19 ont été confirmés depuis le début de la pandémie, avec une incidence qui varie selon les vagues épidémiques [1].
Les données 2024-2025 montrent une circulation continue du virus avec des pics saisonniers. L'incidence hebdomadaire oscille entre 50 et 200 cas pour 100 000 habitants selon les périodes, avec des variations régionales importantes [1]. Les régions les plus touchées restent l'Île-de-France et les zones urbaines denses.
Au niveau mondial, l'Organisation mondiale de la santé estime que plus de 700 millions de cas ont été officiellement recensés, mais le nombre réel serait bien supérieur. En Europe, la France se situe dans la moyenne avec un taux de létalité stabilisé autour de 0,1% grâce aux vaccinations et aux traitements [1,4].
Concernant les autres coronavirus, les infections saisonnières touchent environ 10 à 15% de la population française chaque hiver, principalement sous forme de rhumes bénins [1]. Ces chiffres restent stables d'une année sur l'autre, contrairement au SARS-CoV-2 qui présente encore une imprévisibilité épidémiologique.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les infections à coronavirus résultent de la transmission de virus entre individus ou parfois depuis des réservoirs animaux. Le SARS-CoV-2 se transmet principalement par voie aérienne via les gouttelettes respiratoires et les aérosols [13,15]. La transmission peut également se faire par contact avec des surfaces contaminées, bien que ce mode soit moins fréquent.
Plusieurs facteurs augmentent le risque d'infection. L'âge constitue un facteur majeur : les personnes de plus de 65 ans présentent un risque accru de formes sévères [1,12]. Les pathologies chroniques comme le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires ou l'obésité multiplient également les risques [5,7].
D'ailleurs, l'activité physique joue un rôle protecteur significatif. Une étude coréenne de 2022 démontre que les personnes pratiquant une activité physique régulière ont 11% moins de risque d'infection et 36% moins de risque de forme grave [12]. Cela s'explique par le renforcement du système immunitaire.
Les facteurs environnementaux influencent aussi la transmission. Les espaces clos, mal ventilés et surpeuplés favorisent la propagation virale [13,15]. C'est pourquoi les clusters se forment souvent dans les établissements de soins, les écoles ou les lieux de travail.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes des infections à coronavirus varient considérablement selon le type de virus et la personne infectée. Pour la COVID-19, les signes les plus fréquents incluent la fièvre, la toux sèche, la fatigue et les maux de tête [13,15]. Mais attention, certaines personnes restent asymptomatiques.
Les symptômes respiratoires dominent le tableau clinique. Vous pourriez ressentir un essoufflement, des douleurs thoraciques ou une sensation d'oppression. La perte d'odorat et de goût, très caractéristique au début de la pandémie, reste présente mais moins fréquente avec les variants récents [13,15].
D'autres manifestations peuvent survenir : troubles digestifs (nausées, diarrhées), douleurs musculaires, maux de gorge ou congestion nasale. Chez certains patients, des éruptions cutanées ou des engelures aux extrémités ont été rapportées [15]. Il est important de noter que ces symptômes peuvent évoluer rapidement, parfois en quelques heures.
Concrètement, la durée des symptômes varie de quelques jours à plusieurs semaines. La plupart des personnes récupèrent complètement, mais environ 10 à 20% développent des symptômes prolongés, appelés "COVID long" [1,4]. Ces symptômes persistants incluent fatigue, difficultés de concentration et essoufflement.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des infections à coronavirus repose principalement sur les tests virologiques. Le test de référence reste la RT-PCR, qui détecte l'ARN viral avec une très haute sensibilité [14,15]. Ce test nécessite un prélèvement nasopharyngé et donne des résultats en 24 à 48 heures.
Les tests antigéniques rapides constituent une alternative pratique. Moins sensibles que la PCR, ils permettent néanmoins un diagnostic en 15 à 30 minutes [13,15]. Ils sont particulièrement utiles pour le dépistage de masse ou en cas de symptômes évocateurs. Leur fiabilité est optimale dans les premiers jours de l'infection.
En complément, les tests sérologiques recherchent les anticorps dans le sang. Ils ne diagnostiquent pas une infection active mais permettent de savoir si vous avez été infecté par le passé [14]. Ces tests sont utiles pour les enquêtes épidémiologiques ou l'évaluation de l'immunité.
L'imagerie médicale peut être nécessaire dans les formes sévères. Le scanner thoracique révèle des lésions pulmonaires caractéristiques en "verre dépoli" [15]. Cependant, ces examens ne sont pas systématiques et restent réservés aux cas hospitalisés ou compliqués.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement des infections à coronavirus a considérablement évolué depuis 2020. Pour les formes légères à modérées, la prise en charge reste principalement symptomatique : repos, hydratation, paracétamol pour la fièvre et les douleurs [13,15]. Il est important d'éviter l'ibuprofène en première intention.
Pour les patients à risque de forme grave, des antiviraux sont désormais disponibles. Le Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) réduit de 89% le risque d'hospitalisation s'il est pris dans les 5 premiers jours [3,4]. Ce traitement oral révolutionne la prise en charge ambulatoire des patients vulnérables.
En milieu hospitalier, d'autres options thérapeutiques existent. La dexaméthasone, un corticoïde, diminue la mortalité chez les patients sous oxygène [4]. Les anticorps monoclonaux, bien qu'efficaces, sont moins utilisés depuis l'émergence de variants résistants.
Rassurez-vous, la plupart des infections guérissent spontanément sans traitement spécifique. Cependant, une surveillance médicale reste recommandée, surtout chez les personnes fragiles. L'oxygénothérapie et parfois la ventilation assistée peuvent être nécessaires dans les formes sévères [15].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
La recherche sur les infections à coronavirus progresse à un rythme soutenu. Les innovations 2024-2025 se concentrent sur plusieurs axes prometteurs [2,3,4]. Les nouveaux antiviraux de deuxième génération montrent une efficacité accrue avec moins d'effets secondaires.
Une approche révolutionnaire concerne les thérapies préventives universelles. Cidara Therapeutics développe le CD388, un traitement préventif qui pourrait protéger contre plusieurs virus respiratoires, incluant les coronavirus . Cette innovation pourrait transformer la prévention des infections saisonnières.
Les recherches sur l'immunité cellulaire ouvrent de nouvelles perspectives. Des études récentes montrent que certains patients développent une immunité croisée contre plusieurs coronavirus [5,6]. Cette découverte pourrait mener à des vaccins universels plus efficaces.
D'ailleurs, l'intelligence artificielle révolutionne le diagnostic. Des algorithmes peuvent désormais prédire l'évolution clinique à partir de données simples [4]. Ces outils d'aide à la décision permettent une prise en charge plus personnalisée et précoce des patients à risque.
Vivre au Quotidien avec Infections à coronavirus
Vivre avec une infection à coronavirus nécessite des adaptations temporaires mais importantes. Pendant la phase aiguë, l'isolement reste la règle pour éviter la transmission [13,15]. Cette période peut être difficile psychologiquement, surtout si vous vivez seul.
L'organisation du quotidien devient cruciale. Préparez vos courses à l'avance, assurez-vous d'avoir suffisamment de médicaments et organisez le télétravail si possible. N'hésitez pas à solliciter votre entourage pour les tâches essentielles [15]. La livraison à domicile peut être une solution pratique.
Pour les personnes développant un COVID long, les défis sont différents. La fatigue chronique peut limiter les activités professionnelles et sociales [1,4]. Il est important d'adapter votre rythme et d'accepter cette nouvelle réalité temporaire. Des consultations spécialisées existent désormais dans de nombreux hôpitaux.
Concrètement, la récupération complète peut prendre plusieurs semaines à plusieurs mois. Écoutez votre corps et ne forcez pas la reprise d'activités intenses. Une approche progressive, avec l'aide de professionnels de santé, optimise les chances de guérison complète.
Les Complications Possibles
Les complications des infections à coronavirus peuvent affecter plusieurs organes. Au niveau pulmonaire, la pneumonie reste la complication la plus fréquente, pouvant évoluer vers un syndrome de détresse respiratoire aiguë [8,9]. Cette complication nécessite souvent une hospitalisation en réanimation.
Les complications cardiovasculaires préoccupent particulièrement les médecins. La myocardite, inflammation du muscle cardiaque, peut survenir même chez des patients jeunes [7]. Cette complication, bien que rare, nécessite une surveillance cardiologique prolongée. Les troubles du rythme et les embolies pulmonaires sont également rapportés.
Mais ce n'est pas tout. Les surinfections bactériennes compliquent parfois l'évolution, particulièrement chez les patients hospitalisés [8,9,10]. Ces infections secondaires, souvent dues à des bactéries résistantes, prolongent l'hospitalisation et aggravent le pronostic.
Les complications neurologiques, moins fréquentes, incluent les accidents vasculaires cérébraux, les encéphalites ou les troubles cognitifs persistants [4]. Ces manifestations peuvent survenir même après une infection initialement bénigne, soulignant l'importance du suivi médical.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des infections à coronavirus s'est considérablement amélioré depuis 2020. Pour la grande majorité des patients, l'évolution est favorable avec une guérison complète en 7 à 14 jours [1,4]. Les formes asymptomatiques ou paucisymptomatiques représentent environ 40% des cas.
L'âge reste le facteur pronostique le plus important. Chez les moins de 50 ans sans comorbidités, le taux de mortalité est inférieur à 0,01% [1]. En revanche, il augmente significativement avec l'âge et les pathologies associées, atteignant 5 à 10% chez les plus de 80 ans non vaccinés.
Heureusement, la vaccination a transformé le pronostic. Les personnes vaccinées présentent un risque réduit de 70 à 90% de développer une forme grave [5,6]. Les infections post-vaccinales, appelées "breakthrough infections", sont généralement plus courtes et moins sévères.
Concernant le COVID long, environ 10 à 20% des patients développent des symptômes persistants [1,4]. Bien que handicapants, ces symptômes s'améliorent généralement avec le temps. Des consultations spécialisées permettent une prise en charge adaptée et un meilleur pronostic fonctionnel.
Peut-on Prévenir Infections à coronavirus ?
La prévention des infections à coronavirus repose sur plusieurs stratégies complémentaires. La vaccination constitue la mesure préventive la plus efficace [5,6]. Les vaccins actuels, régulièrement mis à jour, offrent une protection significative contre les formes graves et réduisent la transmission.
Les gestes barrières restent essentiels au quotidien. Le port du masque dans les lieux clos bondés, le lavage fréquent des mains et la distanciation physique limitent efficacement la transmission [13,15]. Ces mesures simples ont prouvé leur efficacité pendant la pandémie.
L'amélioration de la qualité de l'air intérieur joue un rôle crucial. Une bonne ventilation, l'utilisation de purificateurs d'air et l'évitement des espaces confinés réduisent considérablement les risques [15]. Ces mesures sont particulièrement importantes dans les établissements recevant du public.
D'un autre côté, le renforcement de l'immunité naturelle contribue à la prévention. Une alimentation équilibrée, un sommeil suffisant, la pratique d'une activité physique régulière et la gestion du stress optimisent les défenses immunitaires [12]. Ces habitudes de vie saines constituent un bouclier naturel contre les infections.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont établi des recommandations précises concernant les infections à coronavirus. Santé Publique France préconise une surveillance continue de la circulation virale et adapte les mesures selon l'évolution épidémiologique [1]. Ces recommandations évoluent régulièrement en fonction des données scientifiques.
La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande la vaccination pour tous les adultes, avec des rappels adaptés selon l'âge et les facteurs de risque. Les personnes immunodéprimées ou âgées de plus de 65 ans bénéficient d'un schéma vaccinal renforcé [1]. Ces recommandations sont mises à jour plusieurs fois par an.
Concernant la prise en charge thérapeutique, les autorités privilégient une approche graduée. Les antiviraux sont réservés aux patients à risque de forme grave, tandis que les traitements symptomatiques suffisent pour la majorité des cas [1,4]. Cette stratégie optimise l'utilisation des ressources sanitaires.
L'important à retenir : les recommandations évoluent avec les connaissances scientifiques. Il est donc essentiel de se tenir informé via les canaux officiels et de suivre les conseils de votre médecin traitant. Les sites de Santé Publique France et du ministère de la Santé constituent des sources fiables d'information.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs ressources sont disponibles pour accompagner les patients atteints d'infections à coronavirus. L'association "Après J20" se consacre spécifiquement aux patients souffrant de COVID long [1]. Elle propose un soutien psychologique, des groupes de parole et des informations médicales actualisées.
Au niveau institutionnel, de nombreux hôpitaux ont créé des consultations dédiées au COVID long. Ces consultations multidisciplinaires réunissent pneumologues, cardiologues, neurologues et psychologues pour une prise en charge globale [4]. La liste de ces consultations est disponible sur le site du ministère de la Santé.
Les plateformes numériques offrent également un soutien précieux. L'application "TousAntiCovid" continue de fournir des informations actualisées sur l'épidémie [1]. Des forums de patients permettent d'échanger expériences et conseils pratiques.
N'oubliez pas que votre médecin traitant reste votre interlocuteur privilégié. Il peut vous orienter vers les ressources les plus adaptées à votre situation et coordonner votre prise en charge avec les spécialistes si nécessaire [15]. L'Assurance Maladie propose également des dispositifs d'accompagnement spécifiques.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour mieux gérer les infections à coronavirus. Dès l'apparition des premiers symptômes, isolez-vous et contactez votre médecin traitant [13,15]. Un diagnostic précoce permet une prise en charge optimale et limite la transmission.
Pendant la maladie, maintenez une hydratation suffisante et reposez-vous. Évitez les efforts physiques intenses qui pourraient aggraver les symptômes [15]. Surveillez votre température et votre saturation en oxygène si vous disposez d'un oxymètre de pouls.
Pour prévenir les infections, adoptez une hygiène rigoureuse. Lavez-vous les mains régulièrement, désinfectez les surfaces fréquemment touchées et aérez votre domicile plusieurs fois par jour [13,15]. Ces gestes simples mais efficaces limitent considérablement les risques.
En cas de symptômes persistants, n'hésitez pas à consulter. Le COVID long nécessite une prise en charge spécialisée pour optimiser la récupération [1,4]. Tenez un journal de vos symptômes pour aider votre médecin dans le suivi de votre évolution.
Quand Consulter un Médecin ?
Il est important de savoir quand consulter pour une infection à coronavirus. Contactez immédiatement votre médecin si vous présentez des difficultés respiratoires, une douleur thoracique persistante ou une confusion [13,15]. Ces signes peuvent indiquer une complication nécessitant une prise en charge urgente.
Chez les personnes à risque (plus de 65 ans, pathologies chroniques, immunodépression), une consultation précoce est recommandée dès l'apparition des symptômes [1,5]. Cette démarche permet d'évaluer l'opportunité d'un traitement antiviral précoce.
Appelez le 15 (SAMU) en cas de détresse respiratoire aiguë, de douleur thoracique intense ou de perte de connaissance [15]. Ces situations constituent des urgences médicales nécessitant une hospitalisation immédiate. N'attendez pas que les symptômes s'aggravent.
Pour les symptômes persistants au-delà de 4 semaines, une consultation spécialisée s'impose [1,4]. Le COVID long nécessite une évaluation multidisciplinaire pour adapter la prise en charge. Votre médecin traitant peut vous orienter vers les consultations dédiées disponibles dans votre région.
Questions Fréquentes
Combien de temps dure une infection à coronavirus ?
La durée varie selon les personnes et la gravité. La plupart des infections guérissent en 7 à 14 jours. Cependant, 10 à 20% des patients développent des symptômes prolongés (COVID long) qui peuvent persister plusieurs semaines à plusieurs mois.
Peut-on attraper plusieurs fois le coronavirus ?
Oui, les réinfections sont possibles, surtout avec l'émergence de nouveaux variants. Cependant, les infections ultérieures sont généralement moins sévères, particulièrement chez les personnes vaccinées.
Quand faut-il prendre des antiviraux ?
Les antiviraux comme le Paxlovid sont recommandés pour les patients à risque de forme grave, idéalement dans les 5 premiers jours après l'apparition des symptômes. Votre médecin évaluera si ce traitement est approprié pour vous.
Le COVID long est-il permanent ?
Non, le COVID long n'est généralement pas permanent. La plupart des patients voient leurs symptômes s'améliorer progressivement avec le temps. Des consultations spécialisées peuvent aider à optimiser la récupération.
Les vaccins protègent-ils contre tous les coronavirus ?
Les vaccins actuels sont spécifiquement conçus contre le SARS-CoV-2. Ils ne protègent pas contre les autres coronavirus responsables de rhumes. Des recherches sont en cours pour développer des vaccins universels.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Infections respiratoires aiguës (grippe, bronchiolite, COVID ...). Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [2] SANTÉ pour tous. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [3] All COVID-19 Updates. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [4] Comprehensive Review of COVID-19 - PubMed Central. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] Cidara Therapeutics to Host Virtual R&D Day to Discuss CD388 as a potential universal once-per-flu-season preventative.Lien
- [6] Becerril-Gaitan A, Vaca-Cartagena BF, et al. Immunogenicity and risk of SARS-CoV-2 infection after COVID-19 vaccination in patients with cancer. European Journal of Cancer. 2022.Lien
- [7] Amanatidou E, Gkiouliava A. Breakthrough infections after COVID-19 vaccination: Insights, perspectives and challenges. 2022.Lien
- [8] Voleti N, Reddy SP. Myocarditis in SARS-CoV-2 infection vs. COVID-19 vaccination: A systematic review and meta-analysis. 2022.Lien
- [9] Russo A, Gavaruzzi F. Multidrug-resistant Acinetobacter baumannii infections in COVID-19 patients hospitalized in intensive care unit. 2022.Lien
- [10] De Bruyn A, Verellen S. Secondary infection in COVID-19 critically ill patients: a retrospective single-center evaluation. 2022.Lien
- [11] Pintado V, Ruiz-Garbajosa P. Carbapenemase-producing Enterobacterales infections in COVID-19 patients. 2022.Lien
- [12] Khan S, Akbar SMF. Dengue infections during COVID-19 period: reflection of reality or elusive data due to effect of pandemic. 2022.Lien
- [13] Lee SW, Lee J. Physical activity and the risk of SARS-CoV-2 infection, severe COVID-19 illness and COVID-19 related mortality in South Korea: a nationwide cohort study. 2022.Lien
- [14] COVID-19 : Symptômes, traitement, ce que vous devez savoir. Gouvernement du Canada.Lien
- [15] Covid-19 (virus SARS-CoV-2). Institut Pasteur.Lien
- [16] Symptômes, transmission et traitement (COVID-19). Gouvernement du Québec.Lien
Publications scientifiques
- [HTML][HTML] … and risk of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection after coronavirus disease 2019 (COVID-19) vaccination in patients with … (2022)118 citations
- [HTML][HTML] Breakthrough infections after COVID-19 vaccination: Insights, perspectives and challenges (2022)85 citations
- Myocarditis in SARS-CoV-2 infection vs. COVID-19 vaccination: A systematic review and meta-analysis (2022)94 citations
- Multidrug-resistant Acinetobacter baumannii infections in COVID-19 patients hospitalized in intensive care unit (2022)155 citations[PDF]
- Secondary infection in COVID-19 critically ill patients: a retrospective single-center evaluation (2022)97 citations[PDF]
Ressources web
- COVID-19 : Symptômes, traitement, ce que vous devez ... (canada.ca)
11 févr. 2025 — Certaines personnes infectées par la COVID-19 peuvent présenter des symptômes à long terme, même après s'être rétablies de leur infection ...
- Covid-19 (virus SARS-CoV-2) (pasteur.fr)
D'autres présentent des symptômes légers et peu spécifiques : maux de tête, fièvre, toux, diarrhée, fatigue. Une perte brutale de l'odorat et/ou du goût peut ...
- Symptômes, transmission et traitement (COVID-19) (quebec.ca)
15 nov. 2024 — À surveiller : fièvre, toux, difficulté à respirer. Les symptômes peuvent être légers ou sévères. Vous pouvez transmettre le virus sans le ...
- Coronavirus COVID-19 - symptômes, causes, traitements ... (vidal.fr)
8 déc. 2023 — Cette maladie, dont les symptômes évoquent ceux de la grippe saisonnière, est plus sévère chez les personnes âgées et les personnes rendues ...
- Quels sont les symptômes de la Covid-19 et quels gestes ... (service-public.fr)
Lorsque le test de dépistage à la Covid-19 est positif : évitez le contact avec les personnes fragiles, prévenez votre entourage, contactez votre médecin, ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
