Tumeurs sous-tentorielles : Guide Complet 2025 - Symptômes, Diagnostic, Traitements
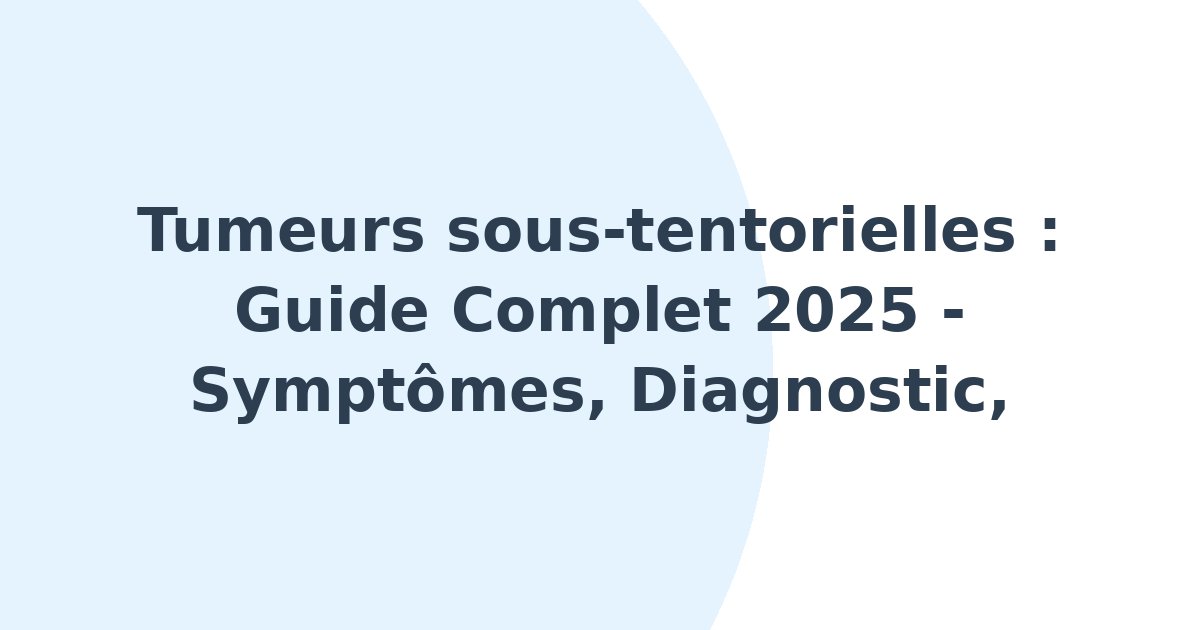
Les tumeurs sous-tentorielles représentent environ 20% des tumeurs cérébrales chez l'adulte et jusqu'à 60% chez l'enfant [1,7]. Situées dans la fosse postérieure du crâne, ces pathologies affectent principalement le cervelet et le tronc cérébral. Bien que leur diagnostic puisse sembler complexe, les avancées thérapeutiques récentes offrent de nouveaux espoirs aux patients et à leurs familles.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Tumeurs sous-tentorielles : Définition et Vue d'Ensemble
Les tumeurs sous-tentorielles sont des masses anormales qui se développent dans la région située sous la tente du cervelet, une structure anatomique qui sépare le cerveau en deux compartiments [15,16]. Cette zone comprend principalement le cervelet, le tronc cérébral et le quatrième ventricule.
Contrairement aux tumeurs sus-tentorielles qui touchent les hémisphères cérébraux, ces pathologies présentent des caractéristiques particulières. Elles peuvent être bénignes ou malignes, primaires ou secondaires (métastases). D'ailleurs, leur localisation stratégique explique pourquoi elles provoquent souvent des symptômes précoces et spécifiques [17].
Il faut savoir que cette région contrôle des fonctions vitales comme l'équilibre, la coordination des mouvements et certaines fonctions respiratoires. C'est pourquoi même une petite tumeur peut avoir des conséquences importantes sur la qualité de vie du patient.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, les tumeurs sous-tentorielles représentent une part significative des pathologies neurologiques. Selon les données du Protocole National de Diagnostic et de Soins, l'incidence annuelle est estimée à 2,5 cas pour 100 000 habitants chez l'adulte [1]. Mais chez l'enfant, cette proportion grimpe considérablement : 60% des tumeurs cérébrales pédiatriques sont localisées dans la fosse postérieure [7,13].
Les statistiques révèlent des disparités importantes selon l'âge. Entre 0 et 15 ans, on observe un pic d'incidence avec environ 4 nouveaux cas pour 100 000 enfants par an. À l'inverse, chez l'adulte de plus de 50 ans, l'incidence diminue à 1,8 cas pour 100 000 habitants [1,10].
Concrètement, cela représente environ 1 650 nouveaux cas diagnostiqués chaque année en France. Les données épidémiologiques montrent également une légère prédominance masculine, avec un ratio homme/femme de 1,3:1 [10]. D'un point de vue géographique, aucune variation régionale significative n'a été identifiée sur le territoire français.
Au niveau international, la France se situe dans la moyenne européenne. Les pays nordiques affichent des taux légèrement supérieurs, probablement liés à de meilleurs systèmes de détection précoce [1]. L'évolution sur les dix dernières années montre une stabilité de l'incidence, mais une amélioration notable du pronostic grâce aux innovations thérapeutiques.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes exactes des tumeurs sous-tentorielles restent largement méconnues. Néanmoins, la recherche a identifié plusieurs facteurs de risque potentiels. L'âge constitue le premier facteur : les enfants de moins de 10 ans et les adultes de plus de 60 ans présentent un risque accru [7,13].
Certaines pathologies génétiques prédisposent au développement de ces tumeurs. La neurofibromatose de type 2, par exemple, augmente significativement le risque de développer des schwannomes vestibulaires. De même, le syndrome de von Hippel-Lindau favorise l'apparition d'hémangioblastomes cérébelleux [16].
L'exposition aux radiations ionisantes représente un facteur de risque établi. Les patients ayant reçu une radiothérapie crânienne dans l'enfance présentent un risque multiplié par 3 à 5 de développer une tumeur cérébrale secondaire [1]. Mais rassurez-vous, ce risque reste faible en valeur absolue.
Contrairement à d'autres cancers, le mode de vie semble avoir peu d'influence. Ni le tabac, ni l'alcool, ni l'alimentation n'ont été formellement associés à ces pathologies. En revanche, certains virus comme l'EBV pourraient jouer un rôle dans des cas très spécifiques [17].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes des tumeurs sous-tentorielles varient selon la localisation exacte et la taille de la masse. Cependant, certains signes sont particulièrement évocateurs et doivent alerter [15,16].
Les troubles de l'équilibre constituent souvent le premier symptôme. Vous pourriez ressentir des vertiges, une instabilité à la marche ou des chutes inexpliquées. Ces manifestations s'expliquent par l'atteinte du cervelet, centre de coordination des mouvements [7,15].
Les céphalées représentent un autre symptôme fréquent, présent chez 80% des patients. Elles sont souvent matinales, s'accompagnent de nausées et s'aggravent progressivement. Cette particularité s'explique par l'augmentation de la pression intracrânienne [16,17].
D'autres signes peuvent apparaître : troubles visuels (vision double, baisse de l'acuité), difficultés de déglutition, troubles de la parole ou encore faiblesse d'un côté du corps. Chez l'enfant, on observe parfois un changement de comportement, une irritabilité ou des difficultés scolaires [13].
Il est important de noter que ces symptômes évoluent généralement de façon progressive sur plusieurs semaines ou mois. Leur association doit conduire à consulter rapidement un médecin.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des tumeurs sous-tentorielles suit un protocole bien établi. La première étape consiste en un examen clinique approfondi par un neurologue ou un neurochirurgien. Ce spécialiste évalue vos symptômes, réalise des tests d'équilibre et examine vos réflexes [1,16].
L'IRM cérébrale avec injection de gadolinium constitue l'examen de référence. Cette technique d'imagerie permet de visualiser précisément la tumeur, d'évaluer sa taille et ses rapports avec les structures avoisinantes [7,8]. L'IRM offre une résolution exceptionnelle pour cette région anatomique complexe.
Dans certains cas, des examens complémentaires sont nécessaires. Le scanner cérébral peut être utile pour détecter des calcifications tumorales. L'angiographie permet d'étudier la vascularisation de la masse, information cruciale avant une éventuelle intervention chirurgicale [12].
La biopsie stéréotaxique reste parfois indispensable pour obtenir un diagnostic histologique précis. Cette procédure mini-invasive, guidée par imagerie, permet de prélever un échantillon de tissu tumoral [3,4]. Rassurez-vous, elle est réalisée sous anesthésie générale et présente des risques limités.
Enfin, un bilan d'extension peut être proposé pour rechercher d'éventuelles métastases, notamment en cas de suspicion de tumeur secondaire. Ce bilan comprend généralement un scanner thoraco-abdomino-pelvien [14].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement des tumeurs sous-tentorielles dépend de nombreux facteurs : type histologique, taille, localisation et état général du patient. La chirurgie reste souvent le traitement de première intention lorsqu'elle est techniquement réalisable [3,4].
L'intervention neurochirurgicale vise à retirer la tumeur tout en préservant les fonctions neurologiques. Les techniques modernes utilisent la neuronavigation et le monitoring peropératoire pour optimiser la sécurité [3]. Cependant, la localisation de ces tumeurs rend parfois l'exérèse complète impossible.
La radiothérapie joue un rôle central, soit en complément de la chirurgie, soit comme traitement principal. Les techniques stéréotaxiques permettent de délivrer des doses élevées tout en épargnant les tissus sains environnants [2,6]. Cette approche s'avère particulièrement efficace pour les tumeurs de petite taille.
La chimiothérapie trouve sa place dans certains types tumoraux, notamment les médulloepitheliomes ou les tumeurs germinales. Les protocoles actuels associent souvent plusieurs molécules pour optimiser l'efficacité [9].
Enfin, les traitements symptomatiques ne doivent pas être négligés. Les corticoïdes réduisent l'œdème péritumoral, les antiépileptiques préviennent les crises convulsives, et la rééducation aide à récupérer les fonctions altérées [1,17].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la prise en charge des tumeurs sous-tentorielles. Le programme Breizh CoCoA 2024 a introduit de nouvelles approches thérapeutiques prometteuses, notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle pour optimiser la planification chirurgicale [2].
Les techniques chirurgicales évoluent rapidement. La formation pratique des opérateurs intègre désormais la réalité virtuelle et la simulation 3D, permettant aux neurochirurgiens de s'entraîner sur des cas complexes avant l'intervention réelle [4]. Cette innovation réduit significativement les risques opératoires.
En matière d'imagerie, les avancées de 2024 permettent une meilleure caractérisation des tumeurs pédiatriques. Les nouvelles séquences IRM offrent une résolution inégalée et aident à prédire la réponse au traitement [5,7]. Concrètement, cela se traduit par des diagnostics plus précoces et plus précis.
La recherche sur le mutisme cérébelleux postopératoire a également progressé. Cette complication redoutée, particulièrement chez l'enfant, fait l'objet d'études approfondies utilisant la neuroimagerie avancée [5]. Les résultats permettent d'identifier les patients à risque et d'adapter la stratégie thérapeutique.
Enfin, la prévention du vasospasme cérébral post-chirurgical bénéficie de nouvelles approches. Les protocoles 2024-2025 intègrent des techniques de monitoring continu et des traitements préventifs innovants [6].
Vivre au Quotidien avec Tumeurs sous-tentorielles
Vivre avec une tumeur sous-tentorielle nécessite des adaptations importantes dans la vie quotidienne. Les troubles de l'équilibre, fréquents dans cette pathologie, peuvent limiter certaines activités [13,15].
L'aménagement du domicile devient souvent nécessaire. Il est recommandé de sécuriser les escaliers avec des rampes, d'éliminer les tapis glissants et d'installer des barres d'appui dans la salle de bain. Ces modifications simples réduisent considérablement le risque de chute [1].
Sur le plan professionnel, des adaptations peuvent être envisagées. Beaucoup de patients conservent leur activité en bénéficiant d'aménagements d'horaires ou de postes de travail. L'important est de communiquer avec votre employeur et la médecine du travail [13].
La rééducation joue un rôle central dans la récupération. La kinésithérapie aide à retrouver l'équilibre, l'orthophonie peut être nécessaire en cas de troubles de la déglutition, et l'ergothérapie optimise l'autonomie dans les gestes quotidiens [17].
Le soutien psychologique ne doit pas être négligé. Cette pathologie génère souvent de l'anxiété et des questionnements légitimes. N'hésitez pas à faire appel à un psychologue spécialisé en oncologie [13].
Les Complications Possibles
Les tumeurs sous-tentorielles peuvent entraîner diverses complications, tant liées à la pathologie elle-même qu'aux traitements. L'hydrocéphalie représente la complication la plus fréquente, survenant chez 30 à 40% des patients [16,17].
Cette accumulation de liquide céphalorachidien résulte de l'obstruction des voies de circulation du liquide par la tumeur. Elle se manifeste par des céphalées intenses, des troubles visuels et parfois des troubles de la conscience. Le traitement nécessite souvent la pose d'une dérivation ventriculaire [1].
Le mutisme cérébelleux constitue une complication redoutée, particulièrement chez l'enfant après chirurgie du cervelet. Cette pathologie se caractérise par une perte temporaire de la parole, associée à des troubles comportementaux [5,13]. Heureusement, la récupération est généralement progressive sur plusieurs mois.
Les troubles de déglutition peuvent survenir en cas d'atteinte du tronc cérébral. Ils nécessitent une prise en charge orthophonique spécialisée et parfois une nutrition entérale temporaire [9]. Ces complications, bien que préoccupantes, sont généralement réversibles avec une rééducation adaptée.
Enfin, le vasospasme cérébral post-chirurgical, bien que rare, peut survenir dans les jours suivant l'intervention. Les équipes médicales sont formées à sa détection précoce et à sa prise en charge [6].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des tumeurs sous-tentorielles varie considérablement selon le type histologique, l'âge du patient et l'étendue de la résection chirurgicale. Globalement, les données récentes montrent une amélioration significative de la survie ces dernières années [1,10].
Pour les tumeurs bénignes comme les méningiomes, le pronostic est excellent après résection complète. Le taux de survie à 10 ans dépasse 95%, et les récidives restent rares [16]. Même en cas de résection partielle, l'évolution est généralement favorable avec un suivi régulier.
Les tumeurs malignes présentent un pronostic plus variable. Les médulloepitheliomes de l'enfant ont un taux de survie à 5 ans d'environ 70% avec les protocoles actuels [13]. Les métastases cérébrales, plus fréquentes chez l'adulte, ont un pronostic qui dépend largement du cancer primitif [14].
L'âge influence significativement le pronostic. Les enfants ont généralement une meilleure capacité de récupération neurologique, mais certaines tumeurs pédiatriques sont plus agressives [7,13]. À l'inverse, les patients âgés tolèrent moins bien les traitements intensifs.
Il faut savoir que les innovations thérapeutiques récentes améliorent constamment ces statistiques. Les techniques chirurgicales modernes réduisent la morbidité, et les nouveaux protocoles de radiothérapie optimisent l'efficacité tout en limitant les séquelles [2,3].
Peut-on Prévenir Tumeurs sous-tentorielles ?
La prévention primaire des tumeurs sous-tentorielles reste limitée en raison de la méconnaissance de leurs causes exactes. Cependant, certaines mesures peuvent réduire le risque de développer ces pathologies [1,16].
La limitation de l'exposition aux radiations ionisantes constitue la mesure préventive la plus établie. Cela concerne particulièrement les examens radiologiques répétés chez l'enfant. Il est important de respecter le principe ALARA (As Low As Reasonably Achievable) : la dose la plus faible raisonnablement possible [1].
Pour les personnes porteuses de syndromes génétiques prédisposants, un suivi médical régulier permet une détection précoce. Les patients atteints de neurofibromatose ou du syndrome de von Hippel-Lindau bénéficient d'un protocole de surveillance spécifique [16].
La prévention secondaire, c'est-à-dire la détection précoce, repose sur la reconnaissance des symptômes d'alarme. Consultez rapidement en cas de céphalées inhabituelles, de troubles de l'équilibre persistants ou de modifications du comportement [15,17].
Enfin, maintenir un mode de vie sain contribue à la prévention générale des cancers. Bien qu'aucun lien direct n'ait été établi avec les tumeurs cérébrales, une alimentation équilibrée et une activité physique régulière renforcent les défenses naturelles de l'organisme.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont établi des recommandations précises pour la prise en charge des tumeurs sous-tentorielles. Le Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS) définit les standards de qualité pour ces pathologies complexes [1].
La Haute Autorité de Santé préconise une prise en charge multidisciplinaire dans des centres experts. Chaque dossier doit être discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) associant neurochirurgiens, oncologues, radiothérapeutes et radiologues [1]. Cette approche garantit une stratégie thérapeutique optimale.
Pour les tumeurs pédiatriques, les recommandations sont encore plus strictes. La prise en charge doit obligatoirement se faire dans un centre spécialisé en oncologie pédiatrique, avec une équipe formée aux spécificités de l'enfant [13]. Le suivi à long terme est également codifié pour détecter d'éventuelles séquelles tardives.
L'Institut National du Cancer (INCa) insiste sur l'importance de l'information du patient et de sa famille. Un programme personnalisé de soins (PPS) doit être remis, détaillant les étapes du traitement et les contacts utiles [1].
Enfin, les recommandations 2024-2025 intègrent les innovations thérapeutiques récentes. L'utilisation de l'intelligence artificielle en aide au diagnostic et la formation continue des équipes font partie des nouvelles exigences [2,4].
Ressources et Associations de Patients
De nombreuses ressources sont disponibles pour accompagner les patients atteints de tumeurs sous-tentorielles et leurs proches. L'Association pour la Recherche sur les Tumeurs Cérébrales (ARTC) propose un soutien personnalisé et des informations actualisées [1].
La Ligue contre le Cancer dispose d'un réseau national de comités départementaux offrant aide psychologique, sociale et financière. Leurs équipes comprennent des psychologues spécialisés en oncologie et des assistantes sociales formées aux problématiques spécifiques [13].
Pour les familles d'enfants malades, l'association Imagine for Margo développe des programmes de recherche et propose un accompagnement adapté. Leur plateforme en ligne offre des ressources pédagogiques pour expliquer la maladie aux fratries [13].
Les centres de ressources hospitaliers proposent également des services précieux : groupes de parole, ateliers bien-être, consultations de socio-esthétique. Ces approches complémentaires améliorent significativement la qualité de vie pendant les traitements.
Enfin, les plateformes numériques comme Mon Réseau Cancer Live permettent d'échanger avec d'autres patients et de bénéficier de conseils pratiques. Ces communautés virtuelles créent des liens précieux et rompent l'isolement souvent ressenti.
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec une tumeur sous-tentorielle nécessite quelques adaptations pratiques qui peuvent grandement améliorer votre quotidien. Voici nos recommandations basées sur l'expérience des patients et des équipes soignantes [1,13].
Concernant la sécurité au domicile, installez des éclairages automatiques dans les couloirs et escaliers. Les troubles de l'équilibre sont souvent plus marqués dans l'obscurité. Portez des chaussures antidérapantes et évitez les talons hauts, même modérés [15].
Pour la gestion des symptômes, tenez un carnet de bord notant l'intensité des céphalées, les épisodes de vertiges et l'efficacité des traitements. Ces informations aident votre médecin à ajuster la prise en charge. En cas de nausées, fractionnez les repas et privilégiez les aliments froids [17].
L'organisation du suivi médical est cruciale. Créez un dossier regroupant tous vos examens, ordonnances et comptes-rendus. Préparez vos questions avant chaque consultation et n'hésitez pas à vous faire accompagner par un proche [1].
Enfin, maintenez une activité physique adaptée. La marche, la natation ou le tai-chi améliorent l'équilibre et le moral. Demandez conseil à votre kinésithérapeute pour choisir les exercices les plus appropriés à votre situation.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains symptômes doivent vous amener à consulter rapidement un médecin, car ils peuvent révéler une tumeur sous-tentorielle ou une complication [15,16,17].
Consultez en urgence si vous présentez : des céphalées soudaines et intenses différentes de vos maux de tête habituels, des troubles de la conscience, des vomissements en jet, ou une paralysie brutale d'un membre. Ces signes peuvent témoigner d'une hypertension intracrânienne aiguë [16].
Prenez rendez-vous rapidement (dans les 48h) en cas de : troubles de l'équilibre persistants depuis plus d'une semaine, céphalées matinales récurrentes, troubles visuels nouveaux (vision double, baisse d'acuité), ou difficultés de déglutition [15,17].
Une consultation programmée s'impose si vous observez : des changements de comportement chez un enfant, une fatigue inhabituelle persistante, des troubles de la mémoire ou de la concentration, ou des modifications de l'écriture [13].
Pour les patients déjà diagnostiqués, contactez votre équipe médicale en cas de : aggravation des symptômes habituels, apparition de nouveaux signes neurologiques, fièvre persistante pendant un traitement, ou effets secondaires importants des médicaments [1].
N'hésitez jamais à appeler le 15 (SAMU) en cas de doute sur l'urgence de la situation. Il vaut mieux consulter pour rien que de passer à côté d'une complication grave.
Questions Fréquentes
Les tumeurs sous-tentorielles sont-elles héréditaires ?La plupart ne sont pas héréditaires. Seuls certains syndromes génétiques rares (neurofibromatose, von Hippel-Lindau) prédisposent à leur développement [16].
Peut-on guérir complètement d'une tumeur sous-tentorielle ?
Oui, particulièrement pour les tumeurs bénignes. Le taux de guérison dépasse 95% après résection complète d'un méningiome [1,16].
Combien de temps dure la récupération après l'opération ?
La récupération varie selon l'intervention. Comptez 2-3 semaines d'hospitalisation et 3-6 mois de rééducation pour retrouver une autonomie complète [3,4].
Les enfants récupèrent-ils mieux que les adultes ?
Généralement oui, grâce à la plasticité cérébrale. Cependant, certaines séquelles peuvent apparaître à distance, d'où l'importance du suivi à long terme [13].
Faut-il arrêter de conduire ?
Temporairement oui, surtout en cas de troubles visuels ou d'équilibre. La reprise de la conduite nécessite l'accord du médecin et parfois un contrôle médical en préfecture [1].
Peut-on reprendre le sport après le traitement ?
Oui, mais progressivement et avec l'accord médical. Évitez les sports de contact et privilégiez les activités douces comme la natation [17].
Actes médicaux associés
Les actes CCAM suivants peuvent être pratiqués dans le cadre de Tumeurs sous-tentorielles :
Questions Fréquentes
Les tumeurs sous-tentorielles sont-elles héréditaires ?
La plupart ne sont pas héréditaires. Seuls certains syndromes génétiques rares (neurofibromatose, von Hippel-Lindau) prédisposent à leur développement.
Peut-on guérir complètement d'une tumeur sous-tentorielle ?
Oui, particulièrement pour les tumeurs bénignes. Le taux de guérison dépasse 95% après résection complète d'un méningiome.
Combien de temps dure la récupération après l'opération ?
La récupération varie selon l'intervention. Comptez 2-3 semaines d'hospitalisation et 3-6 mois de rééducation pour retrouver une autonomie complète.
Les enfants récupèrent-ils mieux que les adultes ?
Généralement oui, grâce à la plasticité cérébrale. Cependant, certaines séquelles peuvent apparaître à distance, d'où l'importance du suivi à long terme.
Faut-il arrêter de conduire ?
Temporairement oui, surtout en cas de troubles visuels ou d'équilibre. La reprise de la conduite nécessite l'accord du médecin et parfois un contrôle médical en préfecture.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS) - HAS 2024-2025Lien
- [2] Breizh CoCoA 2024 - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] Programme Déroulé - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] La Formation pratique des opérateurs au service de... - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [5] Neuroimaging of postoperative pediatric cerebellar mutism - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [6] Cerebral vasospasm following tumor resection - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [7] R Essofi, K Lemtouni. Apport de l'imagerie dans les tumeurs cérébrales chez l'enfant. 2023Lien
- [8] F Durand-Dubief. Démarche diagnostique devant des hypersignaux de la substance blanche cérébrale. 2024Lien
- [9] J Cros-Labrit, A Sauquet. Nécrose médullaire en contexte oncologique. 2025Lien
- [10] MM GA, MM CF. Adult brain tumors in Libreville from 2017 to 2022. 2023Lien
- [13] A Longaud, Z Barrault. Approche neuropsychologique des cancers pédiatriques. 2023Lien
- [15] Signes selon le siège de la tumeur du cerveau - InfoCancerLien
- [16] Tumeurs intracrâniennes - CEN NeurologieLien
- [17] Tumeurs intra-crâniennes - Neurochirurgie Pitié-SalpêtrièreLien
Publications scientifiques
- Apport de l'imagerie dans les tumeurs cérébrales chez l'enfant (2023)
- Démarche diagnostique devant des hypersignaux de la substance blanche cérébrale (2024)
- Nécrose médullaire en contexte oncologique (2025)
- Adult brain tumors in Libreville from 2017 to 2022: frequency, clinical presentation, paraclinical findings and outcome (2023)
- Tuberculose disséminée révélée par une localisation épididymaire chez un patient immunocompétent: à propos d'un cas (2024)[PDF]
Ressources web
- Signes selon le siège de la tumeur du cerveau - InfoCancer (arcagy.org)
13 avr. 2020 — Elles se traduisent par une hypertension intracrânienne (HTIC) dite "en clapet", un dérobement des jambes, des pertes de connaissance et des ...
- Tumeurs intracrâniennes | www.cen-neurologie.fr (cen-neurologie.fr)
Elle se manifeste par une HTIC, un trouble de la conscience ou un déficit neurologique focal aigus. Il faut donc demander une IRM cérébrale à 4 à 6 semaines ...
- TUMEURS INTRA-CRANIENNES (neurochirurgie-pitie-salpetriere.fr)
Moteur, sensitif, visuel : dépend de la localisation. • Si tumeurs sous-tentorielles : signes cérébelleux, déficits de nerfs crâniens et du tronc cérébral.
- Comment diagnostiquer une tumeur cérébrale ? InfoCancer (arcagy.org)
14 avr. 2020 — Pour affirmer le diagnostic, on vous proposera souvent de réaliser une biopsie de la tumeur. L'étude du tissu prélevé permettra de préciser la ...
- Tumeurs cérébrales (ihope.fr)
D'autres signes très variés peuvent conduire au diagnostic : convulsions (sans température), déficit moteur (plus grande difficulté à bouger un côté ou une ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
