Tumeurs du col de l'utérus : Guide Complet 2025 | Symptômes, Traitements
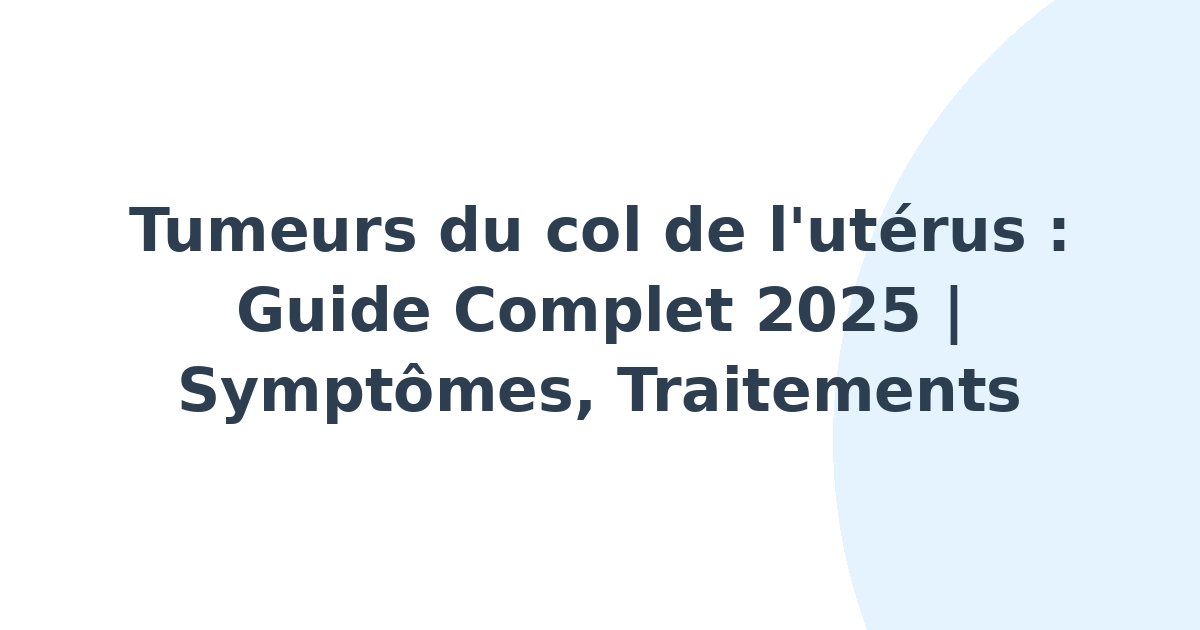
Les tumeurs du col de l'utérus représentent une pathologie gynécologique majeure touchant environ 3 000 femmes chaque année en France [2]. Cette maladie, principalement causée par le papillomavirus humain (HPV), peut être prévenue et traitée efficacement lorsqu'elle est détectée précocement. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette pathologie, des premiers symptômes aux innovations thérapeutiques 2025.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Tumeurs du col de l'utérus : Définition et Vue d'Ensemble
Les tumeurs du col de l'utérus désignent un ensemble de lésions qui se développent au niveau du col utérin, la partie inférieure de l'utérus qui s'ouvre dans le vagin. Cette pathologie comprend les lésions précancéreuses et les cancers invasifs [2,16].
Le col de l'utérus joue un rôle crucial dans la reproduction féminine. Il mesure environ 3 à 4 centimètres de long et se compose de deux parties distinctes. L'endocol, tapissé de cellules glandulaires, et l'exocol, recouvert de cellules squameuses. C'est précisément à la jonction de ces deux zones que naissent la plupart des tumeurs [17].
Mais pourquoi cette zone est-elle si vulnérable ? En fait, cette région subit constamment des transformations cellulaires, particulièrement pendant la puberté, la grossesse et la ménopause. Ces changements naturels créent un environnement propice au développement de lésions lorsque certains facteurs de risque sont présents [2].
L'important à retenir, c'est que cette maladie évolue généralement lentement. Les lésions précancéreuses peuvent mettre 10 à 15 ans avant de se transformer en cancer invasif. Cette évolution progressive offre de nombreuses opportunités de dépistage et de traitement précoce [16,17].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, les tumeurs du col de l'utérus touchent environ 3 000 nouvelles femmes chaque année, avec un taux d'incidence de 6,1 pour 100 000 femmes [2]. Cette pathologie représente la 12ème cause de cancer chez la femme dans notre pays.
L'âge médian au diagnostic se situe autour de 51 ans, mais on observe deux pics d'incidence distincts. Le premier survient entre 25 et 35 ans, principalement pour les lésions précancéreuses. Le second pic, plus tardif, concerne les cancers invasifs chez les femmes de 45 à 65 ans [9,13].
Bonne nouvelle : l'incidence de cette maladie diminue régulièrement en France depuis les années 1980. Cette baisse s'explique par l'amélioration du dépistage par frottis cervical et, plus récemment, par l'introduction de la vaccination contre le papillomavirus [4,9]. Les données 2024 montrent une réduction de 2,5% par an de l'incidence chez les femmes de moins de 50 ans [4].
Au niveau mondial, la situation reste préoccupante. L'Organisation mondiale de la santé recense plus de 600 000 nouveaux cas annuels, avec une mortalité particulièrement élevée dans les pays en développement où l'accès au dépistage reste limité [5,6]. En Europe, la France se situe dans la moyenne basse avec des pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas [9].
Concrètement, ces chiffres reflètent l'efficacité des politiques de santé publique françaises. Le programme national de dépistage organisé, généralisé en 2018, vise à atteindre un taux de participation de 80% chez les femmes de 25 à 65 ans [9,11].
Les Causes et Facteurs de Risque
Le papillomavirus humain (HPV) constitue la cause principale des tumeurs du col de l'utérus. Plus de 99% des cancers cervicaux sont liés à une infection persistante par certains types d'HPV, notamment les types 16 et 18 qui représentent 70% des cas [4,16].
Mais attention, avoir une infection HPV ne signifie pas développer automatiquement un cancer. En réalité, la plupart des infections HPV disparaissent spontanément en 1 à 2 ans grâce au système immunitaire. Seules les infections persistantes, qui durent plusieurs années, peuvent évoluer vers des lésions précancéreuses puis cancéreuses [4,17].
D'autres facteurs augmentent significativement le risque de développer cette pathologie. Le tabagisme multiplie par deux le risque, car les substances toxiques du tabac s'accumulent dans les sécrétions cervicales. L'immunodépression, qu'elle soit liée au VIH ou à des traitements immunosuppresseurs, favorise également la persistance des infections HPV [16,17].
Les facteurs hormonaux jouent aussi un rôle important. Une utilisation prolongée de contraceptifs oraux (plus de 5 ans) ou de nombreuses grossesses (plus de 3) peuvent légèrement augmenter le risque. Cependant, ces facteurs restent modérés comparés à l'infection HPV [2,16].
L'âge des premiers rapports sexuels et le nombre de partenaires influencent également le risque d'exposition au HPV. Plus l'activité sexuelle débute tôt et plus le nombre de partenaires est élevé, plus le risque d'infection HPV augmente [17].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les lésions précancéreuses du col de l'utérus ne provoquent généralement aucun symptôme. C'est pourquoi le dépistage régulier par frottis reste essentiel, même en l'absence de signes d'alerte [2,16].
Lorsque la maladie évolue vers un stade plus avancé, plusieurs symptômes peuvent apparaître. Les saignements anormaux constituent le signe le plus fréquent et le plus précoce. Il peut s'agir de saignements entre les règles, après les rapports sexuels, ou de règles plus abondantes et prolongées que d'habitude [16,17].
Les pertes vaginales représentent un autre symptôme important à surveiller. Elles peuvent devenir plus abondantes, changer de couleur (rosées, brunâtres) ou d'odeur. Parfois, ces pertes contiennent du sang en dehors des périodes menstruelles [2,16].
D'autres signes peuvent alerter : des douleurs pelviennes persistantes, des douleurs pendant les rapports sexuels, ou encore des douleurs lors de la miction. Ces symptômes apparaissent généralement à un stade plus avancé de la maladie [16,17].
Il est crucial de comprendre que ces symptômes ne sont pas spécifiques au cancer du col. Ils peuvent être causés par de nombreuses autres pathologies bénignes comme des infections ou des troubles hormonaux. Néanmoins, leur apparition justifie toujours une consultation médicale rapide [2].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des tumeurs du col de l'utérus suit un protocole précis qui débute généralement par le frottis cervical. Cet examen de dépistage, recommandé tous les 3 ans entre 25 et 65 ans, permet de détecter les cellules anormales avant même l'apparition de symptômes [2,11].
Lorsque le frottis révèle des anomalies, votre médecin vous orientera vers une colposcopie. Cet examen, réalisé par un gynécologue, utilise un microscope spécial pour examiner le col de l'utérus en détail. Il permet de visualiser les zones suspectes et de guider d'éventuelles biopsies [2,8].
La biopsie cervicale constitue l'étape diagnostique définitive. Elle consiste à prélever un petit fragment de tissu suspect pour analyse au microscope. Cet examen, généralement peu douloureux, permet de confirmer ou d'infirmer la présence de cellules cancéreuses et de déterminer leur type [2,16].
En cas de diagnostic de cancer, un bilan d'extension devient nécessaire pour évaluer l'étendue de la maladie. Ce bilan peut inclure une IRM pelvienne, un scanner thoraco-abdominal, et parfois une TEP-TDM au FDG [8,14,15]. Ces examens d'imagerie permettent de déterminer le stade de la maladie et d'adapter le traitement.
Les innovations 2024 incluent l'utilisation croissante de la TEP-TDM au FDG dans le bilan initial, qui améliore significativement la précision du staging et modifie la prise en charge dans 20 à 30% des cas [8,15]. Cette technique permet une meilleure détection des métastases ganglionnaires et à distance.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement des tumeurs du col de l'utérus dépend principalement du stade de la maladie et de l'âge de la patiente. Pour les lésions précancéreuses, des traitements conservateurs permettent souvent de préserver la fertilité [2,10].
La conisation représente le traitement de référence pour les lésions de haut grade. Cette intervention consiste à retirer une partie du col en forme de cône, incluant la zone pathologique. Elle peut être réalisée au laser, par électrochirurgie ou au bistouri froid, selon les préférences du chirurgien [2,17].
Pour les cancers invasifs précoces, plusieurs options thérapeutiques existent. La trachélectomie permet de préserver l'utérus chez les jeunes femmes désirant une grossesse. Cette technique innovante retire uniquement le col et la partie supérieure du vagin, conservant le corps utérin [10,17].
Dans les stades plus avancés, l'hystérectomie radicale reste souvent nécessaire. Cette intervention retire l'utérus, le col, la partie supérieure du vagin et les ganglions lymphatiques pelviens. Elle peut être réalisée par voie abdominale, vaginale ou cœlioscopique [2,10].
La radiothérapie joue un rôle central dans le traitement des cancers localement avancés. Elle est souvent associée à une chimiothérapie concomitante (radiochimiothérapie) pour améliorer l'efficacité. Cette approche combinée représente le standard de soins pour les stades IB2 à IVA [10,17].
Les innovations récentes incluent l'utilisation de techniques de radiothérapie plus précises comme la radiothérapie guidée par l'image (IGRT) et la curiethérapie adaptative, qui permettent de mieux cibler la tumeur tout en préservant les organes sains [10].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque une révolution dans la prise en charge des tumeurs du col de l'utérus avec l'arrivée de nouvelles immunothérapies. Le pembrolizumab (KEYTRUDA) a obtenu une autorisation de mise sur le marché pour le traitement des cancers cervicaux récidivants ou métastatiques [1,5].
Cette molécule, qui bloque la protéine PD-1, permet au système immunitaire de mieux reconnaître et détruire les cellules cancéreuses. Les essais cliniques montrent une amélioration significative de la survie globale, avec une réduction du risque de décès de 27% comparé aux traitements conventionnels [1,6].
Les thérapies ciblées représentent une autre avancée majeure de 2024. Le bevacizumab, un anticorps dirigé contre le facteur de croissance vasculaire (VEGF), montre des résultats prometteurs en association avec la chimiothérapie standard [5,7,10]. Cette combinaison améliore la survie sans progression de 3,7 mois en moyenne [7].
La recherche 2025 se concentre sur les stratégies de désescalade thérapeutique pour les patientes répondant bien aux traitements initiaux. L'objectif est de maintenir l'efficacité tout en réduisant la toxicité à long terme [7]. Ces approches personnalisées pourraient révolutionner la prise en charge dans les prochaines années.
Du côté de la prévention, les nouveaux vaccins HPV nonavalents couvrent désormais 9 types de papillomavirus, protégeant contre 90% des cancers cervicaux [4]. Les données 2024 confirment l'efficacité exceptionnelle de ces vaccins, avec une réduction de 87% des lésions précancéreuses chez les femmes vaccinées [4].
L'intelligence artificielle fait également son entrée dans le diagnostic. Des algorithmes d'apprentissage automatique permettent d'améliorer l'interprétation des frottis cervicaux et de réduire les erreurs de diagnostic [3,6]. Ces outils pourraient transformer le dépistage dans les années à venir.
Vivre au Quotidien avec Tumeurs du col de l'utérus
Recevoir un diagnostic de tumeur du col de l'utérus bouleverse profondément la vie quotidienne. Les premiers jours sont souvent marqués par l'anxiété et de nombreuses questions sur l'avenir [17]. Il est normal de ressentir de la peur, de la colère ou de la tristesse face à cette annonce.
L'impact sur la vie professionnelle varie selon le type de traitement. Une conisation simple nécessite généralement 1 à 2 semaines d'arrêt de travail, tandis qu'une hystérectomie peut requérir 6 à 8 semaines de convalescence. Votre médecin vous aidera à planifier ces périodes en fonction de votre activité professionnelle [2,17].
La sexualité représente souvent une préoccupation majeure. Après une conisation, les rapports sexuels peuvent reprendre après 4 à 6 semaines, le temps de la cicatrisation complète. Une hystérectomie peut temporairement affecter la libido et la lubrification, mais ces effets s'améliorent généralement avec le temps [17].
Le soutien psychologique joue un rôle crucial dans cette épreuve. De nombreux centres de cancérologie proposent un accompagnement par des psycho-oncologues spécialisés. Ces professionnels vous aident à gérer l'anxiété et à retrouver un équilibre émotionnel [2].
Concrètement, maintenir une activité physique adaptée améliore la qualité de vie et réduit la fatigue liée aux traitements. La marche, la natation ou le yoga peuvent être bénéfiques, toujours en accord avec votre équipe médicale [17].
Les Complications Possibles
Les complications des tumeurs du col de l'utérus varient selon le stade de la maladie et les traitements reçus. Dans les stades précoces, les complications chirurgicales restent rares mais peuvent inclure des saignements, des infections ou des sténoses cervicales [2,17].
Après une conisation, environ 5% des femmes développent une sténose cervicale qui peut compliquer les grossesses futures. Cette complication se manifeste par des difficultés d'ouverture du col pendant l'accouchement, nécessitant parfois une césarienne [17].
Les traitements plus lourds comme la radiothérapie peuvent entraîner des complications à long terme. La cystite radique touche 10 à 15% des patientes, provoquant des douleurs et des saignements urinaires. La rectite radique, moins fréquente, peut causer des troubles digestifs persistants [10,17].
L'infertilité représente une complication majeure pour les jeunes femmes. Une hystérectomie rend impossible toute grossesse naturelle, tandis qu'une trachélectomie préserve cette possibilité dans 70% des cas. Il est crucial d'aborder cette question avant tout traitement [2,10].
Les complications psychologiques ne doivent pas être négligées. Anxiété, dépression et troubles de l'image corporelle peuvent survenir, particulièrement après des traitements mutilants. Un suivi psychologique adapté permet de prévenir et traiter ces difficultés [17].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des tumeurs du col de l'utérus dépend essentiellement du stade au diagnostic. Plus la maladie est détectée tôt, meilleures sont les chances de guérison complète [2,16].
Pour les lésions précancéreuses, le pronostic est excellent avec un taux de guérison proche de 100% après traitement approprié. La conisation permet d'éliminer complètement les cellules anormales dans plus de 95% des cas [2,17].
Les cancers de stade précoce (stades I et IIA) présentent également un excellent pronostic. La survie à 5 ans dépasse 90% pour les tumeurs de moins de 4 cm traitées par chirurgie ou radiothérapie. Ces chiffres encourageants soulignent l'importance du dépistage précoce [16,17].
Pour les stades plus avancés, le pronostic reste favorable mais nécessite des traitements plus intensifs. La survie à 5 ans varie de 70% pour les stades IIB à 40% pour les stades IVA. Les innovations thérapeutiques 2024, notamment l'immunothérapie, améliorent progressivement ces statistiques [1,5,6].
Plusieurs facteurs influencent le pronostic : l'âge de la patiente, le type histologique de la tumeur, la présence de métastases ganglionnaires et l'état général. Les femmes jeunes et en bonne santé générale ont tendance à mieux répondre aux traitements [2,16].
Il est important de rappeler que ces statistiques sont des moyennes et que chaque situation est unique. Votre équipe médicale pourra vous donner des informations plus précises adaptées à votre cas particulier [17].
Peut-on Prévenir Tumeurs du col de l'utérus ?
La prévention des tumeurs du col de l'utérus repose sur deux piliers fondamentaux : la vaccination contre le HPV et le dépistage régulier. Cette pathologie fait partie des rares cancers que l'on peut prévenir efficacement [4,9].
La vaccination HPV représente la prévention primaire la plus efficace. Le vaccin nonavalent, disponible depuis 2024, protège contre 9 types de papillomavirus responsables de 90% des cancers cervicaux. Il est recommandé pour toutes les filles et garçons entre 11 et 14 ans, avec un rattrapage possible jusqu'à 19 ans [4].
Les données récentes montrent une efficacité remarquable de cette vaccination. En Australie, pays pionnier de la vaccination généralisée, l'incidence des lésions précancéreuses a chuté de 87% chez les femmes vaccinées [4]. La France observe des tendances similaires avec une réduction significative des infections HPV chez les jeunes femmes vaccinées [9].
Le dépistage par frottis constitue la prévention secondaire. Recommandé tous les 3 ans entre 25 et 65 ans, il permet de détecter les lésions avant qu'elles ne deviennent cancéreuses. Le programme national de dépistage organisé vise à atteindre 80% de participation [9,11].
D'autres mesures préventives peuvent réduire le risque : limiter le nombre de partenaires sexuels, utiliser des préservatifs (protection partielle contre le HPV), arrêter le tabac et maintenir un système immunitaire fort par une alimentation équilibrée et une activité physique régulière [16,17].
L'innovation 2024 inclut le développement de nouveaux tests de dépistage basés sur la recherche directe de l'ADN viral HPV, plus sensibles que le frottis traditionnel pour détecter les lésions précancéreuses [9].
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024 des recommandations actualisées pour la prise en charge des tumeurs du col de l'utérus, intégrant les dernières innovations thérapeutiques [1]. Ces guidelines définissent les standards de soins français et européens.
Concernant le dépistage, la HAS maintient ses recommandations de frottis cervical tous les 3 ans pour les femmes de 25 à 65 ans. Cependant, elle préconise désormais l'introduction progressive des tests HPV-ADN comme méthode de dépistage primaire chez les femmes de plus de 30 ans [9,11].
Pour la vaccination, les autorités françaises recommandent la vaccination HPV pour tous les adolescents, filles et garçons, entre 11 et 14 ans. Cette extension aux garçons, effective depuis 2021, vise à créer une immunité collective et protéger indirectement les femmes non vaccinées [4].
Les innovations thérapeutiques 2024 sont intégrées dans les recommandations. L'immunothérapie par pembrolizumab est désormais recommandée en première ligne pour les cancers métastatiques avec expression PD-L1 positive [1,5]. Cette approche révolutionne la prise en charge des stades avancés.
La HAS insiste également sur l'importance de la prise en charge multidisciplinaire. Chaque dossier de cancer cervical doit être discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) incluant gynécologue-oncologue, radiothérapeute, anatomopathologiste et radiologue [1,10].
Enfin, les recommandations 2024 mettent l'accent sur la préservation de la fertilité chez les jeunes femmes. Les techniques conservatrices comme la trachélectomie doivent être proposées systématiquement aux patientes désirant une grossesse future [10].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations nationales accompagnent les femmes touchées par les tumeurs du col de l'utérus. La Ligue contre le Cancer propose un soutien psychologique gratuit via sa ligne d'écoute 0 805 123 124, disponible du lundi au vendredi [17].
L'Institut National du Cancer (INCa) met à disposition de nombreuses ressources en ligne, notamment le guide "Comprendre le cancer du col de l'utérus" téléchargeable gratuitement. Ce document de référence explique la maladie, les traitements et le suivi en langage accessible [2].
Pour les questions spécifiques à la fertilité, l'association BAMP (Collectif Bamp) offre un soutien aux femmes confrontées à des problèmes de procréation après un cancer. Leurs forums en ligne permettent d'échanger avec d'autres femmes ayant vécu des situations similaires.
Les centres de ressources régionaux proposent des consultations d'annonce, des groupes de parole et des ateliers bien-être. Ces structures, présentes dans chaque région, coordonnent l'accompagnement social et psychologique des patientes [17].
L'application mobile "Mon suivi cancer" développée par l'INCa aide à organiser le suivi médical, noter les effets secondaires et préparer les consultations. Cet outil gratuit facilite la communication avec l'équipe soignante.
Pour les jeunes femmes, l'association "Jeunes Solidarité Cancer" organise des rencontres spécifiques et des séjours de répit. Ces initiatives permettent de rompre l'isolement et de partager son expérience avec des personnes du même âge.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils essentiels pour bien vivre avec une tumeur du col de l'utérus. Tout d'abord, n'hésitez jamais à poser des questions à votre équipe médicale, même si elles vous semblent évidentes. Comprendre sa maladie et ses traitements aide à mieux les accepter [17].
Tenez un carnet de suivi où vous noterez vos symptômes, vos questions et les réponses de vos médecins. Cette habitude facilite grandement les consultations et permet un meilleur suivi de votre évolution [2].
Concernant l'alimentation, privilégiez une nourriture riche en fruits et légumes, sources d'antioxydants qui soutiennent le système immunitaire. Évitez l'alcool et le tabac qui peuvent interférer avec les traitements et ralentir la cicatrisation [17].
L'activité physique adaptée améliore la qualité de vie et réduit la fatigue. Commencez progressivement par de la marche, puis augmentez l'intensité selon vos capacités. Le yoga et la natation sont particulièrement bénéfiques [17].
N'oubliez pas de prendre soin de votre santé mentale. Cette épreuve est difficile et il est normal de ressentir de l'anxiété ou de la tristesse. Le soutien psychologique fait partie intégrante du traitement et ne doit pas être négligé [2].
Enfin, maintenez vos liens sociaux. Parlez de votre maladie à vos proches si vous le souhaitez, mais n'hésitez pas aussi à préserver des moments "normaux" où vous ne parlez pas de cancer. L'équilibre est essentiel pour bien traverser cette période.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes d'alerte nécessitent une consultation médicale rapide, même en dehors de vos rendez-vous de suivi habituels. Les saignements vaginaux anormaux, qu'ils surviennent entre les règles, après les rapports sexuels ou après la ménopause, doivent toujours être explorés [2,16].
Des pertes vaginales qui changent brutalement d'aspect, de couleur ou d'odeur peuvent également signaler un problème. Particulièrement si elles deviennent malodorantes, sanguinolentes ou très abondantes [16,17].
Les douleurs pelviennes persistantes, qui ne cèdent pas aux antalgiques habituels ou qui s'intensifient progressivement, méritent une évaluation médicale. De même pour les douleurs lors des rapports sexuels qui apparaissent soudainement [2,16].
Pendant vos traitements, surveillez l'apparition de fièvre (température >38°C), de frissons ou de signes d'infection. Ces symptômes peuvent indiquer une complication nécessitant une prise en charge urgente [17].
N'attendez pas non plus si vous ressentez une fatigue extrême, des essoufflements anormaux ou des malaises. Ces signes peuvent révéler une anémie ou d'autres complications liées aux traitements [2].
En cas de doute, il vaut toujours mieux consulter "pour rien" que de laisser passer un problème important. Votre équipe médicale préfère être sollicitée inutilement plutôt que de découvrir tardivement une complication [17].
Questions Fréquentes
Puis-je avoir des enfants après un traitement pour tumeur du col de l'utérus ?Cela dépend du type de traitement reçu. Une conisation préserve généralement la fertilité, bien qu'elle puisse légèrement augmenter le risque d'accouchement prématuré. La trachélectomie permet des grossesses dans 70% des cas. Une hystérectomie rend impossible toute grossesse naturelle, mais la préservation d'ovocytes avant traitement peut permettre une gestation pour autrui [2,10].
Le cancer du col de l'utérus est-il héréditaire ?
Non, ce cancer n'est pas héréditaire au sens classique. Il est causé principalement par une infection au papillomavirus humain (HPV). Cependant, certains facteurs génétiques peuvent influencer la capacité du système immunitaire à éliminer l'infection HPV [4,16].
Dois-je arrêter ma contraception hormonale ?
Cette décision doit être prise avec votre médecin. L'utilisation prolongée de contraceptifs oraux (plus de 5 ans) augmente légèrement le risque, mais cet effet reste modéré. Votre médecin évaluera le rapport bénéfice-risque selon votre situation personnelle [16,17].
Combien de temps dure le suivi après traitement ?
Le suivi s'étend généralement sur 5 ans minimum, avec des consultations tous les 4 mois les deux premières années, puis tous les 6 mois. Après 5 ans sans récidive, un suivi annuel peut suffire. Ce rythme peut être adapté selon votre situation [2,17].
La vaccination HPV est-elle utile après 25 ans ?
La vaccination reste possible jusqu'à 45 ans, mais son efficacité diminue avec l'âge car la probabilité d'avoir déjà été exposée au HPV augmente. Discutez avec votre médecin de l'intérêt dans votre situation particulière [4].
Actes médicaux associés
Les actes CCAM suivants peuvent être pratiqués dans le cadre de Tumeurs du col de l'utérus :
Questions Fréquentes
Puis-je avoir des enfants après un traitement pour tumeur du col de l'utérus ?
Cela dépend du type de traitement reçu. Une conisation préserve généralement la fertilité, la trachélectomie permet des grossesses dans 70% des cas, tandis qu'une hystérectomie rend impossible toute grossesse naturelle.
Le cancer du col de l'utérus est-il héréditaire ?
Non, ce cancer n'est pas héréditaire. Il est causé principalement par une infection au papillomavirus humain (HPV), bien que certains facteurs génétiques puissent influencer la réponse immunitaire.
Combien de temps dure le suivi après traitement ?
Le suivi s'étend sur 5 ans minimum, avec des consultations tous les 4 mois les deux premières années, puis tous les 6 mois. Après 5 ans sans récidive, un suivi annuel peut suffire.
La vaccination HPV est-elle utile après 25 ans ?
La vaccination reste possible jusqu'à 45 ans, mais son efficacité diminue avec l'âge car la probabilité d'avoir déjà été exposée au HPV augmente.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] KEYTRUDA 25 mg/ml - Autorisation HAS 2024 pour cancers cervicaux métastatiquesLien
- [2] Diagnostic du cancer du col de l'utérus - Ameli.frLien
- [3] Innovation thérapeutique 2024-2025 - TransgeneLien
- [4] Vaccination papillomavirus 2024-2025Lien
- [5] Gynecologic oncology breakthrough trials 2024Lien
- [6] Gynecologic oncology in 2024Lien
- [7] De-escalating first-line treatment stage IVBLien
- [8] TEP-TDM au FDG dans le bilan d'extension initialLien
- [9] Corrélation statut vaccinal HPV et dépistageLien
- [10] Place des thérapies innovantes cancer col utérusLien
- [11] Evaluation dépistage cancer col utérusLien
- [16] Symptômes du cancer du col de l'utérusLien
- [17] L'essentiel sur le cancer du col de l'utérusLien
Publications scientifiques
- TEP-TDM au FDG dans le bilan d'extension initial du cancer du col et du corps de l'utérus (2024)
- Corrélation entre statut vaccinal HPV et taux de participation au dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes de 25 à 40 ans du Nord-Pas de Calais (2024)
- Place des thérapies innovantes dans la prise en charge des cancers du col de l'utérus (2024)
- Evaluation de dépistage du cancer du col de l'utérus par l'étude des frottis cervico utérins, Cas de la wilaya de Ghardaïa (2023)[PDF]
- Les principales pathologies de l'utérus chez les brebis (2024)[PDF]
Ressources web
- Le diagnostic du cancer du col de l'utérus (ameli.fr)
Les symptômes en l'absence de dépistage · saignements vaginaux après les rapports sexuel ; · saignements vaginaux spontanés en dehors de la période des règles ; ...
- Symptômes du cancer du col de l'utérus (cancer.ca)
Symptômes du cancer du col de l'utérus · saignements vaginaux anormaux, entre autres entre les menstruations, après la ménopause et à la suite de relations ...
- L'essentiel sur le cancer du col de l'utérus (roche.fr)
Dans d'autres cas, des symptômes du cancer du col de l'utérus peuvent survenir, comme de légers saignements en dehors des périodes de règles, des pertes ...
- Cancer du col de l'utérus - Problèmes de santé de la femme (msdmanuals.com)
Les premiers symptômes sont généralement des saignements vaginaux irréguliers, généralement après un rapport sexuel, mais les symptômes peuvent n'apparaître qu' ...
- Cancer du col de l'utérus et papillomavirus (hpv) (pasteur.fr)
19 sept. 2023 — Pour diagnostiquer la maladie, un frottis est effectué, c'est à dire un prélèvement de cellules au niveau du col de l'utérus. Par la suite, un ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
