Tuberculose hépatique : Symptômes, Diagnostic et Traitements 2025
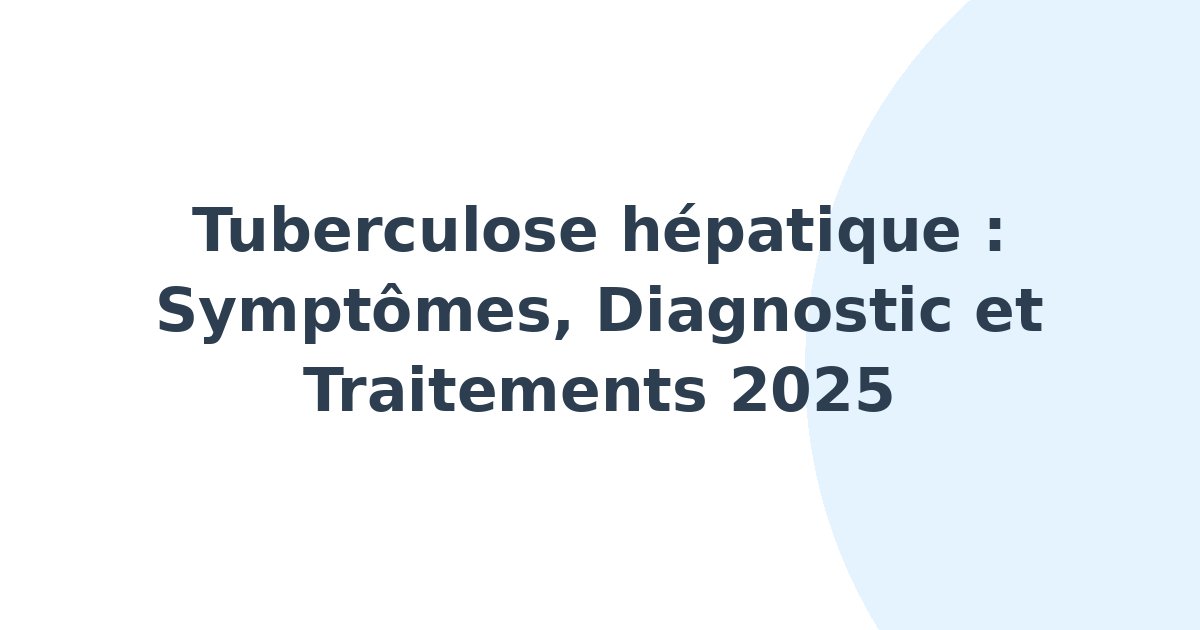
La tuberculose hépatique représente une forme rare mais préoccupante de tuberculose extrapulmonaire. Cette pathologie, causée par Mycobacterium tuberculosis, touche spécifiquement le foie et peut se manifester de façon isolée ou associée à d'autres localisations. Bien que moins fréquente que la tuberculose pulmonaire, elle nécessite une prise en charge spécialisée et un diagnostic précoce pour éviter les complications graves.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Tuberculose hépatique : Définition et Vue d'Ensemble
La tuberculose hépatique est une infection du foie causée par la bactérie Mycobacterium tuberculosis. Cette pathologie représente environ 1 à 2% de toutes les formes de tuberculose extrapulmonaire [4,18]. Contrairement à la tuberculose pulmonaire, elle peut passer inaperçue pendant des mois.
Il existe deux formes principales : la tuberculose hépatique primaire, où le foie est le seul organe atteint, et la forme secondaire, associée à d'autres localisations. La forme primaire reste exceptionnelle et représente un véritable défi diagnostique pour les médecins [9,11].
Cette maladie peut toucher n'importe qui, mais certaines personnes présentent un risque plus élevé. Les patients immunodéprimés, les personnes âgées et celles vivant dans des zones d'endémie tuberculeuse sont particulièrement vulnérables. D'ailleurs, l'augmentation des cas d'immunodépression dans le monde contribue à une recrudescence de cette pathologie [13].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, la tuberculose hépatique demeure une pathologie rare avec une incidence estimée à 0,3 cas pour 100 000 habitants par an. Cependant, cette donnée pourrait être sous-estimée en raison des difficultés diagnostiques [1,2]. Les régions les plus touchées correspondent aux zones urbaines avec une forte densité de population immigrée en provenance de pays d'endémie tuberculeuse.
Selon Santé Publique France, on observe une légère augmentation des cas depuis 2020, particulièrement chez les patients de 25 à 45 ans [1]. Cette tendance s'explique en partie par l'amélioration des techniques diagnostiques et une meilleure reconnaissance de cette pathologie par les cliniciens.
Au niveau mondial, l'incidence varie considérablement selon les régions. L'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud-Est présentent les taux les plus élevés, avec parfois plus de 5 cas pour 100 000 habitants [3]. En Europe, la France se situe dans la moyenne basse avec l'Allemagne et l'Italie.
L'âge moyen au diagnostic est de 42 ans, avec une légère prédominance masculine (ratio 1,3:1). Fait intéressant, contrairement à la tuberculose pulmonaire, la tuberculose hépatique touche davantage les adultes jeunes actifs que les personnes âgées [12].
Les Causes et Facteurs de Risque
La tuberculose hépatique résulte de l'infection par Mycobacterium tuberculosis, une bactérie acido-résistante qui peut atteindre le foie par plusieurs voies. La dissémination hématogène représente le mécanisme le plus fréquent, où les bacilles migrent depuis un foyer pulmonaire initial vers le foie via la circulation sanguine [4,18].
Mais d'autres voies sont possibles. La propagation lymphatique depuis les ganglions médiastinaux ou abdominaux constitue une autre route d'infection. Plus rarement, une contamination directe par contiguïté depuis un organe adjacent peut survenir [13].
Plusieurs facteurs augmentent significativement le risque de développer cette pathologie. L'immunodépression, qu'elle soit liée au VIH, aux traitements immunosuppresseurs ou aux maladies auto-immunes, multiplie le risque par 10 à 50 [9]. Le diabète, la malnutrition et l'alcoolisme chronique constituent également des facteurs prédisposants importants.
L'origine géographique joue un rôle crucial. Les personnes nées dans des pays à forte endémie tuberculeuse (Afrique, Asie du Sud-Est) présentent un risque 5 à 10 fois supérieur [12]. De même, les maladies de vie précaires, la promiscuité et l'exposition professionnelle (personnel soignant) augmentent la probabilité d'infection.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de la tuberculose hépatique sont souvent trompeurs et non spécifiques, ce qui explique les retards diagnostiques fréquents. La fièvre représente le signe le plus constant, présente chez 80 à 90% des patients [4]. Cette fièvre est typiquement vespérale, modérée (38-39°C) et peut s'accompagner de sueurs nocturnes profuses.
Les douleurs abdominales constituent le deuxième symptôme en fréquence. Elles siègent généralement dans l'hypochondre droit et peuvent irradier vers l'épaule droite, mimant une pathologie biliaire [11,14]. Ces douleurs sont souvent sourdes, continues, mais peuvent parfois être aiguës et simuler un abdomen chirurgical.
L'altération de l'état général s'installe progressivement sur plusieurs semaines ou mois. Vous pourriez ressentir une fatigue intense, une perte d'appétit et un amaigrissement significatif, parfois supérieur à 10% du poids initial [9]. Ces signes, bien que non spécifiques, doivent alerter lorsqu'ils persistent.
D'autres manifestations peuvent compléter le tableau clinique. Une hépatomégalie (augmentation du volume du foie) est palpable chez 60% des patients. Plus rarement, on peut observer un ictère (jaunisse), des troubles digestifs ou une ascite [10,16]. Certains patients présentent également une toux sèche persistante, même en l'absence d'atteinte pulmonaire visible.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de tuberculose hépatique représente un véritable défi médical en raison de la diversité des présentations cliniques. La première étape consiste en un bilan biologique complet qui révèle souvent des anomalies non spécifiques : élévation des transaminases, augmentation de la phosphatase alcaline et parfois une cholestase [4,17].
L'imagerie médicale joue un rôle crucial dans l'orientation diagnostique. L'échographie abdominale peut révéler une hépatomégalie hétérogène avec des nodules hypoéchogènes. Le scanner abdominal avec injection de produit de contraste reste l'examen de référence, montrant des lésions hypodenses multiples ou une infiltration diffuse du parenchyme hépatique [7,8].
Mais le diagnostic de certitude repose sur la mise en évidence du bacille tuberculeux. La biopsie hépatique constitue l'examen gold standard, permettant l'identification de granulomes épithélioïdes et gigantocellulaires caractéristiques [11,13]. L'examen bactériologique direct et la culture sur milieu spécifique confirment la présence de Mycobacterium tuberculosis.
Les techniques modernes ont révolutionné le diagnostic. La PCR (réaction en chaîne par polymérase) permet une détection rapide de l'ADN bactérien en quelques heures, contre plusieurs semaines pour la culture traditionnelle [6]. L'intradermoréaction à la tuberculine et les tests de libération d'interféron gamma (IGRA) complètent le bilan diagnostique, particulièrement utiles chez les patients immunocompétents.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de la tuberculose hépatique repose sur une antibiothérapie antituberculeuse prolongée, similaire à celle utilisée pour la tuberculose pulmonaire. Le schéma thérapeutique standard associe quatre médicaments pendant les deux premiers mois : isoniazide, rifampicine, éthambutol et pyrazinamide [4,18].
Cette phase intensive est suivie d'une phase de consolidation de quatre mois avec seulement l'isoniazide et la rifampicine. La durée totale du traitement est donc de six mois minimum, mais peut être prolongée selon l'évolution clinique et radiologique [13]. Il est crucial de respecter scrupuleusement cette durée pour éviter les rechutes et l'émergence de résistances.
La surveillance du traitement nécessite une attention particulière en raison de la toxicité hépatique potentielle des antituberculeux. Un contrôle des transaminases est réalisé toutes les deux semaines pendant le premier mois, puis mensuellement [9]. En cas d'élévation significative des enzymes hépatiques, une adaptation posologique ou un changement de molécules peut s'avérer nécessaire.
Certaines situations particulières requièrent des adaptations thérapeutiques. Chez les patients immunodéprimés, la durée du traitement peut être prolongée à 9-12 mois. En cas de résistance documentée, des antituberculeux de seconde ligne sont utilisés, nécessitant une prise en charge spécialisée en centre de référence [12].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque une période d'innovations importantes dans la prise en charge de la tuberculose hépatique. Les nouvelles techniques d'imagerie, notamment l'échographie de contraste (CEUS), permettent désormais une caractérisation plus précise des lésions hépatiques tuberculeuses [7]. Cette technique non invasive aide à différencier les abcès tuberculeux des autres pathologies hépatiques.
Les avancées en biologie moléculaire révolutionnent le diagnostic. Les nouveaux tests de détection rapide par PCR multiplex permettent d'identifier simultanément Mycobacterium tuberculosis et les principales résistances en moins de 2 heures [6]. Cette rapidité diagnostique transforme la prise en charge précoce des patients.
Le congrès 2025 de la Société Algérienne de Pathologie Pulmonaire a présenté des résultats prometteurs concernant de nouveaux schémas thérapeutiques raccourcis [5]. Des études pilotes évaluent l'efficacité de traitements de 4 mois au lieu de 6, avec des résultats encourageants chez des patients sélectionnés.
La recherche se concentre également sur les biomarqueurs prédictifs de réponse thérapeutique. L'identification de profils génétiques spécifiques pourrait permettre une personnalisation du traitement selon le patient et la souche bactérienne [5,6]. Ces approches de médecine personnalisée ouvrent des perspectives passionnantes pour optimiser l'efficacité thérapeutique tout en réduisant la toxicité.
Vivre au Quotidien avec Tuberculose hépatique
Vivre avec une tuberculose hépatique implique des adaptations importantes dans votre quotidien, mais rassurez-vous, une vie normale reste tout à fait possible avec un traitement approprié. La première préoccupation concerne souvent la fatigue, symptôme fréquent qui peut persister plusieurs semaines après le début du traitement [9].
L'adaptation de votre rythme de vie devient essentielle. Il est recommandé de fractionner vos activités, de prévoir des temps de repos et d'éviter les efforts intenses pendant les premiers mois de traitement. Beaucoup de patients trouvent bénéfique de réorganiser leur emploi du temps professionnel, parfois avec un aménagement temporaire de leurs horaires.
L'alimentation joue un rôle crucial dans votre rétablissement. Une nutrition équilibrée riche en protéines aide à compenser la perte de poids souvent observée. Il est particulièrement important d'éviter l'alcool pendant toute la durée du traitement, car il augmente le risque de toxicité hépatique des médicaments antituberculeux [13].
Le soutien psychologique ne doit pas être négligé. Cette maladie peut générer de l'anxiété, notamment concernant la contagiosité et l'évolution. Heureusement, la tuberculose hépatique isolée n'est pas contagieuse, contrairement à la forme pulmonaire. Vous pouvez donc maintenir vos relations sociales normalement, ce qui constitue un élément important pour le moral et la guérison.
Les Complications Possibles
Bien que généralement de bon pronostic avec un traitement approprié, la tuberculose hépatique peut parfois évoluer vers des complications graves si elle n'est pas prise en charge rapidement. L'abcès hépatique tuberculeux représente l'une des évolutions les plus redoutées, nécessitant parfois un drainage percutané en complément du traitement médical [14,16].
La fibrose hépatique constitue une autre complication possible, particulièrement chez les patients diagnostiqués tardivement ou ayant présenté une forme sévère. Cette fibrose peut évoluer vers une cirrhose dans de rares cas, d'où l'importance d'un suivi hépatologique prolongé après la guérison [10].
Les complications liées au traitement lui-même ne sont pas négligeables. L'hépatotoxicité des antituberculeux peut provoquer une élévation importante des transaminases, nécessitant parfois un arrêt temporaire ou une modification du schéma thérapeutique [9,12]. Cette toxicité est particulièrement préoccupante chez les patients ayant déjà une atteinte hépatique.
Plus rarement, on peut observer des complications systémiques. La dissémination hématogène vers d'autres organes (méninges, os, reins) reste possible, surtout chez les patients immunodéprimés. C'est pourquoi un bilan d'extension complet est systématiquement réalisé au diagnostic [18].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la tuberculose hépatique est généralement excellent lorsque le diagnostic est posé précocement et le traitement correctement suivi. Les études récentes montrent un taux de guérison supérieur à 95% chez les patients immunocompétents traités selon les recommandations internationales [4,9].
La durée de récupération varie selon les patients et la sévérité initiale de l'atteinte. La plupart des symptômes s'améliorent dans les 2 à 4 premières semaines de traitement, avec une disparition de la fièvre généralement observée dans les 10 premiers jours [11]. La normalisation des paramètres biologiques hépatiques peut prendre 2 à 3 mois.
Certains facteurs influencent favorablement le pronostic. Un âge jeune, l'absence de comorbidités, un diagnostic précoce et une bonne observance thérapeutique sont associés à une guérison plus rapide et complète [13]. À l'inverse, l'immunodépression, le retard diagnostique et la présence de complications initiales peuvent prolonger la durée de récupération.
Le risque de rechute après un traitement complet et bien conduit reste très faible, inférieur à 2% selon les séries récentes [12]. Cette rechute survient généralement dans les deux années suivant l'arrêt du traitement, d'où l'importance d'un suivi médical régulier pendant cette période. La séquelle la plus fréquente reste une fibrose hépatique minime, généralement sans conséquence clinique.
Peut-on Prévenir Tuberculose hépatique ?
La prévention de la tuberculose hépatique s'inscrit dans une démarche globale de lutte contre la tuberculose. La vaccination par le BCG (Bacille de Calmette et Guérin) reste la mesure préventive de référence, particulièrement efficace contre les formes graves et disséminées chez l'enfant [4]. En France, cette vaccination est recommandée pour les enfants à risque élevé d'exposition.
Le dépistage précoce des formes pulmonaires constitue un enjeu majeur de santé publique. En effet, la tuberculose hépatique résulte souvent d'une dissémination à partir d'un foyer pulmonaire initial, parfois asymptomatique [18]. Les campagnes de dépistage ciblées sur les populations à risque permettent d'identifier et de traiter ces formes avant leur dissémination.
La prévention passe également par l'amélioration des maladies socio-économiques. La lutte contre la précarité, l'amélioration de l'habitat et la réduction de la promiscuité constituent des mesures préventives efficaces à long terme [12]. L'accès aux soins et le suivi médical régulier des populations vulnérables sont également essentiels.
Chez les personnes immunodéprimées, des mesures spécifiques s'appliquent. Le traitement de l'infection tuberculeuse latente peut être proposé après évaluation du rapport bénéfice-risque. Cette chimioprophylaxie, généralement par isoniazide pendant 6 à 9 mois, permet de prévenir la réactivation d'une infection ancienne [13].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont établi des recommandations précises pour la prise en charge de la tuberculose hépatique, s'appuyant sur les guidelines internationales et l'expertise des centres de référence nationaux. La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise une approche multidisciplinaire associant gastro-entérologues, pneumologues et infectiologues [1,2].
Santé Publique France insiste sur l'importance de la déclaration obligatoire de tous les cas de tuberculose, y compris les formes extrapulmonaires comme la tuberculose hépatique. Cette surveillance épidémiologique permet d'adapter les stratégies de prévention et de contrôle [1]. Les médecins disposent de 24 heures pour effectuer cette déclaration après confirmation diagnostique.
Les recommandations thérapeutiques suivent les standards internationaux avec quelques spécificités françaises. La durée minimale de traitement est fixée à 6 mois, avec possibilité de prolongation selon l'évolution clinique et radiologique [2,3]. Un suivi biologique rapproché est obligatoire pendant les trois premiers mois de traitement.
L'organisation des soins s'appuie sur un réseau de centres de lutte antituberculeuse (CLAT) répartis sur tout le territoire. Ces centres assurent le diagnostic, le traitement et le suivi des patients, ainsi que l'enquête autour des cas et la prévention. Ils constituent le pivot de la prise en charge de la tuberculose en France [3].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations accompagnent les patients atteints de tuberculose en France, offrant soutien, information et aide pratique. L'Association Française de Lutte Antituberculeuse (AFLAT) constitue la référence nationale, proposant des brochures d'information, des groupes de parole et un accompagnement personnalisé.
Le Comité National contre les Maladies Respiratoires (CNMR) développe des programmes d'éducation thérapeutique spécifiquement adaptés aux patients tuberculeux. Ces programmes, d'une durée de 3 à 6 mois, abordent la compréhension de la maladie, l'observance thérapeutique et la gestion des effets secondaires.
Au niveau local, de nombreuses associations régionales proposent des services complémentaires : aide au transport pour les consultations, soutien nutritionnel, accompagnement social. Ces structures travaillent en étroite collaboration avec les CLAT pour assurer une prise en charge globale des patients.
Les ressources numériques se développent également. Le site ameli.fr propose une section dédiée à la tuberculose avec des fiches pratiques régulièrement mises à jour [4]. Des applications mobiles d'aide à l'observance thérapeutique sont disponibles, permettant un rappel quotidien de prise médicamenteuse et un suivi des symptômes.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils essentiels pour bien vivre avec une tuberculose hépatique et optimiser votre guérison. Tout d'abord, l'observance thérapeutique représente la clé du succès : prenez vos médicaments tous les jours à heure fixe, même si vous vous sentez mieux. Un pilulier hebdomadaire peut vous aider à ne pas oublier vos prises.
Concernant l'alimentation, privilégiez une nutrition riche et variée. Augmentez vos apports en protéines (viandes, poissons, œufs, légumineuses) pour compenser la perte de poids souvent observée. Les fruits et légumes riches en vitamines C et E soutiennent votre système immunitaire. Évitez absolument l'alcool pendant toute la durée du traitement.
Gérez votre fatigue intelligemment. Écoutez votre corps et n'hésitez pas à faire des siestes courtes dans la journée. Planifiez vos activités importantes le matin quand votre énergie est maximale. Une activité physique douce comme la marche est bénéfique, mais évitez les efforts intenses les premiers mois.
Maintenez un suivi médical rigoureux. Respectez tous vos rendez-vous, même si vous vous sentez bien. Signalez immédiatement tout effet secondaire : nausées persistantes, jaunisse, douleurs abdominales intenses. Tenez un carnet de suivi avec vos symptômes et l'évolution de votre poids.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes d'alarme doivent vous amener à consulter rapidement votre médecin, que ce soit avant le diagnostic ou pendant le traitement. Une fièvre persistante supérieure à 38°C pendant plus de 48 heures, associée à des douleurs abdominales, justifie une consultation dans les 24 heures [4].
Pendant le traitement, surveillez attentivement l'apparition d'une jaunisse (coloration jaune de la peau et des yeux), de nausées importantes ou de vomissements répétés. Ces signes peuvent témoigner d'une toxicité hépatique médicamenteuse nécessitant une adaptation urgente du traitement [9,13].
Une aggravation de votre état général doit également vous alerter : perte de poids rapide (plus de 2 kg en une semaine), fatigue extrême vous empêchant vos activités habituelles, ou apparition de nouveaux symptômes comme des troubles visuels ou des maux de tête intenses.
N'hésitez jamais à contacter votre équipe médicale en cas de doute. La plupart des centres de lutte antituberculeuse proposent une ligne téléphonique d'urgence 24h/24. Il vaut mieux une consultation de trop qu'une complication grave par négligence. Votre médecin préfère être sollicité pour rien plutôt que de découvrir tardivement un problème sérieux.
Questions Fréquentes
La tuberculose hépatique est-elle contagieuse ?Non, la tuberculose hépatique isolée n'est pas contagieuse. Contrairement à la tuberculose pulmonaire, elle ne se transmet pas par voie aérienne. Vous pouvez maintenir vos relations sociales et professionnelles normalement [4,18].
Combien de temps dure le traitement ?
Le traitement standard dure 6 mois minimum : 2 mois de quadrithérapie intensive, puis 4 mois de bithérapie de consolidation. Cette durée peut être prolongée selon l'évolution clinique [13].
Peut-on guérir complètement ?
Oui, le taux de guérison dépasse 95% avec un traitement approprié et bien suivi. La plupart des patients récupèrent complètement sans séquelle [9,11].
Quels sont les effets secondaires des médicaments ?
Les principaux effets secondaires incluent : nausées, troubles digestifs, éruptions cutanées et risque d'hépatotoxicité. Un suivi biologique régulier permet de les détecter précocement [12].
Peut-on travailler pendant le traitement ?
Oui, dans la plupart des cas. Un aménagement temporaire des horaires peut être nécessaire les premières semaines en raison de la fatigue. Votre médecin peut établir un arrêt de travail si nécessaire.
Y a-t-il un risque de récidive ?
Le risque de rechute après un traitement complet est très faible, inférieur à 2%. Un suivi médical régulier pendant 2 ans permet de détecter toute récidive précocement [12].
Questions Fréquentes
La tuberculose hépatique est-elle contagieuse ?
Non, la tuberculose hépatique isolée n'est pas contagieuse. Contrairement à la tuberculose pulmonaire, elle ne se transmet pas par voie aérienne. Vous pouvez maintenir vos relations sociales et professionnelles normalement.
Combien de temps dure le traitement ?
Le traitement standard dure 6 mois minimum : 2 mois de quadrithérapie intensive, puis 4 mois de bithérapie de consolidation. Cette durée peut être prolongée selon l'évolution clinique.
Peut-on guérir complètement ?
Oui, le taux de guérison dépasse 95% avec un traitement approprié et bien suivi. La plupart des patients récupèrent complètement sans séquelle.
Quels sont les effets secondaires des médicaments ?
Les principaux effets secondaires incluent : nausées, troubles digestifs, éruptions cutanées et risque d'hépatotoxicité. Un suivi biologique régulier permet de les détecter précocement.
Y a-t-il un risque de récidive ?
Le risque de rechute après un traitement complet est très faible, inférieur à 2%. Un suivi médical régulier pendant 2 ans permet de détecter toute récidive précocement.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Prévalence des hépatites B. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [2] Les données de mortalité liée à l'hépatite B. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [3] Prévalence de l'hépatite C. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [4] Symptômes, diagnostic et évolution de la tuberculose. www.ameli.fr.Lien
- [5] Programme du congrès 2025 - SAPP. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] Detection of Mycobacterium tuberculosis in a patient with .... Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [7] The role of CEUS in diagnosing tuberculous abscess of the .... Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [8] Granulomatous hepatitis | Radiology Reference Article. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [9] YB Ekanga, S Ouahid. Tuberculose hépatique primaire chez un immunocompétent: à propos d'un cas. 2024.Lien
- [10] M Ghazali, ML Djama. Tuberculose hépatique et éosinophilie massive: cas plus rares et défis diagnostiques. 2023.Lien
- [11] S Ayadi, F Fares. Tuberculose hépatique isolée de découverte per-opératoire fortuite: Cas clinique. 2023.Lien
- [12] OL Ben, C Jneyeh. La particularité des perturbations hépatiques chez les réfugiés atteints de tuberculose pleuropulmonaire. 2025.Lien
- [13] AR Kpossou, AP Wachinou. Aspects diagnostiques et thérapeutiques des tuberculoses hépatique, bilio-pancréatique et péritonéale. 2022.Lien
- [14] S Haddadi, M El Mammeri. Un tuberculome hepatique mimant un kyste hydatique (cas clinique). 2023.Lien
- [15] K Bouslama, M Ines. Particularités cliniques, biologiques, morphologiques et évolutives de la sarcoïdose hépatique. 2023.Lien
- [16] M Sghaier, IB Ismail. Tuberculose iléocæcale et hépatique mimant une tumeur caecale métastatique. 2022.Lien
- [17] CA253 La tuberculose hépatique : un défi diagnostique. www.sciencedirect.com.Lien
- [18] Tuberculose extrapulmonaire (TB) - Maladies infectieuses. www.msdmanuals.com.Lien
Publications scientifiques
- [HTML][HTML] Tuberculose hépatique primaire chez un immunocompétent: à propos d'un cas (2024)
- Tuberculose hépatique et éosinophilie massive: cas plus rares et défis diagnostiques (2023)
- Tuberculose hépatique isolée de découverte per-opératoire fortuite: Cas clinique (2023)[PDF]
- La particularité des perturbations hépatiques chez les réfugiés atteints de tuberculose pleuropulmonaire (2025)
- Aspects diagnostiques et thérapeutiques des tuberculoses hépatique, bilio-pancréatique et péritonéale (2022)
Ressources web
- CA253 La tuberculose hépatique : un défi diagnostique (sciencedirect.com)
de N Elleuch · 2017 · Cité 1 fois — Son diagnostic est difficile à établir, car elle simule de nombreuses pathologies. Les données de l'imagerie ne sont pas spécifiques mais leur confrontation ...
- Symptômes, diagnostic et évolution de la tuberculose (ameli.fr)
26 mars 2025 — Symptômes de tuberculose pulmonaire · une fièvre traînante, avec souvent des sueurs nocturnes ; · une toux chronique avec des crachats épais, ...
- Tuberculose extrapulmonaire (TB) - Maladies infectieuses (msdmanuals.com)
Les symptômes de la miliaire tuberculeuse comprennent fièvre, frissons, asthénie, sensation de malaise et souvent dyspnée évolutive. La dissémination ...
- Tuberculose hépatique primaire chez un immunocompétent (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)
de YB Ekanga · 2024 — Démarche diagnostique: dès son admission, des bilans ont été réalisés rapportant un syndrome infectieux biologique une hyperleucocytose (17800 ...
- La tuberculose hépatique : un défi diagnostique (em-consulte.com)
23 nov. 2017 — Son diagnostic est difficile à établir, car elle simule de nombreuses pathologies. Les données de l'imagerie ne sont pas spécifiques mais leur ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
