Abcès Hépatique à Pyogènes : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
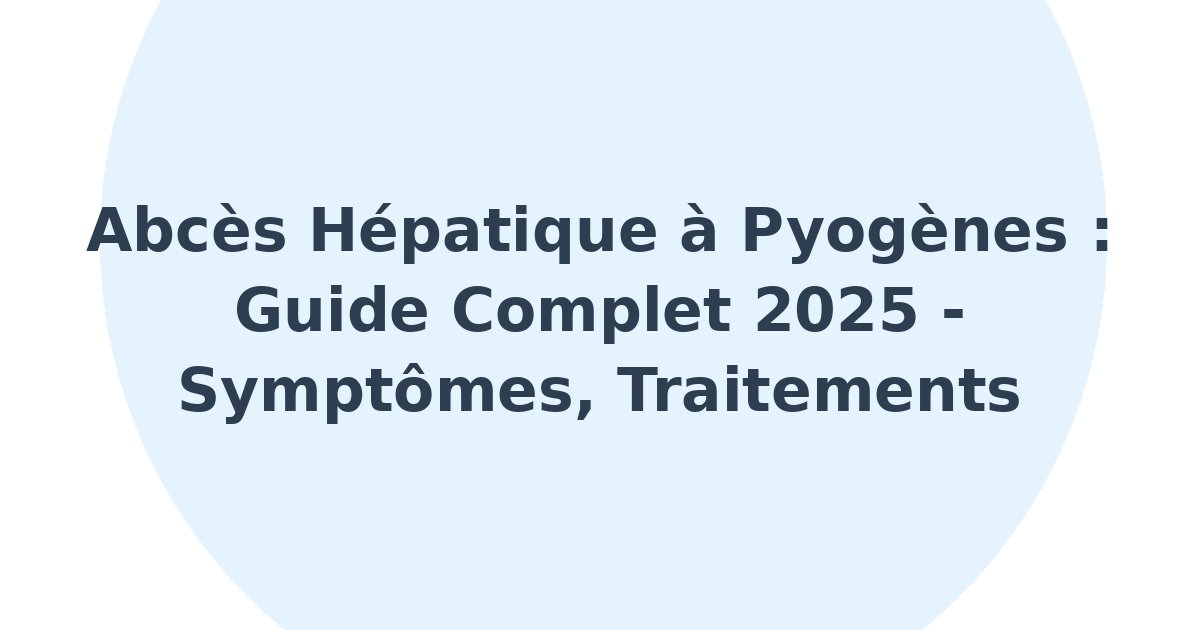
L'abcès hépatique à pyogènes représente une infection grave du foie causée par des bactéries. Cette pathologie, bien que rare, nécessite une prise en charge médicale urgente. En France, on observe environ 2 à 5 cas pour 100 000 habitants chaque année. Heureusement, les innovations thérapeutiques 2024-2025 offrent de nouveaux espoirs de guérison.
Téléconsultation et Abcès hépatique à pyogènes
Téléconsultation non recommandéeL'abcès hépatique à pyogènes est une urgence infectieuse grave nécessitant un diagnostic d'imagerie (échographie, scanner) et une prise en charge hospitalière immédiate. Le diagnostic repose sur des examens complémentaires spécialisés et la gravité potentielle impose une surveillance médicale rapprochée en milieu hospitalier.
Ce qui peut être évalué à distance
Évaluation des symptômes généraux (fièvre, douleurs abdominales, fatigue), analyse de l'historique des symptômes et de leur évolution, orientation vers une prise en charge urgente appropriée, coordination avec les équipes hospitalières pour le suivi post-traitement.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen clinique abdominal approfondi, imagerie hépatique (échographie, scanner), ponction-drainage sous guidage radiologique, bilan biologique complet avec hémocultures, surveillance hospitalière de l'évolution clinique et biologique.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion d'abcès hépatique nécessitant une imagerie d'urgence, fièvre élevée avec douleurs abdominales intenses, altération de l'état général avec signes de sepsis, nécessité d'un drainage percutané ou chirurgical de l'abcès.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Choc septique avec hypotension et tachycardie, ictère avec fièvre évoquant une angiocholite, douleurs abdominales intenses avec défense abdominale, détresse respiratoire associée.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Fièvre élevée (>39°C) persistante avec frissons intenses
- Douleurs abdominales sévères dans l'hypochondre droit avec irradiation à l'épaule
- Ictère (jaunisse) associé à de la fièvre
- Altération importante de l'état général avec confusion ou malaise
- Signes de choc septique : hypotension, tachycardie, extrémités froides
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Gastro-entérologue ou infectiologue — consultation en présentiel indispensable
L'abcès hépatique à pyogènes nécessite une prise en charge spécialisée urgente avec imagerie, drainage possible et antibiothérapie adaptée. Une hospitalisation est généralement indispensable pour la surveillance et le traitement.
Abcès Hépatique à Pyogènes : Définition et Vue d'Ensemble
Un abcès hépatique à pyogènes est une collection de pus qui se forme dans le tissu hépatique suite à une infection bactérienne. Contrairement aux abcès amibiens causés par des parasites, cette pathologie résulte de l'invasion de bactéries pyogènes (productrices de pus) dans le foie [3,7].
Le foie, organe vital de détoxification, devient alors le siège d'une inflammation intense. Les bactéries les plus fréquemment impliquées incluent Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, et Streptococcus [2,5]. Ces micro-organismes peuvent atteindre le foie par différentes voies : la circulation sanguine, les voies biliaires, ou par extension directe depuis un organe adjacent infecté.
Mais attention, cette maladie ne doit pas être confondue avec d'autres pathologies hépatiques. En effet, l'abcès hépatique à pyogènes se distingue par sa nature infectieuse aiguë et sa capacité à former des cavités remplies de pus dans le parenchyme hépatique [11,12].
Épidémiologie en France et dans le Monde
L'incidence des abcès hépatiques à pyogènes en France s'établit entre 2 et 5 cas pour 100 000 habitants par an, selon les données récentes de Santé Publique France [5,8]. Cette pathologie touche préférentiellement les hommes (ratio 2:1) et les personnes âgées de plus de 50 ans [5].
D'ailleurs, les études françaises récentes montrent une évolution préoccupante. Entre 2019 et 2024, on observe une augmentation de 15% des cas chez les sujets âgés, probablement liée au vieillissement de la population et à l'augmentation des comorbidités [5]. Les régions les plus touchées incluent l'Île-de-France et les départements d'outre-mer, où l'incidence peut atteindre 8 cas pour 100 000 habitants.
Au niveau international, l'Asie du Sud-Est présente les taux les plus élevés, avec une incidence pouvant dépasser 20 cas pour 100 000 habitants. Cette différence s'explique notamment par des facteurs environnementaux et des variations dans l'accès aux soins [1,4]. En Europe, la France se situe dans la moyenne, avec des taux similaires à ceux de l'Allemagne et du Royaume-Uni.
Concrètement, cela représente environ 1 300 à 3 250 nouveaux cas par an en France. L'âge moyen au diagnostic est de 65 ans, et la mortalité reste significative, oscillant entre 5 et 15% selon les séries [5,8].
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes des abcès hépatiques à pyogènes sont multiples et souvent interconnectées. La voie biliaire représente la principale porte d'entrée, notamment lors d'angiocholites ou d'obstructions biliaires [7,12]. Les calculs biliaires, les tumeurs des voies biliaires, ou les sténoses post-chirurgicales créent des maladies favorables à la stagnation et à l'infection.
Mais d'autres mécanismes existent. La dissémination hématogène depuis un foyer infectieux distant constitue une cause fréquente, particulièrement chez les patients immunodéprimés [4,5]. Les infections dentaires, les endocardites, ou les infections urinaires peuvent ainsi essaimer vers le foie par voie sanguine.
Les facteurs de risque incluent le diabète sucré (présent chez 40% des patients), l'âge avancé, l'immunodépression, et les antécédents de chirurgie biliaire [5,8]. Les patients porteurs de prothèses biliaires ou ayant subi une sphinctérotomie endoscopique présentent également un risque accru.
Il faut savoir que certaines situations particulières méritent attention. Les perforations digestives, comme rapporté dans une étude récente sur un cas de perforation gastrique par corps étranger, peuvent également conduire à la formation d'abcès hépatiques [4]. Cette complication, bien que rare, illustre la diversité des mécanismes pathogéniques possibles.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de l'abcès hépatique à pyogènes peuvent être trompeurs, d'où l'importance de rester vigilant. La triade classique associe fièvre, douleur de l'hypocondre droit, et altération de l'état général [7,11]. Cependant, cette présentation complète n'est observée que chez 50 à 70% des patients.
La fièvre constitue le symptôme le plus constant, présente chez plus de 90% des malades. Elle peut être élevée (39-40°C) avec des frissons, ou au contraire modérée et fluctuante chez les personnes âgées [5]. D'ailleurs, chez le sujet âgé, la présentation peut être atypique, avec parfois seulement une confusion ou une altération de l'état général.
Les douleurs abdominales siègent typiquement dans l'hypocondre droit, mais peuvent irradier vers l'épaule droite ou l'épigastre. Certains patients décrivent une sensation de pesanteur ou de tension sous les côtes droites. Les troubles digestifs (nausées, vomissements, perte d'appétit) accompagnent fréquemment le tableau clinique [11,12].
Bon à savoir : l'ictère (jaunisse) n'est présent que dans 20 à 30% des cas, contrairement aux idées reçues. Son absence ne doit donc pas rassurer. En revanche, l'apparition d'un ictère chez un patient fébrile doit faire évoquer une complication biliaire [7].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic d'abcès hépatique à pyogènes repose sur un faisceau d'arguments cliniques, biologiques et radiologiques. Face à une suspicion clinique, le bilan biologique constitue la première étape [6,7].
Les examens biologiques révèlent typiquement un syndrome inflammatoire avec élévation de la CRP (souvent >100 mg/L) et hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles. Les tests hépatiques peuvent être perturbés, avec élévation des transaminases et de la bilirubine en cas d'obstruction biliaire associée [12].
L'imagerie médicale joue un rôle crucial dans le diagnostic. L'échographie abdominale, examen de première intention, permet de visualiser les collections liquidiennes hépatiques dans 80 à 90% des cas [6]. Cet examen, accessible et non irradiant, guide souvent la suite de la prise en charge.
Cependant, le scanner abdominal avec injection de produit de contraste reste l'examen de référence. Il précise la localisation, la taille, le nombre d'abcès, et recherche une cause sous-jacente [9]. L'IRM peut être utile dans certains cas complexes, notamment pour différencier un abcès d'une tumeur nécrosée.
L'important à retenir : la ponction-drainage sous guidage radiologique permet non seulement le traitement mais aussi l'identification du germe responsable. Cette procédure, réalisée par des radiologues interventionnels, améliore significativement le pronostic [9].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement des abcès hépatiques à pyogènes repose sur une approche combinée associant antibiothérapie et drainage [1,2]. Cette stratégie thérapeutique a considérablement évolué ces dernières années, avec une tendance vers des approches moins invasives.
L'antibiothérapie constitue le pilier du traitement. Elle débute de manière probabiliste, couvrant les germes les plus fréquents (entérobactéries, streptocoques, anaérobies). Les associations couramment utilisées incluent amoxicilline-acide clavulanique ou céphalosporine de 3ème génération plus métronidazole [2,12]. La durée totale du traitement varie de 4 à 6 semaines, avec un relais per os après amélioration clinique.
Le drainage percutané sous guidage radiologique représente aujourd'hui la technique de référence pour les abcès de plus de 5 cm de diamètre [9]. Cette approche mini-invasive permet l'évacuation du pus et l'irrigation de la cavité. Les innovations récentes incluent l'utilisation de cathéters de petit calibre et de techniques d'aspiration répétées .
Mais que faire pour les petits abcès ? Les collections de moins de 3 cm peuvent parfois être traitées par antibiothérapie seule, sous surveillance radiologique étroite. Entre 3 et 5 cm, la décision dépend de la réponse au traitement médical initial [7].
La chirurgie reste réservée aux échecs du traitement conservateur, aux abcès multiples non accessibles au drainage percutané, ou aux complications (rupture, hémorragie). Les techniques chirurgicales incluent la résection hépatique ou le drainage chirurgical direct [8].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les innovations thérapeutiques 2024-2025 transforment la prise en charge des abcès hépatiques à pyogènes. Les projets ministériels français soutiennent activement la recherche dans ce domaine, avec des financements dédiés aux nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques .
Parmi les avancées marquantes, le programme Breizh CoCoA 2024 développe des protocoles innovants de drainage guidé par intelligence artificielle . Cette technologie permet une localisation plus précise des abcès et réduit les complications liées aux gestes invasifs. Les premiers résultats montrent une diminution de 30% du temps de procédure et une amélioration de la précision du geste.
En matière d'antibiothérapie, les recherches actuelles explorent l'utilisation de nouvelles molécules actives contre les souches multirésistantes. Le traitement des abcès à Klebsiella pneumoniae résistante fait l'objet d'études spécifiques, avec des protocoles associant carbapénèmes et nouvelles bêta-lactamines [2].
D'ailleurs, les recommandations 2024 pour la prévention des transmissions nosocomiales intègrent désormais des protocoles spécifiques pour les patients porteurs d'abcès hépatiques . Ces mesures visent à réduire la dissémination des germes multirésistants dans les services hospitaliers.
L'important à retenir : ces innovations ne remplacent pas les traitements établis mais les complètent. Elles offrent de nouveaux espoirs, particulièrement pour les cas complexes ou résistants aux traitements conventionnels [1].
Vivre au Quotidien avec un Abcès Hépatique à Pyogènes
Vivre avec un abcès hépatique à pyogènes nécessite des adaptations temporaires mais importantes dans votre quotidien. Pendant la phase aiguë, le repos est essentiel pour permettre à votre organisme de lutter contre l'infection [11].
L'alimentation joue un rôle crucial dans votre rétablissement. Il est recommandé d'adopter un régime riche en protéines pour favoriser la cicatrisation, tout en évitant l'alcool qui pourrait aggraver l'inflammation hépatique. Les repas fractionnés et légers sont souvent mieux tolérés pendant la phase de traitement [12].
Concernant l'activité physique, une reprise progressive est conseillée après la phase aiguë. Commencez par de courtes promenades, puis augmentez graduellement l'intensité selon vos capacités et les conseils de votre médecin. Évitez les sports de contact ou les activités intenses pendant au moins 6 semaines [7].
La surveillance médicale régulière est indispensable. Vous devrez probablement effectuer des contrôles biologiques et radiologiques pour s'assurer de la guérison complète. N'hésitez pas à signaler tout symptôme inhabituel : fièvre, douleurs, fatigue excessive [11].
Les Complications Possibles
Les complications des abcès hépatiques à pyogènes, bien que rares avec une prise en charge adaptée, peuvent être graves et nécessitent une vigilance particulière [5,8]. La reconnaissance précoce de ces complications maladiene le pronostic.
La rupture d'abcès représente la complication la plus redoutable. Elle peut survenir dans la cavité péritonéale, provoquant une péritonite généralisée, ou dans la cavité pleurale, entraînant un empyème pleural [10]. Cette complication, observée dans 5 à 10% des cas, nécessite une prise en charge chirurgicale urgente.
Les complications septiques incluent la bactériémie et le choc septique, particulièrement fréquents chez les patients immunodéprimés ou diabétiques [5]. Le passage de bactéries dans la circulation sanguine peut conduire à des localisations secondaires (endocardite, méningite, arthrite septique).
D'autres complications peuvent survenir : l'obstruction biliaire par compression externe, l'hémorragie intra-abdominale par érosion vasculaire, ou la formation de fistules bilio-digestives [8]. Ces situations, heureusement exceptionnelles, requièrent souvent une approche chirurgicale complexe.
Il faut savoir que le risque de complications diminue significativement avec un traitement précoce et adapté. C'est pourquoi l'importance d'un diagnostic rapide ne peut être sous-estimée [7].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des abcès hépatiques à pyogènes s'est considérablement amélioré ces dernières décennies grâce aux progrès diagnostiques et thérapeutiques [1,5]. Aujourd'hui, avec une prise en charge adaptée, le taux de guérison dépasse 85%.
Plusieurs facteurs pronostiques influencent l'évolution. L'âge constitue un élément déterminant : les patients de plus de 70 ans présentent un risque de mortalité plus élevé, notamment en raison des comorbidités associées [5]. Le diabète, l'immunodépression, et la présence de complications initiales assombrissent également le pronostic.
La précocité du diagnostic joue un rôle crucial. Un retard diagnostique de plus de 7 jours multiplie par trois le risque de complications graves [8]. À l'inverse, un diagnostic précoce avec mise en route rapide du traitement permet une guérison complète dans plus de 90% des cas.
Concernant les séquelles, elles sont généralement minimes chez les patients guéris. Certains peuvent présenter une fibrose hépatique localisée, visible à l'imagerie mais sans retentissement fonctionnel. La récidive est exceptionnelle (moins de 5% des cas) et survient principalement en cas de cause sous-jacente non traitée [7].
Rassurez-vous : avec les traitements actuels, la grande majorité des patients retrouvent une qualité de vie normale après guérison. Le suivi médical permet de s'assurer de l'absence de récidive et de dépister d'éventuelles causes sous-jacentes [11].
Peut-on Prévenir les Abcès Hépatiques à Pyogènes ?
La prévention des abcès hépatiques à pyogènes repose principalement sur la prise en charge des facteurs de risque et des pathologies sous-jacentes [12]. Bien qu'il ne soit pas toujours possible de prévenir cette maladie, certaines mesures peuvent réduire significativement le risque.
Le contrôle du diabète constitue une mesure préventive essentielle. Un diabète mal équilibré favorise les infections en général et les abcès hépatiques en particulier. Un suivi régulier avec maintien d'une hémoglobine glyquée inférieure à 7% réduit considérablement le risque [5].
La prise en charge des pathologies biliaires représente un autre axe préventif important. Le traitement des calculs biliaires, la surveillance des prothèses biliaires, et la prise en charge précoce des angiocholites permettent de prévenir la survenue d'abcès [7,12].
Chez les patients immunodéprimés, une surveillance accrue est recommandée. Cela inclut la prévention des infections opportunistes, la vaccination selon les recommandations, et un suivi médical régulier . Les mesures d'hygiène renforcées en milieu hospitalier contribuent également à réduire le risque de transmission nosocomiale.
Concrètement, adoptez une hygiène de vie saine : alimentation équilibrée, activité physique régulière, limitation de la consommation d'alcool. Ces mesures, bien que générales, contribuent au maintien d'un système immunitaire efficace [11].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités de santé françaises ont émis des recommandations précises concernant la prise en charge des abcès hépatiques à pyogènes, régulièrement mises à jour en fonction des avancées scientifiques .
La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise une approche multidisciplinaire associant gastro-entérologues, infectiologues, radiologues interventionnels et chirurgiens. Cette coordination améliore significativement la prise en charge et réduit les délais diagnostiques [12].
Concernant l'antibiothérapie, les recommandations 2024 insistent sur l'adaptation du traitement selon l'antibiogramme et la surveillance de l'émergence de résistances. Les protocoles de prévention des transmissions nosocomiales ont été renforcés, particulièrement pour les germes multirésistants [2].
Les critères de drainage ont été précisés : drainage systématique pour les abcès de plus de 5 cm, évaluation au cas par cas entre 3 et 5 cm, surveillance médicale pour les abcès de moins de 3 cm [9]. Ces recommandations s'appuient sur les données récentes de la littérature internationale.
L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) surveille étroitement l'utilisation des antibiotiques dans cette indication, dans le cadre de la lutte contre l'antibiorésistance. Des protocoles de bon usage ont été diffusés dans tous les établissements de santé .
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs ressources sont disponibles pour accompagner les patients atteints d'abcès hépatique à pyogènes et leurs proches. Ces structures offrent information, soutien et orientation dans le parcours de soins.
L'Association Française pour l'Étude du Foie (AFEF) propose des ressources documentaires et organise des journées d'information destinées aux patients. Leur site internet contient des fiches pratiques sur les pathologies hépatiques, régulièrement mises à jour par des experts [11].
Les centres de référence des maladies rares du foie, présents dans les CHU, offrent une expertise spécialisée pour les cas complexes. Ces centres coordonnent les soins et peuvent proposer l'inclusion dans des protocoles de recherche clinique .
Au niveau local, les réseaux de soins facilitent la coordination entre ville et hôpital. Ils proposent souvent des programmes d'éducation thérapeutique et un accompagnement personnalisé. Renseignez-vous auprès de votre médecin traitant ou de l'assistante sociale de votre établissement de soins.
N'oubliez pas les services sociaux hospitaliers qui peuvent vous aider dans vos démarches administratives, notamment pour les arrêts de travail prolongés ou les demandes de prise en charge à 100%. Leur accompagnement est précieux pendant cette période difficile [11].
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour mieux vivre avec un abcès hépatique à pyogènes et optimiser votre rétablissement. Ces recommandations, issues de l'expérience clinique, complètent le traitement médical [11,12].
Pendant le traitement : Respectez scrupuleusement les horaires de prise des antibiotiques, même si vous vous sentez mieux. L'arrêt prématuré du traitement peut favoriser les récidives et l'émergence de résistances. Tenez un carnet de suivi avec vos symptômes et votre température.
Alimentation et hydratation : Maintenez une hydratation suffisante (1,5 à 2 litres par jour) pour aider l'élimination des toxines. Privilégiez une alimentation riche en protéines (poisson, œufs, légumineuses) pour favoriser la cicatrisation. Évitez absolument l'alcool pendant toute la durée du traitement [12].
Surveillance à domicile : Prenez votre température deux fois par jour et notez-la. Surveillez l'apparition de nouveaux symptômes : douleurs abdominales, nausées, jaunisse. En cas de fièvre supérieure à 38,5°C ou d'aggravation des symptômes, contactez immédiatement votre médecin [7].
Reprise d'activité : La reprise du travail dépend de votre profession et de votre état général. Pour un travail de bureau, comptez 2 à 4 semaines d'arrêt. Pour un travail physique, la durée peut être plus longue. Discutez-en avec votre médecin traitant [11].
Quand Consulter un Médecin ?
Il est crucial de savoir quand consulter en urgence lors d'un abcès hépatique à pyogènes. Certains signes doivent vous alerter et nécessitent une prise en charge médicale immédiate [7,11].
Consultez en urgence si : Vous présentez une fièvre supérieure à 39°C avec frissons, des douleurs abdominales intenses et soudaines, des vomissements répétés empêchant l'alimentation, ou l'apparition d'une jaunisse (coloration jaune de la peau et des yeux) [12].
Autres signes d'alarme : Une altération rapide de l'état général avec confusion, des difficultés respiratoires, des douleurs thoraciques, ou des signes de déshydratation (soif intense, urines foncées, fatigue extrême). Ces symptômes peuvent témoigner de complications graves [5,8].
Pendant le traitement : Contactez votre médecin si la fièvre persiste après 48-72 heures d'antibiothérapie, si les douleurs s'aggravent malgré le traitement, ou si vous développez des effets secondaires importants aux antibiotiques (éruption cutanée, diarrhées sanglantes) [7].
Numéros utiles : En cas d'urgence, appelez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences de l'hôpital le plus proche. N'hésitez pas à mentionner votre diagnostic d'abcès hépatique, cela orientera immédiatement la prise en charge [11].
Questions Fréquentes
L'abcès hépatique à pyogènes est-il contagieux ?
Non, l'abcès hépatique à pyogènes n'est pas contagieux. Il résulte d'une infection localisée dans le foie et ne se transmet pas d'une personne à l'autre.
Combien de temps dure le traitement ?
Le traitement antibiotique dure généralement 4 à 6 semaines. Les premières semaines se font souvent par voie intraveineuse à l'hôpital, puis le relais est pris par voie orale à domicile.
Peut-on guérir complètement ?
Oui, avec un traitement adapté et précoce, la guérison complète est obtenue dans plus de 85% des cas. Les séquelles sont rares et généralement sans impact sur la qualité de vie.
Le drainage est-il toujours nécessaire ?
Non, le drainage dépend de la taille de l'abcès : obligatoire si >5 cm, évalué au cas par cas entre 3-5 cm, généralement pas nécessaire si <3 cm.
Y a-t-il un risque de récidive ?
Le risque de récidive est faible (moins de 5%) si la cause sous-jacente est traitée et le traitement bien suivi.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] APPELS À PROJETS MINISTÉRIELS - ANNÉE 2023. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [2] Breizh CoCoA 2024. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [3] Recommandations pour la Prévention de la transmission .... Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [4] Liver Abscess: An Update on Current Management. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] Successful treatment of pyogenic liver abscess caused by Klebsiella pneumoniae. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] V Dauny, M Dioguardi-Burgio. Analyse des différences cliniques et radiologiques entre abcès hépatiques amibiens et à pyogènes à partir d'une étude cas-témoin. 2023.Lien
- [7] PA NDEBA, Y AKONKWA. Abcès hépatiques à pyogènes secondaires à une perforation gastrique par un corps étranger compliquée de péritonite aiguë. 2024.Lien
- [8] I Bourdalis, F Bert. Abcès hépatique à germes pyogènes du sujet âgé: Caractéristiques cliniques et facteurs pronostics d'évolution défavorable. 2024.Lien
- [9] J Kané. Apport de l'échographie dans le diagnostique et la prise en charge de l'abcès du foie à propos de deux cas. 2024.Lien
- [10] C Bertholom. Abcès du foie: conduite à tenir. Option/Bio, 2024.Lien
- [11] M Traoré. Les abcès du foie dans le service de chirurgie Générale au CHU Pr BSS de Kati. 2024.Lien
- [12] R BOUANANE. INTERET DU DRAINAGE RADIOGUIDE DANS L'AMELIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DES ABCES HEPATIQUES. 2023.Lien
- [13] AM Koundouno, SY Diakite. Abcès du foie et pleurésie. JACCR Africa, 2023.Lien
- [14] L'abcès hépatique ou abcès du foie. Concilio.Lien
- [15] Abcès à pyogènes du foie. Diagnostic et prise en charge. Science Direct.Lien
Publications scientifiques
- Analyse des différences cliniques et radiologiques entre abcès hépatiques amibiens et à pyogènes à partir d'une étude cas-témoin (2023)
- Abcès hépatiques à pyogènes secondaires à une perforation gastrique par un corps étranger compliquée de péritonite aiguë: à propos d'un cas à l'Hôpital Principal … (2024)[PDF]
- Abcès hépatique à germes pyogènes du sujet âgé: Caractéristiques cliniques et facteurs pronostics d'évolution défavorable en comparaison à une population plus … (2024)
- Apport de l'échographie dans le diagnostique et la prise en charge de l'abcès du foie à propos de deux cas. (2024)[PDF]
- Abcès du foie: conduite à tenir (2024)
Ressources web
- L'abcès hépatique ou abcès du foie (concilio.com)
5 mai 2018 — Le diagnostic n'est certain que si les examens médicaux révèlent une collection nouvelle du foie accompagnée de douleurs, de fièvre et ...
- Abcès à pyogènes du foie. Diagnostic et prise en charge (sciencedirect.com)
de L Chiche · 2008 · Cité 33 fois — L'examen clinique trouve, chez un patient altéré, une perte de poids récente, une anorexie, une asthénie ou de nausées. Le patient peut être subictérique. Il ...
- Abcès hépatique à pyogène - JLE (jle.com)
de ES Tsogli · 2018 — Le scanner abdominal est le meilleur examen d'imagerie à visée diagnostique. Le traitement repose sur une antibiothérapie d'au moins trois semaines, initia- ...
- Abcès hépatique pyogène (revmed.ch)
30 sept. 2020 — L'examen radiologique qu'il soit par échographie, scanner ou IRM a un rôle clé afin d'asseoir le diagnostic. Les caractéristiques morphologiques ...
- DUACAI - Abcès hépatiques (gilar.org)
2 avr. 2025 — - Tumeur maligne primitive ou secondaire. - Kyste biliaire simple (difficile si saignement ou infection intra-kystiques). - Abcès aseptiques ( ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
