Troubles liés aux traumatismes et au stress : Guide Complet 2025 | Symptômes, Traitements
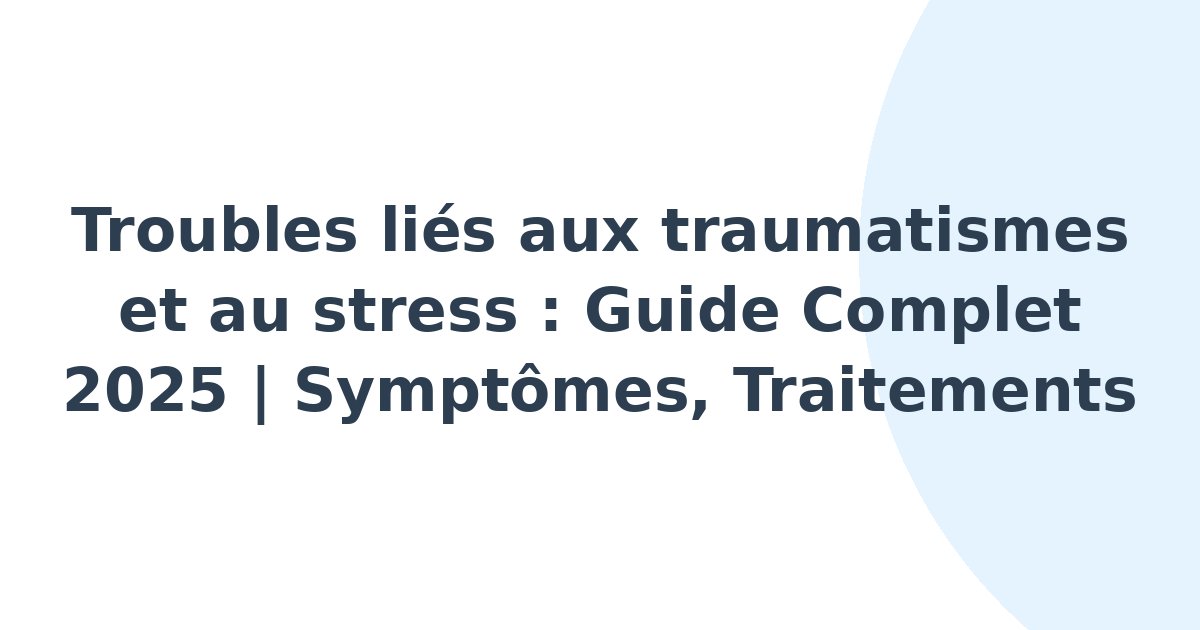
Les troubles liés aux traumatismes et au stress touchent des millions de personnes après des événements difficiles. Ces pathologies, incluant le trouble de stress post-traumatique (TSPT), peuvent profondément impacter votre vie quotidienne. Heureusement, de nouveaux traitements émergent en 2024-2025, offrant de l'espoir aux patients. Comprendre ces troubles est la première étape vers la guérison.
Téléconsultation et Troubles liés aux traumatismes et au stress
Partiellement adaptée à la téléconsultationLes troubles liés aux traumatismes et au stress peuvent être partiellement évalués à distance par l'interrogatoire clinique spécialisé et l'observation comportementale. Cependant, l'évaluation complète nécessite souvent un examen psychologique approfondi et une évaluation du risque suicidaire qui sont généralement plus efficaces en présentiel.
Ce qui peut être évalué à distance
Évaluation des symptômes de stress post-traumatique par questionnaires validés, analyse de l'historique traumatique et des déclencheurs, observation des signes comportementaux visibles (agitation, évitement), évaluation de l'impact fonctionnel sur le quotidien, orientation diagnostique initiale vers les troubles anxieux ou dépressifs associés.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Évaluation approfondie du risque suicidaire et d'auto-agression, examen neurologique si suspicion de traumatisme crânien associé, bilan psychologique complet avec tests projectifs, mise en place d'une psychothérapie structurée (EMDR, TCC trauma).
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Préparer votre téléconsultation
Pour que votre téléconsultation soit la plus efficace possible, préparez les éléments suivants :
- Symptômes et durée : Noter précisément les symptômes de reviviscence (cauchemars, flashbacks), d'évitement, d'hypervigilance, les troubles du sommeil, les changements d'humeur et depuis combien de temps ils sont présents après l'événement traumatique.
- Traitements en cours : Mentionner tous les psychotropes en cours : antidépresseurs (ISRS, IRSNA), anxiolytiques (benzodiazépines), hypnotiques, stabilisateurs de l'humeur, ainsi que toute prise en charge psychothérapeutique actuelle.
- Antécédents médicaux pertinents : Antécédents de troubles psychiatriques personnels et familiaux, traumatismes antérieurs, tentatives de suicide, addictions, troubles de la personnalité, ainsi que le contexte social et professionnel actuel.
- Examens récents disponibles : Résultats d'évaluations psychologiques récentes, échelles d'évaluation du stress post-traumatique (PCL-5, IES-R), bilans biologiques si suspicion de troubles associés, comptes-rendus d'hospitalisations psychiatriques.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Première évaluation d'un trouble de stress post-traumatique complexe nécessitant un bilan approfondi, suspicion de troubles dissociatifs associés nécessitant une évaluation spécialisée, nécessité d'ajustement thérapeutique complexe avec surveillance rapprochée, évaluation de la capacité de jugement et d'insight du patient.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Idéations suicidaires actives ou passage à l'acte auto-agressif, état de décompensation psychotique avec perte de contact avec la réalité, crise d'agitation majeure avec risque pour autrui.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Idées suicidaires avec planification ou tentative de passage à l'acte
- Décompensation psychotique avec hallucinations ou délire
- Agitation majeure avec agressivité envers autrui ou automutilation
- Dissociation sévère avec perte de contact avec la réalité
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Psychiatre — consultation en présentiel recommandée
Le psychiatre est le spécialiste le plus adapté pour évaluer et traiter les troubles liés aux traumatismes. Une consultation en présentiel est généralement recommandée pour une évaluation complète du risque et la mise en place d'une prise en charge adaptée.

- Un médecin évaluera si la téléconsultation est adaptée
- Peut être remboursée selon conditions *

Troubles liés aux traumatismes et au stress : Définition et Vue d'Ensemble
Les troubles liés aux traumatismes et au stress regroupent plusieurs pathologies qui se développent après l'exposition à un événement traumatisant. Le plus connu est le trouble de stress post-traumatique (TSPT), mais cette catégorie inclut aussi le trouble de stress aigu et les troubles de l'adaptation [2,14].
Contrairement aux idées reçues, ces troubles ne sont pas des signes de faiblesse. Il s'agit de véritables pathologies neurologiques où le cerveau réagit de manière particulière au trauma. L'INSERM précise que ces troubles résultent d'un dysfonctionnement des circuits neuronaux impliqués dans la gestion du stress et de la peur [2].
Concrètement, votre cerveau reste en état d'alerte permanent, comme si le danger était toujours présent. Cette hypervigilance épuise votre système nerveux et génère les symptômes caractéristiques. D'ailleurs, les recherches récentes montrent que certaines personnes présentent une vulnérabilité génétique à ces troubles [9].
Bon à savoir : ces pathologies peuvent survenir immédiatement après le trauma ou plusieurs mois plus tard. Parfois, un événement apparemment anodin peut réactiver des souvenirs traumatiques enfouis.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, environ 2,5% de la population souffre de TSPT à un moment donné de sa vie, selon les données de Santé publique France. Cette prévalence grimpe à 8% chez les populations exposées à des traumas répétés, comme les forces de l'ordre ou les soignants [13].
Les femmes sont deux fois plus touchées que les hommes, avec une prévalence de 3,6% contre 1,8%. Cette différence s'explique en partie par une exposition plus fréquente à certains types de traumas, notamment les violences sexuelles [13,15].
Au niveau mondial, l'Organisation mondiale de la santé estime que 3,9% de la population mondiale présente un TSPT. Les pays en conflit affichent des taux bien plus élevés, pouvant atteindre 15-20% de la population [2]. En Europe, la France se situe dans la moyenne, avec des taux similaires à l'Allemagne et au Royaume-Uni.
L'incidence annuelle en France s'élève à environ 400 000 nouveaux cas par an. Mais attention, ces chiffres sont probablement sous-estimés car beaucoup de personnes ne consultent pas ou ne sont pas diagnostiquées [10]. Les projections pour 2025-2030 suggèrent une augmentation de 15% des cas, notamment liés aux conséquences de la pandémie de COVID-19.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les événements traumatisants à l'origine de ces troubles sont variés. Les plus fréquents incluent les accidents de la route (responsables de 30% des cas), les agressions physiques ou sexuelles, les catastrophes naturelles, et l'exposition à la violence [11,13].
Mais pourquoi certaines personnes développent-elles un TSPT après un trauma et d'autres non ? Plusieurs facteurs de risque entrent en jeu. L'âge au moment du trauma joue un rôle crucial : les enfants et les personnes âgées sont plus vulnérables [12]. Les antécédents de troubles mentaux multiplient le risque par trois.
Les facteurs génétiques représentent environ 30% du risque de développer un TSPT. Des variants génétiques affectant la régulation du cortisol et des neurotransmetteurs comme la sérotonine ont été identifiés [9]. D'ailleurs, avoir un parent proche avec un TSPT double votre risque.
L'environnement social compte énormément. Un soutien familial solide divise le risque par deux, tandis que l'isolement social l'augmente considérablement. Les professionnels exposés répétitivement aux traumas (pompiers, policiers, soignants) présentent des taux de TSPT particulièrement élevés [10].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes du TSPT se regroupent en quatre catégories principales. D'abord, les reviviscences : vous revivez l'événement traumatisant à travers des flashbacks, des cauchemars ou des pensées intrusives. Ces épisodes peuvent être déclenchés par des odeurs, des sons ou des situations rappelant le trauma [14,15].
Ensuite vient l'évitement. Vous fuyez tout ce qui pourrait vous rappeler l'événement : lieux, personnes, activités, voire certaines émotions. Cet évitement peut devenir si envahissant qu'il limite drastiquement votre vie sociale et professionnelle.
Les altérations cognitives et émotionnelles constituent le troisième groupe. Vous pourriez ressentir une culpabilité excessive, une perte d'intérêt pour vos activités habituelles, ou des difficultés à ressentir des émotions positives. Certains patients décrivent un sentiment de détachement, comme s'ils observaient leur vie de l'extérieur [6].
Enfin, l'hyperactivation se manifeste par une hypervigilance constante, des sursauts exagérés, des troubles du sommeil et des difficultés de concentration. Votre corps reste en état d'alerte permanent, épuisant vos réserves d'énergie [2]. Ces symptômes doivent persister plus d'un mois pour poser le diagnostic de TSPT.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des troubles liés aux traumatismes repose principalement sur l'entretien clinique. Votre médecin utilisera des critères précis définis dans le DSM-5 ou la CIM-11 pour évaluer vos symptômes [14,15].
L'évaluation commence par un interrogatoire détaillé sur l'événement traumatisant et vos symptômes actuels. Des questionnaires standardisés comme l'échelle PCL-5 (PTSD Checklist) permettent de quantifier la sévérité de vos symptômes. Cette échelle, validée en français, évalue les 20 symptômes principaux du TSPT [2].
Contrairement à d'autres pathologies, il n'existe pas d'examen biologique spécifique pour diagnostiquer le TSPT. Cependant, votre médecin pourra prescrire des analyses pour éliminer d'autres causes : dosage du cortisol, bilan thyroïdien, ou imagerie cérébrale si nécessaire.
Le diagnostic différentiel est crucial. Il faut distinguer le TSPT d'autres troubles comme la dépression, les troubles anxieux, ou les troubles dissociatifs. Cette étape peut prendre plusieurs consultations, car certains patients minimisent leurs symptômes ou ont du mal à verbaliser leur vécu [11].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge des troubles liés aux traumatismes combine approches psychothérapeutiques et médicamenteuses. Les thérapies cognitivo-comportementales (TCC) spécialisées dans le trauma constituent le traitement de première ligne [8,14].
L'EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) a révolutionné le traitement du TSPT. Cette technique utilise des mouvements oculaires pour aider à retraiter les souvenirs traumatiques. Son efficacité est démontrée par de nombreuses études, avec des taux de rémission atteignant 70% [2].
La thérapie dialectique comportementale (TCD) adaptée au TSPT montre des résultats prometteurs, particulièrement chez les patients avec des traumas complexes. Cette approche combine techniques de régulation émotionnelle et de pleine conscience [8].
Côté médicamenteux, les antidépresseurs ISRS (sertraline, paroxétine) restent les traitements de référence. Ils réduisent l'intensité des symptômes chez 60% des patients. Les prazosin peut aider contre les cauchemars, tandis que certains anticonvulsivants montrent une efficacité sur l'hyperactivation [15].
L'important à retenir : chaque patient répond différemment aux traitements. Il faut parfois essayer plusieurs approches avant de trouver celle qui vous convient le mieux.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans le traitement des troubles liés aux traumatismes. Le programme pluriannuel santé mentale de la HAS 2025-2030 met l'accent sur l'innovation thérapeutique, avec un budget de 50 millions d'euros dédié à la recherche sur le TSPT [1].
Les thérapies assistées par réalité virtuelle révolutionnent l'exposition thérapeutique. Ces dispositifs permettent une immersion contrôlée dans des environnements rappelant le trauma, facilitant le processus de désensibilisation. Les premiers résultats montrent une efficacité comparable à l'EMDR avec moins d'abandon de traitement [3].
La recherche sur les psychédéliques thérapeutiques connaît un essor remarquable. La MDMA assistée par psychothérapie entre en phase III d'essais cliniques, avec des résultats préliminaires exceptionnels : 67% de rémission complète du TSPT [3,5]. L'Agence européenne du médicament pourrait autoriser cette approche dès 2025.
Le BNC210, un nouveau modulateur des récepteurs GABA, fait l'objet d'essais cliniques prometteurs. Cette molécule cible spécifiquement l'anxiété sociale souvent associée au TSPT, avec moins d'effets secondaires que les traitements actuels [4]. Les résultats de phase III sont attendus fin 2025.
Enfin, les biomarqueurs génétiques permettront bientôt de personnaliser les traitements. Des tests génétiques identifient déjà les patients répondeurs aux ISRS, optimisant ainsi le choix thérapeutique .
Vivre au Quotidien avec Troubles liés aux traumatismes et au stress
Gérer un TSPT au quotidien demande des stratégies adaptées. La régulation émotionnelle devient une compétence essentielle à développer. Des techniques simples comme la respiration profonde ou la relaxation musculaire progressive peuvent vous aider lors des moments difficiles [6].
L'organisation de votre environnement joue un rôle crucial. Créez des espaces sécurisants chez vous, évitez les déclencheurs identifiés quand c'est possible, et établissez des routines rassurantes. Beaucoup de patients trouvent utile de tenir un journal pour identifier leurs déclencheurs et leurs stratégies efficaces.
Le soutien social reste fondamental. N'hésitez pas à expliquer votre pathologie à vos proches : leur compréhension facilitera votre quotidien. Les groupes de parole et associations de patients offrent un soutien précieux entre personnes vivant des expériences similaires.
Au travail, vous pouvez bénéficier d'aménagements : horaires flexibles, télétravail partiel, ou adaptation de vos missions. La reconnaissance en maladie professionnelle est possible dans certains cas, notamment pour les métiers exposés aux traumas [10].
Les Complications Possibles
Sans traitement approprié, les troubles liés aux traumatismes peuvent entraîner des complications sérieuses. La dépression majeure survient chez 50% des patients avec TSPT non traité, créant un cercle vicieux difficile à briser [11,15].
Les troubles anxieux généralisés et les phobies spécifiques se développent fréquemment. Certains patients développent une agoraphobie sévère, limitant drastiquement leurs déplacements et leur autonomie. Les troubles du sommeil chroniques affectent 80% des patients, avec des répercussions sur la santé physique [14].
Les conduites addictives représentent un risque majeur. L'alcool et les substances psychoactives sont souvent utilisés comme automédication pour gérer l'anxiété et les souvenirs intrusifs. Cette stratégie aggrave paradoxalement les symptômes à long terme [2].
Plus préoccupant encore, le risque suicidaire est multiplié par six chez les personnes avec TSPT. Les idées suicidaires touchent 40% des patients, nécessitant une surveillance attentive et une prise en charge spécialisée [15]. C'est pourquoi un diagnostic et un traitement précoces sont essentiels.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des troubles liés aux traumatismes dépend largement de la précocité et de la qualité de la prise en charge. Avec un traitement adapté, 70% des patients connaissent une amélioration significative dans les six premiers mois [2,14].
Plusieurs facteurs influencent l'évolution. Un diagnostic précoce (dans les trois mois suivant le trauma) améliore considérablement les chances de guérison complète. À l'inverse, un TSPT chronique (plus de deux ans) nécessite souvent des traitements plus longs et intensifs [15].
L'âge joue un rôle important : les patients jeunes récupèrent généralement mieux, tandis que les personnes âgées peuvent nécessiter des approches thérapeutiques adaptées. Le soutien social reste un facteur pronostique majeur : les patients bien entourés récupèrent deux fois plus vite [12].
Même dans les cas complexes, l'espoir reste permis. Les nouvelles thérapies comme l'EMDR permettent des améliorations même après des années de souffrance. Certains patients décrivent même une croissance post-traumatique, développant une résilience et une force qu'ils ne se connaissaient pas [6].
Peut-on Prévenir Troubles liés aux traumatismes et au stress ?
La prévention primaire vise à réduire l'exposition aux événements traumatisants. Cela passe par des politiques de sécurité routière, la prévention des violences, ou la formation des professionnels exposés aux risques [10].
Mais quand l'exposition au trauma est inévitable, la prévention secondaire devient cruciale. Les interventions précoces dans les 72 heures suivant un événement traumatisant peuvent réduire le risque de développer un TSPT. Le débriefing psychologique, longtemps pratiqué, s'avère finalement contre-productif selon les études récentes [2].
Les techniques de premiers secours psychologiques montrent plus d'efficacité. Elles consistent à assurer la sécurité, calmer la détresse, favoriser l'auto-efficacité et encourager la connectivité sociale. Ces interventions simples réduisent de 30% le risque de TSPT [14].
Pour les professionnels à risque, des programmes de résilience préventive se développent. Ils incluent formation au stress, techniques de gestion émotionnelle, et soutien par les pairs. Ces programmes réduisent l'incidence du TSPT de 25% chez les forces de l'ordre et les soignants [10].
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024 des recommandations actualisées sur la prise en charge des troubles liés aux traumatismes. Ces guidelines privilégient une approche multidisciplinaire associant psychiatres, psychologues et médecins généralistes [1].
Les thérapies cognitivo-comportementales et l'EMDR sont recommandées en première intention, avec un niveau de preuve élevé. La HAS préconise un accès facilité à ces thérapies spécialisées, avec un objectif de délai maximal de quatre semaines entre la demande et le premier rendez-vous [1].
Concernant les traitements médicamenteux, les ISRS restent les molécules de première ligne. La HAS recommande une durée minimale de traitement de 12 mois après rémission des symptômes, pour prévenir les rechutes [1].
Le programme pluriannuel 2025-2030 prévoit la création de centres spécialisés dans chaque région, l'amélioration de la formation des professionnels, et le développement de la télémédecine pour les zones sous-dotées. Un accent particulier est mis sur la prise en charge des enfants et adolescents [1].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations accompagnent les personnes souffrant de troubles liés aux traumatismes en France. L'Association française du trouble de stress post-traumatique (AFTSPT) propose soutien, information et groupes de parole dans toute la France.
La Fédération française de psychiatrie met à disposition un annuaire des professionnels spécialisés dans le trauma. Leur site web propose également des ressources éducatives pour patients et familles, régulièrement mises à jour.
Pour les professionnels exposés, des structures spécialisées existent : cellules d'aide psychologique pour les forces de l'ordre, services de santé au travail renforcés pour les soignants, et programmes d'accompagnement pour les pompiers et secouristes.
Les plateformes numériques se développent également. Des applications mobiles proposent des exercices de relaxation, des techniques de gestion du stress, et même des consultations à distance avec des thérapeutes spécialisés. Certaines sont remboursées par l'Assurance maladie depuis 2024.
Nos Conseils Pratiques
Face aux symptômes de TSPT, quelques stratégies simples peuvent vous aider au quotidien. Établissez une routine de sommeil régulière : couchez-vous et levez-vous à heures fixes, évitez les écrans avant le coucher, et créez un environnement propice au repos.
Pratiquez des techniques de relaxation quotidiennement. La respiration profonde, la méditation de pleine conscience ou la relaxation musculaire progressive peuvent réduire l'anxiété. Même cinq minutes par jour peuvent faire la différence.
Maintenez une activité physique régulière. L'exercice libère des endorphines naturelles et aide à réguler le stress. Commencez doucement : une marche de 20 minutes peut suffire au début. L'important est la régularité, pas l'intensité.
Évitez l'alcool et les substances psychoactives, même si elles semblent temporairement soulager vos symptômes. Elles aggravent l'anxiété à long terme et interfèrent avec les traitements. Privilégiez une alimentation équilibrée riche en oméga-3 et magnésium, bénéfiques pour le système nerveux.
Quand Consulter un Médecin ?
Consultez rapidement si vous présentez des symptômes persistants plus de quatre semaines après un événement traumatisant. N'attendez pas que les symptômes s'aggravent : plus la prise en charge est précoce, meilleur est le pronostic [14,15].
Certains signaux d'alarme nécessitent une consultation en urgence : idées suicidaires, consommation excessive d'alcool ou de drogues, isolement social complet, ou incapacité totale à fonctionner au quotidien. Dans ces cas, n'hésitez pas à vous rendre aux urgences ou à contacter le 3114 (numéro national de prévention du suicide).
Votre médecin généraliste peut être votre premier interlocuteur. Il évaluera vos symptômes et vous orientera si nécessaire vers un psychiatre ou un psychologue spécialisé dans le trauma. Cette orientation est souvent nécessaire pour bénéficier de thérapies spécialisées comme l'EMDR.
Pour les enfants et adolescents, soyez particulièrement vigilant aux changements de comportement : troubles du sommeil, régression, difficultés scolaires soudaines, ou comportements agressifs. Les symptômes peuvent être différents de ceux des adultes [12].
Questions Fréquentes
Le TSPT peut-il guérir complètement ?
Oui, avec un traitement adapté, une guérison complète est possible chez 60-70% des patients. Même dans les cas chroniques, des améliorations significatives restent possibles.
Combien de temps dure un traitement ?
La durée varie selon les patients. Les thérapies comme l'EMDR montrent souvent des résultats en 8-12 séances. Les traitements médicamenteux nécessitent généralement 12-18 mois.
Peut-on travailler avec un TSPT ?
Beaucoup de patients continuent à travailler avec des aménagements. La reconnaissance en maladie professionnelle est possible dans certains cas.
Les proches peuvent-ils développer un TSPT ?
Oui, on parle de traumatisme vicariant. Les proches de victimes peuvent développer des symptômes similaires, particulièrement s'ils ont été témoins de l'événement.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Programme pluriannuel « santé mentale et psychiatrie. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] Troubles du stress post-traumatique. www.inserm.frLien
- [3] Les nouvelles voies pour traiter les troubles de stress post-traumatique. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] 2024. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [5] Bionomics Initiates AFFIRM-1, a Phase 3 Clinical Trial with BNC210Lien
- [6] What's new in psychiatry - UpToDate. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [7] Habiletés de prévision affective et expérience émotionnelle dans le trouble de stress post-traumatiqueLien
- [8] 10 films pour comprendre le psychotrauma. Des traumatismes aux troubles stress post-traumatiquesLien
- [9] La TCD adaptée au traitement du trouble de stress post-traumatique (TSPT)Lien
- [10] Les modèles animaux du traumatisme et du trouble de stress post-traumatiqueLien
- [11] Efficacité des programmes résidentiels et externes pour le traitement des traumatismes liés au stress opérationnel des vétéransLien
- [12] Traumatisme, trouble de stress post-traumatique et psychose: à propos d'un casLien
- [13] Le trouble de stress post traumatique (TSPT) chez l'enfant: propriétés cliniques et prise en chargeLien
- [14] Prévalence et facteurs prédicteurs des troubles post-traumatiques chez les accidentés de la voie publiqueLien
- [15] Trouble de stress post-traumatique (TSPT). www.msdmanuals.comLien
- [16] Trouble de stress post-traumatique. www.msdmanuals.comLien
Publications scientifiques
- Habiletés de prévision affective et expérience émotionnelle dans le trouble de stress post-traumatique (2023)[PDF]
- Des traumatismes aux troubles stress post-traumatiques; d'une vision processuelle à la psychopathologisation. Regards métapsychologiques (2023)
- Chapitre 19. La TCD adaptée au traitement du trouble de stress post-traumatique (TSPT) (2024)
- Les modèles animaux du traumatisme et du trouble de stress post-traumatique (2023)1 citations
- [LIVRE][B] Efficacité des programmes résidentiels et externes pour le traitement des traumatismes liés au stress opérationnel des vétérans: rapport d'ETMIS-SS (2023)[PDF]
Ressources web
- Trouble de stress post-traumatique (TSPT) (msdmanuals.com)
Diagnostic du TSPT · La personne a été exposée directement ou indirectement à un événement traumatique. · Les symptômes persistent depuis 1 mois ou plus. · Les ...
- Troubles du stress post-traumatique (inserm.fr)
23 nov. 2020 — Le développement de signes d'une activité neurovégétative : hypervigilance, irritabilité, difficultés de concentration, troubles du sommeil…
- Trouble de stress post-traumatique (msdmanuals.com)
18 déc. 2024 — Diagnostic du trouble de stress post-traumatique · Avoir des souvenirs récurrents, involontaires, intrusifs, perturbants · Avoir des rêves ...
- Trouble de stress post-traumatique (psycom.org)
7 avr. 2025 — des troubles psychosomatiques avec des symptômes physiques persistants comme la douleur, les maux de tête ou la fatigue; des pensées suicidaires ...
- Syndrome de stress post-traumatique (SSPT) (inicea.fr)
Le diagnostic d'un trouble de stress post-traumatique chronique est posé lorsque les symptômes durent plus de six mois. Un grand nombre de personnes vivent avec ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
