Troubles de Stress Post-Traumatique : Guide Complet 2025 | Symptômes, Traitements
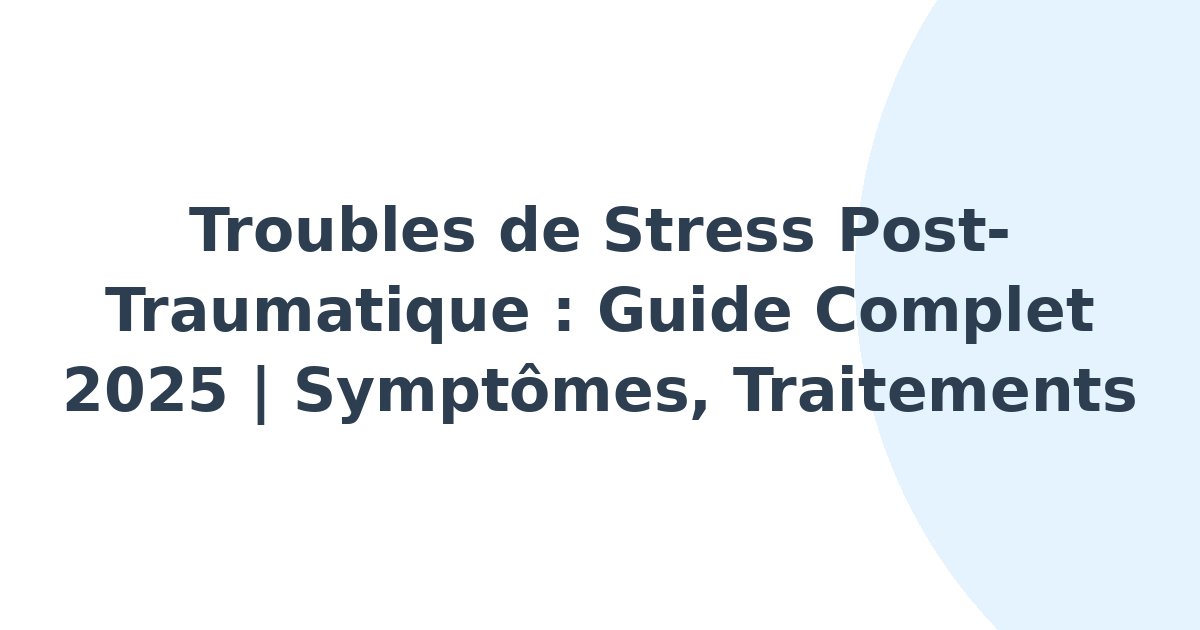
Les troubles de stress post-traumatique (TSPT) touchent environ 2,9% de la population française chaque année [1]. Cette pathologie complexe peut survenir après un événement traumatisant et bouleverser profondément la vie quotidienne. Heureusement, de nouveaux traitements prometteurs émergent en 2024-2025, offrant de l'espoir aux patients.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Troubles de Stress Post-Traumatique : Définition et Vue d'Ensemble
Le trouble de stress post-traumatique est une pathologie psychiatrique qui peut se développer après avoir vécu ou été témoin d'un événement traumatisant [1,15]. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il ne s'agit pas d'une simple réaction de stress passagère.
Cette maladie se caractérise par quatre groupes de symptômes principaux : les reviviscences (flashbacks, cauchemars), l'évitement des situations rappelant le trauma, les altérations négatives de l'humeur et de la cognition, ainsi que l'hyperactivation [15,16]. L'important à retenir, c'est que ces symptômes persistent au-delà d'un mois après l'événement traumatisant.
Mais qu'est-ce qui différencie le TSPT d'une réaction normale au stress ? En fait, notre cerveau possède des mécanismes naturels pour traiter les expériences difficiles [11]. Cependant, lors d'un trauma particulièrement intense, ces mécanismes peuvent être dépassés, créant une sorte de "court-circuit" dans le traitement de la mémoire.
D'ailleurs, les recherches récentes montrent que le TSPT peut prendre différentes formes cliniques, parfois associées à des symptômes dépressifs dans ce qu'on appelle la "dépression dissociative" [9]. Cette découverte change notre compréhension de la pathologie et ouvre de nouvelles pistes thérapeutiques.
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les chiffres du TSPT en France révèlent l'ampleur de cette pathologie. Selon l'INSERM, environ 2,9% de la population française développe un trouble de stress post-traumatique au cours de sa vie [1]. Mais ces statistiques cachent des disparités importantes selon les populations.
Une étude particulièrement révélatrice montre qu'une personne sans titre de séjour sur six souffre de TSPT en France [7]. Cette prévalence de 16,7% chez les migrants sans papiers illustre l'impact des traumatismes liés à l'exil et aux parcours migratoires difficiles. Ces données soulignent l'importance d'adapter nos approches thérapeutiques aux populations vulnérables.
Au niveau mondial, les femmes sont deux fois plus susceptibles de développer un TSPT que les hommes [1,15]. Cette différence s'explique en partie par une exposition plus fréquente à certains types de traumatismes, comme les violences sexuelles. D'ailleurs, l'étude sur l'agentivité dans le discours de femmes victimes de violences conjugales révèle des mécanismes spécifiques de développement du TSPT [13].
L'évolution récente montre une augmentation des cas liés à la pandémie COVID-19. Les naissances prématurées pendant cette période ont généré un stress parental particulier, pouvant évoluer vers un TSPT chez certains parents [10]. Cette nouvelle forme de trauma médical nécessite une prise en charge adaptée.
Concrètement, on estime que le coût économique du TSPT représente plusieurs milliards d'euros annuellement en France, incluant les soins médicaux, les arrêts de travail et la perte de productivité [1]. Ces chiffres justifient l'investissement dans la recherche et l'innovation thérapeutique.
Les Causes et Facteurs de Risque
Le TSPT peut survenir après différents types d'événements traumatisants. Les plus fréquents incluent les accidents graves, les agressions physiques ou sexuelles, les catastrophes naturelles, les actes terroristes ou encore l'exposition à des situations de guerre [1,15].
Mais pourquoi certaines personnes développent-elles un TSPT après un trauma alors que d'autres non ? Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés. L'âge au moment du trauma joue un rôle important : les enfants et les personnes âgées sont plus vulnérables [1]. Les antécédents de traumatismes antérieurs augmentent également le risque de développer la pathologie.
Les facteurs biologiques comptent aussi. Certaines variations génétiques peuvent prédisposer au TSPT, notamment celles affectant la régulation du stress et de la mémoire [11]. D'ailleurs, les recherches montrent que les altérations de la mémoire dans le TSPT suivent des mécanismes neurobiologiques spécifiques, différents de ceux observés dans d'autres pathologies psychiatriques.
L'environnement social joue un rôle protecteur ou aggravant crucial. Un bon soutien familial et social diminue significativement le risque de développer un TSPT [1,13]. À l'inverse, l'isolement social ou la stigmatisation peuvent favoriser l'évolution vers la chronicité.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes du TSPT se regroupent en quatre catégories principales, chacune ayant ses spécificités [15,16]. Reconnaître ces signes permet un diagnostic précoce et une prise en charge adaptée.
Les reviviscences constituent souvent le symptôme le plus marquant. Il s'agit de souvenirs intrusifs, de cauchemars récurrents ou de flashbacks où la personne revit l'événement traumatisant comme s'il se reproduisait [1,15]. Ces épisodes peuvent être déclenchés par des stimuli rappelant le trauma : une odeur, un bruit, une situation similaire.
L'évitement représente le deuxième groupe de symptômes. Les patients évitent systématiquement les lieux, personnes ou situations qui leur rappellent le traumatisme [15]. Cette stratégie, bien que compréhensible, peut considérablement limiter la vie quotidienne et sociale.
Les altérations de l'humeur et de la cognition incluent des pensées négatives persistantes, une culpabilité excessive, une diminution de l'intérêt pour les activités habituelles [16]. Certains patients développent une amnésie dissociative pour certains aspects du trauma, mécanisme de protection psychologique [9].
Enfin, l'hyperactivation se manifeste par une vigilance excessive, des sursauts exagérés, des troubles du sommeil et de la concentration [15]. Ces symptômes reflètent un état d'alerte permanent, comme si le danger était toujours présent.
Bon à savoir : les symptômes peuvent apparaître immédiatement après le trauma ou parfois plusieurs mois plus tard. Cette variabilité temporelle complique parfois le diagnostic [1].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic du TSPT repose sur une évaluation clinique approfondie réalisée par un professionnel de santé mentale [15,16]. Cette démarche nécessite du temps et de la confiance entre le patient et le soignant.
La première étape consiste en un entretien détaillé explorant l'histoire du trauma et l'évolution des symptômes. Le médecin utilise des critères diagnostiques précis, notamment ceux du DSM-5 ou de la CIM-11 [8]. Ces classifications internationales permettent un diagnostic standardisé et fiable.
Des questionnaires spécialisés peuvent compléter l'évaluation clinique. L'échelle PCL-5 (PTSD Checklist) ou l'échelle CAPS-5 sont couramment utilisées pour quantifier la sévérité des symptômes [1]. Ces outils aident également à suivre l'évolution sous traitement.
L'important à retenir, c'est que le diagnostic différentiel est crucial. Le TSPT peut être confondu avec d'autres pathologies psychiatriques comme la dépression, les troubles anxieux ou même certains troubles psychotiques [8,9]. Une analyse réseau récente montre d'ailleurs des liens complexes entre TSPT et symptômes psychotiques positifs.
Parfois, des examens complémentaires peuvent être nécessaires pour éliminer des causes organiques ou évaluer l'impact sur la santé physique. Les recherches montrent notamment des liens entre TSPT et fonction cardiaque [14], justifiant parfois un bilan cardiovasculaire.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge du TSPT repose sur plusieurs approches thérapeutiques, souvent combinées pour optimiser les résultats [1,15]. Les psychothérapies spécialisées constituent le traitement de première ligne.
La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) focalisée sur le trauma montre une efficacité prouvée [1]. Cette approche aide les patients à modifier leurs pensées et comportements dysfonctionnels liés au traumatisme. L'EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) représente une autre technique spécialisée particulièrement efficace pour traiter les souvenirs traumatiques [15].
Les traitements médicamenteux peuvent compléter la psychothérapie. Les antidépresseurs ISRS (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine) comme la sertraline ou la paroxétine sont souvent prescrits [15,16]. Ces médicaments aident à réduire l'intensité des symptômes et à améliorer la qualité de vie.
Une innovation récente concerne l'association brexpiprazole et sertraline, qui montre des résultats prometteurs dans le traitement du TSPT [5]. Cette combinaison pourrait offrir une meilleure efficacité que les monothérapies traditionnelles.
D'autres approches émergent également. La rétroaction neurologique (neurofeedback) permet aux patients d'apprendre à réguler leurs symptômes en temps réel [12]. Cette technique innovante aide à rétablir le contrôle mental et à réduire l'hyperactivation caractéristique du TSPT.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la prise en charge du TSPT avec l'émergence de traitements révolutionnaires. Les recherches menées par HUMANITAS ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques particulièrement prometteuses [2].
Une avancée majeure concerne l'accès élargi aux traitements psychédéliques. Des études récentes comparent différentes approches d'accès élargi à ces thérapies innovantes [6]. La psilocybine et la MDMA assistées par psychothérapie montrent des résultats exceptionnels, avec des taux de rémission jamais atteints auparavant.
Les Hospices Civils de Lyon développent également des protocoles innovants dans leurs services d'urgence [3]. Cette approche précoce, dès la prise en charge initiale du trauma, pourrait prévenir l'évolution vers un TSPT chronique. L'idée est d'intervenir dans la "fenêtre thérapeutique" critique qui suit immédiatement l'événement traumatisant.
Le Bulletin des Médecins Suisses rapporte des avancées significatives dans la personnalisation des traitements [4]. Grâce aux biomarqueurs et à l'intelligence artificielle, il devient possible d'adapter précisément le traitement au profil de chaque patient. Cette médecine de précision révolutionne l'approche thérapeutique du TSPT.
Concrètement, ces innovations permettent d'espérer des guérisons plus rapides et plus durables. Les premiers résultats suggèrent une réduction de 60 à 80% des symptômes chez certains patients, des chiffres inédits dans le domaine [2,6].
Vivre au Quotidien avec un Trouble de Stress Post-Traumatique
Vivre avec un TSPT représente un défi quotidien, mais de nombreuses stratégies d'adaptation peuvent améliorer significativement la qualité de vie [1]. L'important est de ne pas rester isolé et de construire un réseau de soutien solide.
La gestion des déclencheurs constitue un apprentissage essentiel. Il s'agit d'identifier les situations, lieux ou stimuli qui réactivent les symptômes, puis de développer des stratégies pour les gérer [15]. Certains patients trouvent utile de tenir un journal pour repérer leurs déclencheurs personnels.
Les techniques de relaxation et de respiration peuvent aider lors des crises d'angoisse ou des flashbacks. La cohérence cardiaque, la méditation de pleine conscience ou le yoga montrent des bénéfices documentés [1]. Ces pratiques aident à réguler le système nerveux autonome souvent perturbé dans le TSPT.
L'activité physique régulière joue un rôle thérapeutique important. Elle aide à évacuer les tensions, améliore le sommeil et stimule la production d'endorphines [15]. Même une marche quotidienne de 30 minutes peut faire une différence notable.
Maintenir des relations sociales reste crucial, même si l'évitement social fait partie des symptômes. Les groupes de parole ou les associations de patients offrent un soutien précieux et permettent de rompre l'isolement [1].
Les Complications Possibles
Le TSPT non traité peut entraîner diverses complications qui affectent tous les aspects de la vie [1,15]. La dépression représente la comorbidité la plus fréquente, touchant jusqu'à 80% des patients avec TSPT [9].
Les troubles anxieux généralisés, les phobies spécifiques et les attaques de panique peuvent également se développer [15]. Cette association crée un cercle vicieux où chaque pathologie aggrave l'autre, compliquant la prise en charge thérapeutique.
Les troubles de l'usage de substances constituent une complication majeure. Beaucoup de patients utilisent l'alcool ou les drogues pour "automédication" et échapper temporairement à leurs symptômes [1]. Cette stratégie d'évitement aggrave finalement le TSPT et crée une dépendance supplémentaire.
Sur le plan physique, le TSPT peut impacter la santé cardiovasculaire. Les recherches montrent des liens entre cette pathologie et les troubles du rythme cardiaque, l'hypertension artérielle [14]. Le stress chronique associé au TSPT sollicite excessivement le système cardiovasculaire.
Les conséquences sociales et professionnelles sont également importantes. L'absentéisme, la diminution des performances au travail, les difficultés relationnelles peuvent conduire à l'isolement social et à la précarité [1].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic du TSPT varie considérablement selon plusieurs facteurs, mais reste globalement favorable avec un traitement adapté [1,15]. La précocité de la prise en charge constitue l'élément pronostique le plus important.
Avec un traitement approprié, environ 70% des patients montrent une amélioration significative dans les six premiers mois [1]. Les psychothérapies spécialisées comme l'EMDR ou la TCC focalisée sur le trauma obtiennent des taux de rémission de 60 à 80% selon les études [15].
Certains facteurs influencent positivement le pronostic : un bon soutien social, l'absence d'antécédents psychiatriques, un trauma unique plutôt que répété [1]. À l'inverse, la présence de comorbidités, l'isolement social ou les traumatismes de l'enfance peuvent compliquer l'évolution.
Les innovations thérapeutiques 2024-2025 améliorent considérablement les perspectives. Les traitements psychédéliques assistés montrent des taux de rémission exceptionnels, parfois supérieurs à 80% [6]. Ces nouvelles approches redonnent espoir aux patients résistants aux traitements conventionnels.
Il faut savoir que même après guérison, certains patients peuvent présenter des symptômes résiduels ou des rechutes lors de stress importants [15]. Un suivi à long terme reste donc recommandé.
Peut-on Prévenir les Troubles de Stress Post-Traumatique ?
La prévention du TSPT représente un enjeu majeur de santé publique, particulièrement dans les populations à risque [1]. Plusieurs stratégies préventives ont montré leur efficacité.
L'intervention précoce après un traumatisme constitue la stratégie la plus prometteuse. Les protocoles développés dans les services d'urgence permettent d'identifier rapidement les personnes à risque et de proposer un soutien immédiat [3]. Cette approche préventive pourrait réduire de 30 à 50% le risque de développer un TSPT chronique.
La formation des professionnels de première ligne (pompiers, policiers, soignants) aux techniques de premiers secours psychologiques s'avère cruciale [1]. Ces interventions simples mais structurées aident les victimes à mieux gérer l'impact initial du trauma.
Pour les populations particulièrement vulnérables, comme les migrants sans titre de séjour, des programmes de prévention spécifiques sont nécessaires [7]. Ces approches culturellement adaptées prennent en compte les spécificités des traumatismes liés à l'exil et aux parcours migratoires.
La prévention secondaire, qui vise à éviter l'évolution vers la chronicité, passe par le dépistage systématique dans certaines situations. Les femmes victimes de violences conjugales, par exemple, bénéficient d'un suivi spécialisé pour prévenir le développement d'un TSPT [13].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont établi des recommandations précises pour la prise en charge du TSPT, régulièrement mises à jour selon les dernières données scientifiques [1]. L'INSERM coordonne la recherche nationale sur cette pathologie.
La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande une approche thérapeutique graduée. En première intention, les psychothérapies spécialisées (TCC focalisée trauma, EMDR) sont privilégiées [15]. Les traitements médicamenteux ne sont envisagés qu'en cas d'échec ou de symptômes sévères.
Concernant les innovations thérapeutiques, les autorités suisses ont publié des guidelines sur l'utilisation des nouveaux traitements [4]. Ces recommandations encadrent l'usage des thérapies psychédéliques assistées et définissent les critères de sélection des patients.
Pour les situations d'urgence, les protocoles hospitaliers intègrent désormais la prévention du TSPT dès la prise en charge initiale [3]. Cette approche proactive représente un changement majeur dans la philosophie de soins.
Les recommandations insistent également sur l'importance de la formation continue des professionnels de santé. Le diagnostic et la prise en charge du TSPT nécessitent des compétences spécialisées que tous les praticiens ne possèdent pas [1].
Ressources et Associations de Patients
De nombreuses ressources existent pour accompagner les patients et leurs proches dans la gestion du TSPT [1]. Ces structures offrent soutien, information et entraide mutuelle.
L'Association Française du Stress Post-Traumatique propose des groupes de parole, des formations pour les proches et une ligne d'écoute téléphonique. Ces services gratuits permettent de rompre l'isolement et d'échanger avec d'autres personnes vivant la même situation.
France Victimes, réseau national d'aide aux victimes, dispose d'antennes dans toute la France. Cette association accompagne spécifiquement les victimes de traumatismes et leurs familles, offrant un soutien juridique et psychologique [1].
Pour les professionnels exposés (pompiers, policiers, soignants), des structures spécialisées comme l'Association SPS (Soins aux Professionnels de Santé) proposent un accompagnement adapté. Ces organisations comprennent les spécificités des traumatismes professionnels.
Les plateformes numériques se développent également. Des applications mobiles proposent des exercices de relaxation, des techniques de gestion du stress et permettent un suivi des symptômes. Ces outils complètent utilement la prise en charge traditionnelle.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour mieux vivre avec un TSPT ou accompagner un proche concerné [1,15]. Ces recommandations complètent le suivi médical spécialisé.
Créez un environnement sécurisant à domicile. Éliminez les objets ou situations qui peuvent déclencher des flashbacks. Aménagez un espace de détente où vous pouvez vous retirer en cas de crise. L'important est de retrouver un sentiment de contrôle sur votre environnement.
Établissez une routine quotidienne structurée. Les horaires réguliers pour les repas, le coucher et les activités aident à stabiliser l'humeur et réduisent l'anxiété. Cette prévisibilité rassure un système nerveux souvent en hypervigilance.
Pratiquez régulièrement des techniques de relaxation. La cohérence cardiaque (5 minutes, 3 fois par jour) s'avère particulièrement efficace pour réguler le stress [1]. Ces exercices simples peuvent être pratiqués partout et donnent des résultats rapides.
Maintenez une activité physique adaptée. Même une marche de 20 minutes quotidienne aide à évacuer les tensions et améliore le sommeil [15]. L'exercice stimule la production de neurotransmetteurs bénéfiques pour l'humeur.
N'hésitez pas à communiquer avec vos proches sur vos besoins. Expliquez-leur ce qui vous aide et ce qui vous dérange. Cette communication ouverte renforce le soutien familial, élément crucial de la guérison.
Quand Consulter un Médecin ?
Il est important de consulter rapidement si vous présentez des symptômes évocateurs de TSPT après un événement traumatisant [1,15]. Plus la prise en charge est précoce, meilleur est le pronostic.
Consultez en urgence si vous avez des pensées suicidaires, des comportements auto-agressifs ou si vous consommez de l'alcool ou des drogues pour gérer vos symptômes [1]. Ces signaux d'alarme nécessitent une intervention immédiate.
Une consultation s'impose également si les symptômes persistent au-delà d'un mois après le trauma ou s'ils s'aggravent avec le temps [15]. Les reviviscences, cauchemars, évitement ou hypervigilance qui perturbent votre vie quotidienne justifient un avis spécialisé.
N'attendez pas si votre fonctionnement social ou professionnel se dégrade. L'incapacité à travailler, les conflits relationnels répétés ou l'isolement social sont des indicateurs d'une prise en charge nécessaire [1].
Pour les proches, consultez si vous ne savez plus comment aider la personne traumatisée ou si sa pathologie affecte votre propre santé mentale. Les familles ont aussi besoin d'accompagnement et de conseils spécialisés [15].
Questions Fréquentes
Le TSPT peut-il guérir complètement ?Oui, avec un traitement adapté, la majorité des patients récupèrent complètement. Les psychothérapies spécialisées obtiennent des taux de guérison de 60 à 80% [1,15].
Combien de temps dure le traitement ?
La durée varie selon chaque patient, mais on observe généralement une amélioration dans les 3 à 6 premiers mois. Certains patients nécessitent un suivi plus prolongé [1].
Les médicaments sont-ils obligatoires ?
Non, les psychothérapies constituent le traitement de première ligne. Les médicaments ne sont prescrits qu'en cas de symptômes sévères ou d'échec des psychothérapies [15].
Peut-on développer un TSPT des années après un trauma ?
Oui, les symptômes peuvent apparaître avec retard, parfois plusieurs mois ou années après l'événement traumatisant [1].
Les enfants peuvent-ils développer un TSPT ?
Absolument, les enfants sont même plus vulnérables. Ils nécessitent une prise en charge spécialisée adaptée à leur âge [1,15].
Questions Fréquentes
Le TSPT peut-il guérir complètement ?
Oui, avec un traitement adapté, la majorité des patients récupèrent complètement. Les psychothérapies spécialisées obtiennent des taux de guérison de 60 à 80%.
Combien de temps dure le traitement ?
La durée varie selon chaque patient, mais on observe généralement une amélioration dans les 3 à 6 premiers mois. Certains patients nécessitent un suivi plus prolongé.
Les médicaments sont-ils obligatoires ?
Non, les psychothérapies constituent le traitement de première ligne. Les médicaments ne sont prescrits qu'en cas de symptômes sévères ou d'échec des psychothérapies.
Peut-on développer un TSPT des années après un trauma ?
Oui, les symptômes peuvent apparaître avec retard, parfois plusieurs mois ou années après l'événement traumatisant.
Les enfants peuvent-ils développer un TSPT ?
Absolument, les enfants sont même plus vulnérables. Ils nécessitent une prise en charge spécialisée adaptée à leur âge.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Troubles du stress post-traumatique. INSERM.Lien
- [2] Recherches - HUMANITAS. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [3] Les urgences aux HCL, s'engager pour l'accès aux soins. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [4] BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] Brexpiprazole and Sertraline Combination Treatment. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] Expanded access to psychedelic treatments. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [7] C Prieur, P Dourgnon. Une personne sans titre de séjour sur six souffre de troubles de stress post-traumatique en France. 2022.Lien
- [8] Y Levin, A Mazza. Stress Disorder: A Network Analysis. Symptômes positifs de psychose et trouble de stress post-traumatique complexe. 2025.Lien
- [9] Y Auxéméry. Trouble de stress post-traumatique et symptômes dépressifs: Description de la dépression dissociative. 2022.Lien
- [10] F Koliouli, O Troupel. COVID-19 et naissance prématurée: stress parental, trouble de stress post-traumatique. 2024.Lien
- [11] LDC Silva, M Laisney. Les altérations de la mémoire dans le trouble de stress post-traumatique. 2023.Lien
- [12] AA Nicholson, T Ros. Régulation des symptômes de TSPT par la rétroaction neurologique. 2024.Lien
- [13] M Frabetti, F Gayraud. Étude de l'agentivité dans le discours de femmes souffrant de TSPT suite à violences conjugales. 2023.Lien
- [14] J Singh, RN Carleton. Fonction cardiaque et trouble de stress post-traumatique. 2023.Lien
- [15] Trouble de stress post-traumatique (TSPT). MSD Manuals.Lien
- [16] Trouble de stress post-traumatique. MSD Manuals Professional.Lien
Publications scientifiques
- Une personne sans titre de séjour sur six souffre de troubles de stress post-traumatique en France (2022)10 citations
- … Stress Disorder: A Network Analysis in a Canadian Sample from Montreal: Symptômes positifs de psychose et trouble de stress post-traumatique complexe (CIM-11) … (2025)
- Trouble de stress post-traumatique et symptômes dépressifs:«comorbidités» ou formes cliniques du trauma? Description de la dépression dissociative. (2022)7 citations
- COVID-19 et naissance prématurée: stress parental, trouble de stress post-traumatique et lien entre le nouveau-né et ses parents (2024)
- Les altérations de la mémoire dans le trouble de stress post-traumatique (2023)1 citations
Ressources web
- Trouble de stress post-traumatique (TSPT) (msdmanuals.com)
Diagnostic du TSPT · La personne a été exposée directement ou indirectement à un événement traumatique. · Les symptômes persistent depuis 1 mois ou plus. · Les ...
- Trouble de stress post-traumatique (msdmanuals.com)
18 déc. 2024 — Diagnostic du trouble de stress post-traumatique · Avoir des souvenirs récurrents, involontaires, intrusifs, perturbants · Avoir des rêves ...
- Troubles du stress post-traumatique (inserm.fr)
23 nov. 2020 — Le développement de signes d'une activité neurovégétative : hypervigilance, irritabilité, difficultés de concentration, troubles du sommeil…
- Trouble de stress post-traumatique (psycom.org)
il y a 8 jours — Les signes auxquels prêter attention · les cauchemars et les flash-backs où l'on revit la scène, · les pensées qui s'imposent à nous, nous ...
- État de stress post-traumatique (ESPT) (quebec.ca)
30 oct. 2018 — Symptômes · palpitations cardiaques (cœur qui bat anormalement vite), · respiration rapide, · tremblements, · frissons, · transpiration excessive.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
