Troubles de Stress Traumatique : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
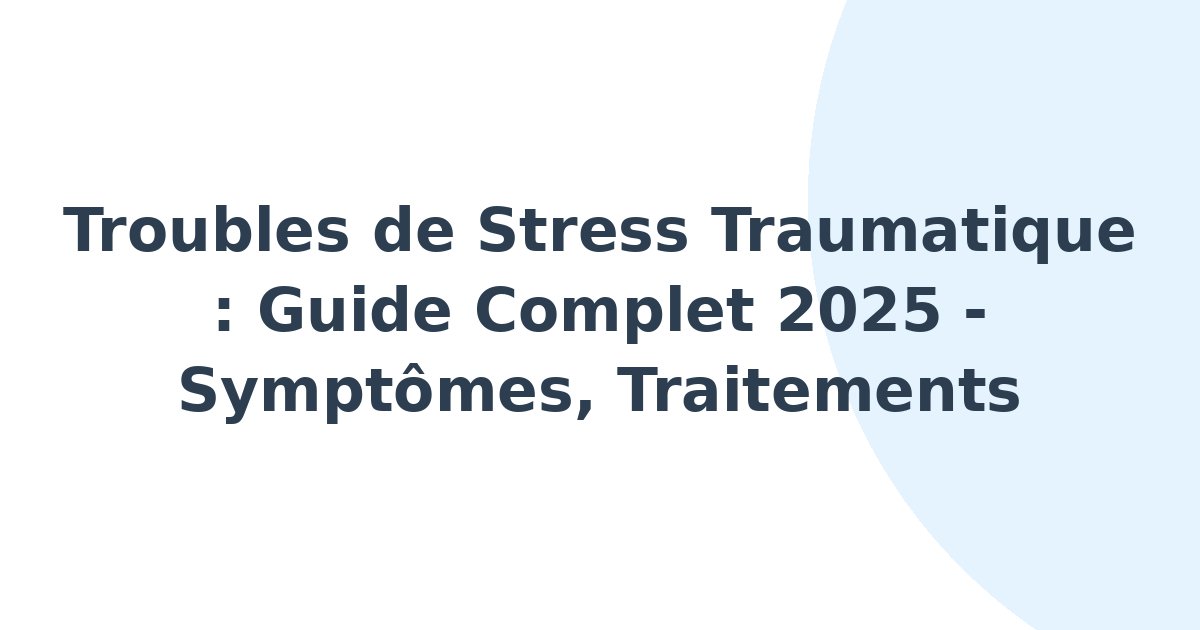
Les troubles de stress traumatique touchent environ 2,9% de la population française selon l'INSERM [1]. Ces pathologies complexes surviennent après un événement traumatisant et peuvent bouleverser durablement la vie quotidienne. Heureusement, de nouveaux traitements émergent en 2024-2025, offrant de l'espoir aux patients. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur ces troubles, leurs symptômes et les solutions thérapeutiques disponibles.
Téléconsultation et Troubles de stress traumatique
Partiellement adaptée à la téléconsultationLes troubles de stress traumatique peuvent bénéficier d'une évaluation initiale à distance pour l'analyse des symptômes et l'orientation thérapeutique. Cependant, l'évaluation complète nécessite souvent un examen clinique approfondi et une prise en charge spécialisée en santé mentale pour établir un diagnostic précis et adapter le traitement.
Ce qui peut être évalué à distance
Évaluation des symptômes psychotraumatiques (reviviscences, évitement, hypervigilance), analyse de l'impact fonctionnel sur le quotidien, évaluation du contexte traumatique et des facteurs déclenchants, orientation diagnostique initiale, suivi de l'évolution des symptômes sous traitement.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Évaluation psychiatrique complète pour diagnostic différentiel, recherche de comorbidités psychiatriques associées, mise en place de thérapies spécialisées (EMDR, thérapies cognitivo-comportementales), évaluation du risque suicidaire nécessitant un examen clinique direct.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Préparer votre téléconsultation
Pour que votre téléconsultation soit la plus efficace possible, préparez les éléments suivants :
- Symptômes et durée : Noter précisément les symptômes de reviviscences (cauchemars, flashbacks), les conduites d'évitement, les troubles du sommeil, l'hypervigilance, les troubles de la concentration, et depuis combien de temps ils sont présents depuis l'événement traumatique.
- Traitements en cours : Mentionner tous les traitements psychotropes en cours (antidépresseurs ISRS comme sertraline ou paroxétine, anxiolytiques, hypnotiques), les thérapies en cours, et tout traitement phytothérapique ou complémentaire.
- Antécédents médicaux pertinents : Antécédents de troubles psychiatriques (dépression, troubles anxieux), antécédents de traumatismes antérieurs, consommation d'alcool ou de substances, antécédents familiaux de troubles mentaux, contexte socio-familial.
- Examens récents disponibles : Bilans biologiques récents si des traitements psychotropes sont envisagés, comptes-rendus de consultations psychiatriques ou psychologiques antérieures, échelles d'évaluation du stress post-traumatique si déjà réalisées.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Première évaluation diagnostique approfondie nécessitant un examen psychiatrique complet, mise en place de thérapies spécialisées nécessitant une présence physique, évaluation de la sévérité des symptômes dissociatifs, ajustement thérapeutique complexe nécessitant un suivi rapproché.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Idées suicidaires avec plan ou moyens identifiés nécessitant une hospitalisation, épisodes dissociatifs sévères avec perte de contact avec la réalité, décompensation psychotique aiguë dans un contexte de stress post-traumatique.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Idées suicidaires avec plan précis ou tentative de suicide
- Épisodes dissociatifs sévères avec désorientation ou perte de contact avec la réalité
- Décompensation psychotique avec hallucinations ou délire
- Comportements auto-agressifs ou hétéro-agressifs incontrôlables
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Psychiatre — consultation en présentiel recommandée
Le psychiatre est le spécialiste le plus adapté pour le diagnostic et la prise en charge des troubles de stress traumatique. Une consultation en présentiel est généralement recommandée pour l'évaluation initiale complète et la mise en place du traitement adapté.

- Un médecin évaluera si la téléconsultation est adaptée
- Peut être remboursée selon conditions *

Troubles de Stress Traumatique : Définition et Vue d'Ensemble
Les troubles de stress traumatique regroupent plusieurs pathologies psychiatriques qui se développent suite à l'exposition à un événement traumatisant. Le plus connu est le trouble de stress post-traumatique (TSPT), mais cette famille comprend aussi le trouble de stress aigu et les troubles de l'adaptation [1,13].
Concrètement, ces troubles surviennent quand votre cerveau n'arrive pas à "digérer" un événement choquant. Imaginez votre esprit comme un ordinateur qui bugge après avoir reçu trop d'informations d'un coup. Les circuits normaux de traitement des émotions et des souvenirs se dérèglent [8].
Mais attention, il ne faut pas confondre stress normal et pathologie. Après un traumatisme, il est tout à fait normal de ressentir de l'anxiété, des cauchemars ou de la tristesse pendant quelques semaines. Le problème survient quand ces symptômes persistent au-delà d'un mois et perturbent significativement votre vie quotidienne [13,14].
D'ailleurs, les critères diagnostiques ont évolué. Depuis 2022, les experts distinguent mieux le TSPT simple du TSPT complexe, ce dernier touchant les personnes ayant subi des traumatismes répétés, souvent dans l'enfance [6,7].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, les chiffres sont préoccupants. L'INSERM estime que 2,9% de la population générale souffre de troubles de stress post-traumatique [1]. Cela représente environ 1,9 million de personnes ! Mais ce pourcentage grimpe drastiquement dans certaines populations vulnérables.
Une étude récente révèle qu'une personne sans titre de séjour sur six présente des symptômes de TSPT en France [5]. Cette prévalence de 16,7% illustre l'impact des parcours migratoires traumatisants. Les femmes sont deux fois plus touchées que les hommes, avec une prévalence de 3,6% contre 1,8% [1].
L'incidence annuelle - c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas chaque année - s'élève à environ 0,5% de la population. Cela signifie que 330 000 Français développent chaque année un trouble de stress traumatique [1]. Ces chiffres ont tendance à augmenter, notamment depuis la pandémie de COVID-19 [11].
Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne. L'Allemagne affiche des taux similaires (2,8%), tandis que les pays nordiques présentent des prévalences légèrement inférieures (2,1% en Suède). Les États-Unis, eux, atteignent 3,5%, probablement en raison d'une exposition plus importante à la violence [4].
Côté projections, les experts s'attendent à une hausse de 15 à 20% des cas d'ici 2030. Les facteurs explicatifs ? Vieillissement de la population, augmentation des catastrophes naturelles liées au changement climatique, et meilleure reconnaissance diagnostique [4]. Le coût pour l'Assurance Maladie est estimé à 2,3 milliards d'euros annuels, incluant soins directs et arrêts de travail.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les événements traumatisants à l'origine de ces troubles sont variés. En tête de liste : les accidents de la route (28% des cas), les agressions physiques ou sexuelles (24%), les catastrophes naturelles (18%) et les situations de guerre ou terrorisme (12%) [1,4].
Mais pourquoi certaines personnes développent-elles un TSPT après un traumatisme et d'autres non ? La réponse tient à plusieurs facteurs de risque. D'abord, votre histoire personnelle compte énormément. Si vous avez vécu des traumatismes dans l'enfance, vous êtes trois fois plus susceptible de développer un TSPT à l'âge adulte [4,6].
Ensuite, il y a des facteurs biologiques. Les femmes présentent un risque doublé, probablement en raison de différences hormonales et de structures cérébrales [1]. Certaines variations génétiques, notamment sur les gènes régulant le stress (comme FKBP5), augmentent aussi la vulnérabilité [4].
L'environnement social joue un rôle crucial. Un bon soutien familial et social divise par deux le risque de développer un TSPT. À l'inverse, l'isolement, la précarité ou les conflits familiaux majorent considérablement ce risque [5,9]. C'est pourquoi les populations migrantes sont particulièrement vulnérables.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes des troubles de stress traumatique s'organisent en quatre grandes catégories. Première catégorie : les reviviscences. Vous revivez l'événement traumatisant de manière involontaire, que ce soit par des flashbacks en pleine journée, des cauchemars récurrents ou des réactions physiques intenses face à des rappels du trauma [13,14].
Deuxième groupe : l'évitement. Vous fuyez systématiquement tout ce qui pourrait vous rappeler l'événement. Cela peut aller de l'évitement de certains lieux à celui de certaines personnes, voire de certaines pensées ou émotions [13]. Une patiente m'expliquait récemment qu'elle ne pouvait plus emprunter l'autoroute depuis son accident.
Troisième catégorie : les altérations cognitives et émotionnelles. Votre vision du monde et de vous-même se noircit. Vous développez des pensées négatives persistantes, vous vous sentez détaché des autres, incapable de ressentir des émotions positives [8,14]. Les troubles de la mémoire sont fréquents, particulièrement pour les détails de l'événement traumatisant [8].
Enfin, quatrième groupe : l'hyperactivation. Votre système nerveux reste en alerte permanente. Vous sursautez au moindre bruit, vous avez des difficultés de concentration, des troubles du sommeil, parfois des comportements à risque ou de l'agressivité [13,14]. Cette hypervigilance constante est épuisante.
Bon à savoir : ces symptômes doivent persister plus d'un mois pour évoquer un TSPT. S'ils durent moins longtemps, on parle plutôt de trouble de stress aigu, qui peut évoluer vers un TSPT ou se résoudre spontanément [14].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des troubles de stress traumatique repose avant tout sur un entretien clinique approfondi. Votre médecin ou psychiatre va d'abord identifier l'événement traumatisant, puis évaluer la présence et l'intensité des symptômes [13,14].
Plusieurs outils standardisés aident au diagnostic. L'échelle PCL-5 (PTSD CheckList for DSM-5) est la plus utilisée. Elle comprend 20 questions sur vos symptômes des dernières semaines. Un score supérieur à 33 suggère fortement un TSPT [14]. D'autres questionnaires comme l'IES-R (Impact of Event Scale-Revised) complètent l'évaluation.
L'examen clinique recherche aussi des comorbidités fréquentes. Environ 80% des patients avec TSPT présentent au moins un autre trouble psychiatrique : dépression (50% des cas), troubles anxieux (40%), addictions (30%) [6,14]. Cette intrication complique parfois le diagnostic.
Depuis 2022, les psychiatres distinguent mieux le TSPT complexe, qui associe aux symptômes classiques des difficultés de régulation émotionnelle, une image de soi négative et des problèmes relationnels [7]. Ce diagnostic nécessite une évaluation spécialisée plus poussée.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Heureusement, les troubles de stress traumatique se soignent ! Les psychothérapies constituent le traitement de première ligne. L'EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) fait référence avec un taux de succès de 70 à 80% [12]. Cette technique aide votre cerveau à "retraiter" le souvenir traumatisant grâce à des mouvements oculaires spécifiques.
La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) centrée sur le trauma obtient des résultats similaires. Elle vous aide à modifier les pensées négatives liées au traumatisme et à affronter progressivement les situations évitées [12]. L'exposition prolongée, une forme spécifique de TCC, donne d'excellents résultats.
Côté médicaments, les antidépresseurs ISRS (comme la sertraline ou la paroxétine) sont recommandés en première intention. Ils réduisent l'intensité des symptômes chez 60% des patients [14]. La prazosin, un médicament contre l'hypertension, s'avère efficace contre les cauchemars traumatiques.
Pour les cas résistants, d'autres approches existent. La thérapie narrative aide à reconstruire son histoire personnelle. Les thérapies corporelles (yoga thérapeutique, sophrologie) complètent utilement les traitements classiques [12]. L'important est de trouver l'approche qui vous convient.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans le traitement des troubles de stress traumatique. La thérapie assistée par midomafétamine fait sensation outre-Atlantique [2]. Cette molécule, proche de la MDMA, facilite le travail psychothérapeutique en réduisant la peur et en augmentant l'empathie. Les premiers essais montrent des résultats spectaculaires : 67% de rémission complète après seulement 3 séances !
Autre innovation prometteuse : Freespira, un dispositif de biofeedback respiratoire [3]. Cet appareil portable vous apprend à contrôler votre respiration pour réguler votre système nerveux. Les études 2024 montrent une réduction de 40% des symptômes d'hyperactivation après 4 semaines d'utilisation. L'avantage ? Vous pouvez l'utiliser chez vous, en complément de votre suivi médical.
La neurofeedback gagne aussi en popularité [10]. Cette technique vous permet de visualiser en temps réel l'activité de votre cerveau et d'apprendre à la modifier. Des études récentes montrent son efficacité pour restaurer le contrôle mental chez les patients avec TSPT. C'est particulièrement intéressant pour ceux qui ne répondent pas aux traitements classiques.
Côté recherche, 2025 voit émerger de nouvelles pistes. L'analyse en réseau des symptômes révèle des sous-types de TSPT jusqu'alors méconnus [7]. Cette approche pourrait permettre des traitements plus personnalisés. Les chercheurs s'intéressent aussi aux liens entre TSPT et symptômes psychotiques, ouvrant de nouvelles perspectives thérapeutiques [7].
Vivre au Quotidien avec les Troubles de Stress Traumatique
Vivre avec un trouble de stress traumatique demande des ajustements au quotidien. Mais rassurez-vous, de nombreuses stratégies peuvent vous aider à retrouver une qualité de vie satisfaisante. Premier conseil : établissez une routine stable. Votre cerveau traumatisé a besoin de prévisibilité pour se sentir en sécurité [9].
La gestion du stress devient cruciale. Apprenez des techniques de relaxation : respiration profonde, méditation de pleine conscience, relaxation musculaire progressive. Ces outils vous aideront à gérer les moments d'angoisse aiguë. Beaucoup de mes patients trouvent que 10 minutes de méditation quotidienne font une vraie différence.
N'hésitez pas à aménager votre environnement. Si certains bruits vous dérangent, utilisez des bouchons d'oreilles ou un casque anti-bruit. Si les foules vous angoissent, privilégiez les sorties aux heures creuses. Il ne s'agit pas d'évitement pathologique, mais d'adaptation intelligente [9].
Le soutien social est fondamental. Maintenez le contact avec vos proches, même si c'est difficile. Rejoignez un groupe de parole ou une association de patients. Partager votre expérience avec des personnes qui comprennent vraiment ce que vous vivez peut être libérateur. L'isolement aggrave toujours les symptômes [5,9].
Les Complications Possibles
Sans prise en charge, les troubles de stress traumatique peuvent entraîner de sérieuses complications. La dépression survient chez un patient sur deux [6]. Cette association TSPT-dépression forme parfois ce qu'on appelle une "dépression dissociative", particulièrement difficile à traiter [6].
Les addictions représentent un autre écueil majeur. Alcool, drogues, médicaments... 30% des patients développent une dépendance pour "s'automédicaliser" [14]. Cette stratégie d'évitement aggrave paradoxalement les symptômes à long terme. Les troubles alimentaires (boulimie, anorexie) touchent aussi certains patients.
Sur le plan social, les conséquences peuvent être dramatiques. Difficultés conjugales, isolement, perte d'emploi... Le TSPT bouleverse souvent l'équilibre familial et professionnel [9]. Les femmes victimes de violences conjugales présentent des altérations spécifiques du discours qui compliquent leur réinsertion sociale [9].
Physiquement, le stress chronique use l'organisme. Hypertension, troubles cardiovasculaires, affaiblissement immunitaire... Les patients avec TSPT consultent 40% plus souvent leur médecin généraliste [1]. D'où l'importance d'un traitement précoce et adapté.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des troubles de stress traumatique dépend largement de la précocité et de la qualité de la prise en charge. Bonne nouvelle : avec un traitement adapté, 70 à 80% des patients voient leurs symptômes s'améliorer significativement [12,14].
Plusieurs facteurs influencent l'évolution. Un traitement débuté dans les 3 mois suivant le traumatisme donne de meilleurs résultats qu'une prise en charge tardive. L'âge joue aussi : les patients jeunes récupèrent généralement mieux que les personnes âgées [4].
Le type de traumatisme compte également. Les traumatismes "simples" (accident unique) ont un meilleur pronostic que les traumatismes complexes ou répétés [7]. Le soutien social reste un facteur pronostique majeur : les patients bien entourés guérissent plus vite et plus complètement [5].
Attention cependant : même guéri, un TSPT peut laisser des "cicatrices". Certains patients gardent une sensibilité particulière au stress ou aux rappels traumatiques. C'est normal et cela ne signifie pas que le traitement a échoué. L'important est de retrouver une vie épanouissante malgré cette vulnérabilité résiduelle.
Peut-on Prévenir les Troubles de Stress Traumatique ?
La prévention des troubles de stress traumatique s'articule autour de plusieurs axes. Impossible d'éviter tous les traumatismes, mais on peut agir sur les facteurs de risque et renforcer les facteurs protecteurs [4].
La prévention primaire vise à réduire l'exposition aux traumatismes. Sécurité routière, lutte contre les violences, prévention des accidents du travail... Ces mesures de santé publique ont un impact réel. Les campagnes de sensibilisation aux violences conjugales permettent aussi une prise en charge plus précoce [9].
La prévention secondaire intervient juste après un traumatisme. Le débriefing psychologique, longtemps pratiqué, s'avère finalement inefficace voire délétère [4]. En revanche, l'information des victimes sur les réactions normales post-traumatiques et l'orientation rapide vers des soins spécialisés en cas de symptômes persistants font leurs preuves.
Renforcer sa résilience constitue une approche préventive prometteuse. Techniques de gestion du stress, maintien d'un réseau social solide, pratique d'activités physiques régulières... Ces habitudes de vie saines réduisent le risque de développer un TSPT après un traumatisme [4,5]. Certaines entreprises proposent désormais des formations à la résilience pour leurs employés exposés.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont publié des recommandations claires sur la prise en charge des troubles de stress traumatique. L'INSERM souligne l'importance d'un diagnostic précoce et d'une approche multidisciplinaire [1]. Les médecins généralistes, souvent en première ligne, doivent être formés au repérage de ces troubles.
La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande les psychothérapies spécialisées comme traitement de première intention. L'EMDR et les TCC centrées sur le trauma ont fait leurs preuves [12]. Les médicaments ne viennent qu'en complément, jamais en traitement unique.
Concernant les populations vulnérables, Santé Publique France insiste sur la nécessité d'adapter les soins. Les migrants, les personnes précaires, les victimes de violences nécessitent une approche spécifique tenant compte de leurs particularités culturelles et sociales [5]. Des interprètes et médiateurs culturels doivent être mobilisés si nécessaire.
L'INSERM recommande aussi de développer la recherche sur les innovations thérapeutiques. Les thérapies assistées par psychédéliques, le neurofeedback, les applications de santé mentale... Ces nouvelles approches doivent être évaluées rigoureusement avant leur généralisation [1,2,3].
Ressources et Associations de Patients
De nombreuses ressources existent pour vous accompagner dans votre parcours avec les troubles de stress traumatique. L'association France Victimes propose un accompagnement gratuit aux victimes d'infractions. Leurs 130 antennes locales offrent soutien psychologique, aide juridique et orientation vers les soins spécialisés.
L'Association française de thérapie comportementale et cognitive (AFTCC) met à disposition un annuaire de thérapeutes formés aux TCC pour le trauma. Leur site web propose aussi des ressources d'information pour les patients et leurs familles.
Pour l'EMDR, l'Association EMDR France certifie les praticiens et attendut la qualité des formations. Leur annuaire en ligne vous permet de trouver un thérapeute EMDR près de chez vous. Attention aux praticiens non certifiés qui proposent parfois des "pseudo-EMDR" inefficaces.
Le numéro national d'information pour les victimes (116 006) fonctionne 7j/7 de 9h à 19h. Gratuit depuis tous les téléphones, il vous oriente vers les dispositifs d'aide locaux. En cas d'urgence, n'hésitez pas à contacter le 15 (SAMU) ou à vous rendre aux urgences de l'hôpital le plus proche.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour mieux vivre avec les troubles de stress traumatique. Premier conseil : tenez un journal de vos symptômes. Notez leur intensité, les déclencheurs, ce qui vous aide. Cette auto-observation vous aidera, vous et votre thérapeute, à mieux comprendre votre fonctionnement.
Apprenez à reconnaître vos signaux d'alarme. Tension musculaire, accélération cardiaque, pensées qui s'emballent... Identifiez ces premiers signes pour agir rapidement. Techniques de respiration, relaxation, appel à un proche... Préparez votre "trousse de secours" émotionnelle.
Maintenez une hygiène de vie rigoureuse. Sommeil régulier, alimentation équilibrée, activité physique modérée... Ces bases semblent évidentes mais sont souvent négligées. Or, un corps fatigué et mal nourri gère moins bien le stress. L'exercice physique, en particulier, a des effets antidépresseurs et anxiolytiques prouvés.
Ne vous isolez pas, même si c'est tentant. Gardez le contact avec au moins une ou deux personnes de confiance. Expliquez-leur votre pathologie, vos besoins, vos limites. Un entourage informé sera plus compréhensif et aidant. Et n'oubliez pas : demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de courage !
Quand Consulter un Médecin ?
Consultez rapidement si vous présentez des symptômes de trouble de stress traumatique persistant plus d'un mois après un événement choquant [13,14]. N'attendez pas que la situation se dégrade ! Plus la prise en charge est précoce, meilleur est le pronostic.
Certains signaux d'alarme nécessitent une consultation en urgence. Idées suicidaires, consommation excessive d'alcool ou de drogues, comportements à risque répétés... Ces symptômes indiquent une décompensation qui peut être dangereuse. N'hésitez pas à vous rendre aux urgences ou à appeler le 15.
Votre médecin traitant peut faire un premier bilan et vous orienter vers un spécialiste si nécessaire. Psychiatres, psychologues cliniciens, thérapeutes EMDR... Plusieurs professionnels peuvent vous aider. L'important est de trouver celui avec qui vous vous sentez en confiance.
Si vous êtes proche d'une personne traumatisée, encouragez-la à consulter sans la forcer. Proposez de l'accompagner, informez-vous sur sa pathologie, montrez-vous patient et compréhensif. Votre soutien peut faire la différence dans son parcours de soins. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous aussi : être proche aidant, c'est épuisant !
Questions Fréquentes
Les troubles de stress traumatique guérissent-ils complètement ?
Avec un traitement adapté, 70 à 80% des patients voient leurs symptômes s'améliorer significativement. Une guérison complète est possible, même si certains gardent une sensibilité résiduelle au stress.
Combien de temps dure un traitement ?
Cela varie selon les personnes et la sévérité des symptômes. En moyenne, comptez 6 mois à 2 ans de suivi. L'EMDR peut donner des résultats plus rapides (3 à 6 mois) que les TCC classiques.
Les médicaments sont-ils obligatoires ?
Non, les psychothérapies peuvent suffire dans de nombreux cas. Les médicaments sont proposés en cas de symptômes sévères ou de troubles associés (dépression, anxiété).
Peut-on développer un TSPT des années après un traumatisme ?
Oui, c'est possible. Certains traumatismes 'dormant' se réveillent à l'occasion d'un événement déclencheur ou d'une période de fragilité. C'est ce qu'on appelle le TSPT à début retardé.
Les enfants peuvent-ils avoir un TSPT ?
Absolument. Les symptômes diffèrent parfois de ceux des adultes : régression, troubles du comportement, jeux répétitifs sur le thème du trauma. Une prise en charge spécialisée en pédopsychiatrie est nécessaire.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Troubles du stress post-traumatique. INSERM.Lien
- [2] Midomafetamine-Assisted Psychotherapy for Post-traumatic Stress Disorder. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [3] Freespira for Panic Disorder and Posttraumatic Stress Disorder. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [4] The risk factors of post-traumatic stress disorder among healthcare workers. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] Prieur C, Dourgnon P. Une personne sans titre de séjour sur six souffre de troubles de stress post-traumatique en France. 2022.Lien
- [6] Auxéméry Y. Trouble de stress post-traumatique et symptômes dépressifs: comorbidités ou formes cliniques du trauma? Annales Médico-psychologiques. 2022.Lien
- [7] Levin Y, Mazza A. Symptômes positifs de psychose et trouble de stress post-traumatique complexe: analyse en réseau. 2025.Lien
- [8] Silva LDC, Laisney M. Les altérations de la mémoire dans le trouble de stress post-traumatique. 2023.Lien
- [9] Frabetti M, Gayraud F. Étude de l'agentivité dans le discours de femmes souffrant de TSPT suite à violences conjugales. 2023.Lien
- [10] Nicholson AA, Ros T. Régulation des symptômes de TSPT par la rétroaction neurologique. 2024.Lien
- [11] Koliouli F, Troupel O. COVID-19 et naissance prématurée: stress parental et TSPT. 2024.Lien
- [12] Orban P. Psychothérapies pour le trouble du stress post-traumatique: Exposition prolongée, TCC, EMDR. 2022.Lien
- [13] Trouble de stress post-traumatique (TSPT). MSD Manuals.Lien
- [14] Trouble de stress post-traumatique. MSD Manuals Professional.Lien
Publications scientifiques
- Une personne sans titre de séjour sur six souffre de troubles de stress post-traumatique en France (2022)10 citations
- Trouble de stress post-traumatique et symptômes dépressifs:«comorbidités» ou formes cliniques du trauma? Description de la dépression dissociative. (2022)7 citations
- … Stress Disorder: A Network Analysis in a Canadian Sample from Montreal: Symptômes positifs de psychose et trouble de stress post-traumatique complexe (CIM-11) … (2025)
- Les altérations de la mémoire dans le trouble de stress post-traumatique (2023)
- Étude de l'agentivité dans le discours de femmes souffrant de trouble de stress post-traumatique dans les suites de violences conjugales (2023)4 citations
Ressources web
- Trouble de stress post-traumatique (TSPT) (msdmanuals.com)
Diagnostic du TSPT · La personne a été exposée directement ou indirectement à un événement traumatique. · Les symptômes persistent depuis 1 mois ou plus. · Les ...
- Trouble de stress post-traumatique (msdmanuals.com)
18 déc. 2024 — Le diagnostic repose sur des critères cliniques. Le traitement comprend une psychothérapie et parfois un traitement pharmacologique d'appoint.
- Troubles du stress post-traumatique (inserm.fr)
23 nov. 2020 — Le développement de signes d'une activité neurovégétative : hypervigilance, irritabilité, difficultés de concentration, troubles du sommeil…
- Trouble de stress post-traumatique (psycom.org)
3 juin 2025 — des troubles psychosomatiques avec des symptômes physiques persistants comme la douleur, les maux de tête ou la fatigue; des pensées suicidaires ...
- Syndrome de stress post-traumatique (SSPT) (inicea.fr)
Le diagnostic d'un trouble de stress post-traumatique chronique est posé lorsque les symptômes durent plus de six mois. Un grand nombre de personnes vivent avec ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
