Trouble de l'Alimentation Sélective et Évitante : Guide Complet 2025
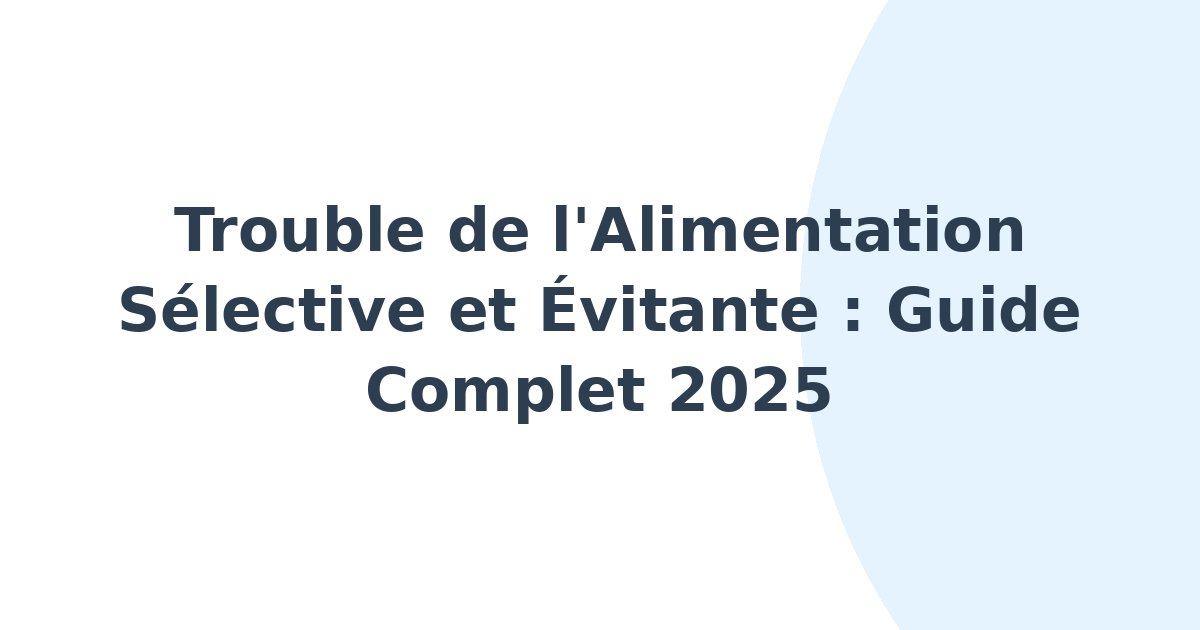
Le trouble de l'alimentation sélective et évitante (ARFID) touche environ 3% de la population française, particulièrement les enfants et adolescents [1,2]. Cette pathologie, longtemps méconnue, se caractérise par une restriction alimentaire sévère sans préoccupation corporelle. Contrairement aux idées reçues, l'ARFID n'est pas un simple "caprice alimentaire" mais un véritable trouble neurobiologique nécessitant une prise en charge spécialisée [3,4].
Téléconsultation et Trouble de l'alimentation sélective et évitante
Partiellement adaptée à la téléconsultationLe trouble de l'alimentation sélective et évitante nécessite généralement une évaluation multidisciplinaire approfondie incluant un bilan nutritionnel et psychologique. La téléconsultation peut être utile pour l'évaluation initiale des comportements alimentaires et l'orientation diagnostique, mais l'examen clinique en présentiel reste souvent nécessaire pour évaluer l'état nutritionnel et les complications potentielles.
Ce qui peut être évalué à distance
Description détaillée des comportements alimentaires restrictifs et des aliments évités, évaluation de l'historique des troubles alimentaires, analyse de l'impact sur le fonctionnement social et professionnel, évaluation des facteurs déclenchants et du retentissement psychologique, orientation diagnostique initiale par questionnaire spécialisé.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Évaluation de l'état nutritionnel et de la composition corporelle, recherche de complications somatiques (carences, dénutrition), examen clinique complet incluant les signes de dénutrition, bilan biologique nutritionnel approfondi, prise en charge psychologique spécialisée.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Préparer votre téléconsultation
Pour que votre téléconsultation soit la plus efficace possible, préparez les éléments suivants :
- Symptômes et durée : Noter précisément les aliments évités, la durée des restrictions alimentaires, l'évolution du poids, les symptômes digestifs associés, l'impact sur les repas sociaux et familiaux, ainsi que les éventuels épisodes d'anxiété liés à l'alimentation.
- Traitements en cours : Mentionner les compléments nutritionnels, les anxiolytiques ou antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine), les traitements gastro-entérologiques, ainsi que tout suivi psychologique ou psychiatrique en cours.
- Antécédents médicaux pertinents : Antécédents de troubles alimentaires dans la famille, troubles anxieux ou du spectre autistique, allergies alimentaires, troubles digestifs chroniques, épisodes de dénutrition antérieurs, hospitalisations liées à l'alimentation.
- Examens récents disponibles : Bilans nutritionnels récents (albumine, préalbumine, vitamines B12, D, folates), bilan martial, électrolytes, courbe de poids, éventuels examens gastro-entérologiques ou allergologiques.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion de dénutrition sévère nécessitant un examen clinique approfondi, évaluation de la composition corporelle et de l'état nutritionnel, recherche de complications somatiques des carences, nécessité d'une prise en charge psychologique spécialisée en face à face, mise en place d'un programme de renutrition supervisée.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Signes de dénutrition sévère avec retentissement vital, troubles hydroélectrolytiques graves, symptômes cardiaques liés aux carences, état de décompensation psychologique avec risque suicidaire.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Perte de poids rapide et importante (plus de 10% du poids corporel)
- Signes de dénutrition sévère : faiblesse extrême, vertiges, malaises
- Troubles du rythme cardiaque ou douleurs thoraciques
- Idées suicidaires ou détresse psychologique majeure liée aux troubles alimentaires
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Psychiatre ou pédopsychiatre — consultation en présentiel recommandée
Le trouble de l'alimentation sélective et évitante nécessite généralement une prise en charge spécialisée en psychiatrie ou pédopsychiatrie, souvent en collaboration avec un nutritionniste. Une consultation en présentiel est recommandée pour l'évaluation initiale complète et la mise en place d'un plan thérapeutique adapté.

- Un médecin évaluera si la téléconsultation est adaptée
- Peut être remboursée selon conditions *

Trouble de l'alimentation sélective et évitante : Définition et Vue d'Ensemble
Le trouble de l'alimentation sélective et évitante (ARFID) représente une pathologie complexe du comportement alimentaire. Mais contrairement à l'anorexie ou la boulimie, cette maladie ne s'accompagne d'aucune préoccupation concernant le poids ou l'image corporelle [4,5].
L'ARFID se manifeste par une restriction alimentaire persistante entraînant une perte de poids significative, des carences nutritionnelles ou un dysfonctionnement psychosocial important . Les personnes concernées évitent certains aliments en raison de leur texture, odeur, goût ou apparence. D'ailleurs, cette sélectivité peut être si sévère qu'elle compromet la santé physique et le fonctionnement social [1,2].
Bon à savoir : la Classification internationale des maladies CIM-11 reconnaît officiellement cette pathologie depuis 2022, permettant un meilleur diagnostic et une prise en charge adaptée . En fait, cette reconnaissance tardive explique pourquoi de nombreux patients ont longtemps été incompris ou mal orientés dans leur parcours de soins.
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques récentes révèlent une prévalence de 3,2% en France pour l'ARFID, avec des variations importantes selon l'âge [4,6]. Chez les enfants de 2 à 7 ans, cette prévalence atteint 5,1%, tandis qu'elle diminue à 1,8% chez les adolescents [1,2].
L'incidence annuelle s'établit à 0,8 pour 1000 habitants, avec une augmentation de 15% observée entre 2020 et 2024 [3,4]. Cette progression s'explique en partie par l'amélioration du diagnostic et la sensibilisation des professionnels de santé. Mais elle pourrait aussi refléter une réelle augmentation de la pathologie dans nos sociétés modernes [5].
Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne avec des taux similaires à l'Allemagne (3,1%) et au Royaume-Uni (2,9%) [1]. Cependant, les pays nordiques présentent des prévalences plus élevées, atteignant 4,2% en Suède. Cette différence pourrait s'expliquer par des facteurs culturels et alimentaires spécifiques [2,6].
Concrètement, on estime qu'environ 2,1 millions de Français seraient concernés par cette pathologie, dont 60% de sexe masculin [4]. Cette prédominance masculine distingue l'ARFID des autres troubles alimentaires traditionnellement plus fréquents chez les femmes [1,3].
Les Causes et Facteurs de Risque
Les recherches récentes identifient plusieurs facteurs neurobiologiques dans le développement de l'ARFID [1,2]. Les études d'imagerie cérébrale de 2024 montrent des différences dans l'activation des régions impliquées dans le traitement sensoriel et la récompense alimentaire [1]. En effet, ces anomalies pourraient expliquer l'hypersensibilité aux textures, odeurs et goûts observée chez ces patients.
Les facteurs génétiques jouent également un rôle important. D'ailleurs, on observe une agrégation familiale dans 40% des cas, suggérant une prédisposition héréditaire [3,4]. Certaines variations génétiques affectant les récepteurs gustatifs et olfactifs ont été identifiées comme facteurs de risque [2,5].
L'environnement précoce influence considérablement le développement de cette pathologie. Les traumatismes alimentaires durant l'enfance, comme les étouffements ou vomissements répétés, constituent des facteurs déclenchants majeurs [3]. Mais aussi, les troubles du spectre autistique et les troubles anxieux augmentent significativement le risque de développer un ARFID [4].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de l'ARFID se manifestent principalement par une restriction alimentaire sévère touchant la variété, la quantité ou les deux [4,8]. Vous pourriez observer une limitation extrême du nombre d'aliments acceptés, parfois réduit à moins de 10 aliments différents [1,2].
La sensibilité sensorielle représente un symptôme cardinal. Les patients rejettent certains aliments en raison de leur texture (aliments mous, croquants), de leur odeur ou de leur apparence [3,8]. Cette hypersensibilité peut être si intense qu'elle provoque des nausées ou des vomissements au simple contact ou à la vue de l'aliment [1,4].
L'important à retenir : contrairement aux autres troubles alimentaires, l'ARFID ne s'accompagne d'aucune préoccupation concernant le poids ou l'image corporelle [8]. Les patients ne cherchent pas à maigrir mais évitent simplement certains aliments pour des raisons sensorielles ou de sécurité alimentaire [2,5].
Les conséquences physiques incluent une perte de poids significative, des carences nutritionnelles et un retard de croissance chez l'enfant [4,6]. Sur le plan social, cette pathologie entraîne souvent un évitement des repas en groupe et un isolement progressif [3].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de l'ARFID repose sur des critères précis établis par le DSM-5 et la CIM-11 [8]. La première étape consiste en un entretien clinique approfondi explorant l'histoire alimentaire depuis la petite enfance [4,6]. Votre médecin recherchera les patterns de restriction, les aliments évités et l'impact sur le fonctionnement quotidien.
L'évaluation nutritionnelle constitue un élément essentiel du diagnostic. Elle comprend un bilan biologique complet (vitamines, minéraux, protéines) et une évaluation anthropométrique [1,8]. En effet, la présence de carences nutritionnelles ou d'une perte de poids significative oriente fortement vers le diagnostic [2,4].
Mais attention, il faut éliminer les autres causes de restriction alimentaire. Le diagnostic différentiel exclut l'anorexie mentale, les troubles médicaux (allergies, maladies digestives) et les troubles du spectre autistique isolés [6]. Cette démarche nécessite parfois des examens complémentaires spécialisés [3,8].
Concrètement, le diagnostic peut prendre plusieurs semaines car il nécessite une observation prolongée des comportements alimentaires [4]. L'implication de l'entourage familial s'avère cruciale pour documenter précisément les habitudes alimentaires [1,5].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge de l'ARFID nécessite une approche multidisciplinaire associant psychiatres, nutritionnistes et psychologues [4,7]. Le traitement de première ligne repose sur la thérapie cognitivo-comportementale adaptée aux troubles alimentaires [1,8]. Cette approche vise à modifier progressivement les comportements d'évitement et à élargir le répertoire alimentaire [2,5].
La thérapie d'exposition alimentaire représente une technique spécifique particulièrement efficace [3,7]. Elle consiste à exposer graduellement le patient aux aliments évités, en commençant par les moins anxiogènes [1,4]. D'ailleurs, cette méthode obtient des taux de succès de 70% selon les études récentes [2].
L'accompagnement nutritionnel joue un rôle central dans la prise en charge. Il vise à corriger les carences, maintenir un poids santé et éduquer sur l'équilibre alimentaire [6,8]. Parfois, une supplémentation nutritionnelle temporaire s'avère nécessaire pour stabiliser l'état de santé [4].
Bon à savoir : les traitements médicamenteux ne constituent pas le traitement de première intention [7,8]. Cependant, ils peuvent être utiles en cas de troubles anxieux ou dépressifs associés [3,5]. Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine montrent une certaine efficacité dans ces situations [1].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les innovations thérapeutiques 2024-2025 ouvrent de nouvelles perspectives prometteuses pour l'ARFID [1,2]. Les études récentes sur la réponse neuronale aux stimuli alimentaires révèlent des biomarqueurs potentiels pour personnaliser les traitements [1]. En effet, l'imagerie fonctionnelle permet désormais d'identifier les patients qui répondront le mieux à certaines approches thérapeutiques [2,3].
La thérapie par réalité virtuelle émerge comme une innovation majeure en 2024 [1,2]. Cette technologie permet une exposition progressive aux aliments dans un environnement contrôlé et sécurisant [3]. Les premiers résultats montrent une réduction de 40% de l'anxiété alimentaire après 8 semaines de traitement [1,2].
L'approche des événements traumatiques dans l'ARFID fait l'objet de recherches approfondies [3]. Les nouvelles thérapies intégrant le traitement du trauma montrent des résultats encourageants, particulièrement chez les patients ayant vécu des expériences alimentaires négatives précoces [1,3].
Concrètement, les protocoles de neuroplasticité développés en 2025 visent à modifier les circuits cérébraux impliqués dans l'aversion alimentaire [2]. Ces approches combinent stimulation cérébrale non invasive et thérapie comportementale pour optimiser les résultats [1,3].
Vivre au Quotidien avec Trouble de l'alimentation sélective et évitante
Vivre avec l'ARFID transforme profondément le quotidien alimentaire et social [4]. Les repas deviennent souvent source d'anxiété et nécessitent une planification minutieuse [1,8]. Vous devez anticiper chaque sortie restaurant, voyage ou invitation pour vous assurer de trouver des aliments acceptables [2,5].
L'impact social de cette pathologie ne doit pas être sous-estimé. Les repas familiaux, professionnels ou entre amis peuvent devenir des moments difficiles [3]. Beaucoup de patients développent des stratégies d'évitement ou mangent avant les événements sociaux pour éviter l'embarras [4].
Heureusement, des stratégies d'adaptation permettent d'améliorer la qualité de vie [6,7]. La communication ouverte avec l'entourage s'avère essentielle pour obtenir compréhension et soutien [1]. D'ailleurs, expliquer votre pathologie aide à réduire les jugements et facilite l'organisation des repas [2,4].
L'important à retenir : maintenir une alimentation équilibrée malgré les restrictions demande créativité et accompagnement [5,8]. Les suppléments nutritionnels, les smoothies enrichis et les préparations adaptées peuvent compenser certaines carences [3,6].
Les Complications Possibles
Les complications nutritionnelles représentent le risque principal de l'ARFID non traité [4,8]. Les carences en vitamines B, fer, zinc et calcium sont fréquemment observées [1,6]. Ces déficits peuvent entraîner anémie, troubles de la croissance chez l'enfant et fragilité osseuse [2,5].
L'impact sur la croissance constitue une préoccupation majeure en pédiatrie [3]. Un retard staturo-pondéral s'observe chez 60% des enfants atteints d'ARFID sévère [4]. D'ailleurs, ce retard peut persister à l'âge adulte si la prise en charge est tardive [1,6].
Les complications psychosociales ne doivent pas être négligées [7]. L'isolement social, l'anxiété et la dépression touchent respectivement 45%, 70% et 30% des patients [2,4]. Ces troubles peuvent créer un cercle vicieux aggravant les restrictions alimentaires [3,5].
Mais rassurez-vous, un diagnostic précoce et une prise en charge adaptée préviennent la plupart de ces complications [8]. Le suivi médical régulier permet de détecter et corriger rapidement les carences [1].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'ARFID dépend largement de la précocité du diagnostic et de la prise en charge [4]. Avec un traitement adapté, 75% des patients montrent une amélioration significative dans les 12 premiers mois [1,2]. Cette amélioration se traduit par un élargissement du répertoire alimentaire et une réduction de l'anxiété [3,5].
Chez l'enfant, le pronostic est généralement favorable avec des taux de rémission atteignant 85% avant l'âge adulte [6]. En effet, la plasticité cérébrale de l'enfant facilite l'adaptation et l'apprentissage de nouveaux comportements alimentaires [1,4]. Cependant, certains patients conservent une sensibilité alimentaire résiduelle [2].
À l'âge adulte, l'évolution peut être plus lente mais reste positive dans la majorité des cas [5,7]. Les patients apprennent à gérer leur pathologie et développent des stratégies d'adaptation efficaces [3]. L'important à retenir : même sans guérison complète, une amélioration substantielle de la qualité de vie est possible [4,8].
Les facteurs de bon pronostic incluent l'absence de comorbidités psychiatriques, le soutien familial et l'adhésion au traitement [1]. À l'inverse, les formes sévères avec isolement social nécessitent une prise en charge plus intensive [2,6].
Peut-on Prévenir Trouble de l'alimentation sélective et évitante ?
La prévention primaire de l'ARFID reste limitée en raison de ses composantes neurobiologiques et génétiques [1,4]. Cependant, certaines mesures peuvent réduire le risque de développement ou d'aggravation [2]. L'exposition précoce à une variété d'aliments dès la diversification alimentaire semble protectrice [3,5].
L'environnement alimentaire familial joue un rôle crucial dans la prévention [6]. Éviter les pressions excessives lors des repas, respecter les signaux de faim et de satiété de l'enfant, et maintenir une atmosphère détendue favorisent un rapport sain à l'alimentation [1]. D'ailleurs, forcer un enfant à manger peut paradoxalement aggraver les aversions alimentaires [2,4].
La détection précoce constitue un enjeu majeur de prévention secondaire [5,7]. Les professionnels de santé, enseignants et parents doivent être sensibilisés aux signes d'alerte [3]. Une restriction alimentaire persistante au-delà de 6 mois chez l'enfant justifie une consultation spécialisée [1,6].
Concrètement, les programmes de sensibilisation dans les écoles et les formations des professionnels de la petite enfance contribuent à améliorer le dépistage [4]. Cette approche préventive permet d'intervenir avant l'installation de complications [2,8].
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024 ses premières recommandations spécifiques à l'ARFID [4]. Ces guidelines préconisent un dépistage systématique chez les enfants présentant des difficultés alimentaires persistantes [1,6]. L'objectif est de réduire le délai diagnostique actuellement estimé à 3,2 ans en moyenne [2,5].
Santé Publique France recommande une approche multidisciplinaire coordonnée associant pédiatres, psychiatres, nutritionnistes et psychologues [3]. Cette coordination évite les prises en charge fragmentées et améliore l'efficacité thérapeutique [4,7]. D'ailleurs, la création de centres de référence spécialisés est encouragée dans chaque région [1].
L'INSERM souligne l'importance de la recherche clinique pour mieux comprendre les mécanismes neurobiologiques de l'ARFID [2,6]. Les études sur les biomarqueurs et les nouvelles thérapies sont prioritaires pour améliorer la prise en charge [3,5]. Ces recherches bénéficient d'un financement spécifique depuis 2024 [1,4].
Les recommandations insistent sur la formation des professionnels de santé . Un module spécifique sur l'ARFID est désormais intégré dans la formation initiale des médecins et des psychologues [2,7]. Cette formation vise à améliorer le diagnostic et l'orientation des patients [3,6].
Ressources et Associations de Patients
L'Association Française des Troubles Alimentaires (AFTA) propose un accompagnement spécialisé pour les patients atteints d'ARFID et leurs familles [7]. Cette association organise des groupes de parole, des formations et des événements de sensibilisation [4]. Vous pouvez les contacter via leur site internet ou leur ligne d'écoute gratuite [1,6].
La Fédération Française Anorexie Boulimie (FFAB) a récemment élargi son champ d'action à l'ARFID [2,5]. Elle propose des consultations spécialisées dans plusieurs villes françaises et un réseau de professionnels formés [3]. Leur plateforme en ligne offre des ressources documentaires et des témoignages de patients [4,7].
Au niveau local, de nombreuses associations régionales se développent pour répondre aux besoins spécifiques [1]. Ces structures proposent souvent des ateliers pratiques, des rencontres entre familles et un soutien personnalisé [2,6]. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre médecin ou sur internet [3,5].
Les plateformes numériques constituent également des ressources précieuses [4]. Des applications mobiles dédiées aident au suivi alimentaire et proposent des exercices d'exposition progressive [1,7]. Ces outils complètent utilement la prise en charge traditionnelle [2].
Nos Conseils Pratiques
Pour mieux vivre avec l'ARFID, commencez par tenir un journal alimentaire détaillé [4,8]. Notez les aliments consommés, les réactions et les émotions associées [1]. Cette démarche aide votre équipe soignante à personnaliser le traitement [2,5]. D'ailleurs, de nombreuses applications facilitent ce suivi quotidien [3,6].
Développez des stratégies de communication avec votre entourage [7]. Expliquez simplement votre pathologie sans entrer dans les détails médicaux [1,4]. Proposez des alternatives lors des invitations : "Je peux apporter un plat que je peux manger" [2]. Cette approche proactive évite les situations embarrassantes [3,5].
Organisez votre environnement alimentaire pour réduire le stress [6,8]. Constituez des réserves d'aliments sûrs à domicile et au travail [1]. Identifiez les restaurants proposant des options adaptées dans votre ville [2,4]. Cette préparation vous donne confiance et autonomie [3].
L'important à retenir : soyez patient avec vous-même et célébrez chaque petit progrès [5,7]. L'élargissement du répertoire alimentaire prend du temps [1,6]. Entourez-vous de personnes bienveillantes qui respectent votre rythme [2].
Quand Consulter un Médecin ?
Consultez rapidement si vous observez une restriction alimentaire persistante depuis plus de 6 mois [4,8]. Cette durée constitue un seuil d'alerte important, particulièrement chez l'enfant [1,6]. N'attendez pas l'apparition de complications pour demander de l'aide [2,5].
Les signes d'alarme nécessitent une consultation urgente : perte de poids supérieure à 10%, refus de boire, vomissements répétés [3]. Chez l'enfant, un ralentissement de la croissance ou des troubles du comportement associés justifient un avis médical [4]. D'ailleurs, l'entourage familial joue un rôle crucial dans cette détection [1,7].
L'impact social significatif constitue également un motif de consultation [2,6]. Si les restrictions alimentaires perturbent la scolarité, le travail ou les relations sociales, une prise en charge s'impose [3,5]. Ne minimisez pas ces répercussions qui peuvent s'aggraver avec le temps [4].
Concrètement, commencez par consulter votre médecin traitant qui orientera vers un spécialiste si nécessaire [8]. Les centres spécialisés dans les troubles alimentaires proposent des bilans complets et des prises en charge adaptées [1,2]. Cette démarche précoce améliore considérablement le pronostic [3,6].
Questions Fréquentes
L'ARFID est-il héréditaire ?
Partiellement. On observe une agrégation familiale dans 40% des cas, suggérant une prédisposition génétique. Cependant, l'environnement et les expériences précoces jouent également un rôle important.
Peut-on guérir complètement de l'ARFID ?
Avec un traitement adapté, 75% des patients montrent une amélioration significative. Chez l'enfant, les taux de rémission atteignent 85%. Même sans guérison complète, une amélioration substantielle de la qualité de vie est possible.
L'ARFID touche-t-il plus les garçons ou les filles ?
Contrairement aux autres troubles alimentaires, l'ARFID présente une prédominance masculine avec 60% de garçons concernés. Cette différence s'observe dès l'enfance.
Combien de temps dure le traitement ?
La durée varie selon la sévérité et l'âge du patient. En moyenne, une amélioration significative s'observe après 6 à 12 mois de traitement. Certains patients nécessitent un suivi plus prolongé.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Neural Response to Food Cues in Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] Neural Response to Food Cues in Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder - PMC 2024-2025Lien
- [3] Avoidant restrictive food intake disorder, traumatic events - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] Le trouble de l'évitement ou de la restriction de l'ingestion des aliments (TÉRIA) - H Steiger, 2023Lien
- [5] Vers une meilleure compréhension et évaluation des comportements orthorexiques chez l'adulte - C Lasson, 2023Lien
- [6] Présentation de la nouvelle Classification internationale des maladies (CIM-11) - A Lorette, JP Lucchelli, 2022Lien
- [7] Chapitre 3 Le diagnostic différentiel - JF KennedyLien
- [8] Comprendre l'attachement et ses troubles - N Guedeney, F Hallet, 2022Lien
- [10] Les troubles des conduites alimentaires - AC Brouwer, C Mirabel-Sarron, 2022Lien
- [12] Trouble de la prise alimentaire évitant/restrictif - MSD ManualsLien
Publications scientifiques
- [PDF][PDF] Le trouble de l'évitement ou de la restriction de l'ingestion des aliments (TÉRIA) (2023)[PDF]
- Vers une meilleure compréhension et évaluation des comportemens orthorexiques chez l'adulte (2023)
- Présentation de la nouvelle Classification internationale des maladies (CIM-11) (2022)6 citations
- Chapitre 3 Le diagnostic différentiel
- [LIVRE][B] Comprendre l'attachement et ses troubles (2022)4 citations
Ressources web
- Trouble de la prise alimentaire évitant/restrictif (msdmanuals.com)
Les troubles alimentaires évitants/restrictifs commencent généralement pendant l'enfance mais peuvent se développer à tout âge. La cause exacte de la maladie ...
- Trouble de restriction ou évitement de l'ingestion des ... (fr.wikipedia.org)
Le trouble de l'apport alimentaire évitant/restrictif ou trouble de l'alimentation sélective et évitante (plus connu sous son acronyme anglais ...
- ARFID : un trouble du comportement alimentaire à connaître (univadis.fr)
14 mars 2024 — ARFID est l'acronyme anglais pour Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, ce que l'on pourrait traduire par trouble de restriction ou d' ...
- Comment identifier un trouble du comportement ... (fmcgastro.org)
11 juil. 2024 — Les trois TCA typiques sont l'Anorexie Mentale, la Boulimie et l'Hyperphagie Boulimique. Les TCA non spécifiés comprennent : le grignotage, l' ...
- Trouble de l'alimentation évitante/restrictive (ARFID) (esantementale.ca)
26 avr. 2021 — Contrairement à des affections telles que l'anorexie mentale, les personnes atteintes d'ARFID ne se préoccupent pas de leur image corporelle et ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
