Traumatismes Sportifs : Guide Complet 2025 - Prévention, Traitement et Récupération
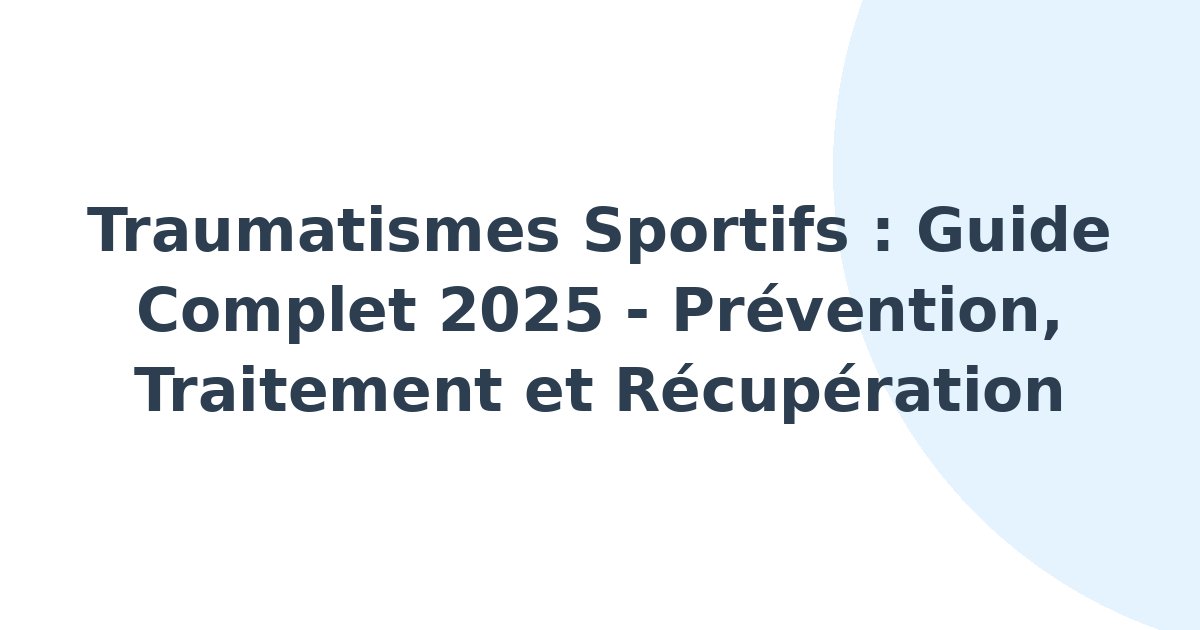
Les traumatismes sportifs touchent chaque année des millions de personnes en France. Qu'il s'agisse d'une entorse bénigne ou d'une fracture complexe, ces blessures peuvent bouleverser votre quotidien et votre pratique sportive. Heureusement, la médecine sportive évolue rapidement avec des innovations thérapeutiques prometteuses en 2024-2025.
Téléconsultation et Traumatismes sportifs
Partiellement adaptée à la téléconsultationLes traumatismes sportifs présentent une grande variabilité de gravité, depuis les contusions bénignes jusqu'aux fractures complexes. La téléconsultation peut être utile pour une évaluation initiale et l'orientation thérapeutique des traumatismes légers, mais nécessite généralement un examen clinique complémentaire pour écarter une lésion grave et adapter la prise en charge.
Ce qui peut être évalué à distance
Évaluation visuelle des hématomes, œdèmes et déformations apparentes, analyse du mécanisme traumatique et des circonstances de survenue, évaluation fonctionnelle par tests de mobilité guidés, orientation sur les premiers gestes thérapeutiques (glaçage, repos, contention), prescription d'antalgiques adaptés.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Palpation pour rechercher une fracture ou une rupture ligamentaire, tests cliniques spécialisés d'instabilité articulaire, prescription d'examens d'imagerie (radiographies, échographie, IRM), évaluation précise de l'amplitude articulaire et de la force musculaire.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Préparer votre téléconsultation
Pour que votre téléconsultation soit la plus efficace possible, préparez les éléments suivants :
- Symptômes et durée : Noter précisément l'intensité de la douleur sur une échelle de 0 à 10, la localisation exacte, la présence de gonflement ou d'hématome, la limitation fonctionnelle et depuis combien d'heures ou de jours ces symptômes sont apparus après le traumatisme.
- Traitements en cours : Mentionner tous les anti-inflammatoires (ibuprofène, diclofénac), antalgiques (paracétamol, tramadol), myorelaxants ou corticoïdes pris depuis le traumatisme, ainsi que les traitements locaux appliqués (pommades, gels, patchs).
- Antécédents médicaux pertinents : Signaler les traumatismes antérieurs sur la même zone, les interventions chirurgicales orthopédiques, les problèmes articulaires chroniques, l'ostéoporose, les troubles de la coagulation et les allergies aux anti-inflammatoires.
- Examens récents disponibles : Avoir sous la main les radiographies, échographies ou IRM récentes de la zone traumatisée, les comptes-rendus de kinésithérapie en cours, les bilans sanguins récents si prise d'anti-inflammatoires au long cours.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion de fracture ou de luxation nécessitant une immobilisation spécialisée, traumatismes articulaires avec instabilité importante, lésions musculaires étendues nécessitant une évaluation échographique, traumatismes crâniens même légers associés à un impact sportif.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Déformation visible évoquant une fracture déplacée ou une luxation, syndrome des loges avec douleur intense et troubles sensitifs, traumatisme crânien avec perte de connaissance ou vomissements.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Déformation visible d'un membre ou d'une articulation évoquant une fracture ou luxation
- Impossibilité totale d'appuyer sur un membre inférieur ou de mobiliser un membre supérieur
- Engourdissement, fourmillements ou perte de sensibilité dans le membre traumatisé
- Douleur très intense non calmée par les antalgiques usuels avec gonflement majeur et rapide
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Médecin du sport ou rhumatologue — consultation en présentiel recommandée
Les médecins du sport et rhumatologues ont l'expertise spécifique des traumatismes sportifs et de leur prise en charge. Une consultation en présentiel est généralement recommandée pour un examen clinique complet et une évaluation précise des lésions.

- Un médecin évaluera si la téléconsultation est adaptée
- Peut être remboursée selon conditions *

Traumatismes sportifs : Définition et Vue d'Ensemble
Les traumatismes sportifs regroupent l'ensemble des blessures survenant lors de la pratique d'une activité physique ou sportive. Ces pathologies peuvent affecter tous les systèmes du corps : muscles, tendons, ligaments, os, articulations, mais aussi le système nerveux [12].
On distingue deux grandes catégories de traumatismes. D'une part, les traumatismes aigus qui surviennent brutalement lors d'un choc, d'une chute ou d'un mouvement violent. D'autre part, les traumatismes chroniques ou de surmenage, qui résultent d'une sollicitation répétée et excessive des structures anatomiques [13].
La gravité varie considérablement selon le mécanisme lésionnel, l'intensité du traumatisme et les structures touchées. Certaines blessures nécessitent une prise en charge d'urgence, tandis que d'autres peuvent être traitées en ambulatoire [2]. L'important est de ne jamais négliger un traumatisme, même apparemment bénin.
Concrètement, vous pourriez être confronté à des entorses, des fractures, des luxations, des déchirures musculaires, des tendinopathies ou encore des commotions cérébrales. Chaque sport présente ses propres risques spécifiques selon les gestes techniques pratiqués et l'intensité des contacts [3].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, les traumatismes sportifs représentent un enjeu majeur de santé publique. Selon les données récentes, environ 900 000 accidents sportifs nécessitent une consultation médicale chaque année dans notre pays [11]. Cette incidence place la France dans la moyenne européenne, avec des variations importantes selon les régions et les sports pratiqués.
Les sports collectifs concentrent le plus grand nombre de blessures, avec le football en tête représentant près de 25% des traumatismes sportifs. Viennent ensuite le rugby (15%), le basketball (12%) et le handball (8%) [14]. Mais attention, ces chiffres ne reflètent pas forcément la dangerosité relative de chaque sport, plutôt leur popularité.
L'analyse par tranche d'âge révèle des disparités importantes. Les 15-24 ans sont les plus touchés avec 35% des traumatismes, suivis des 25-34 ans (28%). Cependant, on observe une augmentation préoccupante chez les seniors de plus de 50 ans, liée au développement du sport-santé [4].
D'un point de vue économique, le coût des traumatismes sportifs pour l'Assurance Maladie est estimé à plus de 1,2 milliard d'euros annuellement. Ce montant inclut les consultations, les examens d'imagerie, les interventions chirurgicales et les arrêts de travail [9]. Les projections pour 2025 suggèrent une stabilisation de ces coûts grâce aux programmes de prévention mis en place.
Les Causes et Facteurs de Risque
Comprendre les causes des traumatismes sportifs vous aide à mieux les prévenir. Les facteurs intrinsèques dépendent de votre organisme : âge, sexe, maladie physique, antécédents de blessures, morphologie et état de santé général [13]. Par exemple, une fatigue musculaire augmente significativement le risque de blessure.
Les facteurs extrinsèques sont liés à l'environnement et aux maladies de pratique. La qualité du terrain, les maladies météorologiques, l'équipement utilisé et les règles du jeu jouent un rôle déterminant [3]. Un terrain glissant ou des chaussures inadaptées multiplient les risques de chute et de traumatisme.
Mais il faut aussi considérer les facteurs comportementaux. Un échauffement insuffisant, une technique défaillante, une prise de risque excessive ou la pratique en état de fatigue sont autant d'éléments qui favorisent la survenue d'accidents [2]. D'ailleurs, 60% des traumatismes sportifs pourraient être évités par une meilleure préparation et des gestes techniques appropriés.
Certaines périodes sont particulièrement à risque. La reprise après une interruption prolongée, les changements de saison, les compétitions importantes génèrent un stress physique et psychologique propice aux blessures. L'important est d'adapter progressivement votre pratique à ces situations particulières [12].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Savoir identifier rapidement les signes d'un traumatisme sportif peut faire la différence entre une récupération rapide et des complications durables. La douleur reste le symptôme le plus évident, mais son intensité ne reflète pas toujours la gravité de la blessure [14].
Les signes d'alarme nécessitant une consultation urgente incluent : une douleur intense et persistante, une déformation visible, une impossibilité de bouger ou d'appuyer sur le membre blessé, un gonflement important et rapide, ou encore des troubles neurologiques comme des fourmillements [12]. En cas de traumatisme crânien, surveillez attentivement les maux de tête, les nausées, les troubles de la vision ou de l'équilibre [1].
Pour les traumatismes moins évidents, d'autres symptômes doivent vous alerter. Une raideur matinale persistante, une diminution des performances, une fatigue anormale ou des douleurs qui s'aggravent à l'effort peuvent signaler un traumatisme de surmenage [10]. Ces pathologies évoluent insidieusement et nécessitent une prise en charge précoce.
Concrètement, apprenez à écouter votre corps. Une gêne qui persiste plus de 48 heures après l'effort mérite une consultation. Il vaut mieux consulter pour rien que de laisser s'installer une pathologie chronique qui pourrait compromettre votre pratique sportive à long terme [13].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic d'un traumatisme sportif suit une démarche méthodique qui commence par un interrogatoire détaillé. Votre médecin vous questionnera sur les circonstances de survenue, le mécanisme lésionnel, l'intensité de la douleur et vos antécédents médicaux et sportifs [2]. Ces informations orientent déjà fortement le diagnostic.
L'examen clinique constitue l'étape fondamentale. Le médecin inspecte, palpe et teste la mobilité de la zone blessée. Des tests spécifiques permettent d'évaluer l'intégrité des ligaments, tendons et structures osseuses [12]. Par exemple, les tests de Lachman et du tiroir antérieur explorent la stabilité du genou.
Les examens complémentaires ne sont prescrits qu'en cas de nécessité. La radiographie reste l'examen de première intention pour éliminer une fracture. L'échographie permet d'explorer les tissus mous : muscles, tendons, ligaments. L'IRM est réservée aux cas complexes nécessitant une analyse fine des structures anatomiques [8].
Depuis 2024, de nouveaux outils diagnostiques font leur apparition. Les capteurs de mouvement et l'intelligence artificielle permettent une analyse biomécanique précise des gestes sportifs, aidant à identifier les facteurs de risque individuels [3]. Cette approche personnalisée révolutionne la prise en charge des sportifs de haut niveau.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge des traumatismes sportifs a considérablement évolué ces dernières années. Le protocole RICE (Rest, Ice, Compression, Elevation) reste la référence pour les traumatismes aigus, mais il s'enrichit désormais d'approches plus nuancées [14]. L'immobilisation prolongée est de moins en moins recommandée au profit d'une mobilisation précoce contrôlée.
Les traitements médicamenteux visent principalement à contrôler la douleur et l'inflammation. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) restent largement utilisés, mais leur prescription doit être limitée dans le temps pour éviter les effets secondaires [9]. Les antalgiques simples comme le paracétamol constituent souvent une alternative suffisante.
La kinésithérapie occupe une place centrale dans la récupération. Elle débute dès que possible avec des techniques de drainage, de mobilisation passive puis active. L'objectif est de restaurer progressivement la fonction tout en respectant les processus de cicatrisation [13]. Les protocoles sont désormais personnalisés selon le sport pratiqué et les objectifs du patient.
Pour les cas les plus sévères, la chirurgie peut s'avérer nécessaire. Les techniques mini-invasives se développent rapidement, permettant une récupération plus rapide et moins de complications [7]. L'arthroscopie, par exemple, révolutionne la prise en charge des pathologies articulaires chez le sportif.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans la prise en charge des traumatismes sportifs avec l'émergence de technologies révolutionnaires. Une entreprise lot-et-garonnaise développe actuellement des solutions innovantes pour mieux traiter les commotions cérébrales dans le sport, utilisant des capteurs intelligents pour un diagnostic précoce et un suivi personnalisé [1].
La médecine régénérative connaît des avancées spectaculaires. Les injections de plasma riche en plaquettes (PRP) et les thérapies cellulaires montrent des résultats prometteurs pour accélérer la cicatrisation des tissus mous [2]. Ces techniques, encore expérimentales il y a quelques années, entrent progressivement dans la pratique courante.
L'intelligence artificielle transforme également le diagnostic et le suivi. Des algorithmes analysent en temps réel les données biomécaniques pour prédire les risques de blessure et optimiser les programmes de prévention [3]. Cette approche prédictive pourrait révolutionner la médecine sportive dans les années à venir.
Une innovation particulièrement intéressante concerne le développement du score RECOWRIST pour évaluer la reprise d'activité après traumatisme du poignet chez le sportif [6]. Cet outil permet une approche plus objective et personnalisée de la décision de retour au sport. Parallèlement, de nouveaux protocoles de prise en charge émergent pour construire des parcours chirurgicaux optimisés pour les sportifs de haut niveau [7].
Vivre au Quotidien avec Traumatismes sportifs
Gérer un traumatisme sportif au quotidien nécessite des adaptations importantes dans votre mode de vie. La première étape consiste à accepter la blessure et à respecter les consignes médicales, même si cela implique une interruption temporaire de votre sport favori [13]. Cette période peut être psychologiquement difficile, surtout pour les sportifs passionnés.
L'adaptation de vos activités quotidiennes devient essentielle. Vous devrez peut-être modifier vos gestes au travail, utiliser des aides techniques ou réorganiser votre domicile pour faciliter vos déplacements [11]. L'important est de maintenir une activité physique adaptée pour éviter le démaladienement tout en respectant la zone blessée.
Le soutien de votre entourage joue un rôle crucial dans votre récupération. N'hésitez pas à communiquer sur vos difficultés et à accepter l'aide proposée. Rejoindre des groupes de patients ou des associations peut également vous apporter un soutien moral précieux [12].
Concrètement, établissez une routine quotidienne incluant vos soins, vos exercices de rééducation et vos activités adaptées. Fixez-vous des objectifs réalistes et célébrez chaque progrès, même petit. Cette approche positive favorise une meilleure récupération et prépare votre retour progressif au sport.
Les Complications Possibles
Bien que la plupart des traumatismes sportifs guérissent sans séquelles, certaines complications peuvent survenir et compromettre votre récupération. L'infection représente un risque majeur après une plaie ouverte ou une intervention chirurgicale. Les signes d'alerte incluent fièvre, rougeur, chaleur et écoulement purulent [12].
Les complications vasculaires sont plus rares mais potentiellement graves. Une thrombose veineuse peut se développer en cas d'immobilisation prolongée, particulièrement chez les patients à risque. C'est pourquoi la mobilisation précoce est désormais privilégiée [14]. Les troubles de la cicatrisation peuvent également retarder la guérison et nécessiter des traitements spécifiques.
À long terme, certains traumatismes peuvent évoluer vers des pathologies chroniques. L'arthrose post-traumatique constitue une complication redoutée, particulièrement après les fractures articulaires ou les entorses graves [10]. Cette évolution n'est heureusement pas systématique et dépend de nombreux facteurs.
Les complications psychologiques ne doivent pas être négligées. La peur de se reblesser, l'anxiété liée à la reprise sportive ou la dépression consécutive à l'arrêt forcé de l'activité peuvent nécessiter un accompagnement spécialisé [13]. Une prise en charge globale incluant l'aspect psychologique améliore significativement les résultats.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des traumatismes sportifs dépend de nombreux facteurs : type et gravité de la blessure, âge du patient, qualité de la prise en charge initiale et observance du traitement [2]. Globalement, les résultats sont encourageants avec plus de 85% de récupération complète pour les traumatismes bénins à modérés.
Les entorses simples guérissent généralement en 2 à 6 semaines avec un traitement approprié. Les fractures non déplacées consolident en 6 à 12 semaines selon l'os concerné. Pour les traumatismes plus complexes comme les ruptures ligamentaires, la récupération peut s'étendre sur plusieurs mois [12].
L'âge influence significativement le pronostic. Les jeunes sportifs récupèrent généralement plus rapidement et plus complètement que leurs aînés. Cependant, une prise en charge adaptée permet d'obtenir d'excellents résultats même chez les patients plus âgés [13]. La motivation et l'observance du patient jouent un rôle déterminant.
Les innovations thérapeutiques récentes améliorent constamment le pronostic. Les techniques chirurgicales mini-invasives, les nouveaux protocoles de rééducation et les thérapies régénératives permettent d'espérer des récupérations plus rapides et plus complètes [7]. L'important est de ne pas précipiter le retour au sport et de respecter les étapes de la guérison.
Peut-on Prévenir Traumatismes sportifs ?
La prévention des traumatismes sportifs constitue un enjeu majeur de santé publique. Des études récentes montrent qu'un programme de prévention neuromusculaire bien conçu peut réduire de 30 à 50% l'incidence des blessures [5]. Cette approche préventive représente un investissement rentable tant sur le plan humain qu'économique.
L'échauffement reste la base de toute prévention efficace. Il doit être progressif, spécifique au sport pratiqué et d'une durée minimale de 15 minutes. Un échauffement bien conduit prépare les muscles, les articulations et le système cardiovasculaire à l'effort [3]. Négligez cette étape et vous multipliez par trois votre risque de blessure.
Le renforcement musculaire ciblé constitue un autre pilier de la prévention. Les programmes d'exercices proprioceptifs et de stabilisation réduisent particulièrement les risques d'entorses de cheville et de genou [4]. Ces exercices doivent être intégrés régulièrement dans votre entraînement, pas seulement en période de récupération.
L'adaptation de l'équipement et de l'environnement joue également un rôle crucial. Des chaussures adaptées, un terrain en bon état, des protections appropriées peuvent prévenir de nombreux accidents [11]. N'oubliez pas non plus l'importance d'une alimentation équilibrée et d'un sommeil de qualité pour optimiser vos capacités de récupération.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont publié en 2024 de nouvelles recommandations pour la prise en charge des traumatismes sportifs. La Haute Autorité de Santé (HAS) insiste particulièrement sur l'importance d'une évaluation initiale rigoureuse et d'une prise en charge multidisciplinaire [2]. Ces guidelines s'appuient sur les dernières données de la littérature scientifique internationale.
Concernant les commotions cérébrales, les recommandations sont désormais très strictes. Tout sportif présentant des signes de commotion doit être immédiatement retiré de la compétition et ne peut reprendre qu'après un protocole de retour progressif validé par un médecin [1]. Cette approche vise à prévenir le syndrome du second impact, potentiellement mortel.
Pour les traumatismes du membre inférieur, les autorités recommandent une approche conservatrice privilégiant la rééducation fonctionnelle précoce. La chirurgie n'est envisagée qu'en cas d'échec du traitement médical ou de lésions spécifiques [8]. Cette stratégie permet de réduire les complications et d'accélérer le retour au sport.
Les pharmaciens ont désormais un rôle reconnu dans la prise en charge des pathologies traumatologiques du sportif [9]. Ils participent à l'éducation thérapeutique, au suivi de l'observance et à la détection des effets indésirables. Cette approche collaborative améliore la qualité des soins et la satisfaction des patients.
Ressources et Associations de Patients
De nombreuses ressources sont disponibles pour vous accompagner dans votre parcours de soins. La Société Française de Médecine du Sport (SFMS) propose des informations fiables et actualisées sur les traumatismes sportifs. Leur site internet regorge de conseils pratiques et de recommandations pour les sportifs [2].
Les associations de patients constituent un soutien précieux, particulièrement pour les traumatismes complexes nécessitant une rééducation prolongée. Elles organisent des groupes de parole, des activités adaptées et facilitent l'échange d'expériences entre patients. Ces structures jouent un rôle important dans l'accompagnement psychologique.
Au niveau local, les maisons sport-santé se développent rapidement sur tout le territoire français. Ces structures proposent un accompagnement personnalisé pour la reprise d'activité physique après un traumatisme [11]. Elles constituent un pont entre le monde médical et le monde sportif.
N'oubliez pas les ressources numériques. De nombreuses applications mobiles proposent des programmes d'exercices de rééducation, des conseils de prévention et un suivi de vos progrès. Cependant, ces outils ne remplacent jamais l'avis d'un professionnel de santé qualifié [13].
Nos Conseils Pratiques
Voici nos recommandations concrètes pour optimiser votre prise en charge et votre récupération. Tout d'abord, constituez un dossier médical complet incluant vos antécédents, vos examens et vos traitements. Cette documentation facilite le suivi par les différents professionnels de santé [12].
Apprenez à reconnaître les signaux d'alarme nécessitant une consultation urgente. Une douleur qui s'aggrave brutalement, un gonflement important, une perte de fonction ou des signes neurologiques doivent vous amener rapidement aux urgences [14]. Il vaut mieux consulter pour rien que de passer à côté d'une complication grave.
Respectez scrupuleusement les consignes de votre équipe soignante, même si elles vous semblent contraignantes. La tentation de reprendre trop tôt est grande, mais elle expose à des récidives ou des complications [13]. Votre patience aujourd'hui maladiene votre pratique sportive de demain.
Maintenez une activité physique adaptée pendant votre convalescence. Votre kinésithérapeute peut vous proposer des exercices spécifiques pour entretenir votre maladie physique tout en respectant la zone blessée [11]. Cette approche facilite votre retour au sport et prévient le démaladienement.
Quand Consulter un Médecin ?
Savoir quand consulter peut faire la différence entre une récupération rapide et des complications durables. Consultez immédiatement en cas de douleur intense, de déformation visible, d'impossibilité de bouger le membre blessé ou de signes neurologiques [12]. Ces symptômes peuvent signaler une fracture, une luxation ou une atteinte nerveuse nécessitant une prise en charge urgente.
Pour les traumatismes apparemment bénins, surveillez l'évolution pendant 48 heures. Si la douleur persiste ou s'aggrave, si le gonflement augmente ou si vous ne récupérez pas votre mobilité normale, une consultation s'impose [14]. N'attendez pas que la situation se dégrade pour agir.
Certaines situations nécessitent un avis spécialisé. Les sportifs de haut niveau, les patients avec des antécédents de blessures récidivantes ou ceux présentant des pathologies chroniques doivent bénéficier d'une prise en charge spécialisée en médecine du sport [2]. Cette expertise permet d'optimiser la récupération et de prévenir les récidives.
N'hésitez jamais à consulter en cas de doute. Votre médecin traitant peut vous orienter vers le bon spécialiste selon votre situation. Une prise en charge précoce et adaptée améliore considérablement le pronostic et réduit le risque de complications [13].
Questions Fréquentes
Combien de temps faut-il pour récupérer d'un traumatisme sportif ?
La durée de récupération varie selon le type et la gravité de la blessure. Les entorses simples guérissent en 2-6 semaines, les fractures en 6-12 semaines. Les traumatismes complexes peuvent nécessiter plusieurs mois de rééducation.
Peut-on prévenir tous les traumatismes sportifs ?
Non, mais 60% des traumatismes sportifs peuvent être évités par une préparation adéquate, un échauffement approprié et le respect des règles de sécurité. Les programmes de prévention réduisent de 30-50% l'incidence des blessures.
Quand reprendre le sport après une blessure ?
La reprise doit être progressive et validée par votre médecin. Elle dépend de la cicatrisation complète, de la récupération de la mobilité et de la force musculaire. Ne précipitez jamais votre retour au risque de récidive.
Les traumatismes sportifs laissent-ils des séquelles ?
La plupart des traumatismes guérissent sans séquelles avec une prise en charge appropriée. Cependant, certaines blessures peuvent évoluer vers l'arthrose ou des douleurs chroniques, d'où l'importance d'un traitement précoce et adapté.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Une entreprise lot-et-garonnaise mobilisée pour mieux traiter les commotions cérébrales dans le sportLien
- [2] Pourquoi la médecine sportive est essentielle pour les sportifs après un accidentLien
- [3] Traumatologie Sportive: Blessures & PréventionLien
- [4] Training-Related Sports Injury Patterns Among Elite Middle Distance RunnersLien
- [5] Outcomes of a randomized controlled trial of neuromuscular trainingLien
- [7] RECOWRIST: proposition originale de score de reprise de l'activité physique après traumatisme du poignet chez le patient sportifLien
- [8] Construire un parcours chirurgical pour le sportif de haut niveauLien
- [9] L'importance d'un diagnostic précis des traumatismes du poignet: ne pas passer à côté d'une fracture coronale de l'hamatum chez le sportifLien
- [10] Place du pharmacien dans la prise en charge des pathologies traumatologiques du sportifLien
- [12] Le poignet microtraumatique du sportifLien
- [13] Blessures et petits maux du sportifLien
- [14] Prise en charge des traumatismes liés au sport - BlessuresLien
- [15] Blessures sportives : Causes et conséquences à Paris 16Lien
- [16] Blessures sportives - Causes, Symptômes, TraitementLien
Publications scientifiques
- [PDF][PDF] Étude d'efficacité des techniques de retrait d'équipements sportifs chez des joueurs de football lors de traumatismes vertébraux suspectés en contexte … (2022)[PDF]
- RECOWRIST: proposition originale de score de reprise de l'activité physique après traumatisme du poignet chez le patient sportif (2023)
- Construire un parcours chirurgical pour le sportif de haut niveau (2024)
- L'importance d'un diagnostic précis des traumatismes du poignet: ne pas passer à côté d'une fracture coronale de l'hamatum chez le sportif (2024)
- Place du pharmacien dans la prise en charge des pathologies traumatologiques du sportif (2022)
Ressources web
- Prise en charge des traumatismes liés au sport - Blessures (msdmanuals.com)
Le diagnostic doit reposer sur une anamnèse et un examen clinique complets. L'anamnèse doit se concentrer sur le mécanisme de la lésion et le stress physique de ...
- Blessures sportives : Causes et conséquences à Paris 16 (jeromeaugerkine.com)
Le diagnostic d'une blessure sportive commence toujours par un examen clinique, réalisé par le médecin ou le médecin du sport. Des tests peuvent être effectués ...
- Blessures sportives - Causes, Symptômes, Traitement ... (ressourcessante.salutbonjour.ca)
Les blessures sportives sont généralement dues à des méthodes d'entraînement inadéquates, des anomalies structurelles, une faiblesse des muscles, des tendons ou ...
- Présentation des lésions sportives - Lésions et intoxications (msdmanuals.com)
Ces lésions entraînent souvent la déformation d'un membre, une douleur intense, un dysfonctionnement du membre ou de l'articulation et elles doivent être ...
- Les pathologies liées au sport - Institut de kinésithérapie (institut-kinesitherapie.paris)
Les différentes blessures sportives traitées en kinésithérapie · Entorse du genou · Entorse de la cheville · Blessures des enfants sportifs · Luxation de l'épaule.
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
