Thrombose : Symptômes, Traitements et Prévention - Guide Complet 2025
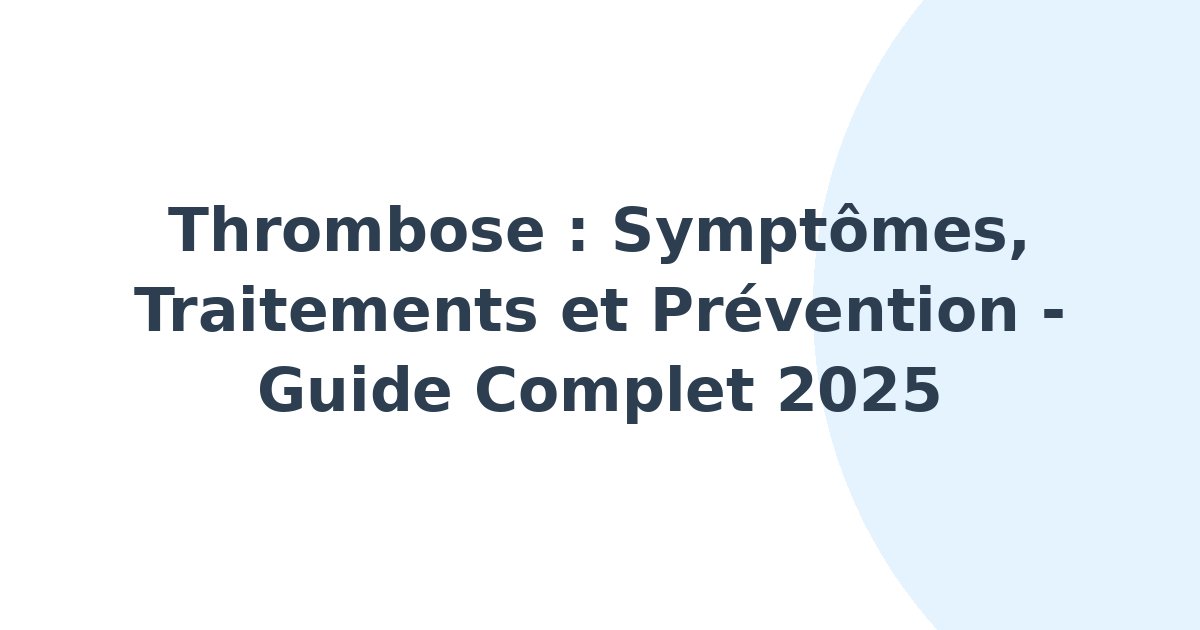
La thrombose correspond à la formation d'un caillot sanguin dans un vaisseau, bloquant partiellement ou totalement la circulation. Cette pathologie touche chaque année plus de 130 000 personnes en France selon Santé Publique France [1,2]. Comprendre ses mécanismes, reconnaître ses symptômes et connaître les traitements disponibles peut vous aider à mieux appréhender cette maladie cardiovasculaire majeure.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Thrombose : Définition et Vue d'Ensemble
La thrombose désigne la formation anormale d'un caillot sanguin, appelé thrombus, à l'intérieur d'un vaisseau sanguin. Ce processus pathologique peut survenir dans les veines (thrombose veineuse) ou les artères (thrombose artérielle) [6].
Mais qu'est-ce qui déclenche exactement cette formation de caillot ? En temps normal, votre sang circule librement dans vos vaisseaux grâce à un équilibre délicat entre coagulation et anticoagulation. Lorsque cet équilibre se rompt, un thrombus peut se former et obstruer la circulation sanguine [20].
La thrombose veineuse profonde (TVP) représente la forme la plus fréquente, touchant principalement les veines des jambes. D'ailleurs, elle peut évoluer vers une embolie pulmonaire si le caillot se détache et migre vers les poumons [1,4]. Cette complication grave nécessite une prise en charge médicale urgente.
Il faut savoir que la thrombose peut également affecter d'autres territoires vasculaires : veines cérébrales, abdominales ou encore rétiniennes [18]. Chaque localisation présente ses propres spécificités cliniques et thérapeutiques.
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques françaises révèlent l'ampleur de cette pathologie cardiovasculaire. En 2022, Santé Publique France rapporte une incidence annuelle de 1,84 pour 1000 habitants pour la maladie veineuse thromboembolique [1,2]. Cela représente environ 130 000 nouveaux cas chaque année dans notre pays.
L'analyse par tranches d'âge montre une augmentation progressive avec l'âge. Ainsi, l'incidence passe de 0,5 pour 1000 chez les 20-39 ans à plus de 5 pour 1000 après 70 ans [2,3]. Les femmes présentent un risque légèrement supérieur aux hommes, notamment en période de grossesse et post-partum.
Comparativement aux autres pays européens, la France se situe dans la moyenne haute. L'Allemagne affiche des taux similaires, tandis que les pays nordiques présentent des incidences légèrement inférieures [1]. Ces variations s'expliquent en partie par les différences de facteurs de risque populationnels et de systèmes de surveillance.
Les projections démographiques suggèrent une augmentation de 15 à 20% des cas d'ici 2030, principalement liée au vieillissement de la population [2,4]. Cette évolution représente un défi majeur pour notre système de santé, avec un coût estimé à plus de 2 milliards d'euros annuels.
Les Causes et Facteurs de Risque
La formation d'une thrombose résulte généralement de la combinaison de trois facteurs, décrits dans la triade de Virchow : stase veineuse, lésion de la paroi vasculaire et hypercoagulabilité [6]. Cette approche conceptuelle aide à comprendre pourquoi certaines situations favorisent la survenue de caillots.
Parmi les facteurs de risque majeurs, l'immobilisation prolongée occupe une place centrale. Un alitement de plus de 3 jours, un voyage en avion de longue durée ou une intervention chirurgique multiplient significativement le risque [20,21]. C'est pourquoi les médecins prescrivent souvent une prophylaxie anticoagulante dans ces situations.
Les facteurs génétiques jouent également un rôle important. Les déficits en protéine C, protéine S ou antithrombine, ainsi que la mutation du facteur V Leiden, prédisposent à la thrombose [6]. Ces anomalies héréditaires concernent environ 5% de la population générale.
D'autres pathologies augmentent considérablement le risque thrombotique. Le cancer multiplie par 4 à 7 le risque de thrombose, particulièrement les cancers digestifs, pulmonaires et gynécologiques [13,16]. Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) constituent également un facteur de risque reconnu [14].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de la thrombose varient considérablement selon sa localisation et son étendue. Pour la thrombose veineuse profonde des membres inférieurs, le tableau clinique associe typiquement douleur, œdème et sensation de lourdeur [20]. Mais attention, ces signes peuvent être trompeurs ou même absents dans 50% des cas.
La douleur thrombotique présente des caractéristiques particulières. Elle siège généralement au mollet ou à la cuisse, s'aggrave à la marche et peut s'accompagner d'une sensation de crampe persistante [21]. L'œdème, quant à lui, prédomine sur un seul membre et s'accompagne souvent d'une augmentation de la chaleur locale.
Certains signes doivent vous alerter immédiatement. Une douleur thoracique brutale, un essoufflement soudain ou des crachats sanglants peuvent signaler une embolie pulmonaire [20]. Cette complication grave nécessite une prise en charge médicale urgente, car elle peut engager le pronostic vital.
Les thromboses dans d'autres territoires présentent des symptômes spécifiques. Une thrombose cérébrale peut se manifester par des maux de tête intenses et inhabituels, tandis qu'une thrombose abdominale provoque des douleurs abdominales sévères [18]. Il est essentiel de consulter rapidement devant tout symptôme évocateur.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de thrombose repose sur une démarche structurée associant évaluation clinique et examens complémentaires. Votre médecin commence par évaluer la probabilité clinique à l'aide de scores validés comme celui de Wells [6]. Cette première étape oriente la suite de la prise en charge.
L'échographie-Doppler constitue l'examen de référence pour diagnostiquer une thrombose veineuse profonde. Cet examen non invasif permet de visualiser directement le caillot et d'évaluer son étendue [20,21]. Sa sensibilité dépasse 95% pour les thromboses proximales, mais elle peut être moins performante pour les thromboses distales.
Les D-dimères représentent un biomarqueur précieux, particulièrement pour exclure le diagnostic. Un taux normal de D-dimères chez un patient à faible probabilité clinique permet d'écarter une thrombose avec une excellente valeur prédictive négative [6]. Cependant, leur élévation n'est pas spécifique et peut s'observer dans de nombreuses situations.
Dans certains cas complexes, d'autres examens peuvent s'avérer nécessaires. L'angioscanner ou l'angio-IRM permettent d'explorer des territoires difficiles d'accès à l'échographie [21]. Ces techniques d'imagerie avancée offrent une vision précise de l'anatomie vasculaire et de l'extension thrombotique.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de la thrombose repose principalement sur l'anticoagulation, dont l'objectif est double : empêcher l'extension du caillot et prévenir les récidives [6]. Les modalités thérapeutiques ont considérablement évolué ces dernières années, offrant plus d'options aux patients et aux médecins.
Les anticoagulants oraux directs (AOD) ont révolutionné la prise en charge. Rivaroxaban, apixaban et dabigatran permettent un traitement simplifié sans surveillance biologique régulière [21]. Ces médicaments présentent une efficacité comparable aux traitements classiques avec un profil de sécurité souvent supérieur.
Dans certaines situations, l'héparine reste indispensable. Les héparines de bas poids moléculaire (HBPM) sont particulièrement utilisées chez la femme enceinte, en cas d'insuffisance rénale sévère ou lors de situations aiguës [6]. Leur administration sous-cutanée quotidienne nécessite un apprentissage de la technique d'injection.
La durée du traitement anticoagulant varie selon le contexte. Pour une première thrombose provoquée, 3 mois de traitement suffisent généralement. En revanche, une thrombose idiopathique ou récidivante peut justifier un traitement prolongé, voire à vie [20]. Cette décision doit toujours peser le bénéfice antithrombotique face au risque hémorragique.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque une période d'innovation majeure dans le traitement des thromboses. Les anticorps anti-facteur XI représentent une avancée prometteuse, avec Regeneron qui fait progresser deux anticorps vers des essais de phase 3 [10]. Cette approche thérapeutique pourrait révolutionner la prévention thrombotique en réduisant significativement le risque hémorragique.
Les nouvelles technologies transforment également la prise en charge. L'intelligence artificielle et les dispositifs connectés permettent désormais un suivi personnalisé des patients sous anticoagulants [8]. Ces outils innovants optimisent l'observance thérapeutique et détectent précocement les complications potentielles.
Les réseaux d'investigations cliniques se développent pour accélérer la recherche. Le programme REFeR-RYTHMO du CHU de Bordeaux illustre cette dynamique, créant des synergies entre centres experts pour tester de nouveaux dispositifs médicaux [9]. Cette approche collaborative favorise l'émergence de solutions thérapeutiques innovantes.
La recherche fondamentale explore de nouvelles cibles thérapeutiques. Les traitements de demain s'orientent vers une médecine personnalisée, tenant compte du profil génétique et des biomarqueurs individuels [7]. Cette approche sur mesure promet une efficacité optimisée avec des effets secondaires minimisés.
Vivre au Quotidien avec Thrombose
Vivre avec une thrombose nécessite certains ajustements, mais ne doit pas vous empêcher de mener une vie normale. L'adaptation de votre mode de vie constitue un élément clé de votre prise en charge globale [19]. Rassurez-vous, la plupart des patients retrouvent rapidement leurs activités habituelles.
L'activité physique régulière représente un pilier fondamental de votre rétablissement. La marche quotidienne favorise le retour veineux et réduit le risque de récidive [21]. Commencez progressivement et augmentez l'intensité selon vos capacités. Évitez cependant les sports de contact pendant la phase aiguë du traitement anticoagulant.
Le port de bas de compression peut soulager les symptômes résiduels et prévenir le syndrome post-thrombotique. Ces dispositifs médicaux exercent une pression graduée qui améliore la circulation veineuse [20]. Votre médecin vous prescrira la classe de compression adaptée à votre situation.
La gestion du traitement anticoagulant au quotidien demande une certaine organisation. Prenez vos médicaments à heure fixe et n'oubliez jamais une prise [19]. En cas de voyage, emportez toujours une réserve suffisante et gardez une ordonnance récente avec vous. Informez systématiquement tous vos soignants de votre traitement anticoagulant.
Les Complications Possibles
La thrombose peut évoluer vers plusieurs complications, dont la gravité varie considérablement. L'embolie pulmonaire constitue la complication la plus redoutable, survenant dans 10 à 20% des thromboses veineuses profondes non traitées [1,4]. Cette migration du caillot vers les poumons peut engager le pronostic vital et nécessite une prise en charge urgente.
Le syndrome post-thrombotique représente une complication chronique fréquente, touchant 20 à 50% des patients dans les deux ans suivant l'épisode initial [20]. Il se manifeste par des douleurs, un œdème persistant, des troubles trophiques cutanés et parfois des ulcères veineux. Cette séquelle peut altérer significativement la qualité de vie.
Les complications hémorragiques liées au traitement anticoagulant méritent une attention particulière. Le risque d'hémorragie majeure sous anticoagulants est estimé à 2-3% par an [21]. Ces saignements peuvent être digestifs, intracrâniens ou dans d'autres localisations. Une surveillance clinique régulière permet de détecter précocement ces complications.
Certaines localisations thrombotiques présentent des risques spécifiques. La thrombose cérébrale peut laisser des séquelles neurologiques, tandis que la thrombose abdominale peut compromettre la fonction des organes concernés [18]. Heureusement, un diagnostic précoce et un traitement adapté réduisent considérablement ces risques.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la thrombose s'est considérablement amélioré grâce aux progrès thérapeutiques récents. Avec un traitement anticoagulant adapté, la mortalité liée à l'embolie pulmonaire est passée sous la barre des 5% [1,2]. Cette amélioration spectaculaire témoigne de l'efficacité des protocoles de prise en charge actuels.
Le risque de récidive constitue un enjeu majeur à long terme. Après un premier épisode, le risque de récurrence est d'environ 10% la première année, puis de 5% par an les années suivantes [6]. Ce risque varie selon le contexte initial : plus faible pour les thromboses provoquées, plus élevé pour les formes idiopathiques.
Plusieurs facteurs influencent le pronostic individuel. L'âge, les comorbidités, l'extension initiale du thrombus et la réponse au traitement modulent l'évolution [20,21]. Les patients jeunes sans facteur de risque persistant ont généralement un excellent pronostic, tandis que les sujets âgés avec cancer présentent un risque plus élevé de complications.
La qualité de vie après thrombose dépend largement de la prévention des complications chroniques. Un suivi médical régulier, le respect du traitement et l'adoption d'un mode de vie adapté permettent à la majorité des patients de retrouver une vie normale [19]. L'important est de maintenir une relation de confiance avec votre équipe soignante.
Peut-on Prévenir Thrombose ?
La prévention de la thrombose repose sur l'identification et la gestion des facteurs de risque modifiables. Cette approche préventive s'avère particulièrement efficace chez les patients à risque élevé [14]. Concrètement, plusieurs mesures simples peuvent réduire significativement votre risque thrombotique.
La mobilisation précoce constitue la mesure préventive la plus importante. Évitez les immobilisations prolongées, levez-vous régulièrement lors de longs voyages et reprenez rapidement la marche après une intervention chirurgicale [21]. Ces gestes simples maintiennent une circulation veineuse efficace.
La prophylaxie pharmacologique s'impose dans certaines situations à haut risque. Les patients hospitalisés, les femmes enceintes à risque ou les personnes subissant une chirurgie majeure bénéficient d'un traitement anticoagulant préventif [13,16]. Cette approche a démontré son efficacité pour réduire l'incidence des thromboses nosocomiales.
L'adoption d'un mode de vie sain contribue également à la prévention. L'activité physique régulière, le maintien d'un poids optimal et l'arrêt du tabac réduisent le risque thrombotique [20]. Chez les patients avec MICI, un contrôle optimal de l'inflammation intestinale diminue le risque de complications thrombotiques [14].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont publié des recommandations actualisées pour optimiser la prise en charge de la thrombose. Santé Publique France souligne l'importance d'une surveillance épidémiologique renforcée, particulièrement dans le contexte post-COVID [1,2]. Cette vigilance permet d'adapter les stratégies préventives aux évolutions épidémiologiques.
La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise une approche personnalisée du traitement anticoagulant. Les recommandations 2024 insistent sur l'évaluation individuelle du rapport bénéfice-risque pour déterminer la durée optimale du traitement [3]. Cette approche sur mesure améliore l'efficacité tout en minimisant les effets indésirables.
L'INSERM met l'accent sur la recherche translationnelle pour développer de nouvelles approches thérapeutiques [6]. Les programmes de recherche actuels explorent notamment les biomarqueurs prédictifs de récidive et les nouvelles cibles thérapeutiques. Ces travaux ouvrent la voie à une médecine de précision en thrombose.
Les sociétés savantes européennes harmonisent leurs recommandations pour améliorer la prise en charge transfrontalière. Cette coordination internationale facilite les échanges de bonnes pratiques et accélère la diffusion des innovations thérapeutiques [5]. Les patients bénéficient ainsi d'une prise en charge standardisée de haute qualité.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations accompagnent les patients atteints de thrombose dans leur parcours de soins. Ces structures offrent information, soutien psychologique et partage d'expériences entre patients [19]. Leur rôle s'avère particulièrement précieux lors de l'annonce du diagnostic et pendant la phase d'adaptation au traitement.
L'Association Française de Lutte contre les Thromboses propose des ressources éducatives et organise des rencontres régionales. Leurs brochures explicatives aident à mieux comprendre la maladie et ses traitements. D'ailleurs, leur site internet regorge de conseils pratiques pour la vie quotidienne sous anticoagulants.
Les réseaux sociaux spécialisés permettent d'échanger avec d'autres patients confrontés aux mêmes défis. Ces communautés virtuelles offrent un soutien moral précieux et partagent des astuces pratiques [19]. Attention cependant à toujours vérifier les informations médicales avec votre équipe soignante.
Votre pharmacien constitue également une ressource précieuse au quotidien. Il peut vous conseiller sur la prise de vos médicaments, détecter les interactions potentielles et vous orienter vers des dispositifs d'aide à l'observance. N'hésitez pas à le solliciter pour toute question pratique concernant votre traitement.
Nos Conseils Pratiques
Gérer une thrombose au quotidien nécessite quelques adaptations simples mais importantes. Organisez votre traitement en utilisant un pilulier hebdomadaire pour éviter les oublis [19]. Programmez une alarme sur votre téléphone si nécessaire. Cette régularité dans la prise médicamenteuse optimise l'efficacité du traitement.
Lors de vos déplacements, emportez toujours une réserve de médicaments dans votre bagage à main. Gardez votre ordonnance récente avec vous et informez-vous sur les noms commerciaux de vos médicaments dans le pays de destination. Ces précautions évitent les ruptures de traitement potentiellement dangereuses.
Adaptez votre alimentation sans tomber dans l'excès. Contrairement aux idées reçues, les patients sous anticoagulants modernes n'ont pas de restrictions alimentaires strictes [21]. Maintenez simplement une alimentation équilibrée et évitez les excès d'alcool qui peuvent interférer avec certains traitements.
Surveillez l'apparition de signes d'alerte sans devenir anxieux. Apprenez à reconnaître les symptômes d'hémorragie (saignements inhabituels, hématomes spontanés) et d'embolie pulmonaire (essoufflement, douleur thoracique) [20]. Cette vigilance éclairée vous permet de réagir rapidement si nécessaire tout en conservant une vie normale.
Quand Consulter un Médecin ?
Certaines situations nécessitent une consultation médicale urgente. Tout essoufflement brutal, douleur thoracique intense ou crachat sanglant doit vous amener immédiatement aux urgences [20]. Ces symptômes peuvent signaler une embolie pulmonaire, complication grave nécessitant un traitement immédiat.
Les signes hémorragiques sous anticoagulants méritent également une attention particulière. Consultez rapidement en cas de saignement abondant, d'hématomes spontanés importants ou de sang dans les urines ou les selles [21]. Votre médecin évaluera la nécessité d'ajuster votre traitement.
Une consultation programmée s'impose lors de l'apparition de nouveaux symptômes évocateurs de récidive. Douleur et gonflement d'un membre, sensation de lourdeur inhabituelle ou modification de la coloration cutanée doivent vous alerter [20]. Un diagnostic précoce améliore significativement le pronostic.
N'hésitez pas à contacter votre médecin pour toute question concernant votre traitement. Interactions médicamenteuses, effets secondaires inhabituels ou doutes sur la conduite à tenir méritent un avis médical [19]. Cette communication ouverte avec votre équipe soignante optimise votre prise en charge.
Questions Fréquentes
Puis-je faire du sport avec une thrombose ? L'activité physique est non seulement autorisée mais recommandée après la phase aiguë. Commencez par la marche puis reprenez progressivement vos activités habituelles. Évitez temporairement les sports de contact pendant le traitement anticoagulant [21].Combien de temps dure le traitement ? La durée varie selon votre situation : 3 mois pour une première thrombose provoquée, 6 mois à vie pour les formes récidivantes ou idiopathiques. Votre médecin réévalue régulièrement cette durée [6,20].
Puis-je voyager sous anticoagulants ? Absolument, avec quelques précautions. Levez-vous régulièrement, portez vos bas de compression et emportez vos médicaments en quantité suffisante. Informez votre médecin de vos projets de voyage [19,21].
Que faire en cas d'oubli de prise ? Prenez votre médicament dès que vous vous en apercevez, sauf si c'est presque l'heure de la prise suivante. Ne doublez jamais la dose. En cas de doute, contactez votre pharmacien ou votre médecin [19].
Actes médicaux associés
Les actes CCAM suivants peuvent être pratiqués dans le cadre de Thrombose :
Questions Fréquentes
Puis-je faire du sport avec une thrombose ?
L'activité physique est non seulement autorisée mais recommandée après la phase aiguë. Commencez par la marche puis reprenez progressivement vos activités habituelles. Évitez temporairement les sports de contact pendant le traitement anticoagulant.
Combien de temps dure le traitement anticoagulant ?
La durée varie selon votre situation : 3 mois pour une première thrombose provoquée, 6 mois à vie pour les formes récidivantes ou idiopathiques. Votre médecin réévalue régulièrement cette durée.
Puis-je voyager sous anticoagulants ?
Absolument, avec quelques précautions. Levez-vous régulièrement, portez vos bas de compression et emportez vos médicaments en quantité suffisante. Informez votre médecin de vos projets de voyage.
Que faire en cas d'oubli de prise de médicament ?
Prenez votre médicament dès que vous vous en apercevez, sauf si c'est presque l'heure de la prise suivante. Ne doublez jamais la dose. En cas de doute, contactez votre pharmacien ou votre médecin.
Quels sont les signes d'une récidive ?
Douleur et gonflement d'un membre, sensation de lourdeur inhabituelle ou modification de la coloration cutanée doivent vous alerter. Consultez rapidement votre médecin en cas de nouveaux symptômes évocateurs.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Épidémiologie de la maladie veineuse thromboembolique en France - Santé Publique France 2024-2025Lien
- [2] Épidémiologie de la maladie veineuse thromboembolique - Santé Publique France 2024-2025Lien
- [3] Épidémiologie de la maladie veineuse thromboembolique - Santé Publique France 2024-2025Lien
- [4] Épidémiologie de la maladie veineuse thromboembolique en France - Santé Publique France 2024-2025Lien
- [5] Épidémiologie des cardiopathies ischémiques en France - Santé Publique France 2024-2025Lien
- [6] Thrombose veineuse (Phlébite) - INSERMLien
- [7] Insuffisance cardiaque : les traitements de demain au cœur de la recherche - Innovation 2024-2025Lien
- [8] Comment les nouvelles technologies peuvent améliorer la prise en charge - Innovation 2024-2025Lien
- [9] Innovation réseaux d'investigations cliniques - CHU Bordeaux 2024-2025Lien
- [10] Regeneron to Advance Two Factor XI Antibodies - Innovation 2024-2025Lien
- [11] Incyte Announces Results of Phase 3 Clinical Trials - Innovation 2024-2025Lien
- [12] Les thromboses veineuses en pédiatrie - M Leleu, B Laruelle 2023Lien
- [13] Prévention et prise en charge des thromboses associées au cancer - D Malka, N Girard 2023Lien
- [14] Prévention du risque de thrombose au cours des MICI - M Fumery 2022Lien
- [15] Tumorassoziierte Thrombose - R Bauersachs 2023Lien
- [16] Prévenir la thrombose : traitements à envisager pour la thrombose associée au cancer - LA Sardo, JA Bayadinova 2023Lien
- [17] Daten zur Hirnvenen-thrombose bei VITTLien
- [18] Thrombose veineuse abdominale : à propos de 51 cas - R Boukhzar, RB Salah 2023Lien
- [19] Prévenir la thrombose : Ce que veulent savoir les patients atteints de cancer - JA Bayadinova, LA Sardo 2022Lien
- [20] Les symptômes et les complications de la thrombose - VIDALLien
- [21] Thrombose : définition, symptômes et traitement - ELSANLien
Publications scientifiques
- Les thromboses veineuses en pédiatrie (2023)1 citations
- Prévention et prise en charge des thromboses associées au cancer: questions pratiques à propos de l'anticoagulation (2023)3 citations
- [PDF][PDF] Prévention du risque de thrombose au cours des MICI (2022)1 citations[PDF]
- Tumorassoziierte Thrombose (2023)2 citations
- «Prévenir la thrombose»: traitements à envisager pour la thrombose associée au cancer (2023)[PDF]
Ressources web
- Les symptômes et les complications de la thrombose ... (vidal.fr)
1 juil. 2022 — Une phlébite d'une grosse veine entraîne une vive douleur dans le mollet ou la cuisse, parfois le bras. Des crampes, un engourdissement ou une ...
- Thrombose veineuse (Phlébite) · Inserm, La science pour ... (inserm.fr)
Rougeur, œdème, douleur au niveau de la jambe ou du mollet : la triade de symptômes typiquement associée à la thrombose veineuse doit alerter les patients et ...
- Thrombose : définition, symptômes et traitement (elsan.care)
Pour confirmer le diagnostic de thrombose, le médecin prend généralement en compte les antécédents de phlébite ou d'embolie pulmonaire du patient et de sa ...
- Le diagnostic des thromboses veineuses (vidal.fr)
1 juil. 2022 — Pour confirmer son diagnostic, le médecin fait effectuer une échographie doppler (qui permet de visualiser le blocage du flux sanguin en passant ...
- Thrombose veineuse (chuv.ch)
8 mai 2019 — Examen au diagnostic Si elle est faible, une prise de sang est requise pour mesurer les D-dimères qui, si son taux est bas, permet d'exclure la ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
