Anévrysme de l'aorte abdominale : Guide Complet 2025 | Symptômes, Traitements
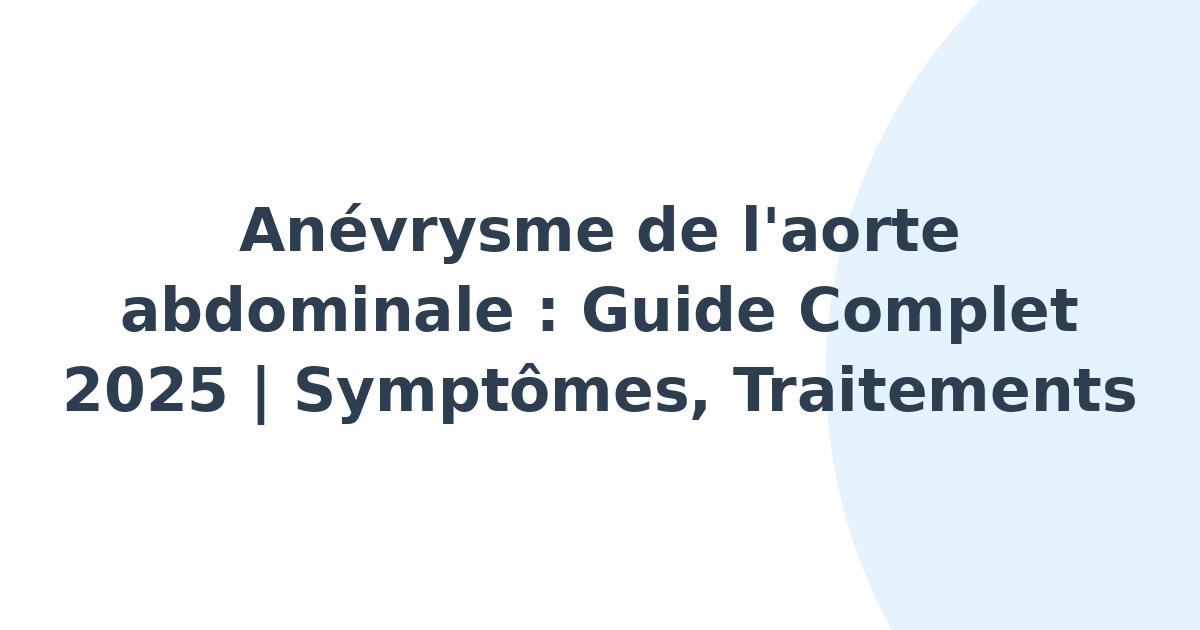
L'anévrysme de l'aorte abdominale représente une dilatation anormale de l'artère principale de l'abdomen. Cette pathologie vasculaire touche principalement les hommes de plus de 65 ans et nécessite une surveillance médicale rigoureuse. Bien que souvent silencieux, cet anévrysme peut présenter des complications graves s'il n'est pas détecté à temps.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Anévrysme de l'aorte abdominale : Définition et Vue d'Ensemble
L'anévrysme de l'aorte abdominale correspond à une dilatation permanente de l'aorte abdominale dont le diamètre dépasse 30 millimètres ou augmente de plus de 50% par rapport à la normale [14]. Cette artère principale transporte le sang oxygéné du cœur vers les organes abdominaux et les membres inférieurs.
Imaginez l'aorte comme un tuyau d'arrosage : avec le temps et sous l'effet de différents facteurs, une zone peut se dilater et former une poche. C'est exactement ce qui se passe avec l'anévrysme. La paroi artérielle s'affaiblit progressivement, créant cette dilatation caractéristique [15].
On distingue plusieurs types d'anévrismes selon leur localisation. L'anévrysme sous-rénal se situe en dessous des artères rénales et représente 95% des cas. L'anévrysme sus-rénal implique les artères rénales et nécessite une prise en charge plus complexe [6]. D'ailleurs, certaines pathologies comme la maladie de Takayasu peuvent révéler des anévrismes dans des localisations inhabituelles [6].
La taille de l'anévrysme détermine largement la stratégie thérapeutique. Un diamètre inférieur à 40 mm justifie généralement une surveillance. Entre 40 et 55 mm, la décision thérapeutique dépend de plusieurs facteurs. Au-delà de 55 mm chez l'homme et 50 mm chez la femme, une intervention est habituellement recommandée [1].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, l'anévrysme de l'aorte abdominale touche environ 2 à 5% des hommes de plus de 65 ans et moins de 1% des femmes du même âge [7]. Cette différence marquée entre les sexes s'explique par des facteurs hormonaux et comportementaux, notamment le tabagisme historiquement plus fréquent chez les hommes.
L'incidence annuelle française s'établit autour de 10 à 15 nouveaux cas pour 100 000 habitants, avec une tendance à l'augmentation liée au vieillissement de la population [7]. Mais cette augmentation apparente pourrait aussi refléter une meilleure détection grâce aux progrès de l'imagerie médicale.
Comparativement, les pays nordiques européens présentent des taux plus élevés, atteignant 6 à 8% chez les hommes de plus de 65 ans. Cette variation géographique suggère l'influence de facteurs génétiques et environnementaux spécifiques [5]. Les États-Unis rapportent des chiffres similaires à l'Europe du Nord, avec environ 200 000 nouveaux diagnostics annuels.
L'analyse bibliométrique récente révèle une évolution des recherches sur cette pathologie, avec un focus croissant sur les biomarqueurs et les techniques mini-invasives [5]. Les projections démographiques suggèrent une augmentation de 20 à 30% des cas d'ici 2030, principalement due au vieillissement de la génération du baby-boom.
L'impact économique sur le système de santé français représente environ 150 millions d'euros annuels, incluant les coûts de dépistage, surveillance et traitement. Cette charge financière justifie l'intérêt croissant pour les programmes de dépistage ciblé [7].
Les Causes et Facteurs de Risque
L'athérosclérose constitue la cause principale de l'anévrysme de l'aorte abdominale, représentant plus de 90% des cas [14]. Cette maladie des artères se caractérise par l'accumulation de plaques lipidiques dans la paroi artérielle, fragilisant progressivement sa structure.
Le tabagisme multiplie par 4 à 8 le risque de développer un anévrysme. En fait, 80% des patients présentant cette pathologie sont ou ont été fumeurs [15]. La nicotine et les substances toxiques du tabac accélèrent la dégradation des fibres élastiques de la paroi aortique.
L'âge représente un facteur incontournable : le risque double tous les 10 ans après 55 ans. Chez les hommes, la prévalence passe de 1% à 50 ans à plus de 10% après 80 ans. Les femmes développent généralement des anévrismes 10 ans plus tard que les hommes, probablement grâce à la protection hormonale œstrogénique [14].
Certaines pathologies inflammatoires peuvent révéler des anévrismes atypiques. La maladie de Behçet, par exemple, peut provoquer des manifestations rénales liées à un anévrysme de l'aorte abdominale [8]. D'ailleurs, les recherches récentes s'intéressent au rôle de l'homéostasie mitochondriale dans le développement de cette pathologie [9].
Les facteurs génétiques jouent également un rôle important. Un antécédent familial d'anévrysme multiplie le risque par 2 à 4. Les études génétiques récentes identifient de nouveaux gènes candidats, ouvrant des perspectives pour une médecine personnalisée [4].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
La majorité des anévrismes de l'aorte abdominale restent asymptomatiques pendant des années, d'où leur surnom de "tueur silencieux" [14]. Cette absence de symptômes explique pourquoi 75% des anévrismes sont découverts fortuitement lors d'examens réalisés pour d'autres motifs.
Quand des symptômes apparaissent, ils peuvent inclure des douleurs abdominales sourdes et persistantes, souvent localisées dans la région ombilicale ou le flanc gauche. Ces douleurs peuvent irradier vers le dos, simulant parfois une lombalgie. Certains patients décrivent une sensation de battements dans l'abdomen, particulièrement perceptible en position allongée [15].
La rupture d'anévrysme constitue l'urgence absolue. Elle se manifeste par une douleur abdominale brutale et intense, souvent accompagnée de douleurs dorsales, de malaise général et de signes de choc. Cette situation engage le pronostic vital et nécessite une intervention chirurgicale immédiate [14].
D'autres symptômes peuvent révéler un anévrysme : une masse abdominale pulsatile palpable, des troubles digestifs inexpliqués, ou encore des signes d'embolie périphérique. Mais attention, ces manifestations restent rares et non spécifiques [15].
Il est important de noter que la taille de l'anévrysme ne corrèle pas toujours avec l'intensité des symptômes. Un petit anévrysme peut parfois être plus symptomatique qu'un anévrysme de grande taille, selon sa localisation et sa forme.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic d'anévrysme de l'aorte abdominale repose principalement sur l'imagerie médicale. L'échographie abdominale constitue l'examen de première intention, simple, non invasif et très fiable pour mesurer le diamètre aortique [10]. Cette technique permet de détecter 95% des anévrismes avec une précision de ±2 millimètres.
Le scanner abdominal avec injection de produit de contraste représente l'examen de référence. Il précise l'anatomie de l'anévrysme, ses rapports avec les artères rénales et viscérales, et recherche d'éventuelles complications comme une fissuration [1]. Cet examen guide la stratégie thérapeutique en fournissant toutes les mesures nécessaires.
Certains patients bénéficient d'un dépistage opportuniste lors d'une échocardiographie. Cette approche s'avère particulièrement utile chez les patients coronariens, population à risque élevé d'anévrysme [10]. Mais cette pratique reste débattue quant à son rapport coût-efficacité.
L'IRM peut être proposée en cas de contre-indication au scanner ou pour une évaluation plus précise des rapports anatomiques. Elle évite l'irradiation et l'injection de produit de contraste iodé, particulièrement intéressante chez les patients insuffisants rénaux [1].
Les critères de dépistage évoluent avec les nouvelles données épidémiologiques. Les recommandations récentes questionnent la pertinence des critères actuels et proposent des approches plus personnalisées [7]. L'objectif reste d'identifier les anévrismes avant qu'ils n'atteignent une taille critique.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge de l'anévrysme de l'aorte abdominale dépend essentiellement de sa taille et de son évolution. Pour les anévrismes de petit diamètre (< 40 mm), la surveillance régulière constitue l'approche standard, avec une échographie tous les 2 à 3 ans [14].
La chirurgie ouverte reste la technique de référence pour les anévrismes volumineux. Elle consiste à remplacer le segment anévrismal par une prothèse vasculaire. Bien que plus invasive, cette technique offre une durabilité excellente avec un taux de succès supérieur à 95% [15].
Le traitement endovasculaire (EVAR) révolutionne la prise en charge depuis les années 2000. Cette technique mini-invasive consiste à introduire une endoprothèse par voie fémorale pour exclure l'anévrysme de la circulation. Elle réduit significativement la morbi-mortalité périopératoire, particulièrement chez les patients âgés [1].
Certaines situations complexes nécessitent une chirurgie hybride, combinant techniques ouvertes et endovasculaires. Cette approche s'avère particulièrement utile pour les anévrismes étendus ou associés à des lésions artérielles digestives [13]. Ces techniques permettent de traiter des cas auparavant inopérables.
Le traitement médical accompagne toujours la prise en charge. Il vise à contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire : arrêt du tabac, traitement de l'hypertension artérielle, prescription de statines. Ces mesures ralentissent la progression de l'anévrysme et réduisent le risque cardiovasculaire global [14].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les innovations 2024-2025 transforment la prise en charge de l'anévrysme de l'aorte abdominale. Les nouvelles endoprothèses fenêtrées et branchées permettent désormais de traiter des anévrismes complexes impliquant les artères viscérales, élargissant considérablement les indications du traitement endovasculaire [1,2].
La planification 3D et la réalité augmentée révolutionnent la préparation chirurgicale. Ces technologies permettent une visualisation précise de l'anatomie patient-spécifique et une simulation préopératoire, réduisant les complications et optimisant les résultats [3]. Les chirurgiens peuvent désormais "répéter" l'intervention avant de la réaliser.
Les recherches génétiques ouvrent des perspectives passionnantes pour une médecine personnalisée. L'identification de nouveaux biomarqueurs génétiques pourrait permettre de prédire l'évolution des anévrismes et d'adapter les traitements [4]. Cette approche pourrait révolutionner le dépistage et la surveillance.
L'intelligence artificielle s'invite dans l'analyse des images médicales. Les algorithmes de deep learning améliorent la détection automatique des anévrismes et prédisent leur évolution avec une précision croissante [5]. Ces outils d'aide au diagnostic pourraient standardiser et améliorer la prise en charge.
Les thérapies régénératives représentent l'avenir du traitement. Les recherches sur les cellules souches et l'ingénierie tissulaire visent à développer des greffons biologiques capables de se régénérer. Bien qu'encore expérimentales, ces approches pourraient transformer radicalement le traitement des anévrismes [3].
Vivre au Quotidien avec un Anévrysme de l'aorte abdominale
Recevoir un diagnostic d'anévrysme de l'aorte abdominale bouleverse souvent la vie quotidienne. Mais rassurez-vous, la majorité des patients mènent une vie normale avec quelques adaptations [14]. L'important est de comprendre que cette pathologie se gère très bien avec un suivi médical approprié.
Les activités physiques restent généralement autorisées, mais doivent être adaptées. Les sports d'endurance modérée comme la marche, la natation ou le vélo sont recommandés. En revanche, il faut éviter les efforts intenses avec manœuvre de Valsalva (haltérophilie, sports de combat) qui augmentent brutalement la pression artérielle [15].
La surveillance régulière constitue le pilier de la prise en charge. Selon la taille de l'anévrysme, les contrôles s'échelonnent de 6 mois à 3 ans. Cette surveillance permet de détecter précocement une évolution et d'adapter le traitement si nécessaire [14].
L'aspect psychologique ne doit pas être négligé. Vivre avec un anévrysme génère parfois de l'anxiété, particulièrement chez les patients conscients des risques de rupture. Un accompagnement psychologique peut s'avérer bénéfique, ainsi que l'adhésion à des groupes de patients [15].
Les voyages restent possibles, mais nécessitent quelques précautions. Il est recommandé d'emporter ses derniers examens et de connaître les coordonnées d'un centre vasculaire dans la région visitée. L'assurance voyage doit couvrir cette pathologie préexistante.
Les Complications Possibles
La rupture d'anévrysme représente la complication la plus redoutable, avec une mortalité de 80 à 90% en cas de rupture libre dans la cavité péritonéale [14]. Cette urgence absolue nécessite une intervention chirurgicale immédiate. Heureusement, le risque de rupture reste faible pour les anévrismes de petit diamètre : moins de 1% par an pour les anévrismes de 40-50 mm.
La fissuration constitue un stade intermédiaire entre l'anévrysme stable et la rupture. Elle se manifeste par des douleurs abdominales ou dorsales intenses et nécessite une prise en charge urgente. Cette complication peut précéder de quelques heures à quelques jours une rupture complète [15].
Les embolies périphériques résultent de la migration de fragments du thrombus intraluminal présent dans l'anévrysme. Ces emboles peuvent obstruer les artères des membres inférieurs, provoquant douleurs, refroidissement et parfois ischémie sévère [12]. Cette complication justifie parfois un traitement préventif.
Certaines complications sont spécifiques aux malformations associées. L'association avec un rein en fer à cheval, par exemple, complique la prise en charge chirurgicale et nécessite une expertise particulière [11]. Ces situations rares requièrent une approche multidisciplinaire.
Les complications post-opératoires incluent les infections de prothèse, les fuites (endoleaks) après traitement endovasculaire, et les complications générales liées à l'intervention. Le suivi post-opératoire vise à détecter précocement ces complications pour les traiter rapidement [1].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'anévrysme de l'aorte abdominale dépend principalement de sa taille et de sa vitesse d'évolution. Pour les petits anévrismes (< 40 mm), le pronostic est excellent avec un risque de rupture inférieur à 1% par an [14]. La surveillance régulière permet de détecter toute évolution et d'adapter la prise en charge.
Les anévrismes de taille intermédiaire (40-55 mm) présentent un risque de rupture de 1 à 5% par an selon leur taille exacte. La décision thérapeutique tient compte de l'âge du patient, de ses comorbidités et de l'évolution de l'anévrysme. Une croissance rapide (> 5 mm/an) peut justifier un traitement préventif [15].
Après traitement chirurgical, le pronostic est généralement favorable. La chirurgie ouverte offre une durabilité excellente avec un taux de survie à 10 ans de 60-70%, comparable à la population générale du même âge. Le traitement endovasculaire présente des résultats similaires à moyen terme [1].
L'âge au diagnostic influence significativement le pronostic. Les patients de moins de 70 ans ont généralement un pronostic plus favorable, tant en termes de survie que de qualité de vie post-opératoire. Cependant, l'amélioration des techniques chirurgicales permet désormais de traiter des patients de plus en plus âgés [15].
Les facteurs pronostiques incluent également le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire. L'arrêt du tabac, le traitement de l'hypertension et la prise de statines améliorent significativement le pronostic à long terme [14].
Peut-on Prévenir l'Anévrysme de l'aorte abdominale ?
La prévention primaire de l'anévrysme de l'aorte abdominale repose sur le contrôle des facteurs de risque modifiables. L'arrêt du tabac constitue la mesure la plus efficace, réduisant de 50% le risque de développer un anévrysme [14]. Cette mesure bénéficie à tous les âges, même après des décennies de tabagisme.
Le dépistage ciblé représente une forme de prévention secondaire. Les recommandations actuelles préconisent un dépistage échographique unique chez les hommes de 65-75 ans ayant des antécédents tabagiques. Cette stratégie permet de détecter les anévrismes avant qu'ils n'atteignent une taille critique [7].
Le contrôle de l'hypertension artérielle ralentit la progression des anévrismes existants et pourrait prévenir leur apparition. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) semblent particulièrement bénéfiques, au-delà de leur effet hypotenseur [15].
L'activité physique régulière et modérée exerce un effet protecteur sur le système cardiovasculaire. Elle améliore la fonction endothéliale et réduit l'inflammation chronique, deux mécanismes impliqués dans la formation des anévrismes [14].
Les recherches actuelles explorent de nouvelles pistes préventives. L'utilisation de biomarqueurs pourrait permettre d'identifier précocement les patients à risque et d'adapter les mesures préventives. Ces approches personnalisées représentent l'avenir de la prévention [4].
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié ses dernières recommandations sur la prise en charge de l'anévrysme de l'aorte abdominale, intégrant les innovations thérapeutiques récentes [1]. Ces guidelines définissent les critères de dépistage, les seuils d'intervention et les modalités de surveillance.
Concernant le dépistage, les autorités recommandent une échographie abdominale unique chez les hommes de 65 à 75 ans ayant des antécédents tabagiques. Cette recommandation fait actuellement l'objet de débats, certains experts plaidant pour un élargissement des critères [7].
Les seuils d'intervention sont clairement définis : 55 mm chez l'homme, 50 mm chez la femme, ou croissance > 10 mm/an. Ces seuils tiennent compte du rapport bénéfice-risque de l'intervention selon le sexe et l'âge du patient [1].
La Société Française de Chirurgie Vasculaire actualise régulièrement ses recommandations techniques. Elle préconise une approche multidisciplinaire associant chirurgiens vasculaires, radiologues interventionnels et anesthésistes-réanimateurs [3].
Au niveau européen, les guidelines de l'European Society for Vascular Surgery (ESVS) convergent largement avec les recommandations françaises. Elles insistent particulièrement sur l'importance du suivi post-opératoire et de la formation des équipes [1]. Ces recommandations internationales facilitent l'harmonisation des pratiques.
Ressources et Associations de Patients
L'Association Française de Chirurgie Vasculaire propose des ressources éducatives destinées aux patients et à leurs familles. Son site internet offre des fiches d'information actualisées et des témoignages de patients [3]. Ces ressources aident à mieux comprendre la pathologie et ses traitements.
La Fédération Française de Cardiologie organise régulièrement des conférences grand public sur les maladies vasculaires. Ces événements permettent aux patients de rencontrer des spécialistes et d'échanger avec d'autres personnes concernées par cette pathologie.
Les centres hospitaliers universitaires développent des programmes d'éducation thérapeutique spécifiquement dédiés aux patients porteurs d'anévrysme. Ces programmes abordent les aspects médicaux, psychologiques et sociaux de la maladie [1].
Les forums en ligne et groupes de soutien permettent aux patients d'échanger leurs expériences. Bien que ces plateformes ne remplacent pas l'avis médical, elles offrent un soutien moral précieux et des conseils pratiques du quotidien.
Les applications mobiles de suivi médical se développent pour aider les patients à gérer leur surveillance. Elles permettent de programmer les rendez-vous, suivre l'évolution des examens et recevoir des rappels personnalisés. Ces outils numériques complètent utilement le suivi médical traditionnel.
Nos Conseils Pratiques
Adoptez un mode de vie sain en privilégiant une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes, et pauvre en graisses saturées. Cette approche nutritionnelle contribue à ralentir la progression de l'athérosclérose et à maintenir un poids optimal [14].
Surveillez votre tension artérielle régulièrement, idéalement à domicile avec un tensiomètre automatique. Notez vos mesures dans un carnet que vous présenterez à votre médecin. Une tension bien contrôlée ralentit l'évolution de l'anévrysme [15].
Respectez scrupuleusement vos rendez-vous de surveillance. Ces contrôles réguliers permettent de détecter précocement toute évolution de l'anévrysme. N'hésitez pas à reporter un rendez-vous plutôt que de l'annuler définitivement.
Préparez vos consultations en listant vos questions à l'avance. Apportez tous vos examens récents et la liste de vos médicaments. Cette préparation optimise le temps de consultation et améliore la qualité des échanges avec votre médecin [14].
En cas de douleurs abdominales inhabituelles, particulièrement si elles irradient dans le dos, consultez rapidement. Même si la plupart du temps ces douleurs ont une autre origine, il vaut mieux être rassuré par un examen médical [15].
Quand Consulter un Médecin ?
Consultez immédiatement en cas de douleur abdominale brutale et intense, particulièrement si elle s'accompagne de douleurs dorsales, de malaise ou de signes de choc. Ces symptômes peuvent signaler une rupture d'anévrysme, urgence vitale absolue [14].
Une consultation rapide (dans les 24-48 heures) s'impose en cas de douleurs abdominales persistantes et inhabituelles, même modérées. Ces douleurs peuvent révéler une fissuration de l'anévrysme, complication qui précède parfois la rupture [15].
Prenez rendez-vous avec votre médecin si vous présentez des facteurs de risque : homme de plus de 65 ans, antécédents de tabagisme, hypertension artérielle, antécédents familiaux d'anévrysme. Un dépistage échographique peut être justifié [7].
Consultez également en cas de découverte d'une masse abdominale pulsatile lors de l'auto-palpation. Bien que cette découverte soit rare, elle peut révéler un anévrysme volumineux nécessitant une évaluation urgente [14].
N'hésitez pas à consulter pour toute question ou inquiétude concernant votre anévrysme connu. Votre médecin est là pour vous rassurer et adapter votre prise en charge si nécessaire. Une communication ouverte améliore la qualité des soins [15].
Questions Fréquentes
L'anévrysme peut-il disparaître spontanément ?Non, un anévrysme ne peut pas régresser spontanément. Une fois formé, il tend à progresser lentement. Seul un traitement chirurgical peut éliminer le risque de rupture [14].
Puis-je faire du sport avec un anévrysme ?
Les activités physiques modérées sont généralement autorisées et même recommandées. Évitez les sports intenses avec efforts en apnée (haltérophilie, sports de combat). Demandez conseil à votre médecin [15].
L'anévrysme est-il héréditaire ?
Il existe une composante génétique : le risque est multiplié par 2 à 4 en cas d'antécédents familiaux. Un dépistage peut être proposé aux apparentés du premier degré [4].
Quelle est la différence entre surveillance et traitement ?
La surveillance concerne les petits anévrismes (< 40-50 mm) avec contrôles réguliers. Le traitement s'impose pour les anévrismes volumineux ou évolutifs [1].
Le traitement endovasculaire est-il définitif ?
Le traitement endovasculaire nécessite un suivi à vie pour détecter d'éventuelles complications (fuites, migration). Des réinterventions peuvent parfois être nécessaires [1].
Puis-je voyager avec un anévrysme ?
Les voyages sont généralement possibles. Emportez vos examens récents et vérifiez votre assurance. Évitez les destinations trop éloignées des centres médicaux spécialisés [15].
Actes médicaux associés
Les actes CCAM suivants peuvent être pratiqués dans le cadre de Anévrysme de l'aorte abdominale :
Questions Fréquentes
L'anévrysme peut-il disparaître spontanément ?
Non, un anévrysme ne peut pas régresser spontanément. Une fois formé, il tend à progresser lentement. Seul un traitement chirurgical peut éliminer le risque de rupture.
Puis-je faire du sport avec un anévrysme ?
Les activités physiques modérées sont généralement autorisées et même recommandées. Évitez les sports intenses avec efforts en apnée (haltérophilie, sports de combat). Demandez conseil à votre médecin.
L'anévrysme est-il héréditaire ?
Il existe une composante génétique : le risque est multiplié par 2 à 4 en cas d'antécédents familiaux. Un dépistage peut être proposé aux apparentés du premier degré.
Quelle est la différence entre surveillance et traitement ?
La surveillance concerne les petits anévrismes (< 40-50 mm) avec contrôles réguliers. Le traitement s'impose pour les anévrismes volumineux ou évolutifs.
Le traitement endovasculaire est-il définitif ?
Le traitement endovasculaire nécessite un suivi à vie pour détecter d'éventuelles complications (fuites, migration). Des réinterventions peuvent parfois être nécessaires.
Puis-je voyager avec un anévrysme ?
Les voyages sont généralement possibles. Emportez vos examens récents et vérifiez votre assurance. Évitez les destinations trop éloignées des centres médicaux spécialisés.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Anévrisme de l'aorte abdominale (AAA) | Fiche santé HCL. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [2] Anévrisme aortique thoraco-abdominale (ATA). Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [3] CONGRÈS. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [4] Human Genetic Evidence to Inform Clinical Development. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] A bibliometric analysis of abdominal aortic aneurysm (2014-2024). Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] K Ikemakhen, L Benjilali. Anévrysme de l'aorte abdominale sus-et sous-rénale inaugural d'une maladie de Takayasu, à propos d'un cas et revue de la littérature. 2024.Lien
- [7] A Layès, É Rivoire. Anévrisme de l'aorte abdominale: pertinence des critères de dépistage. 2025.Lien
- [8] I Doukkali, M El Khatib. Manifestation rénale d'un anévrysme de l'aorte abdominale au cours de la maladie de Behçet. 2024.Lien
- [9] A Richard. Rôle de l'homéostasie mitochondriale dans l'hypertension artérielle et l'anévrisme de l'aorte abdominale. 2023.Lien
- [10] R Durieux, N Sakalihasan. Dépistage opportuniste de l'anévrysme de l'aorte abdominale lors de l'échocardiographie chez le patient coronarien: utile ou futile?. 2022.Lien
- [11] A DHIFALLAH. ANEVRISME DE L'AORTE ABDOMINALE ET REIN EN FER A CHEVAL A PROPOS D'UN CAS. 2022.Lien
- [12] K Yahiaoui. Rôle des plaquettes dans la formation du thrombus intraluminal de l'anévrisme de l'aorte abdominale. 2022.Lien
- [13] AI SAWSSEN. CHIRURGIE HYBRIDE DE L'ANEVRISME DE L'AORTE ABDOMINALE SOUS RENALE ET LESIONS OCCLUSIVES DES ARTERES DIGESTIVES: A PROPOS D'UN CAS. 2023.Lien
- [14] Anévrismes de l'aorte abdominale - Troubles cardiaques et vasculaires. MSD Manuals.Lien
- [15] Anévrisme de l'aorte abdominale. American Hospital of Paris.Lien
Publications scientifiques
- Anévrysme de l'aorte abdominale sus-et sous-rénale inaugural d'une maladie de Takayasu, à propos d'un cas et revue de la littérature (2024)
- Anévrisme de l'aorte abdominale: pertinence des critères de dépistage (2025)
- Manifestation rénale d'un anévrysme de l'aorte abdominale au cours de la maladie de Behçet (2024)
- Rôle de l'homéostasie mitochondriale dans l'hypertension artérielle et l'anévrisme de l'aorte abdominale (2023)[PDF]
- Dépistage opportuniste de l'anévrysme de l'aorte abdominale lors de l'échocardiographie chez le patient coronarien: utile ou futile? (2022)
Ressources web
- Anévrismes de l'aorte abdominale - Troubles cardiaques et ... (msdmanuals.com)
Diagnostic des anévrismes de l'aorte abdominale · La douleur est un signe utile, mais souvent la douleur ne se produit que si l'anévrisme est de grande taille ou ...
- Anévrisme de l'aorte abdominale (american-hospital.org)
L'anévrisme aortique, vu l'absence de symptômes cliniques chez la plupart des patients, est principalement décelé lors d'un examen médical de routine, lorsqu' ...
- Anévrismes de l'aorte abdominale (msdmanuals.com)
La plupart des anévrismes de l'aorte abdominale sont asymptomatiques. Les symptômes et les signes, s'ils apparaissent, peuvent être non spécifiques et ils ...
- Anévrisme de l'aorte abdominale (chuv.ch)
3 juil. 2019 — Le symptôme le plus courant est la douleur abdominale ou dorsale. Elle témoigne de la rupture ou de la fissuration de l'anévrisme. Le patient ...
- L'anévrisme de l'aorte : causes, symptômes et traitement (doctissimo.fr)
2 juin 2025 — Quels sont les symptômes d'un anévrisme de l'aorte thoracique ou abdominale ? · Douleurs thoraciques ; · Gêne pour respirer (dyspnée) ; · Syndrome ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
