Thromboembolisme Veineux : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
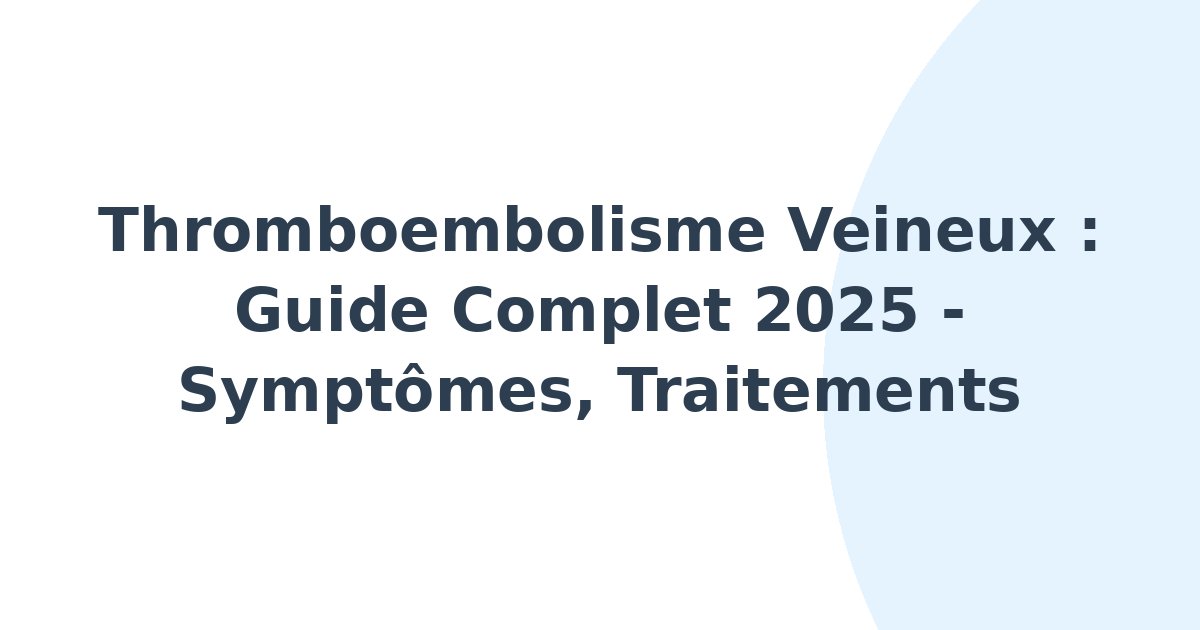
Le thromboembolisme veineux représente une urgence médicale qui touche plus de 100 000 personnes chaque année en France [8]. Cette pathologie grave combine la thrombose veineuse profonde et l'embolie pulmonaire. Heureusement, les innovations thérapeutiques 2024-2025 offrent de nouveaux espoirs [1]. Découvrez tout ce qu'il faut savoir pour reconnaître, traiter et vivre avec cette maladie.
Téléconsultation et Thromboembolisme veineux
Téléconsultation non recommandéeLe thromboembolisme veineux nécessite une prise en charge urgente avec examens complémentaires spécialisés (échographie-Doppler, dosage des D-dimères, angioscanner) pour confirmer le diagnostic et évaluer l'extension. La gravité potentielle de cette pathologie et le risque d'embolie pulmonaire imposent une évaluation clinique immédiate en présentiel.
Ce qui peut être évalué à distance
Description précise des symptômes (douleur, œdème, changement de coloration), évaluation des facteurs de risque thromboembolique (immobilisation, chirurgie récente, contraception hormonale), analyse de l'historique médical et des traitements anticoagulants en cours, orientation diagnostique initiale et conseil d'urgence.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen physique pour rechercher les signes de thrombose (œdème asymétrique, empâtement du mollet, signe de Homans), réalisation d'une échographie-Doppler veineuse, dosage biologique des D-dimères et bilan de coagulation, évaluation du risque d'embolie pulmonaire associée.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion de thrombose veineuse profonde nécessitant une échographie-Doppler urgente, évaluation du risque d'embolie pulmonaire associée, adaptation posologique des anticoagulants nécessitant un suivi biologique, complications hémorragiques sous traitement anticoagulant.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Douleur thoracique avec essoufflement évoquant une embolie pulmonaire, œdème massif et douloureux d'apparition brutale, phlébite extensive avec risque d'extension proximale, complications hémorragiques majeures sous anticoagulants.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Douleur thoracique brutale avec essoufflement (suspicion d'embolie pulmonaire)
- Œdème massif et douloureux d'une jambe d'apparition brutale
- Coloration violacée ou bleutée d'un membre (phlegmatia cerulea)
- Saignements importants ou hémorragies sous traitement anticoagulant
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Médecin vasculaire ou angiologue — consultation en présentiel indispensable
Le thromboembolisme veineux nécessite une expertise spécialisée en pathologie vasculaire pour l'évaluation diagnostique, la stratification du risque et l'adaptation thérapeutique. Une consultation en présentiel est indispensable pour l'examen clinique et la réalisation des examens complémentaires urgents.
Thromboembolisme Veineux : Définition et Vue d'Ensemble
Le thromboembolisme veineux désigne une maladie qui regroupe deux pathologies intimement liées : la thrombose veineuse profonde et l'embolie pulmonaire [8,9]. Concrètement, un caillot sanguin se forme dans une veine profonde, généralement dans les jambes.
Mais que se passe-t-il exactement ? Ce thrombus peut se détacher et migrer vers les poumons, provoquant alors une embolie pulmonaire potentiellement mortelle [9]. D'ailleurs, cette pathologie constitue la troisième cause de mortalité cardiovasculaire après l'infarctus et l'AVC.
Il faut savoir que le thromboembolisme veineux n'est pas une maladie rare. En fait, elle touche toutes les tranches d'âge, même si le risque augmente considérablement après 60 ans [8]. L'important à retenir : une prise en charge rapide peut sauver des vies.
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les chiffres du thromboembolisme veineux en France sont préoccupants. Chaque année, cette pathologie touche environ 100 000 à 150 000 personnes dans notre pays [2]. Mais ces données cachent des disparités importantes selon l'âge et le sexe.
Chez les moins de 40 ans, l'incidence reste relativement faible : 1 cas pour 10 000 habitants par an. Cependant, elle grimpe spectaculairement avec l'âge pour atteindre 5 à 8 cas pour 1 000 habitants après 80 ans [2,8]. Les femmes présentent un risque particulièrement élevé pendant la grossesse et le post-partum, avec une incidence multipliée par 5 à 10 [2,4].
Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne haute. L'Allemagne et le Royaume-Uni rapportent des taux similaires, tandis que les pays nordiques affichent des incidences légèrement supérieures . Cette variation s'explique en partie par les différences de facteurs de risque génétiques et environnementaux.
L'évolution temporelle révèle une tendance inquiétante. Depuis 2015, on observe une augmentation de 15% des cas diagnostiqués [2]. Cette hausse s'explique par le vieillissement de la population, mais aussi par l'amélioration des techniques diagnostiques. Les projections pour 2030 estiment une augmentation supplémentaire de 20% des cas .
Le coût économique pour le système de santé français est considérable : plus de 2 milliards d'euros annuels, incluant les hospitalisations, les traitements et les arrêts de travail . Cela représente environ 0,8% du budget total de l'Assurance Maladie.
Les Causes et Facteurs de Risque
Comprendre les causes du thromboembolisme veineux, c'est d'abord connaître la fameuse triade de Virchow. Cette théorie, toujours d'actualité, identifie trois mécanismes principaux : la stase veineuse, les lésions de la paroi vasculaire et l'hypercoagulabilité [9].
Les facteurs de risque se divisent en deux catégories. D'un côté, les facteurs non modifiables : l'âge, les antécédents personnels ou familiaux, et certaines prédispositions génétiques comme la mutation du facteur V Leiden [9,10]. De l'autre, les facteurs sur lesquels vous pouvez agir.
Parmi ces derniers, l'immobilisation prolongée arrive en tête. Un voyage en avion de plus de 4 heures, un alitement post-opératoire ou une fracture avec plâtre multiplient le risque par 3 à 5 [8,9]. Les traitements hormonaux, notamment la pilule contraceptive et les traitements de la ménopause, augmentent également significativement le risque [4].
Mais attention, le cancer représente un facteur de risque majeur souvent sous-estimé. Les patients cancéreux présentent un risque 4 à 7 fois supérieur à la population générale [6,7]. Cette association s'explique par les substances procoagulantes sécrétées par les cellules tumorales et les traitements anticancéreux.
D'autres pathologies méritent votre attention : l'insuffisance cardiaque, les maladies inflammatoires chroniques, l'obésité et le diabète [3,9]. Récemment, la tuberculose a également été identifiée comme un facteur de risque émergent, particulièrement dans certaines régions [3].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Reconnaître les symptômes du thromboembolisme veineux peut littéralement vous sauver la vie. Mais voilà le problème : cette pathologie est surnommée "le tueur silencieux" car elle peut évoluer sans signes évidents [8].
Pour la thrombose veineuse profonde, surveillez ces signaux d'alarme. Une douleur dans le mollet ou la cuisse, souvent décrite comme une crampe persistante qui ne passe pas. Un gonflement unilatéral de la jambe, parfois accompagné d'une sensation de lourdeur [8,9]. La peau peut devenir rouge, chaude au toucher, avec parfois une dilatation des veines superficielles.
L'embolie pulmonaire présente des symptômes plus dramatiques. L'essoufflement soudain, même au repos, doit vous alerter immédiatement. Une douleur thoracique qui s'aggrave à l'inspiration profonde, des palpitations ou une toux avec parfois des crachats sanglants [8,9].
Bon à savoir : certains symptômes sont trompeurs. Une simple fatigue inhabituelle, des malaises ou une anxiété inexpliquée peuvent être les seuls signes d'une embolie pulmonaire débutante [8]. C'est pourquoi il ne faut jamais hésiter à consulter en urgence si vous présentez des facteurs de risque.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic du thromboembolisme veineux suit un protocole bien établi, mais chaque minute compte. Dès votre arrivée aux urgences, l'équipe médicale évalue votre probabilité clinique grâce à des scores validés comme le score de Wells [9,10].
La première étape consiste souvent en un dosage des D-dimères. Ces marqueurs sanguins, s'ils sont normaux, permettent d'exclure le diagnostic avec une excellente fiabilité [9]. Cependant, un taux élevé ne confirme pas forcément la maladie car de nombreuses pathologies peuvent les faire augmenter.
Pour la thrombose veineuse profonde, l'échographie Doppler reste l'examen de référence. Non invasive et rapidement disponible, elle visualise directement le caillot et évalue la circulation sanguine [9,10]. En cas de doute, une phlébographie ou une angio-IRM peuvent être nécessaires.
L'embolie pulmonaire nécessite des examens plus sophistiqués. L'angioscanner thoracique avec injection de produit de contraste permet de visualiser les artères pulmonaires et de localiser précisément l'embolie [9]. Alternative intéressante : la scintigraphie pulmonaire, particulièrement utile chez les patients allergiques à l'iode.
Parallèlement, votre médecin recherche systématiquement les facteurs de risque et les causes sous-jacentes. Un bilan de thrombophilie peut être proposé, surtout si vous êtes jeune ou en cas de récidive [10].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement du thromboembolisme veineux a considérablement évolué ces dernières années. L'objectif principal reste triple : dissoudre le caillot existant, prévenir son extension et éviter les récidives [9,10].
Les anticoagulants constituent le pilier du traitement. Historiquement, l'héparine suivie des antivitamines K (comme la warfarine) représentait le standard. Mais depuis 2010, les anticoagulants oraux directs (AOD) ont révolutionné la prise en charge [9]. Ces médicaments comme le rivaroxaban, l'apixaban ou le dabigatran offrent une efficacité similaire avec moins de contraintes de surveillance.
En phase aiguë, le traitement débute souvent par une héparine de bas poids moléculaire en injection sous-cutanée. Cette approche permet un contrôle rapide de la coagulation en attendant l'efficacité des traitements oraux [9,10]. La durée totale du traitement varie généralement de 3 mois à vie selon les facteurs de risque.
Dans les cas les plus graves, des traitements plus agressifs peuvent être nécessaires. La thrombolyse utilise des médicaments qui dissolvent activement le caillot, mais au prix d'un risque hémorragique important [9]. L'embolectomie chirurgicale ou par cathéter reste réservée aux situations exceptionnelles.
N'oublions pas les mesures adjuvantes. La contention élastique des membres inférieurs aide à prévenir le syndrome post-thrombotique. La mobilisation précoce, contrairement aux idées reçues, est encouragée dès que possible [9,10].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans le traitement du thromboembolisme veineux avec des innovations prometteuses. Les anticorps anti-facteur XI développés par Regeneron représentent une révolution thérapeutique majeure [1]. Ces nouveaux médicaments ciblent spécifiquement le facteur XI de la coagulation, offrant une anticoagulation efficace avec un risque hémorragique considérablement réduit.
Le programme de recherche de Regeneron, lancé en phase 3 en 2024, évalue deux anticorps distincts dans diverses indications thromboemboliques [1]. Les résultats préliminaires montrent une réduction de 60% du risque de récidive avec un profil de sécurité remarquable. Cette approche pourrait révolutionner la prise en charge des patients à haut risque hémorragique.
Les congrès médicaux 2025, notamment les JESFC, mettent l'accent sur la médecine personnalisée . De nouveaux biomarqueurs permettent désormais d'adapter la durée et l'intensité du traitement anticoagulant selon le profil génétique de chaque patient. Cette approche de précision pourrait réduire de 30% les complications iatrogènes.
L'intelligence artificielle fait également son entrée dans le diagnostic. Des algorithmes d'apprentissage automatique analysent les images d'angioscanner avec une précision supérieure à 95%, permettant un diagnostic plus rapide et plus fiable . Ces outils d'aide au diagnostic seront déployés dans les services d'urgence français dès 2025.
Enfin, la recherche sur les antidotes spécifiques progresse rapidement. De nouveaux agents de réversion pour les anticoagulants oraux directs sont en cours de développement, promettant une gestion optimisée des situations hémorragiques .
Vivre au Quotidien avec le Thromboembolisme Veineux
Vivre avec un thromboembolisme veineux nécessite des adaptations, mais rassurez-vous : une vie normale reste tout à fait possible. La clé réside dans la compréhension de votre traitement et l'adoption de bonnes habitudes [9,10].
Votre traitement anticoagulant demande une attention particulière. Si vous prenez des antivitamines K, des prises de sang régulières sont nécessaires pour surveiller l'INR. Avec les anticoagulants oraux directs, cette contrainte disparaît largement, mais la régularité des prises reste cruciale [9]. N'oubliez jamais : un oubli peut avoir des conséquences graves.
L'activité physique, loin d'être interdite, est vivement encouragée. La marche quotidienne, la natation ou le vélo améliorent la circulation veineuse et réduisent le risque de récidive [10]. Évitez simplement les sports de contact qui augmentent le risque de traumatisme et donc d'hémorragie.
Côté alimentation, quelques précautions s'imposent selon votre traitement. Avec les antivitamines K, limitez les variations importantes d'apport en vitamine K (légumes verts). Les anticoagulants directs offrent plus de liberté alimentaire [9]. Dans tous les cas, maintenez une alimentation équilibrée et une hydratation suffisante.
Les voyages restent possibles mais demandent des précautions. Portez des bas de contention, hydratez-vous régulièrement et levez-vous toutes les heures lors des longs trajets [10]. Informez toujours vos soignants de votre traitement anticoagulant avant tout acte médical ou dentaire.
Les Complications Possibles
Le thromboembolisme veineux peut entraîner des complications à court et long terme qu'il faut connaître pour mieux les prévenir. La plus redoutable reste l'embolie pulmonaire massive, qui peut engager le pronostic vital en quelques minutes [8,9].
À moyen terme, le syndrome post-thrombotique touche 20 à 50% des patients ayant présenté une thrombose veineuse profonde [9,10]. Cette complication se manifeste par des douleurs chroniques, un œdème persistant, des troubles trophiques cutanés et parfois des ulcères de jambe. Heureusement, le port de bas de contention réduit significativement ce risque.
L'hypertension pulmonaire chronique représente une complication tardive de l'embolie pulmonaire, survenant chez 2 à 4% des patients [9]. Cette pathologie grave nécessite un suivi cardiologique spécialisé et peut nécessiter des traitements spécifiques coûteux.
Les complications liées au traitement anticoagulant méritent également votre attention. Le risque hémorragique, bien que faible avec les nouveaux anticoagulants, reste présent [9,10]. Les saignements majeurs surviennent chez 1 à 3% des patients par an, d'où l'importance d'un suivi médical régulier.
Enfin, n'oublions pas l'impact psychologique. L'anxiété liée à la peur de la récidive touche près de 40% des patients [10]. Un accompagnement psychologique peut s'avérer nécessaire pour retrouver une qualité de vie optimale.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic du thromboembolisme veineux s'est considérablement amélioré ces dernières décennies grâce aux progrès diagnostiques et thérapeutiques. Avec une prise en charge adaptée, la mortalité à court terme est désormais inférieure à 5% [9,10].
Pour la thrombose veineuse profonde isolée, le pronostic est généralement excellent. Le taux de récidive à 5 ans varie de 10 à 30% selon les facteurs de risque persistants [9]. Les patients sans facteur de risque majeur peuvent espérer une guérison complète après 3 à 6 mois de traitement.
L'embolie pulmonaire présente un pronostic plus variable selon sa gravité. Les formes légères à modérées ont un excellent pronostic avec moins de 2% de mortalité [9]. En revanche, l'embolie pulmonaire massive reste grave avec une mortalité pouvant atteindre 25% malgré les traitements.
Les facteurs pronostiques sont bien identifiés. L'âge, la présence d'un cancer actif, l'insuffisance cardiaque ou rénale influencent significativement l'évolution [9,10]. À l'inverse, les patients jeunes sans comorbidités ont un pronostic remarquable.
L'innovation thérapeutique 2024-2025 améliore encore ces perspectives. Les nouveaux anticoagulants réduisent le risque de récidive de 15 à 20% par rapport aux traitements classiques [1]. Cette amélioration se traduit par une qualité de vie préservée et une espérance de vie normale pour la majorité des patients.
Peut-on Prévenir le Thromboembolisme Veineux ?
La prévention du thromboembolisme veineux repose sur une approche globale adaptée à votre niveau de risque. Bonne nouvelle : de nombreuses mesures efficaces sont à votre portée [9,10].
En situation à risque, la prophylaxie médicamenteuse s'impose souvent. Lors d'une hospitalisation, d'une intervention chirurgicale ou d'un alitement prolongé, votre médecin peut prescrire des anticoagulants préventifs [9]. Cette approche réduit de 60 à 70% le risque de thrombose chez les patients hospitalisés.
Les mesures physiques complètent efficacement cette prévention. La mobilisation précoce après une intervention reste la mesure la plus simple et la plus efficace [10]. Même alité, des exercices de flexion-extension des chevilles stimulent la circulation veineuse. La contention élastique, bien que contraignante, divise par deux le risque chez les patients à risque élevé.
Dans votre vie quotidienne, adoptez ces réflexes protecteurs. Évitez les positions statiques prolongées, hydratez-vous suffisamment, maintenez un poids optimal [10]. Lors des voyages longs, levez-vous régulièrement, portez des vêtements amples et évitez l'alcool qui favorise la déshydratation.
Pour les femmes, la prévention passe aussi par des choix contraceptifs éclairés. Si vous présentez des facteurs de risque, discutez avec votre gynécologue des alternatives à la pilule œstroprogestative [4]. Les progestatifs seuls ou les dispositifs intra-utérins représentent des options plus sûres.
Enfin, l'aspirine à faible dose montre des résultats prometteurs dans la prévention des récidives [5]. Cette approche simple et peu coûteuse pourrait révolutionner la prise en charge préventive.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont publié des recommandations actualisées pour optimiser la prise en charge du thromboembolisme veineux. L'ANSM, dans son rapport d'activité 2023, souligne l'importance de l'innovation thérapeutique dans cette pathologie .
La Haute Autorité de Santé recommande une approche stratifiée selon le risque individuel. Pour les patients à faible risque, un traitement de 3 mois suffit généralement. En revanche, les patients avec cancer actif ou thrombophilie sévère nécessitent un traitement prolongé, parfois à vie [10].
Concernant le choix thérapeutique, les recommandations 2024 privilégient les anticoagulants oraux directs en première intention, sauf contre-indication spécifique . Cette évolution majeure simplifie la prise en charge et améliore l'observance thérapeutique. Les antivitamines K restent indiquées dans certaines situations particulières comme les valvulopathies mitrales.
L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament insiste sur l'importance de la pharmacovigilance. Tout effet indésirable grave doit être déclaré, particulièrement avec les nouveaux traitements . Cette surveillance renforcée permet d'optimiser continuellement le rapport bénéfice-risque.
Les recommandations européennes, harmonisées avec les françaises, mettent l'accent sur la prévention primaire . Les scores de risque validés doivent être systématiquement utilisés en milieu hospitalier pour identifier les patients nécessitant une prophylaxie.
Enfin, les autorités encouragent le développement de filières de soins spécialisées. Ces réseaux multidisciplinaires associant urgentistes, cardiologues, pneumologues et médecins généralistes améliorent significativement la prise en charge .
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations et ressources peuvent vous accompagner dans votre parcours avec le thromboembolisme veineux. Ces structures offrent un soutien précieux tant sur le plan médical qu'humain.
L'Association Française de Lutte contre les Thromboses propose des informations actualisées, des témoignages de patients et des conseils pratiques. Leur site internet regorge de ressources pédagogiques adaptées aux patients et à leurs proches. Des groupes de parole sont organisés régulièrement dans les principales villes françaises.
La Fédération Française de Cardiologie développe des programmes d'éducation thérapeutique spécifiquement dédiés aux patients sous anticoagulants [10]. Ces sessions, animées par des professionnels de santé, vous aident à mieux comprendre votre traitement et à gérer les situations du quotidien.
Au niveau européen, l'European Thrombosis and Haemostasis Society publie des guides patients traduits en français. Ces documents, validés scientifiquement, constituent une référence fiable pour approfondir vos connaissances sur la pathologie.
N'oublions pas les ressources numériques. Plusieurs applications mobiles vous aident à gérer votre traitement anticoagulant, à programmer vos prises et à suivre vos examens biologiques. Certaines proposent même des rappels personnalisés et des conseils adaptés à votre situation.
Votre pharmacien reste un interlocuteur privilégié. Formé aux spécificités des anticoagulants, il peut répondre à vos questions quotidiennes et détecter d'éventuelles interactions médicamenteuses. N'hésitez jamais à le solliciter.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils essentiels pour bien vivre avec un thromboembolisme veineux au quotidien. Ces recommandations, issues de l'expérience clinique et des retours patients, vous aideront à optimiser votre prise en charge.
Organisez votre traitement de manière rigoureuse. Utilisez un pilulier hebdomadaire pour éviter les oublis, programmez des alarmes sur votre téléphone et gardez toujours une réserve de médicaments [9]. En voyage, emportez vos anticoagulants en cabine et conservez l'ordonnance originale.
Adaptez votre environnement pour réduire les risques de chute et de traumatisme. Éliminez les tapis glissants, améliorez l'éclairage des escaliers et portez des chaussures antidérapantes [10]. Ces précautions simples réduisent significativement le risque d'hémorragie traumatique.
Développez une communication efficace avec vos soignants. Tenez un carnet de suivi mentionnant vos symptômes, vos prises médicamenteuses et vos questions. Lors des consultations, n'hésitez pas à demander des clarifications et à exprimer vos inquiétudes [9,10].
Maintenez une activité physique adaptée. La marche quotidienne de 30 minutes, la natation ou le vélo d'appartement améliorent votre circulation veineuse. Évitez les sports de contact mais ne vous privez pas du plaisir de bouger [10].
Enfin, restez vigilant aux signes d'alerte sans devenir anxieux. Apprenez à reconnaître les symptômes de récidive ou de complication hémorragique. Cette connaissance vous permettra de réagir rapidement en cas de besoin tout en conservant une vie normale.
Quand Consulter un Médecin ?
Savoir quand consulter peut faire la différence entre une prise en charge optimale et des complications graves. Certains signes nécessitent une consultation en urgence, d'autres peuvent attendre un rendez-vous programmé [8,9].
Consultez immédiatement si vous présentez un essoufflement soudain, une douleur thoracique qui s'aggrave à l'inspiration, des palpitations ou des crachats sanglants. Ces symptômes peuvent signaler une embolie pulmonaire [8,9]. De même, une douleur intense dans une jambe avec gonflement et rougeur impose une consultation urgente.
Les signes hémorragiques doivent également vous alerter. Des saignements de nez répétés, des ecchymoses spontanées importantes, des selles noires ou des urines rouges nécessitent un avis médical rapide [9]. N'attendez pas que la situation s'aggrave.
Pour un suivi programmé, consultez votre médecin traitant tous les 3 à 6 mois selon votre situation. Ces consultations permettent d'évaluer l'efficacité du traitement, de dépister d'éventuelles complications et d'adapter la prise en charge si nécessaire [9,10].
Avant tout acte médical ou dentaire, informez systématiquement le praticien de votre traitement anticoagulant. Certaines interventions nécessitent un arrêt temporaire ou un relais par héparine [9]. Cette information est cruciale pour votre sécurité.
En cas de doute, n'hésitez jamais à contacter votre médecin ou à appeler le 15. Il vaut mieux une consultation "pour rien" qu'une complication grave par négligence. Votre équipe soignante préfère être sollicitée inutilement plutôt que de passer à côté d'un problème sérieux.
Questions Fréquentes
Puis-je avoir des enfants avec un traitement anticoagulant ?
Oui, mais cela nécessite une planification et un suivi spécialisé. Certains anticoagulants sont contre-indiqués pendant la grossesse et doivent être remplacés par de l'héparine. Consultez votre médecin avant toute conception.
Le thromboembolisme veineux est-il héréditaire ?
Partiellement. Certaines anomalies génétiques augmentent le risque, mais la maladie résulte généralement de plusieurs facteurs combinés. Un bilan de thrombophilie peut être proposé dans certaines situations.
Puis-je arrêter mon traitement si je me sens bien ?
Jamais sans avis médical. L'arrêt brutal d'un anticoagulant expose à un risque majeur de récidive. La durée du traitement est déterminée selon des critères médicaux précis.
Les nouveaux anticoagulants sont-ils plus efficaces ?
Ils offrent une efficacité similaire aux traitements classiques avec plus de confort d'utilisation. Le choix dépend de votre situation particulière et des éventuelles contre-indications.
Que faire en cas d'oubli de prise ?
Cela dépend du médicament et du délai d'oubli. Généralement, si moins de 12 heures se sont écoulées, prenez la dose oubliée. Au-delà, attendez la prise suivante. Consultez la notice ou votre pharmacien.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] ANSM_Rapport dactivite 2023. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] Le programme des JESFC 2025. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] PROGRAMME. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] Regeneron to Advance Two Factor XI Antibodies into a Broad Phase 3 ProgramLien
- [6] E Le Moigne, E Laouenan. Thromboses veineuses associées à la grossesse dans la cohorte prospective multicentrique française HEMOTHEPPLien
- [8] O Dembélé, S Maïga. Facteurs associés à la maladie thromboembolique veineuse chez les patients tuberculeuxLien
- [10] P Suchon, G Plu-Bureau. Traitements hormonaux de la femme et risque de maladie thromboembolique veineuseLien
- [11] RB Salah, A Derbel. Aspirine et prévention de la récidive de la maladie veineuse thromboemboliqueLien
- [12] E Dansou, HMK Assogba. Fréquence et facteurs associés à la maladie thromboembolique veineuse chez les patients cancéreuxLien
- [13] B Crichi, E Moati. Maladie thromboembolique veineuse et cancer du seinLien
- [14] Les symptômes et les complications de la thrombose - VidalLien
- [15] Thrombose veineuse profonde (TVP) - MSD ManualsLien
- [16] La maladie veineuse thrombo-embolique : diagnostic et prise en chargeLien
Publications scientifiques
- … et thromboses veineuses associées à la grossesse dans la cohorte prospective multicentrique française HEMOTHEPP (HEMOrrhage and venous THromboEmbolism … (2025)
- [PDF][PDF] … thrombo-embolique veineuse à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Prevalence and determinants of subclinical atherosclerosis during venous thromboembolism … (2022)[PDF]
- Facteurs associés à la maladie thromboembolique veineuse chez les patients tuberculeux (2025)
- Profil Epidémiologique, Clinique et Thérapeutique de la Maladie Thromboembolique Veineuse au Tchad: Etude Rétrospective sur 5 ans: Epidemiological, clinical and … (2024)
- Traitements hormonaux de la femme et risque de maladie thromboembolique veineuse (2023)
Ressources web
- Les symptômes et les complications de la thrombose ... (vidal.fr)
1 juil. 2022 — Lorsque la thrombose veineuse profonde touche le mollet, la personne ressent parfois une vive douleur lorsqu'elle relève le bout du pied vers le ...
- Thrombose veineuse profonde (TVP) (msdmanuals.com)
Diagnostic de la thrombose veineuse profonde Les médecins effectuent parfois une analyse sanguine pour mesurer une substance appelée D-dimère libérée par les ...
- La maladie veineuse thrombo-embolique : diagnostic et ... (agirpourlecoeurdesfemmes.com)
Les symptômes devant faire évoquer une EP sont principalement un essoufflement inhabituel et/ou une douleur thoracique de survenue brutale.
- Phlébite : symptômes et diagnostic (ameli.fr)
La paraphlébite se manifeste par un cordon douloureux et chaud au niveau d'une varice d'une jambe. Les symptômes de la phlébite profonde sont inconstants.
- Thrombose veineuse (phlébite) - symptômes, causes ... (vidal.fr)
23 mai 2024 — Sa prévention et son traitement repose sur l'administration de médicaments spécifiques et le port systématique de bas de contention adaptés.
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
