Syndrome uvéo-méningo-encéphalique : Guide Complet 2025 | Symptômes, Diagnostic, Traitements
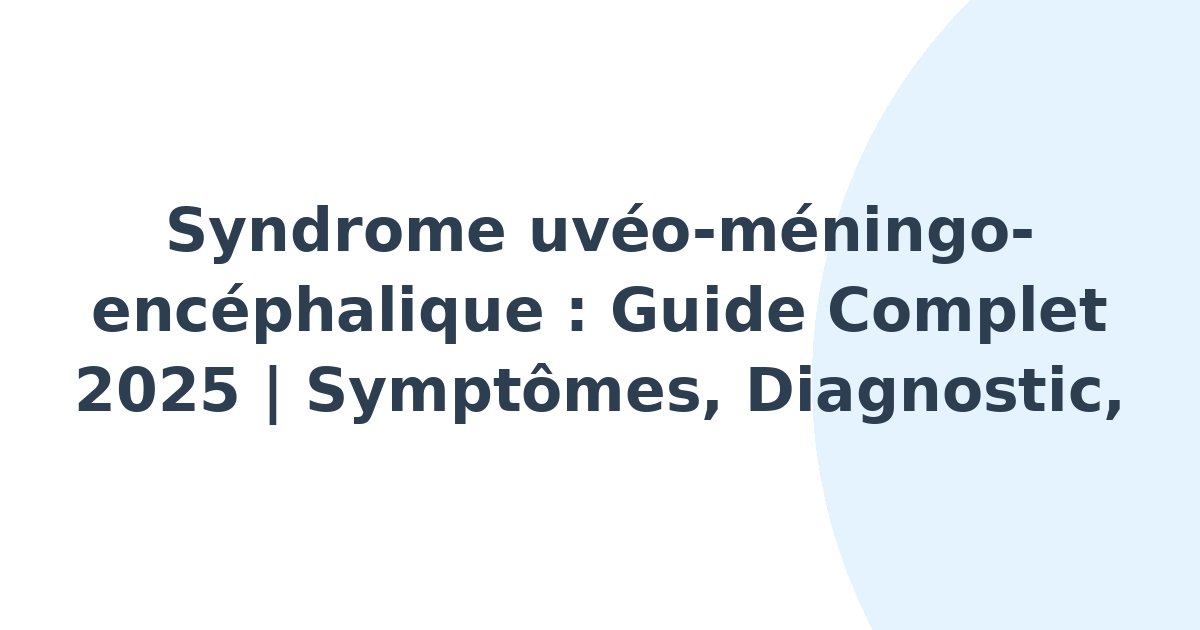
Le syndrome uvéo-méningo-encéphalique, aussi appelé maladie de Vogt-Koyanagi-Harada, est une pathologie auto-immune rare qui touche simultanément les yeux, le système nerveux et parfois la peau. Cette maladie inflammatoire chronique affecte principalement les adultes jeunes, avec une prédominance féminine. Bien que rare, elle nécessite une prise en charge spécialisée rapide pour préserver la vision et limiter les complications neurologiques.
Téléconsultation et Syndrome uvéo-méningo-encéphalique
Téléconsultation non recommandéeLe syndrome uvéo-méningo-encéphalique (maladie de Vogt-Koyanagi-Harada) est une pathologie inflammatoire multisystémique grave nécessitant un diagnostic spécialisé urgent et des examens complémentaires spécifiques. L'atteinte oculaire, neurologique et dermatologique requiert un examen ophtalmologique approfondi avec fond d'œil, une évaluation neurologique clinique et souvent une ponction lombaire pour confirmer le diagnostic.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil des symptômes visuels (baisse d'acuité, douleurs oculaires, photophobie), évaluation des signes neurologiques rapportés (céphalées, raideur de nuque, troubles auditifs), description des manifestations cutanées (vitiligo, alopécie), analyse de l'évolution des symptômes et de leur chronologie, orientation diagnostique préliminaire vers une prise en charge spécialisée urgente.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen ophtalmologique spécialisé avec fond d'œil et mesure de la pression intraoculaire, évaluation neurologique clinique complète, ponction lombaire pour analyse du liquide céphalorachidien, examens d'imagerie cérébrale (IRM), bilan inflammatoire et immunologique complet.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion de syndrome uvéo-méningo-encéphalique nécessitant un diagnostic urgent en milieu spécialisé, aggravation brutale des troubles visuels ou neurologiques, nécessité d'examens ophtalmologiques spécialisés (angiographie, OCT), besoin d'adaptation thérapeutique avec surveillance étroite des effets secondaires des immunosuppresseurs.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Baisse brutale et importante de l'acuité visuelle, céphalées intenses avec signes méningés, troubles de conscience ou déficits neurologiques focaux, hypertonie oculaire sévère avec risque de glaucome aigu.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Baisse brutale et sévère de l'acuité visuelle d'un ou des deux yeux
- Céphalées intenses avec raideur de nuque, photophobie et vomissements
- Troubles de conscience, confusion ou déficits neurologiques focaux
- Douleurs oculaires intenses avec nausées et vision d'halos colorés (suspicion de glaucome aigu)
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Ophtalmologue — consultation en présentiel indispensable
Le syndrome uvéo-méningo-encéphalique nécessite impérativement une prise en charge ophtalmologique spécialisée en urgence, souvent en collaboration avec un neurologue et un dermatologue. Le diagnostic repose sur des examens ophtalmologiques approfondis impossibles à réaliser à distance.
Syndrome uvéo-méningo-encéphalique : Définition et Vue d'Ensemble
Le syndrome uvéo-méningo-encéphalique représente une maladie auto-immune complexe qui cible spécifiquement les cellules contenant de la mélanine [3]. Cette pathologie inflammatoire chronique se caractérise par une atteinte simultanée de plusieurs organes : les yeux (uvéite), le système nerveux central (méningite) et parfois la peau et les cheveux.
Mais qu'est-ce qui rend cette maladie si particulière ? En fait, elle résulte d'une réaction immunitaire dirigée contre les mélanocytes, ces cellules productrices de pigment présentes dans l'œil, la peau et les méninges [4]. Cette attaque auto-immune provoque une inflammation généralisée qui peut avoir des conséquences graves si elle n'est pas traitée rapidement.
D'ailleurs, les médecins distinguent généralement quatre phases dans l'évolution de cette pathologie. La phase prodromique débute par des symptômes pseudo-grippaux, suivie de la phase uvéitique aiguë avec baisse brutale de la vision. Viennent ensuite la phase de convalescence et parfois une phase chronique récurrente [5].
L'important à retenir, c'est que cette maladie touche préférentiellement certaines populations. Les personnes d'origine asiatique, hispanique ou amérindienne présentent une susceptibilité génétique plus élevée, bien que tous les groupes ethniques puissent être affectés [3,4].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, le syndrome uvéo-méningo-encéphalique demeure une pathologie rare avec une incidence estimée à 0,5 à 1 cas pour 100 000 habitants par an [4]. Cette fréquence place notre pays dans la moyenne européenne, bien que les données épidémiologiques précises restent limitées en raison de la rareté de la maladie.
Cependant, la répartition géographique mondiale révèle des disparités frappantes. Au Japon, cette pathologie représente jusqu'à 8% de toutes les uvéites, contre seulement 1-2% en Europe occidentale [3,4]. Cette différence s'explique principalement par des facteurs génétiques, notamment la présence de certains allèles HLA plus fréquents dans les populations asiatiques.
Concernant les caractéristiques démographiques, les femmes sont touchées deux fois plus souvent que les hommes [5]. L'âge de survenue se situe typiquement entre 20 et 50 ans, avec un pic d'incidence autour de 30-40 ans. En France, on estime qu'environ 500 à 800 personnes vivent actuellement avec cette maladie.
Les données récentes montrent une légère augmentation du diagnostic ces dernières années, probablement liée à une meilleure reconnaissance de la pathologie par les professionnels de santé plutôt qu'à une réelle augmentation de l'incidence . D'ailleurs, les innovations diagnostiques 2024-2025 permettent désormais une détection plus précoce et plus précise de cette maladie complexe.
Les Causes et Facteurs de Risque
La cause exacte du syndrome uvéo-méningo-encéphalique reste encore partiellement mystérieuse, mais les recherches récentes ont permis d'identifier plusieurs facteurs de risque importants [3]. Cette maladie résulte probablement d'une interaction complexe entre prédisposition génétique et facteurs environnementaux déclenchants.
Le facteur génétique le plus documenté concerne les allèles HLA, notamment HLA-DR4 et HLA-DRB1*0405, particulièrement fréquents chez les patients atteints [4,5]. Ces marqueurs génétiques sont présents chez plus de 80% des malades d'origine asiatique, contre seulement 20-30% dans la population générale. Mais attention, posséder ces allèles ne signifie pas développer automatiquement la maladie.
Parmi les facteurs déclenchants potentiels, les infections virales occupent une place importante. Certains virus, comme l'Epstein-Barr ou le cytomégalovirus, pourraient déclencher la réaction auto-immune chez des personnes génétiquement prédisposées [3]. Le stress physique ou psychologique intense constitue également un facteur de risque reconnu.
Il faut savoir que l'exposition à certains médicaments ou substances chimiques pourrait aussi jouer un rôle. Cependant, dans la majorité des cas, aucun élément déclencheur spécifique n'est identifié, ce qui rend la prévention particulièrement difficile [4,5].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes du syndrome uvéo-méningo-encéphalique évoluent généralement en plusieurs phases, ce qui peut rendre le diagnostic initial difficile [4]. La maladie débute souvent de manière insidieuse, avec des signes qui peuvent facilement être confondus avec d'autres pathologies plus courantes.
La phase prodromique se manifeste par des symptômes pseudo-grippaux : fièvre, maux de tête, nausées et parfois raideur de la nuque. Ces signes, qui durent généralement quelques jours à quelques semaines, correspondent à l'inflammation des méninges [5]. Beaucoup de patients consultent d'abord leur médecin généraliste en pensant avoir une simple grippe.
Puis survient brutalement la phase uvéitique aiguë, qui constitue le cœur de la maladie. Vous pourriez alors ressentir une baisse rapide de la vision, des douleurs oculaires intenses, une photophobie (gêne à la lumière) et voir des « mouches volantes » [3,4]. Cette phase nécessite une consultation ophtalmologique urgente car elle peut conduire à une cécité irréversible.
D'autres symptômes peuvent accompagner cette phase : acouphènes (bourdonnements d'oreilles), vertiges, et parfois une perte auditive [5]. Ces signes témoignent de l'atteinte de l'oreille interne, riche en mélanocytes. Certains patients développent également des troubles cutanés : dépigmentation (vitiligo), blanchiment prématuré des cheveux ou alopécie localisée.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic du syndrome uvéo-méningo-encéphalique repose sur un faisceau d'arguments cliniques, biologiques et d'imagerie [4,5]. Il n'existe malheureusement pas de test unique permettant de confirmer la maladie, ce qui explique parfois les délais de diagnostic.
L'examen ophtalmologique constitue l'étape clé du diagnostic. Votre ophtalmologue recherchera des signes spécifiques d'uvéite : inflammation de la chambre antérieure, œdème papillaire, décollements séreux de la rétine . L'angiographie à la fluorescéine et l'OCT (tomographie par cohérence optique) permettent de visualiser précisément les lésions rétiniennes et de suivre leur évolution.
Les innovations diagnostiques 2024-2025 ont révolutionné l'approche de cette pathologie . Les nouvelles techniques d'imagerie non invasive permettent désormais une détection plus précoce des signes inflammatoires, même avant l'apparition des symptômes visuels. Ces avancées technologiques réduisent significativement les délais diagnostiques.
L'examen du liquide céphalorachidien par ponction lombaire révèle généralement une pléocytose lymphocytaire (augmentation des globules blancs) et parfois une élévation des protéines [5]. Cet examen, bien qu'impressionnant, reste indispensable pour confirmer l'atteinte méningée. Les examens sanguins recherchent des marqueurs inflammatoires et éliminent d'autres causes d'uvéite.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement du syndrome uvéo-méningo-encéphalique repose principalement sur l'immunosuppression pour contrôler l'inflammation et préserver la fonction visuelle [4,5]. La prise en charge doit être précoce et agressive pour éviter les complications irréversibles.
Les corticoïdes constituent le traitement de première ligne. En phase aiguë, de fortes doses de prednisolone (1-2 mg/kg/jour) sont généralement prescrites, parfois précédées de bolus intraveineux de méthylprednisolone [5]. Cette corticothérapie intensive permet de contrôler rapidement l'inflammation, mais elle doit être progressivement diminuée sur plusieurs mois.
Cependant, la corticothérapie seule ne suffit souvent pas. Les immunosuppresseurs comme le méthotrexate, l'azathioprine ou la ciclosporine sont fréquemment associés pour permettre une réduction des corticoïdes et maintenir la rémission [4]. Ces traitements nécessitent une surveillance biologique régulière en raison de leurs effets secondaires potentiels.
Les biothérapies représentent une avancée majeure pour les formes résistantes. L'adalimumab (anti-TNF alpha) et l'infliximab ont montré leur efficacité dans plusieurs études [5]. D'autres molécules comme le rituximab ou les inhibiteurs d'interleukines sont parfois utilisés en cas d'échec des traitements conventionnels. Ces innovations thérapeutiques offrent de nouveaux espoirs aux patients les plus difficiles à traiter.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la prise en charge du syndrome uvéo-méningo-encéphalique avec l'émergence de nouvelles approches thérapeutiques prometteuses . Ces innovations offrent de nouveaux espoirs aux patients, particulièrement ceux présentant des formes résistantes aux traitements conventionnels.
Les thérapies ciblées représentent l'avancée la plus significative. Le programme Breizh CoCoA 2024 a identifié plusieurs molécules innovantes ciblant spécifiquement les voies inflammatoires impliquées dans cette pathologie . Ces nouveaux traitements permettent une action plus précise avec moins d'effets secondaires que les immunosuppresseurs classiques.
D'ailleurs, les techniques diagnostiques non invasives révolutionnent également la prise en charge . Les innovations NIDIskin permettent désormais de détecter l'inflammation oculaire avant même l'apparition des symptômes visuels. Cette détection précoce ouvre la voie à des traitements préventifs qui pourraient changer le pronostic de la maladie.
La médecine personnalisée fait également son entrée dans ce domaine. Les recherches actuelles visent à identifier des biomarqueurs prédictifs de réponse aux différents traitements . Cette approche permettra bientôt de choisir le traitement le plus adapté à chaque patient dès le diagnostic, optimisant ainsi les chances de rémission tout en minimisant les effets indésirables.
Vivre au Quotidien avec le Syndrome uvéo-méningo-encéphalique
Vivre avec le syndrome uvéo-méningo-encéphalique nécessite des adaptations importantes, mais une vie épanouie reste tout à fait possible [3,4]. L'important est d'apprendre à gérer la maladie au quotidien tout en préservant sa qualité de vie.
La gestion des traitements constitue un aspect central de la vie quotidienne. Vous devrez probablement prendre plusieurs médicaments chaque jour, respecter des horaires précis et effectuer des contrôles biologiques réguliers. Il est essentiel de bien comprendre vos traitements et de ne jamais les arrêter brutalement, même si vous vous sentez mieux.
L'adaptation professionnelle peut s'avérer nécessaire, particulièrement si votre travail sollicite intensément la vision. Certains patients bénéficient d'aménagements de poste : éclairage adapté, pauses visuelles fréquentes, ou parfois reconversion professionnelle. N'hésitez pas à vous rapprocher de la médecine du travail pour évaluer vos besoins.
Sur le plan personnel, il faut savoir que cette maladie peut avoir un impact psychologique important. L'angoisse de perdre la vue, les contraintes thérapeutiques et la fatigue liée aux traitements peuvent affecter le moral. Un soutien psychologique est souvent bénéfique, que ce soit individuellement ou en groupe de patients [5].
Les Complications Possibles
Le syndrome uvéo-méningo-encéphalique peut entraîner plusieurs complications graves si la prise en charge n'est pas optimale [4,5]. Ces complications justifient l'importance d'un diagnostic précoce et d'un traitement adapté.
Les complications oculaires représentent la principale préoccupation. Sans traitement, l'uvéite chronique peut provoquer des cataractes, un glaucome secondaire, des synéchies (adhérences intraoculaires) ou des décollements de rétine récidivants [3,4]. Ces complications peuvent conduire à une baisse visuelle irréversible, voire à la cécité dans les cas les plus sévères.
L'atteinte auditive constitue également une complication fréquente mais souvent sous-estimée. La surdité de perception peut être définitive si l'inflammation de l'oreille interne n'est pas rapidement contrôlée [5]. Certains patients développent des acouphènes persistants qui altèrent significativement leur qualité de vie.
Les complications neurologiques, bien que plus rares, peuvent être particulièrement graves. Elles incluent des troubles cognitifs, des céphalées chroniques, ou exceptionnellement des convulsions [4]. Ces manifestations témoignent d'une atteinte cérébrale qui nécessite une prise en charge neurologique spécialisée. Heureusement, avec les traitements actuels, ces complications sévères sont devenues exceptionnelles.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic du syndrome uvéo-méningo-encéphalique s'est considérablement amélioré ces dernières décennies grâce aux progrès thérapeutiques [4,5]. Cependant, il reste étroitement lié à la précocité du diagnostic et à l'efficacité du traitement initial.
Avec une prise en charge optimale, environ 70 à 80% des patients conservent une acuité visuelle satisfaisante à long terme [3,4]. Ce chiffre encourageant masque néanmoins des disparités importantes selon la sévérité initiale et la réponse aux traitements. Les patients diagnostiqués et traités dans les premières semaines ont généralement un meilleur pronostic visuel.
La maladie évolue typiquement par poussées entrecoupées de rémissions. Environ 60% des patients présentent une forme récurrente nécessitant un traitement au long cours [5]. Cette évolution chronique implique un suivi médical régulier et une adaptation constante des traitements selon l'activité de la maladie.
Il faut savoir que les innovations thérapeutiques 2024-2025 laissent entrevoir un pronostic encore plus favorable . Les nouvelles molécules et les techniques de diagnostic précoce permettent d'espérer une meilleure préservation de la fonction visuelle et une réduction des complications à long terme. D'ailleurs, certains patients atteignent désormais une rémission complète et durable, ce qui était exceptionnel il y a encore quelques années.
Peut-on Prévenir le Syndrome uvéo-méningo-encéphalique ?
La prévention primaire du syndrome uvéo-méningo-encéphalique reste actuellement impossible en raison de la méconnaissance des facteurs déclenchants précis [3,4]. Cette maladie auto-immune survient généralement de manière imprévisible chez des personnes apparemment en bonne santé.
Cependant, certaines mesures peuvent théoriquement réduire le risque de déclenchement chez les personnes génétiquement prédisposées. La gestion du stress occupe une place importante, car le stress physique ou psychologique intense pourrait favoriser l'apparition de la maladie [5]. Des techniques de relaxation, une activité physique régulière et un sommeil de qualité constituent des éléments protecteurs généraux.
La prévention secondaire, visant à éviter les récidives, est en revanche bien codifiée. Le respect scrupuleux du traitement prescrit, même en période de rémission, reste essentiel [4]. L'arrêt brutal des immunosuppresseurs expose à un risque majeur de rechute, parfois plus sévère que l'épisode initial.
Les innovations 2024-2025 ouvrent de nouvelles perspectives préventives . Les techniques de dépistage précoce permettent désormais d'identifier les signes d'inflammation avant l'apparition des symptômes. Cette détection ultra-précoce pourrait permettre d'initier un traitement préventif chez les patients à haut risque de récidive, révolutionnant ainsi la prise en charge de cette pathologie complexe.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises et internationales ont établi des recommandations précises pour la prise en charge du syndrome uvéo-méningo-encéphalique [4,5]. Ces guidelines, régulièrement mises à jour, visent à standardiser les pratiques et améliorer le pronostic des patients.
La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise une prise en charge multidisciplinaire associant ophtalmologiste, interniste et parfois neurologue [5]. Cette approche collaborative permet une évaluation complète de la maladie et une adaptation optimale des traitements. Le suivi doit être particulièrement rapproché durant les six premiers mois suivant le diagnostic.
Concernant les traitements, les recommandations internationales privilégient une corticothérapie précoce et intensive, associée rapidement à un immunosuppresseur pour permettre la décroissance des corticoïdes [4]. Cette stratégie "treat to target" vise à obtenir une rémission complète tout en minimisant les effets secondaires des traitements.
Les innovations diagnostiques 2024-2025 sont progressivement intégrées dans les nouvelles recommandations . L'utilisation des techniques d'imagerie non invasive pour le suivi de l'inflammation oculaire devient un standard de soins dans les centres spécialisés. Ces avancées permettent un ajustement plus fin des traitements selon l'activité réelle de la maladie.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations de patients et ressources spécialisées peuvent vous accompagner dans votre parcours avec le syndrome uvéo-méningo-encéphalique [3]. Ces structures offrent un soutien précieux, tant sur le plan informatif que psychologique.
L'Association Française d'Uvéite (AFU) constitue la référence nationale pour les patients atteints d'uvéites, incluant le syndrome uvéo-méningo-encéphalique. Elle propose des groupes de parole, des journées d'information et met en relation les patients avec des centres experts. Leur site internet regorge d'informations pratiques et de témoignages inspirants.
Au niveau international, la Uveitis Society offre des ressources en plusieurs langues et facilite les échanges entre patients du monde entier. Ces plateformes permettent de partager expériences et conseils pratiques pour mieux vivre avec la maladie [4].
N'oubliez pas les ressources institutionnelles. Le site de l'Assurance Maladie détaille vos droits en matière d'Affection Longue Durée (ALD), particulièrement importante pour cette pathologie chronique. Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) peuvent également vous accompagner si votre maladie entraîne des limitations fonctionnelles [5]. Ces démarches administratives, bien que fastidieuses, sont essentielles pour bénéficier d'une prise en charge optimale.
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec le syndrome uvéo-méningo-encéphalique nécessite quelques adaptations pratiques qui peuvent grandement améliorer votre quotidien [3,4]. Ces conseils, issus de l'expérience de nombreux patients, vous aideront à mieux gérer votre maladie.
Pour protéger vos yeux, investissez dans de bonnes lunettes de soleil avec protection UV maximale. La photophobie étant fréquente, ces lunettes deviendront vos meilleures alliées, même par temps couvert. À domicile, privilégiez un éclairage doux et évitez les sources lumineuses directes. Des rideaux occultants peuvent s'avérer très utiles lors des poussées inflammatoires.
Concernant l'organisation de vos soins, tenez un carnet de suivi détaillé : symptômes, traitements, effets secondaires, résultats d'examens. Cette trace écrite facilitera vos consultations et permettra à vos médecins d'adapter plus finement vos traitements. N'hésitez pas à préparer vos questions avant chaque rendez-vous [5].
Sur le plan alimentaire, aucun régime spécifique n'est nécessaire, mais une alimentation équilibrée riche en antioxydants peut soutenir votre système immunitaire. Évitez l'automédication, particulièrement les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui peuvent interférer avec vos traitements. En cas de doute, contactez toujours votre équipe médicale plutôt que de prendre des initiatives qui pourraient compromettre votre prise en charge.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes d'alarme nécessitent une consultation médicale urgente, que vous soyez déjà diagnostiqué ou non [4,5]. La reconnaissance précoce de ces symptômes peut faire la différence entre une prise en charge efficace et des complications irréversibles.
Si vous n'êtes pas encore diagnostiqué, consultez immédiatement en cas de baisse brutale de la vision, de douleurs oculaires intenses, de photophobie sévère ou de vision de "mouches volantes" nombreuses [3]. Ces symptômes, surtout s'ils s'accompagnent de maux de tête et de fièvre, doivent vous conduire aux urgences ophtalmologiques sans délai.
Pour les patients déjà suivis, plusieurs situations justifient une consultation non programmée. Toute aggravation des symptômes visuels, l'apparition de nouveaux symptômes neurologiques (maux de tête inhabituels, troubles de l'équilibre) ou auditifs (baisse d'audition, acouphènes) doivent alerter [5]. Ces signes peuvent témoigner d'une poussée inflammatoire nécessitant un ajustement thérapeutique.
N'attendez jamais que les symptômes s'aggravent. Cette maladie évolue parfois rapidement, et chaque heure compte pour préserver votre vision. En cas de doute, il vaut toujours mieux consulter "pour rien" que de laisser passer une urgence réelle [4]. Votre équipe médicale préfère être sollicitée inutilement plutôt que d'intervenir trop tard sur des complications évitables.
Questions Fréquentes
Le syndrome uvéo-méningo-encéphalique est-il héréditaire ?
Cette maladie n'est pas héréditaire au sens strict, mais il existe une prédisposition génétique. Certains allèles HLA augmentent le risque, mais posséder ces gènes ne signifie pas développer automatiquement la maladie.
Peut-on guérir complètement de cette pathologie ?
Il n'existe pas de guérison définitive, mais une rémission complète et durable est possible avec les traitements actuels. Les innovations 2024-2025 permettent d'espérer des rémissions plus fréquentes et plus prolongées.
Cette maladie affecte-t-elle la fertilité ou la grossesse ?
La maladie elle-même n'affecte pas la fertilité. Cependant, certains traitements immunosuppresseurs peuvent nécessiter des adaptations en cas de projet de grossesse. Une planification avec votre équipe médicale est indispensable.
Faut-il éviter certaines activités ou sports ?
Aucune restriction spécifique n'est nécessaire en période de rémission. Évitez simplement les sports de contact risquant de traumatiser les yeux et adaptez vos activités selon votre tolérance à la lumière.
Les traitements ont-ils beaucoup d'effets secondaires ?
Les corticoïdes et immunosuppresseurs peuvent avoir des effets secondaires, mais ils sont généralement bien tolérés avec une surveillance appropriée. Les bénéfices du traitement dépassent largement les risques dans cette maladie potentiellement cécitante.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Breizh CoCoA 2024. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] Research - NIDIskin - Non-Invasive Diagnostic Innovations. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] Search results (207 results) - Retina Image Bank. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] Optic neuritis. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [5] JP Trevizo, TM de Lima. Síndrome de Vogt Koyanagi Harada com manifestação cutâneo vulvar: relato de caso. 2023Lien
- [6] Syndrome de Vogt-Koyanagi-Harada. fr.wikipedia.orgLien
- [7] Le syndrome de Vogt-Koyanagi-Harada : une urgence. www.sciencedirect.comLien
- [8] Prise en charge diagnostique des uvéoméningites. www.sciencedirect.comLien
Publications scientifiques
Ressources web
- Syndrome de Vogt-Koyanagi-Harada (fr.wikipedia.org)
La maladie se caractérise par une uvéite diffuse, des douleurs, des rougeurs et un flou de la vision. · La phase prodromique peut ne présenter aucun symptôme ou ...
- Le syndrome de Vogt-Koyanagi-Harada : une urgence ... (sciencedirect.com)
de A Venaille · 2011 · Cité 2 fois — Le syndrome de VKH est une uvéite bilatérale, granulomateuse diffuse, associée à des signes généraux à type de poliose, vitiligo, alopécie, signes neurologiques ...
- Prise en charge diagnostique des uvéoméningites ... (sciencedirect.com)
de S Abad · 2016 · Cité 3 fois — Les uvéoméningites correspondent à un état inflammatoire endoculaire allant de l'iris et des procès ciliaires jusqu'à la choroïde proche du nerf optique.
- Uvéo-méningo-encéphalite : quand penser à la toxocarose (em-consulte.com)
Le diagnostic passe par la mise en évidence des anticorps spécifiques aussi bien dans le sang que dans le LCR. La persistance des anomalies radiologiques a été ...
- Méningo-encéphalite (deuxiemeavis.fr)
12 déc. 2023 — Quels sont les symptômes d'une méningo-encéphalite ? ; troubles neurovégétatifs comme un ; pouls irrégulier, une ; élévation de la température, une ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
