Sclérose en Plaques Récurrente-Rémittente : Guide Complet 2025 | Symptômes, Traitements
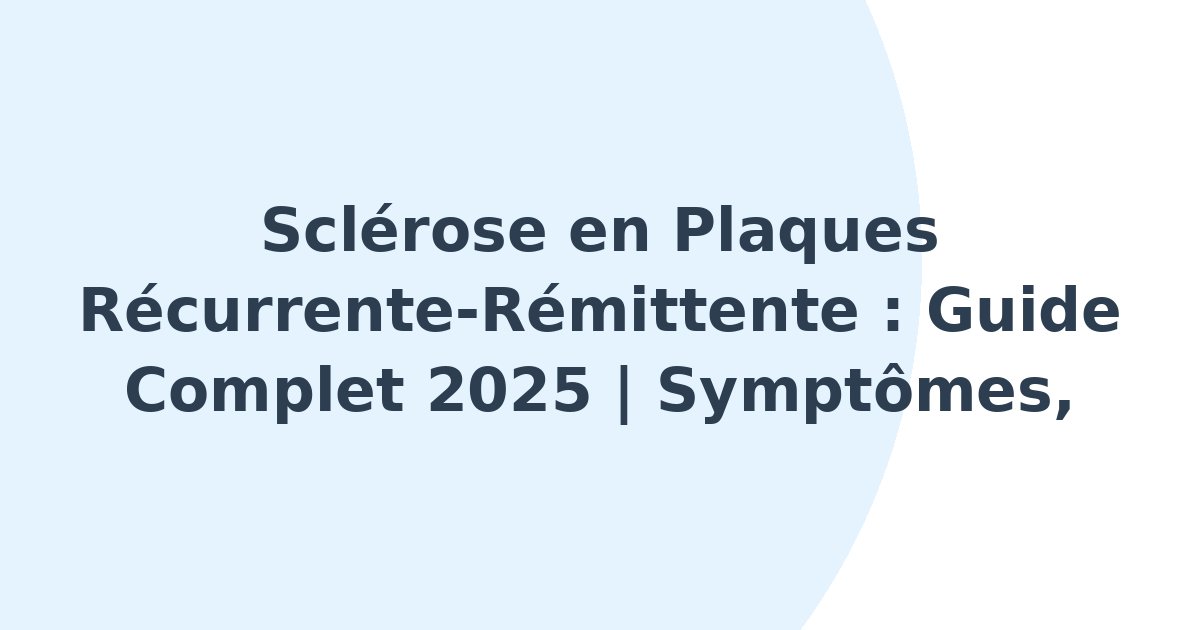
La sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP-RR) représente la forme la plus courante de cette maladie neurologique, touchant environ 85% des patients diagnostiqués [2]. Cette pathologie auto-immune se caractérise par des poussées inflammatoires suivies de périodes de rémission. Comprendre cette maladie complexe vous permettra de mieux appréhender votre parcours de soins et les options thérapeutiques disponibles.
Téléconsultation et Sclérose en plaques récurrente-rémittente
Partiellement adaptée à la téléconsultationLa sclérose en plaques récurrente-rémittente peut bénéficier d'un suivi à distance pour l'évaluation des symptômes, l'adaptation thérapeutique et le monitoring des effets secondaires. Cependant, l'examen neurologique complet et les examens complémentaires spécialisés restent indispensables pour le diagnostic initial et l'évaluation des poussées.
Ce qui peut être évalué à distance
Évaluation des symptômes de fatigue, troubles cognitifs et de l'humeur. Suivi de l'observance et des effets secondaires des traitements de fond (interférons, acétate de glatiramère, fingolimod). Évaluation de la qualité de vie et du handicap fonctionnel par questionnaires. Adaptation des mesures de prévention et conseils hygiéno-diététiques. Coordination avec l'équipe pluridisciplinaire de soins.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen neurologique complet avec évaluation de l'EDSS (Expanded Disability Status Scale). Réalisation et interprétation d'IRM cérébrales et médullaires. Ponction lombaire pour analyse du liquide céphalo-rachidien si nécessaire. Évaluation spécialisée lors de poussées neurologiques avec nouveaux déficits.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Préparer votre téléconsultation
Pour que votre téléconsultation soit la plus efficace possible, préparez les éléments suivants :
- Symptômes et durée : Noter précisément les troubles de la vision (vision double, baisse d'acuité, douleur oculaire), troubles sensitifs (fourmillements, engourdissements), troubles moteurs (faiblesse, spasticité), troubles de l'équilibre, fatigue anormale, troubles urinaires, et leur évolution depuis leur apparition.
- Traitements en cours : Mentionner tous les traitements de fond (interféron bêta, acétate de glatiramère, fingolimod, natalizumab, alemtuzumab), traitements symptomatiques (baclofène, gabapentine, amantadine), corticoïdes récents et leurs dosages, ainsi que leur tolérance.
- Antécédents médicaux pertinents : Antécédents de névrite optique, myélite, syndrome cliniquement isolé, autres maladies auto-immunes personnelles ou familiales, antécédents de leucoencéphalopathie multifocale progressive, infections récentes ou vaccinations.
- Examens récents disponibles : IRM cérébrales et médullaires avec dates et rapports, résultats de ponction lombaire, bilan biologique récent (NFS, bilan hépatique, sérologies), évaluations neuropsychologiques, mesures d'EDSS antérieures.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion de poussée neurologique avec nouveaux déficits nécessitant un examen neurologique urgent. Évaluation initiale d'un syndrome cliniquement isolé ou diagnostic différentiel. Surveillance rapprochée sous natalizumab ou autres traitements à risque de LEMP. Détérioration neurologique progressive inexpliquée nécessitant une réévaluation complète.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Poussée sévère avec déficit moteur majeur, troubles de la déglutition ou respiratoires. Suspicion de leucoencéphalopathie multifocale progressive avec troubles cognitifs rapidement progressifs. État de mal épileptique ou convulsions chez un patient connu.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Faiblesse motrice sévère des membres avec impossibilité de marcher ou de se tenir debout
- Troubles de la déglutition avec risque de fausse route ou difficultés respiratoires
- Troubles visuels bilatéraux sévères avec perte de vision importante
- Troubles cognitifs rapidement progressifs avec confusion ou désorientation
- Convulsions ou état de mal épileptique
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Neurologue — consultation en présentiel recommandée
La sclérose en plaques nécessite une expertise neurologique spécialisée pour le diagnostic, le suivi et l'adaptation thérapeutique. Une consultation en présentiel est généralement recommandée pour l'examen neurologique complet, bien que certains aspects du suivi puissent bénéficier de la téléconsultation.

- Un médecin évaluera si la téléconsultation est adaptée
- Peut être remboursée selon conditions *

Sclérose en Plaques Récurrente-Rémittente : Définition et Vue d'Ensemble
La sclérose en plaques récurrente-rémittente est une maladie auto-immune chronique du système nerveux central. Votre système immunitaire attaque par erreur la myéline, cette gaine protectrice qui entoure les fibres nerveuses.
Cette pathologie se distingue par son évolution particulière. Vous alternez entre des poussées (ou rechutes) où les symptômes s'aggravent, et des phases de rémission où ils s'améliorent partiellement ou complètement [2,15]. Ces périodes de calme peuvent durer des mois, voire des années.
Concrètement, imaginez votre système nerveux comme un réseau électrique complexe. La myéline joue le rôle d'isolant autour des câbles. Quand elle est endommagée, les signaux électriques ne passent plus correctement, provoquant les symptômes que vous ressentez.
L'important à retenir : cette forme de sclérose en plaques évolue généralement plus lentement que d'autres variants. Bon à savoir, les traitements actuels permettent de réduire significativement la fréquence des poussées [1].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, la sclérose en plaques touche environ 120 000 personnes, avec une prévalence de 1,8 pour 1000 habitants [2]. Cette pathologie représente la première cause de handicap neurologique non traumatique chez l'adulte jeune.
Les femmes sont trois fois plus touchées que les hommes, particulièrement entre 20 et 40 ans [2,15]. D'ailleurs, cette prédominance féminine s'explique en partie par des facteurs hormonaux encore à l'étude. L'incidence annuelle s'établit à 7 nouveaux cas pour 100 000 habitants.
Mais les chiffres varient considérablement selon les régions. Le nord de la France présente une prévalence plus élevée que le sud, phénomène observé dans de nombreux pays [2]. Cette répartition géographique suggère l'influence de facteurs environnementaux comme l'exposition au soleil et la vitamine D.
Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne haute. Les pays nordiques comme la Finlande affichent des taux deux fois supérieurs. En revanche, les régions méditerranéennes présentent une prévalence plus faible [15,16].
Les projections pour 2025-2030 indiquent une stabilisation de l'incidence, mais un vieillissement de la population de patients. Cette évolution démographique nécessite une adaptation des stratégies de prise en charge [1].
Les Causes et Facteurs de Risque
La sclérose en plaques récurrente-rémittente résulte d'une interaction complexe entre prédisposition génétique et facteurs environnementaux. Rassurez-vous, cette maladie n'est pas héréditaire au sens strict du terme [2,15].
Votre patrimoine génétique influence votre susceptibilité. Certains gènes, notamment ceux du système HLA, augmentent légèrement le risque. Mais avoir un parent atteint ne signifie pas que vous développerez forcément la maladie. Le risque familial reste faible, autour de 2-3% [15].
Les facteurs environnementaux jouent un rôle déterminant. L'infection par le virus d'Epstein-Barr (responsable de la mononucléose) constitue un facteur de risque reconnu [2]. De même, un faible taux de vitamine D, souvent lié à un manque d'exposition solaire, favorise le développement de la pathologie.
Le tabagisme double pratiquement le risque de développer une sclérose en plaques. Il accélère également la progression vers les formes secondairement progressives [15,16]. L'obésité à l'adolescence représente un autre facteur de risque émergent.
Certaines infections virales, le stress chronique et les traumatismes psychologiques pourraient également contribuer au déclenchement de la maladie. Cependant, aucun facteur isolé ne suffit à expliquer son apparition [2,15].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de la sclérose en plaques récurrente-rémittente varient énormément d'une personne à l'autre. Cette diversité s'explique par la localisation imprévisible des lésions dans votre système nerveux central [2,8].
Les troubles visuels constituent souvent le premier signe d'alerte. Vous pourriez ressentir une baisse brutale de l'acuité visuelle d'un œil, des douleurs lors des mouvements oculaires, ou percevoir des couleurs délavées. Cette névrite optique touche environ 20% des patients lors de la première poussée [2,8].
Les troubles sensitifs se manifestent par des fourmillements, engourdissements ou sensations de brûlure. Ces symptômes débutent généralement aux extrémités et remontent progressivement. Certains patients décrivent une sensation de « coup de jus » le long de la colonne vertébrale lors de la flexion du cou [2,15].
La fatigue représente le symptôme le plus fréquent et invalidant. Cette fatigue neurologique diffère de la fatigue habituelle : elle survient brutalement, même après un effort minime, et ne s'améliore pas avec le repos [2]. D'ailleurs, elle peut persister même en période de rémission.
Les troubles moteurs incluent une faiblesse musculaire, des difficultés de coordination et des troubles de l'équilibre. Vous pourriez avoir l'impression que vos jambes « ne vous portent plus » ou ressentir une raideur musculaire [15,16]. Les troubles cognitifs, bien que plus discrets, affectent la mémoire, l'attention et la vitesse de traitement de l'information [7,11].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de la sclérose en plaques récurrente-rémittente repose sur des critères précis, récemment actualisés en 2024 [1,3]. Votre médecin utilise les critères de McDonald révisés, qui combinent données cliniques et examens complémentaires.
L'IRM cérébrale et médullaire constitue l'examen clé du diagnostic. Elle révèle les lésions caractéristiques de la myéline, leur localisation et leur évolution dans le temps [2]. Les nouvelles séquences d'imagerie 2024 permettent une détection plus précoce des lésions actives [3,7].
La ponction lombaire n'est plus systématique mais reste utile dans certains cas. Elle recherche la présence de bandes oligoclonales dans le liquide céphalorachidien, témoins de l'inflammation chronique du système nerveux [2,15]. Cet examen aide à éliminer d'autres pathologies mimant la sclérose en plaques.
Les potentiels évoqués évaluent la conduction nerveuse. Ils détectent des ralentissements de transmission même en l'absence de symptômes cliniques [2]. Ces examens complètent le bilan diagnostique, particulièrement pour les formes débutantes.
Bon à savoir : le diagnostic peut prendre plusieurs mois. Il faut démontrer la dissémination des lésions dans l'espace et dans le temps. Votre neurologue s'assure également d'éliminer d'autres maladies pouvant présenter des symptômes similaires [15,16].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Les traitements de fond ont révolutionné la prise en charge de la sclérose en plaques récurrente-rémittente. Ces médicaments réduisent la fréquence des poussées et ralentissent la progression du handicap [1,5,6].
Les immunomodulateurs de première ligne incluent les interférons bêta et l'acétate de glatiramère. Bien qu'efficaces, ils nécessitent des injections régulières et peuvent provoquer des effets secondaires comme un syndrome pseudo-grippal [2,14]. Heureusement, de nouvelles formulations améliorent la tolérance.
Les traitements oraux offrent une alternative pratique. Le diméthylfumarate, le fingolimod et la cladribine présentent une efficacité supérieure aux traitements injectables [5,6,12,13]. Cependant, ils requièrent une surveillance biologique régulière en raison de leurs effets immunosuppresseurs.
Les anticorps monoclonaux représentent les traitements les plus efficaces. L'ocrelizumab, administré par perfusion semestrielle, réduit drastiquement l'activité de la maladie [9]. Le natalizumab reste réservé aux formes très actives en raison du risque de leucoencéphalopathie multifocale progressive.
La stratégie thérapeutique s'individualise selon votre profil. Votre neurologue considère l'activité de la maladie, votre âge, vos comorbidités et vos préférences [10,14]. L'objectif : obtenir une absence d'activité de la maladie (NEDA : No Evidence of Disease Activity).
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans la prise en charge de la sclérose en plaques récurrente-rémittente. Les innovations thérapeutiques se multiplient, offrant de nouveaux espoirs aux patients [3,4].
Le BRIUMVI (ublituximab), récemment approuvé par la HAS, représente une avancée majeure [1]. Cet anticorps monoclonal anti-CD20 présente une efficacité comparable à l'ocrelizumab avec un profil de tolérance amélioré. Sa particularité : un temps de perfusion réduit à une heure contre six heures pour les autres traitements.
Les formulations sous-cutanées d'ocrelizumab sont en cours d'évaluation [9]. Cette innovation permettrait d'éviter les perfusions hospitalières et d'améliorer votre qualité de vie. Les premiers résultats montrent une efficacité équivalente à la forme intraveineuse.
La thérapie cellulaire ouvre des perspectives révolutionnaires. Les cellules souches mésenchymateuses, administrées par voie intrathécale, montrent des résultats prometteurs dans la réparation de la myéline [4]. Ces approches régénératives pourraient transformer le pronostic de la maladie.
L'intelligence artificielle révolutionne le suivi des patients. Les nouveaux algorithmes prédisent les poussées avec une précision de 85%, permettant une prise en charge préventive [3]. Cette médecine prédictive personnalise davantage les traitements selon votre profil évolutif.
Vivre au Quotidien avec la Sclérose en Plaques Récurrente-Rémittente
Vivre avec une sclérose en plaques récurrente-rémittente nécessite des adaptations, mais n'empêche pas une vie épanouie. L'important : développer des stratégies pour gérer les symptômes et maintenir votre qualité de vie [2,7].
La gestion de la fatigue constitue un défi quotidien. Planifiez vos activités aux moments où vous vous sentez le plus en forme, généralement le matin. Accordez-vous des pauses régulières et n'hésitez pas à déléguer certaines tâches. L'activité physique adaptée, paradoxalement, combat efficacement cette fatigue neurologique [2,11].
L'activité professionnelle peut souvent être maintenue avec des aménagements. Le télétravail, les horaires flexibles ou l'adaptation du poste de travail facilitent votre quotidien professionnel [14]. N'hésitez pas à solliciter la médecine du travail pour bénéficier de ces adaptations.
Les relations sociales restent essentielles à votre bien-être. Expliquez votre maladie à vos proches : ils comprendront mieux vos difficultés et pourront mieux vous soutenir. Rejoindre des groupes de patients permet de partager expériences et conseils pratiques [4].
La planification familiale mérite une attention particulière. La grossesse est possible mais nécessite un suivi spécialisé. Certains traitements doivent être arrêtés avant la conception, d'où l'importance d'anticiper ce projet avec votre neurologue [2,15].
Les Complications Possibles
La sclérose en plaques récurrente-rémittente peut évoluer vers différentes complications qu'il convient de connaître pour mieux les prévenir [2,15]. Heureusement, les traitements actuels réduisent considérablement ces risques.
L'évolution vers une forme secondairement progressive constitue la complication la plus redoutée. Environ 50% des patients non traités développent cette forme dans les 10-15 ans suivant le diagnostic [15,16]. Cependant, les traitements de fond modernes retardent significativement cette évolution.
Les troubles cognitifs affectent 40 à 60% des patients. Ils touchent principalement la mémoire de travail, l'attention et la vitesse de traitement de l'information [7,11]. Ces difficultés, souvent discrètes, peuvent impacter votre vie professionnelle et sociale. Des programmes de rééducation cognitive montrent des résultats encourageants.
La dépression survient chez un tiers des patients. Elle résulte à la fois de l'impact psychologique du diagnostic et de mécanismes neurobiologiques liés à la maladie [2]. Un suivi psychologique précoce permet de prévenir cette complication fréquente.
Les complications liées aux traitements nécessitent une surveillance régulière. Les immunosuppresseurs augmentent le risque d'infections opportunistes. Le fingolimod peut provoquer des troubles du rythme cardiaque [6]. Votre équipe médicale adapte la surveillance selon le traitement prescrit.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la sclérose en plaques récurrente-rémittente s'est considérablement amélioré ces dernières décennies. Les traitements modernes transforment l'évolution naturelle de cette maladie [1,10,14].
Avec les traitements actuels, l'espérance de vie des patients se rapproche de celle de la population générale. La différence n'excède pas 5 à 7 ans, principalement due aux complications tardives [15]. Cette amélioration spectaculaire résulte de la prise en charge précoce et des thérapies innovantes.
L'accumulation du handicap ralentit significativement sous traitement. Sans thérapie, 50% des patients nécessitent une aide à la marche après 15 ans d'évolution. Avec les traitements de haute efficacité, ce pourcentage chute à moins de 20% [10,14]. L'objectif thérapeutique actuel vise l'absence totale d'activité de la maladie.
Plusieurs facteurs pronostiques influencent l'évolution. Un âge jeune au diagnostic, un faible nombre de lésions à l'IRM initiale et une bonne récupération après la première poussée constituent des éléments favorables [12,14]. À l'inverse, un début tardif et des lésions médullaires assombrissent le pronostic.
Les innovations 2024-2025 laissent entrevoir un avenir encore plus prometteur. Les thérapies régénératives et la médecine personnalisée pourraient transformer cette maladie chronique en pathologie contrôlable [3,4]. L'espoir d'une guérison n'est plus utopique.
Peut-on Prévenir la Sclérose en Plaques Récurrente-Rémittente ?
La prévention primaire de la sclérose en plaques récurrente-rémittente reste limitée, car les causes exactes demeurent partiellement inconnues [2,15]. Cependant, certaines mesures peuvent réduire le risque de développer la maladie.
Le maintien d'un taux optimal de vitamine D constitue la mesure préventive la mieux documentée. Un taux sanguin supérieur à 30 ng/ml (75 nmol/l) réduit significativement le risque [15]. Cette supplémentation s'avère particulièrement importante dans les régions peu ensoleillées comme le nord de la France.
L'arrêt du tabac représente une priorité absolue. Le tabagisme double le risque de développer la maladie et accélère sa progression [15,16]. Si vous fumez, votre médecin peut vous accompagner dans cette démarche d'arrêt avec des substituts nicotiniques ou des thérapies comportementales.
La prévention secondaire vise à retarder l'apparition des symptômes chez les personnes à risque. Les études sur le syndrome cliniquement isolé montrent qu'un traitement précoce peut retarder la conversion vers une sclérose en plaques avérée [2]. Cette approche nécessite une surveillance neurologique spécialisée.
Certaines mesures d'hygiène de vie pourraient également jouer un rôle protecteur. Une alimentation méditerranéenne, riche en oméga-3 et antioxydants, semble bénéfique. L'exercice physique régulier et la gestion du stress contribuent également à maintenir un système immunitaire équilibré [15].
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024 des recommandations actualisées pour la prise en charge de la sclérose en plaques récurrente-rémittente [1]. Ces guidelines intègrent les dernières innovations thérapeutiques et les données d'efficacité en vie réelle.
La HAS préconise une prise en charge précoce dès le diagnostic confirmé. L'objectif thérapeutique vise l'absence d'activité de la maladie (NEDA), définie par l'absence de poussées, de progression du handicap et de nouvelles lésions à l'IRM [1]. Cette approche proactive améliore significativement le pronostic à long terme.
Les critères de choix thérapeutique s'individualisent selon l'activité de la maladie. Pour les formes peu actives, les immunomodulateurs de première ligne restent appropriés. Les formes très actives nécessitent d'emblée des traitements de haute efficacité comme les anticorps monoclonaux [1,14].
La surveillance thérapeutique suit un protocole standardisé. Une IRM de contrôle est recommandée tous les 6 à 12 mois selon le traitement. Les bilans biologiques vérifient la tolérance et dépistent les effets secondaires précocement [1]. Cette surveillance rapprochée optimise le rapport bénéfice-risque.
L'approche multidisciplinaire constitue un pilier de la prise en charge. L'équipe associe neurologue, infirmier de coordination, kinésithérapeute, ergothérapeute et psychologue selon les besoins [1]. Cette coordination améliore l'adhésion thérapeutique et la qualité de vie des patients.
Ressources et Associations de Patients
De nombreuses associations accompagnent les patients atteints de sclérose en plaques récurrente-rémittente. Ces structures offrent soutien, information et défense de vos droits [4].
L'Association pour la Recherche sur la Sclérose En Plaques (ARSEP) finance la recherche et informe les patients. Elle organise régulièrement des conférences et publie des brochures d'information actualisées. Son site internet constitue une mine d'informations fiables et accessibles.
La Ligue Française contre la Sclérose En Plaques propose un accompagnement personnalisé. Ses délégations régionales organisent des groupes de parole, des activités sportives adaptées et des séjours de répit. Cette association milite également pour l'amélioration de la prise en charge.
Les réseaux sociaux spécialisés permettent d'échanger avec d'autres patients. Ces plateformes offrent un soutien moral précieux et des conseils pratiques du quotidien [4]. Attention cependant aux informations non vérifiées : privilégiez toujours l'avis de votre équipe médicale.
Les centres de ressources hospitaliers proposent des consultations d'éducation thérapeutique. Ces programmes vous aident à mieux comprendre votre maladie et à optimiser votre prise en charge. Ils incluent souvent des ateliers pratiques sur la gestion des traitements et des symptômes.
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec une sclérose en plaques récurrente-rémittente nécessite quelques adaptations pratiques qui faciliteront votre quotidien [2,7,11].
Organisez votre environnement pour compenser les troubles de l'équilibre. Éliminez les tapis glissants, installez des barres d'appui dans la salle de bain et améliorez l'éclairage. Ces aménagements simples préviennent les chutes et préservent votre autonomie.
Gérez votre énergie comme un budget précieux. Planifiez les activités importantes aux moments où vous vous sentez le mieux. Alternez périodes d'activité et de repos. N'hésitez pas à utiliser des aides techniques comme un déambulateur lors des poussées [11].
Maintenez une activité physique adaptée à vos capacités. La natation, le yoga ou la marche nordique améliorent la force musculaire et l'équilibre. L'exercice combat également la fatigue et la dépression [2]. Demandez conseil à votre kinésithérapeute pour un programme personnalisé.
Surveillez votre alimentation sans tomber dans l'obsession. Privilégiez les aliments riches en oméga-3, antioxydants et vitamine D. Limitez les aliments pro-inflammatoires comme les sucres raffinés et les graisses saturées [15].
Préparez vos rendez-vous médicaux en notant vos questions et symptômes. Tenez un carnet de suivi avec l'évolution de vos symptômes, l'efficacité des traitements et les effets secondaires. Cette information aide votre neurologue à adapter votre prise en charge [7].
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes d'alerte nécessitent une consultation médicale urgente, même si vous êtes déjà suivi pour votre sclérose en plaques récurrente-rémittente [2,15].
Consultez immédiatement en cas de baisse brutale de la vision, de faiblesse soudaine d'un membre ou de troubles de la parole. Ces symptômes peuvent signaler une nouvelle poussée nécessitant un traitement par corticoïdes [2]. N'attendez pas que les symptômes s'aggravent.
Une fièvre élevée (>38,5°C) sous traitement immunosuppresseur impose une consultation rapide. Votre système immunitaire affaibli vous expose aux infections opportunistes. Votre médecin évaluera la nécessité d'un bilan infectieux et d'une antibiothérapie [1,6].
Des troubles de l'humeur persistants, une perte d'appétit ou des idées noires justifient un avis médical. La dépression, fréquente dans cette maladie, se traite efficacement si elle est prise en charge précocement [2]. N'hésitez pas à en parler à votre neurologue ou médecin traitant.
Signalez rapidement tout effet secondaire inhabituel de vos traitements. Éruption cutanée, troubles digestifs persistants ou fatigue extrême peuvent nécessiter un ajustement thérapeutique [5,6]. Votre équipe médicale préfère être alertée pour rien plutôt que de passer à côté d'une complication.
Planifiez des consultations de suivi régulières même en l'absence de symptômes. Cette surveillance permet d'adapter votre traitement et de dépister précocement une évolution de la maladie [1,14].
Questions Fréquentes
Puis-je avoir des enfants avec une sclérose en plaques récurrente-rémittente ?
Oui, la grossesse est tout à fait possible. Elle nécessite cependant un suivi spécialisé et l'arrêt de certains traitements avant la conception. Paradoxalement, la grossesse stabilise souvent la maladie grâce aux modifications hormonales.
Vais-je finir en fauteuil roulant ?
Avec les traitements actuels, la majorité des patients conservent leur autonomie de marche. Moins de 20% des patients traités précocement nécessitent une aide à la marche après 15 ans d'évolution.
Puis-je continuer à travailler ?
Dans la plupart des cas, oui. Des aménagements de poste, du télétravail ou des horaires flexibles facilitent le maintien de l'activité professionnelle.
Les vaccins sont-ils dangereux ?
Les vaccins inactivés sont recommandés et sûrs. Évitez les vaccins vivants atténués sous traitement immunosuppresseur.
L'alimentation peut-elle influencer ma maladie ?
Aucun régime ne guérit la sclérose en plaques, mais une alimentation équilibrée soutient votre système immunitaire. Privilégiez les aliments anti-inflammatoires.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] BRIUMVI 150 mg, HAS 2024-2025 - Nouvelles recommandations thérapeutiquesLien
- [2] Symptômes, diagnostic et évolution de la sclérose en plaques - Ameli.frLien
- [3] Document d'enregistrement universel 2024 - Innovation thérapeutiqueLien
- [4] JNLF 2024 - Journées de Neurologie de Langue FrançaiseLien
- [5] Aller loin contre la sclérose en plaques - Innovations 2024-2025Lien
- [6] Real-World Safety and Effectiveness of Dimethyl Fumarate - PubMed 2024Lien
- [7] Safety of fingolimod in patients with relapsing remitting MS - ScienceDirect 2024Lien
- [8] Imagerie mentale et mémoire prospective dans la SEP-RR - Thèse 2024Lien
- [9] L'anisocorie intermittente comme signe révélateur de la SEP-RRLien
- [10] Injection sous-cutanée d'ocrelizumab - Évaluation 2025Lien
- [11] Traitements de haute efficacité versus modérée - Étude HEMEMuS 2023Lien
- [12] Le déclin exécutif chez les sujets atteints de SEP-RR - 2023Lien
- [13] Facteurs pronostiques pour cladribine dans la SEP-RR - 2024Lien
- [14] Diméthylfumarate chez patients pédiatriques SEP-RR - 2022Lien
- [15] Stratégie thérapeutique après première ligne - France 2022Lien
- [16] Sclérose en plaques - Manuel MSDLien
- [17] Formes de sclérose en plaques - Roche FranceLien
Publications scientifiques
- Imagerie mentale et mémoire prospective dans la sclérose en plaques récurrente-rémittente (2024)
- [PDF][PDF] L'anisocorie intermittente comme signe révélateur de la sclérose en plaques récurrente-rémittente
- Injection sous-cutanée d'ocrelizumab chez des patients atteints de sclérose en plaques récurrente-rémittente et primaire progressive (SEP-R/SEP-PP): évaluation du … (2025)
- Traitements de haute efficacité versus d'efficacité modérée chez les patients présentant une sclérose en plaques récurrente-rémittente: étude HEMEMuS (2023)
- Le déclin exécutif, chez les sujets atteints de la sclérose en plaque récurrente-rémittente (SEP-RR) (2023)
Ressources web
- Symptômes, diagnostic et évolution de la sclérose en ... (ameli.fr)
Les symptômes de la sclérose en plaques varient d'une personne à l'autre. Le diagnostic de la maladie est difficile car il n'existe pas d'examen spécifique.
- Sclérose en plaques (SEP) - Troubles du cerveau, de la ... (msdmanuals.com)
Les personnes peuvent avoir des troubles de la vue et des sensations anormales, et les mouvements peuvent être faibles et maladroits. Habituellement, les ...
- Formes de sclérose en plaques : quelles sont les ... (roche.fr)
Les symptômes les plus fréquents de la sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP-RR) incluent des périodes épisodiques de fatigue, engourdissement, ...
- Sclérose en plaques : définition, causes et traitements (elsan.care)
Les premiers symptômes de la sclérose en plaques peuvent inclure des troubles visuels et une perte de la vue, mais aussi des problèmes de locomotion, ou encore ...
- Sclérose en plaques (who.int)
7 août 2023 — Ils comprennent souvent des problèmes de vision, de la fatigue, des difficultés à marcher et à garder l'équilibre, ainsi qu'un engourdissement ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
