Syndrome Thoracique Aigu : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
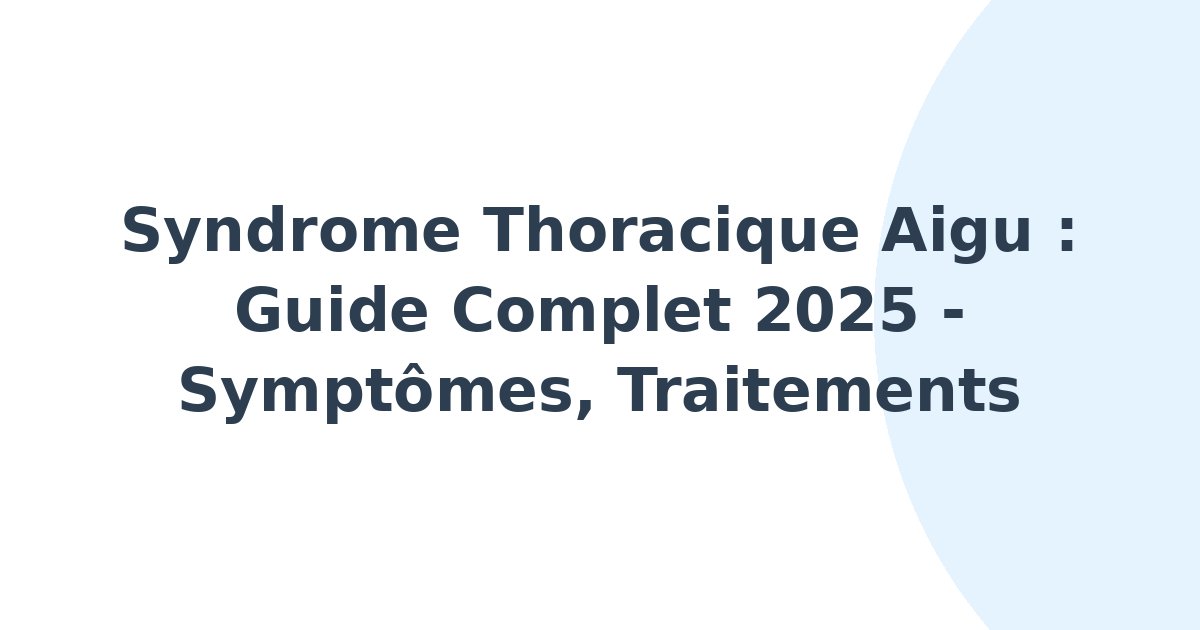
Le syndrome thoracique aigu représente une complication pulmonaire grave de la drépanocytose, touchant particulièrement les patients adultes. Cette pathologie, caractérisée par l'apparition d'infiltrats pulmonaires nouveaux accompagnés de symptômes respiratoires, constitue la deuxième cause d'hospitalisation chez les personnes drépanocytaires [8]. Heureusement, les avancées thérapeutiques récentes, notamment avec l'arrivée de CASGEVY en 2024, ouvrent de nouvelles perspectives [2].

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Syndrome Thoracique Aigu : Définition et Vue d'Ensemble
Le syndrome thoracique aigu est une complication pulmonaire aiguë qui survient exclusivement chez les patients atteints de drépanocytose. Cette pathologie se définit par l'association d'un infiltrat pulmonaire nouveau visible à la radiographie thoracique et d'au moins un symptôme respiratoire [8,16].
Concrètement, il s'agit d'une inflammation des poumons qui peut rapidement évoluer vers une détresse respiratoire. Les globules rouges déformés par la drépanocytose viennent obstruer les petits vaisseaux pulmonaires, créant des zones d'inflammation et de nécrose [17].
Cette pathologie touche principalement les adultes drépanocytaires, avec un pic d'incidence entre 20 et 40 ans. Mais attention : elle peut également survenir chez l'enfant, souvent dans un contexte d'infection respiratoire [13]. L'important à retenir, c'est que le syndrome thoracique aigu constitue une urgence médicale nécessitant une prise en charge hospitalière immédiate.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, le syndrome thoracique aigu touche environ 30 à 50% des patients drépanocytaires au cours de leur vie [8,10]. Cette prévalence élevée en fait la deuxième cause d'hospitalisation dans cette population, juste après les crises vaso-occlusives douloureuses.
Les données récentes de 2024 montrent une incidence annuelle d'environ 15 à 25 épisodes pour 100 patients-années chez les adultes drépanocytaires [10,11]. Cette incidence varie considérablement selon les régions : elle est plus élevée dans les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane) où la prévalence de la drépanocytose atteint 1 naissance sur 300 [11].
Comparativement aux États-Unis, où l'incidence du syndrome thoracique aigu est estimée à 12,8 épisodes pour 100 patients-années, la France présente des taux légèrement supérieurs [7]. Cette différence s'explique en partie par les variations génétiques et les facteurs environnementaux.
L'analyse des données épidémiologiques révèle également des disparités selon l'âge et le sexe. Les hommes adultes présentent un risque 1,5 fois plus élevé que les femmes, avec une mortalité qui peut atteindre 3 à 9% selon la sévérité de l'épisode [8,14]. Chez l'enfant, grâce notamment à la vaccination pneumococcique conjuguée, l'incidence a diminué de 40% depuis 2010 [13].
Les Causes et Facteurs de Risque
Le syndrome thoracique aigu résulte de mécanismes complexes impliquant plusieurs facteurs déclenchants. La cause principale reste l'occlusion des vaisseaux pulmonaires par les globules rouges falciformes, mais d'autres éléments peuvent précipiter un épisode [8,16].
Les infections représentent le facteur déclenchant le plus fréquent, particulièrement chez l'enfant. Les agents pathogènes les plus souvent impliqués sont Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, et les virus respiratoires comme le VRS ou la grippe [13,17]. D'ailleurs, c'est pourquoi la vaccination pneumococcique a permis de réduire significativement l'incidence chez les plus jeunes.
Chez l'adulte, les facteurs de risque sont plus variés. Les crises vaso-occlusives douloureuses constituent un facteur prédisposant majeur : environ 20% des patients hospitalisés pour crise douloureuse développent secondairement un syndrome thoracique aigu [14]. L'embolie graisseuse, consécutive à la nécrose de la moelle osseuse, représente également un mécanisme important.
D'autres facteurs peuvent favoriser la survenue d'un épisode : la déshydratation, l'exposition au froid, l'effort physique intense, ou encore certains médicaments comme les opiacés à fortes doses [8,14]. Bon à savoir : le tabagisme multiplie par deux le risque de développer un syndrome thoracique aigu.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes du syndrome thoracique aigu peuvent apparaître de manière progressive ou brutale. Il est crucial de savoir les reconnaître car un diagnostic précoce améliore considérablement le pronostic [8,15].
La dyspnée (essoufflement) constitue le symptôme le plus fréquent, présent dans 80% des cas. Elle peut être d'apparition progressive ou brutale, s'aggravant rapidement à l'effort puis au repos [11,17]. Vous pourriez ressentir une sensation d'oppression thoracique ou avoir l'impression de "manquer d'air".
La douleur thoracique accompagne souvent la dyspnée. Cette douleur peut être localisée ou diffuse, parfois décrite comme une sensation de brûlure ou de serrement. Elle s'intensifie généralement à l'inspiration profonde [8,16]. La fièvre est également très fréquente, présente dans 70% des cas, avec des températures souvent supérieures à 38,5°C.
D'autres symptômes peuvent s'associer : une toux sèche ou productive, des expectorations parfois teintées de sang, et une fatigue intense. Chez certains patients, on observe une cyanose (coloration bleutée des lèvres et des ongles) témoignant d'un manque d'oxygène [11,17].
L'important à retenir : ces symptômes peuvent évoluer très rapidement vers une détresse respiratoire. N'attendez pas si vous présentez plusieurs de ces signes, surtout si vous êtes drépanocytaire.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic du syndrome thoracique aigu repose sur l'association de signes cliniques et d'anomalies radiologiques. La rapidité du diagnostic est cruciale car elle maladiene la prise en charge et le pronostic [8,15].
La première étape consiste en un examen clinique approfondi. Votre médecin recherchera les symptômes caractéristiques et évaluera votre état respiratoire. L'auscultation pulmonaire peut révéler des râles crépitants ou une diminution du murmure vésiculaire [17].
La radiographie thoracique constitue l'examen de référence pour confirmer le diagnostic. Elle met en évidence des infiltrats pulmonaires nouveaux, souvent localisés aux bases pulmonaires [8,16]. Ces infiltrats peuvent être unilatéraux ou bilatéraux, et leur étendue maladiene la gravité de l'épisode.
L'échographie pulmonaire représente une innovation diagnostique prometteuse. Les études récentes de 2024 montrent qu'elle permet un diagnostic plus précoce que la radiographie, avec une sensibilité de 95% [12,15]. Cette technique non irradiante est particulièrement intéressante chez l'enfant.
Les examens biologiques complètent le bilan : numération formule sanguine (recherche d'une anémie aggravée), gaz du sang artériel (évaluation de l'oxygénation), et marqueurs inflammatoires. La recherche d'agents infectieux par prélèvements respiratoires est également systématique [9,17].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge du syndrome thoracique aigu nécessite une hospitalisation en urgence, souvent en unité de soins intensifs. Le traitement associe plusieurs approches thérapeutiques complémentaires [8,9].
L'oxygénothérapie constitue la base du traitement. Elle vise à maintenir une saturation en oxygène supérieure à 95%. En cas d'insuffisance respiratoire sévère, une ventilation non invasive ou même une intubation peut être nécessaire [17].
L'antibiothérapie est systématiquement prescrite, même en l'absence de preuve d'infection bactérienne. Les macrolides, notamment l'azithromycine, occupent une place privilégiée dans cette indication [9]. Une étude de 2025 confirme leur efficacité dans la réduction de la durée d'hospitalisation.
La transfusion sanguine représente souvent un traitement de première ligne. Elle peut être simple (transfusion de culots globulaires) ou par échange érythrocytaire selon la gravité. L'objectif est de diminuer le taux d'hémoglobine S en dessous de 30% [8,16].
Les bronchodilatateurs et les corticoïdes peuvent être utilisés en cas de composante asthmatiforme. L'hydratation intraveineuse et l'antalgie adaptée complètent la prise en charge [17]. Rassurez-vous : avec un traitement précoce et adapté, l'évolution est généralement favorable.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans la prise en charge de la drépanocytose avec l'arrivée de nouvelles thérapies révolutionnaires. CASGEVY (exagamglogene autotemcel), première thérapie génique approuvée par la HAS, ouvre des perspectives inédites [2].
Cette thérapie génique utilise la technologie CRISPR-Cas9 pour modifier les cellules souches du patient. Les premiers résultats montrent une réduction drastique des crises vaso-occlusives et, par conséquent, du risque de syndrome thoracique aigu [2,7]. Cependant, cette approche reste réservée aux formes les plus sévères de la maladie.
SIKLOS, l'hydroxyurée de référence, bénéficie également d'innovations avec de nouvelles formulations 100 et 1000 mg facilitant l'observance [1]. Les études de 2024 confirment son efficacité dans la prévention du syndrome thoracique aigu, avec une réduction de 50% des épisodes [1,7].
Les recherches actuelles explorent également de nouvelles pistes thérapeutiques. L'étude TASC, publiée en 2024, évalue l'efficacité de nouveaux agents anti-adhésifs qui empêchent les globules rouges de se coller aux parois vasculaires [6]. Les résultats préliminaires sont encourageants.
D'ailleurs, les innovations ne se limitent pas aux médicaments. Les techniques d'imagerie évoluent également : l'intelligence artificielle commence à être utilisée pour prédire les épisodes de syndrome thoracique aigu à partir des données cliniques [3,4].
Vivre au Quotidien avec le Syndrome Thoracique Aigu
Vivre avec le risque de syndrome thoracique aigu nécessite une adaptation de votre mode de vie, mais cela ne doit pas vous empêcher de mener une existence épanouie. L'important est de connaître vos limites et d'adopter les bonnes stratégies préventives [11].
La surveillance des symptômes constitue un élément clé. Apprenez à reconnaître les signes précurseurs : essoufflement inhabituel, douleur thoracique, fièvre. Tenez un carnet de suivi que vous pourrez présenter à votre équipe médicale [8]. Cette démarche proactive peut faire la différence.
L'activité physique reste possible et même recommandée, mais elle doit être adaptée. Privilégiez les exercices d'endurance modérée comme la marche, la natation en eau tempérée, ou le vélo. Évitez les sports intenses ou en altitude qui peuvent déclencher une crise [11,17].
Côté professionnel, il est important d'informer votre employeur de votre pathologie. Vous pouvez bénéficier d'aménagements : télétravail lors des épisodes de fatigue, horaires flexibles, ou adaptation du poste de travail. La reconnaissance en qualité de travailleur handicapé peut faciliter ces démarches.
N'oubliez pas l'importance du soutien psychologique. Vivre avec une maladie chronique peut générer de l'anxiété, surtout face au risque d'hospitalisation d'urgence. Les associations de patients offrent un soutien précieux et des conseils pratiques [14].
Les Complications Possibles
Le syndrome thoracique aigu peut évoluer vers plusieurs complications graves, d'où l'importance d'une prise en charge précoce et adaptée. La connaissance de ces risques permet une surveillance optimale [8,11].
La détresse respiratoire aiguë représente la complication la plus redoutable. Elle survient dans 10 à 15% des cas et nécessite souvent une ventilation mécanique [17]. Cette évolution peut être rapide, parfois en quelques heures, d'où l'importance de la surveillance hospitalière.
Les séquelles pulmonaires constituent une préoccupation majeure à long terme. Une étude guadeloupéenne de 2024 montre que 40% des patients gardent des séquelles fonctionnelles respiratoires après un épisode sévère [11]. Ces séquelles se traduisent par une diminution de la capacité respiratoire et une intolérance à l'effort.
Le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) peut compliquer les formes les plus graves. Il s'agit d'une inflammation généralisée des poumons avec œdème pulmonaire [16,17]. Cette complication engage le pronostic vital et nécessite une prise en charge en réanimation.
D'autres complications peuvent survenir : embolie pulmonaire, pneumothorax, ou encore insuffisance cardiaque droite par hypertension artérielle pulmonaire [8]. Heureusement, avec les progrès thérapeutiques actuels, ces complications graves sont devenues plus rares.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic du syndrome thoracique aigu s'est considérablement amélioré ces dernières années grâce aux progrès de la prise en charge. Néanmoins, il reste variable selon plusieurs facteurs [8,7].
La mortalité actuelle se situe entre 3 et 9% selon la gravité de l'épisode et la rapidité de la prise en charge [8,14]. Ce taux était de 15% dans les années 1990, témoignant des progrès réalisés. Les formes les plus graves, nécessitant une ventilation mécanique, présentent encore une mortalité de 20%.
Plusieurs facteurs influencent le pronostic. L'âge constitue un élément déterminant : les patients de plus de 20 ans ont un risque de complications plus élevé [14]. L'étendue des infiltrats pulmonaires à la radiographie initiale est également prédictive de la gravité.
La récidive est fréquente : environ 50% des patients présenteront un nouvel épisode dans les 5 ans [10,11]. Cependant, les traitements préventifs comme l'hydroxyurée réduisent significativement ce risque de récidive.
Concernant les séquelles à long terme, les données de 2024 montrent qu'environ 30% des patients conservent une limitation fonctionnelle respiratoire [11]. Ces séquelles sont généralement modérées et compatibles avec une vie normale, moyennant quelques adaptations.
L'important à retenir : un diagnostic précoce et un traitement adapté permettent d'obtenir une guérison complète dans la majorité des cas. Les innovations thérapeutiques de 2024-2025 laissent espérer une amélioration encore plus importante du pronostic [2,7].
Peut-on Prévenir le Syndrome Thoracique Aigu ?
La prévention du syndrome thoracique aigu repose sur plusieurs stratégies complémentaires. Bien qu'il ne soit pas toujours possible d'éviter complètement les épisodes, vous pouvez considérablement réduire leur fréquence et leur gravité [1,13].
L'hydroxyurée (SIKLOS) constitue le traitement préventif de référence. Ce médicament augmente la production d'hémoglobine fœtale, réduisant ainsi la falciformation des globules rouges [1]. Les études montrent une diminution de 50% des épisodes de syndrome thoracique aigu chez les patients traités.
La vaccination joue un rôle crucial, particulièrement chez l'enfant. La vaccination pneumococcique conjuguée a permis de réduire de 40% l'incidence du syndrome thoracique aigu pédiatrique depuis 2010 [13]. La vaccination antigrippale annuelle est également recommandée.
L'adoption de mesures hygiéno-diététiques s'avère essentielle. Maintenez une hydratation suffisante (au moins 2 litres d'eau par jour), évitez l'exposition au froid, et limitez les efforts physiques intenses [8,14]. L'arrêt du tabac est impératif car il multiplie par deux le risque d'épisodes.
La surveillance médicale régulière permet de détecter précocement les signes d'aggravation. Des consultations trimestrielles avec votre hématologue, associées à un bilan biologique, permettent d'adapter le traitement préventif [17].
Enfin, l'éducation thérapeutique vous aide à mieux connaître votre maladie et à réagir appropriément face aux premiers symptômes. Cette approche proactive peut faire la différence entre un épisode bénin et une hospitalisation prolongée.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont émis des recommandations précises concernant la prise en charge du syndrome thoracique aigu. Ces guidelines, régulièrement mises à jour, s'appuient sur les dernières données scientifiques [1,2].
La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande depuis 2024 l'utilisation préférentielle de SIKLOS dans ses nouvelles formulations 100 et 1000 mg pour la prévention [1]. Cette recommandation s'appuie sur des études démontrant une meilleure observance et une efficacité maintenue.
Concernant les innovations thérapeutiques, la HAS a approuvé CASGEVY (thérapie génique) pour les formes les plus sévères de drépanocytose [2]. Cette approbation s'accompagne de recommandations strictes sur les centres habilités et les critères de sélection des patients.
Le Ministère de la Santé a publié en 2024 de nouvelles directives sur l'organisation des soins pour les patients drépanocytaires [4]. Ces directives prévoient la création de filières de soins spécialisées et l'amélioration de la coordination entre les différents acteurs.
Les recommandations insistent particulièrement sur l'importance du diagnostic précoce et de la prise en charge en urgence. Tout patient drépanocytaire présentant des symptômes respiratoires doit bénéficier d'une évaluation médicale dans les 4 heures [8,17].
Enfin, les autorités recommandent le développement de programmes d'éducation thérapeutique et le renforcement du rôle des associations de patients dans l'accompagnement des malades [4].
Ressources et Associations de Patients
De nombreuses ressources sont disponibles pour vous accompagner dans la gestion du syndrome thoracique aigu et de la drépanocytose. Ces structures offrent un soutien précieux tant sur le plan médical que psychosocial.
L'Association pour l'Information et la Prévention de la Drépanocytose (APIPD) constitue la référence en France. Elle propose des groupes de parole, des formations pour les patients et leurs familles, ainsi qu'un accompagnement dans les démarches administratives. Leur site internet regorge d'informations pratiques actualisées.
La Fédération SOS Globi fédère plusieurs associations régionales et organise des événements de sensibilisation. Elle milite également pour l'amélioration de la prise en charge et le développement de la recherche. Leurs antennes locales peuvent vous mettre en relation avec d'autres patients de votre région.
Au niveau hospitalier, de nombreux centres de référence proposent des programmes d'éducation thérapeutique. Ces programmes vous aident à mieux comprendre votre maladie, à reconnaître les signes d'alerte, et à adapter votre mode de vie. Renseignez-vous auprès de votre hématologue.
Les réseaux sociaux offrent également des espaces d'échange entre patients. Des groupes Facebook dédiés permettent de partager expériences et conseils pratiques. Attention cependant à toujours vérifier les informations médicales avec votre équipe soignante.
N'oubliez pas les ressources numériques : applications mobiles pour le suivi des symptômes, sites web spécialisés, et plateformes de téléconsultation qui se développent rapidement [3,5].
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour mieux vivre avec le risque de syndrome thoracique aigu. Ces recommandations, issues de l'expérience clinique et des témoignages de patients, peuvent faire une réelle différence dans votre quotidien.
Préparez votre trousse d'urgence : gardez toujours avec vous une liste de vos médicaments, les coordonnées de votre hématologue, et votre carte de soins d'urgence. Ayez un oxymètre de pouls à domicile pour surveiller votre saturation en oxygène [11,15].
Organisez votre environnement : maintenez votre domicile à une température stable (évitez les écarts de plus de 5°C), utilisez un humidificateur en hiver, et aérez régulièrement. Évitez les atmosphères enfumées et les produits irritants [8,17].
Planifiez vos voyages : évitez les destinations en altitude (>1500m), prévoyez une assurance voyage adaptée, et emportez une réserve de médicaments. Informez-vous sur les structures médicales de votre destination [14].
Gérez votre stress : le stress peut déclencher des crises. Pratiquez des techniques de relaxation, maintenez un sommeil régulier (7-8h par nuit), et n'hésitez pas à consulter un psychologue si nécessaire.
Restez actif socialement : ne vous isolez pas. Maintenez vos activités sociales en les adaptant si nécessaire. Informez vos proches sur votre maladie pour qu'ils puissent vous aider en cas de besoin. L'important est de trouver le bon équilibre entre prudence et qualité de vie.
Quand Consulter un Médecin ?
Savoir quand consulter en urgence peut sauver votre vie en cas de syndrome thoracique aigu. Certains signes ne trompent pas et nécessitent une prise en charge médicale immédiate [8,17].
Consultez immédiatement si vous présentez : un essoufflement inhabituel au repos, une douleur thoracique intense, une fièvre supérieure à 38,5°C, ou une toux avec expectorations sanglantes. Ces symptômes peuvent évoluer rapidement vers une détresse respiratoire [11,17].
Appelez le 15 (SAMU) en cas de : difficultés respiratoires majeures, coloration bleutée des lèvres ou des ongles, confusion ou agitation, ou impossibilité de parler par phrases complètes. N'attendez pas : chaque minute compte [8].
Consultez dans les 24h pour : une fatigue inhabituelle persistante, une toux sèche qui s'aggrave, des douleurs thoraciques modérées mais persistantes, ou une fièvre modérée chez un patient drépanocytaire [14,17].
Bon à savoir : même si vos symptômes semblent bénins, n'hésitez pas à contacter votre équipe médicale. Il vaut mieux une consultation "pour rien" qu'un retard de diagnostic. Votre hématologue préfère être contacté trop souvent que pas assez.
Gardez toujours sur vous les numéros d'urgence de votre centre de référence. Beaucoup d'hôpitaux ont mis en place des lignes dédiées aux patients drépanocytaires, disponibles 24h/24 [4].
Questions Fréquentes
Le syndrome thoracique aigu est-il héréditaire ?Le syndrome thoracique aigu lui-même n'est pas héréditaire, mais il survient exclusivement chez les patients atteints de drépanocytose, qui est une maladie génétique héréditaire [8,16].
Peut-on guérir définitivement du syndrome thoracique aigu ?
Il n'existe pas de guérison définitive, mais les nouveaux traitements comme CASGEVY (thérapie génique) offrent des perspectives de rémission prolongée pour les formes sévères [2,7].
Le syndrome thoracique aigu est-il contagieux ?
Non, le syndrome thoracique aigu n'est absolument pas contagieux. Il s'agit d'une complication de la drépanocytose liée à l'occlusion des vaisseaux pulmonaires [17].
Combien de temps dure un épisode ?
La durée varie selon la gravité : de 3-5 jours pour les formes légères à 2-3 semaines pour les formes sévères nécessitant une ventilation mécanique [8,11].
Peut-on faire du sport avec un antécédent de syndrome thoracique aigu ?
Oui, mais l'activité physique doit être adaptée. Privilégiez les sports d'endurance modérée et évitez les efforts intenses ou en altitude [11,14].
Les femmes enceintes sont-elles plus à risque ?
La grossesse peut augmenter le risque de complications chez les femmes drépanocytaires, nécessitant une surveillance médicale renforcée [8].
Questions Fréquentes
Le syndrome thoracique aigu est-il héréditaire ?
Le syndrome thoracique aigu lui-même n'est pas héréditaire, mais il survient exclusivement chez les patients atteints de drépanocytose, qui est une maladie génétique héréditaire.
Peut-on guérir définitivement du syndrome thoracique aigu ?
Il n'existe pas de guérison définitive, mais les nouveaux traitements comme CASGEVY (thérapie génique) offrent des perspectives de rémission prolongée pour les formes sévères.
Combien de temps dure un épisode ?
La durée varie selon la gravité : de 3-5 jours pour les formes légères à 2-3 semaines pour les formes sévères nécessitant une ventilation mécanique.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] SIKLOS 100 et 1000 mg - Nouvelles formulations pour améliorer l'observance dans la prévention du syndrome thoracique aiguLien
- [2] CASGEVY (Exagamglogene autotemcel) - Première thérapie génique approuvée pour la drépanocytose sévèreLien
- [8] Syndrome thoracique aigu chez les patients drépanocytaires adultes - Épidémiologie et prise en chargeLien
- [9] Évaluation de la place des macrolides dans l'antibiothérapie probabiliste du syndrome thoracique aiguLien
- [10] Étude de la prévalence et des facteurs de risque du syndrome thoracique aigu dans une cohorte africaineLien
Publications scientifiques
- Syndrome thoracique aigu chez les patients drépanocytaires adultes (2022)9 citations
- Évaluation de la place des macrolides dans l'antibiothérapie probabiliste du syndrome thoracique aigu chez le patient drépanocytaire en unité de soins intensifs. (2025)
- Étude de la prévalence et des facteurs de risque du syndrome thoracique aigu dans une cohorte de patients drépanocytaires vivant dans cinq pays d'Afrique … (2024)
- Conséquences fonctionnelles respiratoires chez les patients drépanocytaires adultes ayant eu un syndrome thoracique aigu en Guadeloupe (2024)
- Apport de l'échographie pleuropulmonaire dans le dépistage et le monitorage du syndrome thoracique aigu chez les drépanocytaires dans le service de réanimation … (2024)[PDF]
Ressources web
- Drépanocytose: syndromes thoracique aigu et de détresse ... (revmed.ch)
Le STA est défini par l'apparition brutale de symptômes respiratoires évoquant une «pneumonie» (état fébrile, toux et dyspnée), associée à un infiltrat ...
- Le syndrome thoracique aigu : complication pulmonaire aiguë ... (revue-mir.srlf.org)
de B Maitre · 2014 · Cité 8 fois — La symptomatologie associe fièvre, dyspnée et douleur thoracique. Elle survient souvent après quelques jours d'hospitalisation pour crise vaso- ...
- Syndrome thoracique aigu (fr.wikipedia.org)
Le syndrome thoracique aigu s'exprime le plus souvent par une toux, une douleur thoracique, une dyspnée et une fièvre. La radiographie thoracique montre le plus ...
- Hématologie - Syndrome thoracique aigu dans la ... - JLE (jle.com)
Le syndrome thoracique aigu (STA), est défini par la survenue de douleurs thoraciques, de dyspnée, de toux, accompagnées de fièvre et surtout par l'apparition ...
- Syndrome thoracique aigu : une complication grave de la ... (revmed.ch)
Le syndrome thoracique aigu est une complication grave et la première cause de mortalité de la drépanocytose. Elle résulte d'une occlusion des capillaires ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
