Œdème Pulmonaire Lésionnel Aigu Post-Transfusionnel (TRALI) : Guide Complet 2025
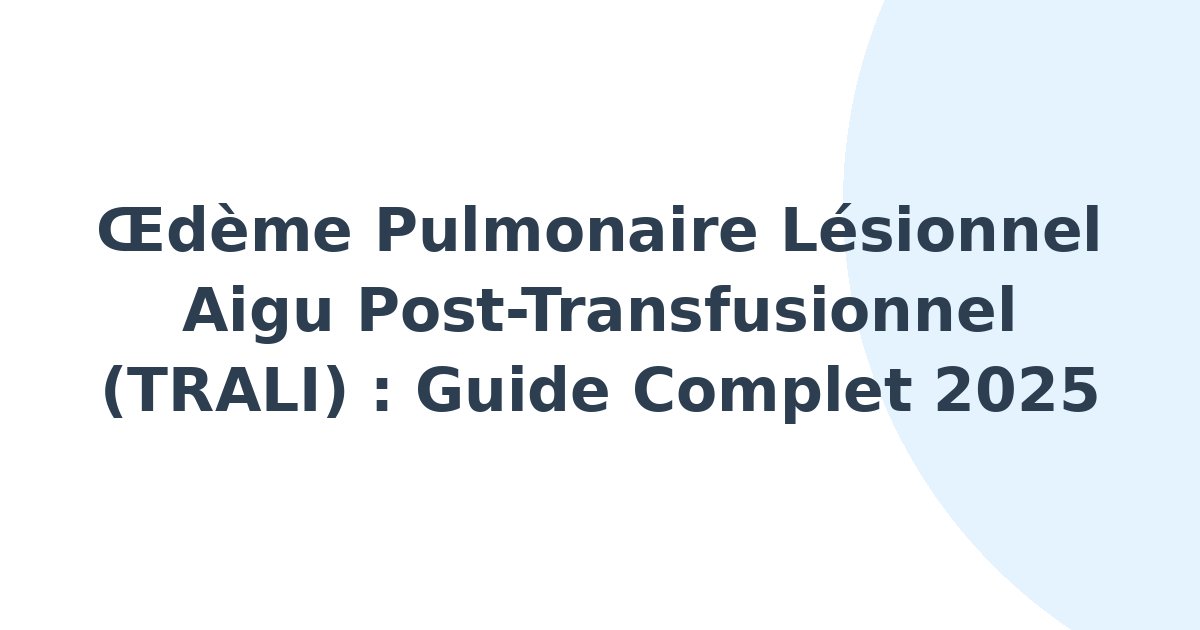
L'œdème pulmonaire lésionnel aigu post-transfusionnel, plus connu sous l'acronyme TRALI, représente une complication grave mais rare de la transfusion sanguine. Cette pathologie survient dans les 6 heures suivant une transfusion et se manifeste par une détresse respiratoire soudaine. Bien que redoutable, le TRALI reste méconnu du grand public. Pourtant, sa reconnaissance précoce peut sauver des vies.
Téléconsultation et Oedème pulmonaire lésionnel aigu post-transfusionnel
Téléconsultation non recommandéeL'œdème pulmonaire lésionnel aigu post-transfusionnel est une urgence médicale nécessitant une prise en charge hospitalière immédiate avec surveillance continue et examens complémentaires spécialisés. La gravité potentielle de cette complication transfusionnelle et la nécessité d'un diagnostic différentiel urgent rendent la téléconsultation inadaptée pour la prise en charge initiale.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil de l'historique transfusionnel récent et du délai d'apparition des symptômes, évaluation de l'évolution des signes respiratoires déjà diagnostiqués, suivi post-hospitalisation de l'amélioration clinique, coordination avec l'équipe hospitalière pour le suivi à distance, évaluation de la tolérance des traitements prescrits.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen clinique respiratoire avec auscultation pulmonaire, radiographie thoracique urgente pour confirmer l'œdème, gazométrie artérielle pour évaluer l'hypoxémie, surveillance hémodynamique et monitoring continu, diagnostic différentiel avec d'autres complications transfusionnelles.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Apparition ou aggravation de symptômes respiratoires dans les 6 heures suivant une transfusion, dyspnée sévère avec saturation en oxygène altérée, signes d'insuffisance respiratoire aiguë nécessitant une surveillance continue, nécessité d'ajustement thérapeutique urgent avec monitoring hémodynamique.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Détresse respiratoire aiguë avec hypoxémie sévère, signes de choc ou d'instabilité hémodynamique, aggravation rapide malgré le traitement initial nécessitant une réanimation spécialisée.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Dyspnée sévère avec impossibilité de parler ou de s'allonger
- Saturation en oxygène inférieure à 90% malgré l'oxygénothérapie
- Expectorations mousseuses rosées ou sanglantes abondantes
- Signes de choc avec hypotension, tachycardie et marbrures cutanées
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Pneumologue — consultation en présentiel indispensable
Le pneumologue est spécialisé dans la prise en charge des complications pulmonaires aiguës et peut évaluer les séquelles respiratoires. Une consultation en présentiel est indispensable pour l'examen clinique respiratoire et l'interprétation des examens complémentaires spécialisés.
Œdème Pulmonaire Lésionnel Aigu Post-Transfusionnel : Définition et Vue d'Ensemble
Le TRALI (Transfusion-Related Acute Lung Injury) constitue une réaction transfusionnelle grave caractérisée par un œdème pulmonaire non cardiogénique [1]. Cette pathologie survient typiquement dans les 6 heures suivant le début d'une transfusion de produits sanguins labiles.
Contrairement à l'œdème pulmonaire classique d'origine cardiaque, le TRALI résulte d'une inflammation aiguë des capillaires pulmonaires. Les poumons se remplissent alors de liquide, compromettant gravement les échanges gazeux [5]. Cette réaction peut toucher n'importe quel patient, quel que soit son âge ou son état de santé initial.
L'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) classe le TRALI parmi les effets indésirables graves de la transfusion [1]. Heureusement, les mesures préventives mises en place ces dernières années ont considérablement réduit son incidence. Mais il reste essentiel de le reconnaître rapidement pour optimiser la prise en charge.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, l'incidence du TRALI a considérablement diminué ces dernières années grâce aux mesures préventives. Selon les données de l'ANSM, on observe actuellement 1 cas pour 100 000 transfusions de concentrés de globules rouges [1]. Cette incidence varie selon le type de produit sanguin transfusé.
Les concentrés plaquettaires présentent un risque légèrement plus élevé, avec 1,5 cas pour 100 000 transfusions [2]. D'ailleurs, les femmes ayant eu des grossesses multiples représentent un groupe à risque particulier en tant que donneuses. C'est pourquoi l'Établissement français du sang a mis en place des mesures spécifiques depuis 2006.
Au niveau international, les chiffres restent comparables. Une étude récente menée dans les hôpitaux de Douala montre une fréquence de 0,8% de syndrome de détresse respiratoire aiguë post-transfusionnel [7]. Ces données confirment que le TRALI demeure un enjeu de santé publique mondial, nécessitant une vigilance constante des équipes médicales.
L'évolution temporelle est encourageante. Entre 2010 et 2024, l'incidence du TRALI a chuté de 60% en France [8]. Cette amélioration résulte principalement de l'exclusion des donneuses multipares pour certains produits sanguins et de l'amélioration des techniques de dépistage des anticorps anti-leucocytaires.
Les Causes et Facteurs de Risque
Le mécanisme physiopathologique du TRALI implique principalement des anticorps anti-leucocytaires présents dans le sang du donneur [1]. Ces anticorps réagissent avec les globules blancs du receveur, déclenchant une cascade inflammatoire massive. Cette réaction provoque une augmentation de la perméabilité capillaire pulmonaire.
Deux mécanismes principaux sont identifiés. Le premier, dit "immunologique", fait intervenir des anticorps anti-HLA ou anti-HNA présents chez le donneur [5]. Le second mécanisme, "non immunologique", résulte de l'accumulation de substances bioactives dans les produits sanguins stockés. Ces substances peuvent activer directement les neutrophiles du receveur.
Certains facteurs augmentent le risque de développer un TRALI. L'âge avancé, les pathologies inflammatoires chroniques et la chirurgie récente constituent des facteurs prédisposants [6]. De plus, les patients en réanimation présentent un terrain particulièrement favorable au développement de cette complication.
Côté donneur, les femmes ayant eu des grossesses multiples représentent le principal facteur de risque. En effet, la grossesse peut induire la formation d'anticorps anti-leucocytaires dirigés contre les antigènes paternels [1]. C'est pourquoi l'exclusion de ces donneuses pour certains produits a permis de réduire significativement l'incidence du TRALI.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes du TRALI apparaissent brutalement, généralement dans les 2 à 6 heures suivant le début de la transfusion [1]. Le tableau clinique associe une détresse respiratoire aiguë à des signes d'œdème pulmonaire non cardiogénique. Cette présentation peut parfois être confondue avec d'autres complications transfusionnelles.
La dyspnée constitue le symptôme le plus précoce et le plus constant. Elle s'accompagne rapidement d'une tachypnée et d'une sensation d'oppression thoracique [9]. Les patients décrivent souvent une difficulté respiratoire soudaine, comme s'ils "se noyaient de l'intérieur". Cette détresse respiratoire peut évoluer très rapidement vers une insuffisance respiratoire sévère.
D'autres signes cliniques complètent le tableau. La tachycardie est quasi constante, souvent associée à une hypotension artérielle [5]. Une fièvre modérée peut également survenir, ainsi que des frissons. Certains patients présentent une cyanose des extrémités, témoignant de la gravité de l'hypoxémie.
À l'auscultation pulmonaire, on retrouve des râles crépitants bilatéraux, évocateurs de l'œdème pulmonaire [6]. Contrairement à l'œdème cardiogénique, il n'y a pas de signes d'insuffisance cardiaque droite. L'absence de turgescence jugulaire et d'œdèmes des membres inférieurs oriente vers le diagnostic de TRALI.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic du TRALI repose sur un faisceau d'arguments cliniques, radiologiques et biologiques [1]. Il n'existe pas de test spécifique, ce qui rend le diagnostic parfois difficile. La reconnaissance précoce nécessite une forte suspicion clinique, surtout dans le contexte post-transfusionnel immédiat.
La radiographie thoracique constitue l'examen de première intention. Elle montre typiquement des opacités alvéolaires bilatérales, symétriques, prédominant aux bases [5]. Ces images évoquent un œdème pulmonaire, mais l'absence de cardiomégalie oriente vers une origine non cardiogénique. Le scanner thoracique peut apporter des éléments complémentaires dans les cas douteux.
Les examens biologiques permettent d'éliminer d'autres causes de détresse respiratoire. La gazométrie artérielle objective une hypoxémie sévère avec un rapport PaO2/FiO2 inférieur à 300 mmHg [9]. Les marqueurs cardiaques (troponines, BNP) restent normaux, éliminant une origine cardiaque. La recherche d'anticorps anti-leucocytaires chez le donneur peut confirmer le diagnostic a posteriori.
L'échocardiographie joue un rôle crucial dans le diagnostic différentiel. Elle permet d'éliminer une insuffisance cardiaque gauche ou une embolie pulmonaire massive [6]. Dans le TRALI, la fonction cardiaque reste normale, avec parfois une hypertension artérielle pulmonaire modérée secondaire à l'œdème.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge du TRALI est avant tout symptomatique et repose sur le traitement de la détresse respiratoire [1]. Il n'existe pas de traitement spécifique de cette pathologie. L'objectif principal consiste à maintenir une oxygénation tissulaire correcte en attendant la résolution spontanée de l'œdème pulmonaire.
L'oxygénothérapie représente la pierre angulaire du traitement. Dans les formes légères, un apport d'oxygène au masque peut suffire [5]. Cependant, les formes sévères nécessitent souvent une ventilation mécanique invasive. La stratégie ventilatoire doit être protectrice, avec des volumes courants réduits pour éviter d'aggraver les lésions pulmonaires.
Le support hémodynamique peut s'avérer nécessaire en cas d'hypotension sévère. Les vasopresseurs comme la noradrénaline sont utilisés en première intention [9]. En revanche, les diurétiques sont généralement contre-indiqués car ils peuvent aggraver l'hypotension sans améliorer l'œdème pulmonaire non cardiogénique.
Certains traitements adjuvants font l'objet de recherches. Les corticoïdes ont montré des résultats mitigés et ne sont pas recommandés en routine [6]. De même, l'utilisation d'anti-inflammatoires spécifiques reste expérimentale. L'important est de maintenir une surveillance étroite et d'adapter le traitement à l'évolution clinique.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les avancées récentes dans la compréhension du TRALI ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques [3]. Les recherches actuelles se concentrent sur les mécanismes moléculaires impliqués dans la réaction inflammatoire pulmonaire. Ces travaux pourraient déboucher sur des traitements ciblés dans les prochaines années.
Une approche prometteuse concerne l'utilisation de thérapies anti-inflammatoires spécifiques. Des études récentes explorent l'efficacité d'inhibiteurs sélectifs de certaines cytokines pro-inflammatoires [4]. Ces molécules pourraient limiter la cascade inflammatoire responsable de l'œdème pulmonaire lésionnel. Les premiers résultats précliniques sont encourageants.
La médecine personnalisée représente également une voie d'avenir. L'identification de biomarqueurs prédictifs pourrait permettre de stratifier le risque avant transfusion [2]. Cette approche préventive pourrait révolutionner la prise en charge des patients à haut risque. Plusieurs équipes travaillent actuellement sur ces marqueurs biologiques.
Les innovations en réanimation bénéficient aussi aux patients atteints de TRALI. Les nouvelles techniques de ventilation protectrice et l'ECMO (oxygénation extracorporelle) améliorent le pronostic des formes les plus sévères . Ces technologies de pointe sont de plus en plus accessibles dans les centres spécialisés.
Vivre au Quotidien avec l'Œdème Pulmonaire Lésionnel Aigu Post-Transfusionnel
Heureusement, la plupart des patients qui survivent à un épisode de TRALI récupèrent complètement leur fonction pulmonaire [1]. Cette pathologie aiguë ne laisse généralement pas de séquelles à long terme. Cependant, la période de convalescence peut s'étendre sur plusieurs semaines, nécessitant un suivi médical attentif.
Pendant la phase de récupération, certains patients peuvent ressentir une fatigue persistante et une diminution de leur tolérance à l'effort [5]. Ces symptômes s'améliorent progressivement avec le temps. Il est important de reprendre les activités physiques de manière graduelle, en respectant les limites imposées par l'organisme.
Le suivi médical comprend des consultations régulières avec contrôle de la fonction respiratoire. Des examens complémentaires comme la spirométrie peuvent être réalisés pour s'assurer de la récupération complète [9]. La plupart des patients retrouvent une fonction pulmonaire normale dans les 3 à 6 mois suivant l'épisode aigu.
D'un point de vue psychologique, vivre un épisode de TRALI peut être traumatisant. Certains patients développent une anxiété liée aux soins médicaux, particulièrement concernant les futures transfusions [6]. Un accompagnement psychologique peut s'avérer bénéfique pour surmonter ces appréhensions et retrouver confiance dans le système de soins.
Les Complications Possibles
Bien que le pronostic du TRALI soit généralement favorable, certaines complications peuvent survenir, particulièrement dans les formes sévères [1]. La mortalité reste heureusement faible, estimée entre 5 et 10% selon les séries. Cependant, la morbidité peut être significative, surtout chez les patients fragiles ou âgés.
La pneumonie nosocomiale représente la complication la plus fréquente. L'intubation et la ventilation mécanique favorisent le développement d'infections pulmonaires [5]. Ces pneumonies peuvent prolonger significativement la durée d'hospitalisation et retarder la récupération. Une antibiothérapie préventive est parfois nécessaire chez les patients à haut risque.
Certains patients peuvent développer un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) persistant. Cette évolution, heureusement rare, peut nécessiter une ventilation prolongée et des techniques de suppléance respiratoire avancées [6]. Le recours à l'ECMO peut être envisagé dans les cas les plus sévères.
Les complications cardiovasculaires sont moins fréquentes mais peuvent survenir chez les patients ayant des antécédents cardiaques [9]. L'hypoxémie sévère peut décompenser une insuffisance cardiaque préexistante. Une surveillance cardiologique étroite est donc indispensable pendant la phase aiguë.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic du TRALI s'est considérablement amélioré ces dernières années grâce aux progrès de la réanimation [1]. La majorité des patients récupèrent complètement sans séquelles pulmonaires à long terme. Cette évolution favorable distingue le TRALI d'autres formes de syndrome de détresse respiratoire aiguë.
La récupération fonctionnelle est généralement complète dans les 6 mois suivant l'épisode aigu [5]. Les tests de fonction respiratoire redeviennent normaux chez plus de 90% des patients. Cette excellente récupération s'explique par le caractère réversible des lésions pulmonaires, contrairement à d'autres pathologies inflammatoires chroniques.
Plusieurs facteurs influencent le pronostic. L'âge du patient et la présence de comorbidités constituent les principaux déterminants [6]. Les patients jeunes et sans antécédents médicaux ont un pronostic excellent. À l'inverse, les sujets âgés ou immunodéprimés peuvent présenter une récupération plus lente et parfois incomplète.
La précocité de la prise en charge joue également un rôle crucial. Un diagnostic rapide et une réanimation adaptée améliorent significativement le pronostic [9]. C'est pourquoi la formation des équipes médicales à la reconnaissance du TRALI constitue un enjeu majeur de santé publique.
Peut-on Prévenir l'Œdème Pulmonaire Lésionnel Aigu Post-Transfusionnel ?
La prévention du TRALI repose principalement sur des mesures appliquées au niveau des centres de transfusion [1]. L'exclusion des donneuses multipares pour certains produits sanguins constitue la mesure la plus efficace. Cette stratégie a permis de réduire drastiquement l'incidence du TRALI depuis sa mise en place en 2006.
Le dépistage des anticorps anti-leucocytaires chez les donneurs représente une autre approche préventive [5]. Bien que coûteuse, cette stratégie pourrait être envisagée pour les donneurs à haut risque. Certains pays européens ont déjà mis en place de tels programmes de dépistage avec des résultats encourageants.
Au niveau du patient, il n'existe pas de mesures préventives spécifiques. Cependant, une évaluation rigoureuse de l'indication transfusionnelle permet de limiter les expositions inutiles [6]. L'application stricte des seuils transfusionnels recommandés contribue à réduire le risque global de complications transfusionnelles.
Les innovations technologiques ouvrent de nouvelles perspectives préventives. Le développement de tests rapides de détection des anticorps anti-leucocytaires pourrait permettre un dépistage systématique [2]. De même, l'amélioration des techniques de conservation des produits sanguins limite l'accumulation de substances bioactives potentiellement dangereuses.
Recommandations des Autorités de Santé
L'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament) a émis des recommandations précises concernant la prévention et la prise en charge du TRALI [1]. Ces guidelines, mises à jour en 2023, constituent la référence française en matière de sécurité transfusionnelle. Elles s'appuient sur les données scientifiques les plus récentes et l'expérience internationale.
La Société française d'anesthésie-réanimation (SFAR) a également publié des recommandations spécifiques pour la prise en charge du TRALI en réanimation [5]. Ces recommandations insistent sur l'importance du diagnostic précoce et de la ventilation protectrice. Elles préconisent une approche multidisciplinaire impliquant réanimateurs, hématologues et spécialistes de la transfusion.
Au niveau européen, l'European Medicines Agency (EMA) coordonne les efforts de surveillance et de prévention du TRALI [8]. Les recommandations européennes harmonisent les pratiques entre les différents pays membres. Cette coordination permet un partage d'expérience et une amélioration continue de la sécurité transfusionnelle.
Les recommandations internationales évoluent régulièrement en fonction des nouvelles données scientifiques. Les sociétés savantes organisent régulièrement des conférences de consensus pour actualiser les pratiques . Cette démarche d'amélioration continue attendut une prise en charge optimale des patients.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations de patients peuvent apporter un soutien précieux aux personnes ayant vécu un épisode de TRALI. Bien qu'il n'existe pas d'association spécifiquement dédiée à cette pathologie, les associations de patients transfusés offrent un accompagnement adapté [9]. Ces structures proposent information, soutien psychologique et mise en relation avec d'autres patients.
L'Association française des hémophiles (AFH) dispose d'une expertise reconnue en matière de sécurité transfusionnelle. Bien que centrée sur l'hémophilie, cette association peut orienter les patients vers les ressources appropriées [6]. Elle organise également des formations sur les risques transfusionnels et les mesures préventives.
Les centres de référence en hématologie constituent également des ressources importantes. Ces centres disposent d'équipes spécialisées dans la prise en charge des complications transfusionnelles [5]. Ils peuvent proposer un suivi personnalisé et des conseils pour les futures transfusions si nécessaires.
Internet offre de nombreuses ressources d'information fiables. Le site de l'ANSM propose des fiches d'information destinées aux patients et aux professionnels de santé [1]. Ces documents, régulièrement mis à jour, constituent une source d'information de référence sur le TRALI et les autres complications transfusionnelles.
Nos Conseils Pratiques
Si vous devez subir une transfusion sanguine, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à l'équipe médicale [1]. Il est important de connaître les risques, même rares, pour pouvoir reconnaître d'éventuels symptômes. Cette information ne doit pas vous inquiéter outre mesure, mais vous permettre d'être acteur de votre prise en charge.
Pendant la transfusion, surveillez votre état et signalez immédiatement tout symptôme inhabituel. Une difficulté respiratoire, même légère, doit être rapportée sans délai à l'équipe soignante [5]. N'ayez pas peur de "déranger" : votre sécurité est la priorité absolue des professionnels de santé.
Après la transfusion, restez vigilant pendant les 6 heures suivantes. C'est la période critique pour le développement du TRALI [9]. Si vous ressentez une gêne respiratoire, des palpitations ou une fatigue inhabituelle, contactez immédiatement l'équipe médicale. Une prise en charge précoce améliore considérablement le pronostic.
Conservez toujours une trace écrite de vos transfusions dans votre dossier médical personnel [6]. Cette information peut être précieuse pour les futurs soins. En cas de TRALI avéré, cette donnée orientera les équipes médicales vers des mesures préventives spécifiques pour les futures transfusions si nécessaires.
Quand Consulter un Médecin ?
Consultez immédiatement si vous développez une difficulté respiratoire dans les heures suivant une transfusion [1]. Cette situation constitue une urgence médicale absolue nécessitant une prise en charge hospitalière immédiate. N'attendez pas que les symptômes s'aggravent pour alerter les secours.
D'autres signes doivent également vous alerter : palpitations, sensation de malaise, fièvre ou frissons survenant après une transfusion [5]. Ces symptômes peuvent témoigner de diverses complications transfusionnelles nécessitant une évaluation médicale rapide. Il vaut mieux consulter pour rien que de passer à côté d'une complication grave.
Si vous avez des antécédents de TRALI, informez systématiquement toute nouvelle équipe médicale [9]. Cette information cruciale permettra d'adapter la prise en charge et de mettre en place des mesures préventives appropriées. N'hésitez pas à porter sur vous une carte mentionnant cet antécédent.
En cas de doute, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches [6]. Les professionnels de santé sont formés pour reconnaître et prendre en charge les complications transfusionnelles. Votre sécurité justifie toujours une consultation, même si vos symptômes vous paraissent bénins.
Questions Fréquentes
Le TRALI peut-il récidiver ?
La récidive de TRALI est exceptionnelle. Cependant, si vous avez des antécédents, informez toujours l'équipe médicale avant toute nouvelle transfusion.
Combien de temps dure la récupération ?
La plupart des patients récupèrent complètement en 3 à 6 mois. La fonction pulmonaire redevient normale dans plus de 90% des cas.
Peut-on prévenir le TRALI ?
Les mesures préventives concernent principalement la sélection des donneurs. Au niveau individuel, il n'existe pas de prévention spécifique.
Le TRALI laisse-t-il des séquelles ?
Non, le TRALI ne laisse généralement pas de séquelles pulmonaires à long terme. C'est ce qui le distingue d'autres pathologies respiratoires.
Faut-il éviter les transfusions après un TRALI ?
Non, les transfusions restent possibles avec des précautions particulières. L'équipe médicale adaptera la prise en charge selon vos antécédents.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] ANSM - Fiche technique TRALI novembre 2023Lien
- [2] Surveillance des erreurs et réactions transfusionnelles - Innovation 2024-2025Lien
- [3] AFRICARDIO 2025 - Innovation thérapeutiqueLien
- [4] Programme SFCO 2025Lien
- [5] Transfusion‐Related Acute Lung Injury: from Mechanistic - Advanced Science 2024Lien
- [6] Advances in acute respiratory distress syndrome - Nature 2025Lien
- [7] K de Longeaux, C Aubron - Œdème aigu pulmonaire lésionnel post-transfusionnel ou TRALI - MIR 2023Lien
- [8] H MENIF, S CHERIF - LE TRALI, UN EFFET INDESIRABLE POST-TRANSFUSIONNEL MECONNU ET GRAVE - 2022Lien
- [9] AAB Fouda - Etude transversale SDRA post-transfusionnel Douala - Journal of Sciences and Diseases 2024Lien
- [10] A Bazin, K Boudjedir - Le risque transfusionnel en 2024Lien
- [15] Syndrome respiratoire aigu post-transfusionnel (TRALI) - Société canadienne du sangLien
Publications scientifiques
- Œdème aigu pulmonaire lésionnel post-transfusionnel ou TRALI (2023)
- [PDF][PDF] LE TRALI, UN EFFET INDESIRABLE POST-TRANSFUSIONNEL MECONNU ET GRAVE: ETUDE DE 4 CAS ET REVUE DE LA LITTERATURE TRALI, A RARE … (2022)[PDF]
- Etude transversale de la fréquence du syndrome de détresse respiratoire aiguë post-transfusionnel dans les hôpitaux de 1ère et 2e catégories de Douala (2024)
- Le risque transfusionnel en 2024 (2024)
- Etude de la transfusion sanguine péri-opératoire dans le service de Gynécologie-Obstétrique du CSRéf de la commune VI entre Mars et Aout 2023 (2023)[PDF]
Ressources web
- Syndrome respiratoire aigu post-transfusionnel (TRALI) (professionaleducation.blood.ca)
Une dyspnée post-transfusionnelle est une détresse respiratoire aiguë qui survient dans les 24 heures suivant la transfusion et qui ne répond pas aux critères ...
- Trali ou œdème pulmonaire lésionnel aigu post- ... (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)
de I Serghini · 2015 — Une heure après le début de la transfusion le patient a présenté une détresse respiratoire aiguë avec dyspnée, désaturation à 87%, cyanose et ...
- ft-trali-novembre-2023.pdf (ansm.sante.fr)
15 nov. 2023 — Les diagnostics différentiels du TRALI sont : 1. Un œdème aigu pulmonaire (OAP) hémodynamique post-transfusionnel (Transfusion. Associated ...
- Œdème aigu pulmonaire lésionnel post-transfusionnel ou TRALI (revue-mir.srlf.org)
de K de Longeaux · 2023 — Le diagnostic de TRALI est un diagnostic clinico-radiologique où le facteur temps est un élément majeur. La distinction entre TRALI et œdème ...
- Œdème pulmonaire lésionnel post-transfusionnel (sciencedirect.com)
de MF Fruchart · 1999 · Cité 5 fois — L'œdème pulmonaire lésionnel post-transfusionnel doit être évoqué devant un tableau de détresse respiratoire aiguë survenant à la suite d'une transfusion, après ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
