Syndrome d'Hypertension Intracrânienne Bénigne : Guide Complet 2025 | Symptômes, Traitements
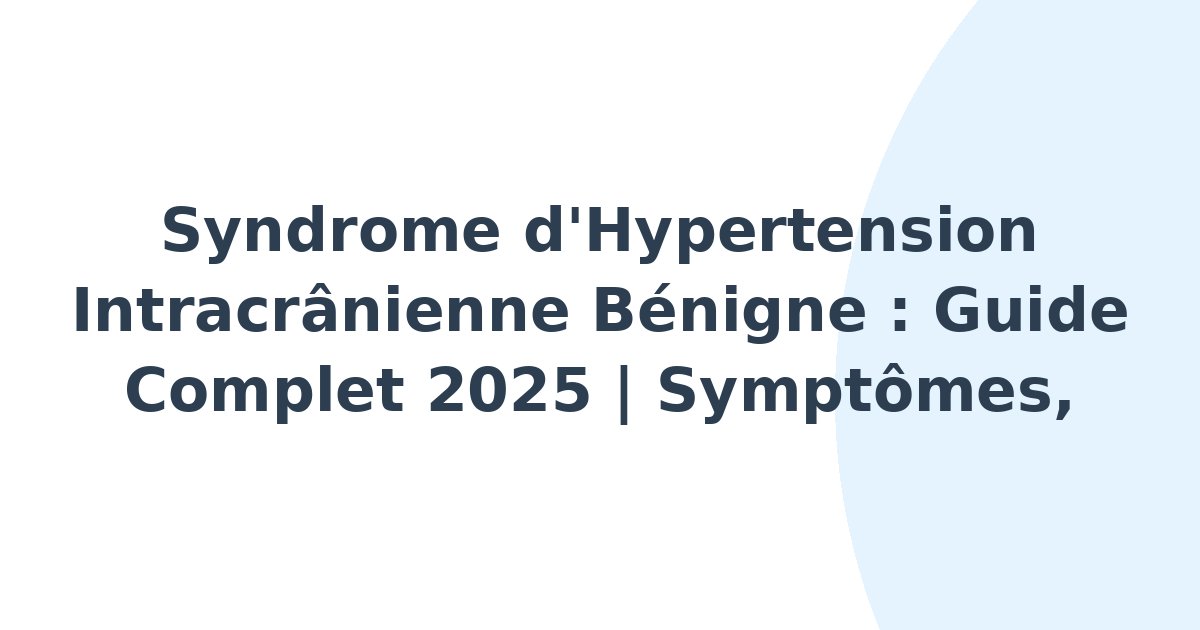
Le syndrome d'hypertension intracrânienne bénigne, aussi appelé pseudotumor cerebri, est une pathologie neurologique qui touche principalement les femmes jeunes. Cette maladie se caractérise par une augmentation de la pression du liquide céphalorachidien sans cause identifiable. Bien que qualifiée de "bénigne", elle peut entraîner des complications graves si elle n'est pas prise en charge rapidement.
Téléconsultation et Syndrome d'hypertension intracrânienne bénigne
Téléconsultation non recommandéeLe syndrome d'hypertension intracrânienne bénigne nécessite un examen neurologique complet avec évaluation du fond d'œil et mesure de la pression intracrânienne par ponction lombaire pour confirmer le diagnostic. La téléconsultation ne permet pas d'effectuer ces examens indispensables ni d'évaluer précisément les signes neurologiques objectifs.
Ce qui peut être évalué à distance
Évaluation de l'intensité et des caractéristiques des céphalées, description des troubles visuels rapportés par le patient, analyse de l'évolution des symptômes sous traitement, suivi de l'observance thérapeutique et des effets secondaires des diurétiques, orientation vers une prise en charge spécialisée urgente.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen du fond d'œil pour rechercher un œdème papillaire, évaluation neurologique complète avec recherche de déficits focaux, mesure de la pression intracrânienne par ponction lombaire, réalisation d'une imagerie cérébrale (IRM ou scanner) pour éliminer une cause secondaire.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Première suspicion diagnostique nécessitant un examen neurologique et ophtalmologique complet, aggravation des troubles visuels nécessitant une évaluation urgente du fond d'œil, inefficacité du traitement médical nécessitant une réévaluation de la pression intracrânienne, surveillance post-chirurgicale après dérivation du liquide céphalorachidien.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Baisse brutale de l'acuité visuelle ou amputation du champ visuel, céphalées d'intensité inhabituelle avec signes neurologiques associés, signes d'engagement cérébral (troubles de la conscience, vomissements en jet).
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Baisse brutale ou importante de l'acuité visuelle
- Troubles de la conscience ou confusion
- Céphalées très intenses avec vomissements en jet
- Apparition de déficits neurologiques focaux (paralysie, troubles de la parole)
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Neurologue — consultation en présentiel indispensable
Le diagnostic et la prise en charge du syndrome d'hypertension intracrânienne bénigne nécessitent une expertise neurologique avec réalisation d'examens spécialisés (ponction lombaire, évaluation neurologique complète). Une consultation en présentiel est indispensable pour confirmer le diagnostic et adapter le traitement.
Syndrome d'hypertension intracrânienne bénigne : Définition et Vue d'Ensemble
Le syndrome d'hypertension intracrânienne bénigne (HTIC idiopathique) représente une pathologie complexe du système nerveux central. Cette maladie se manifeste par une élévation anormale de la pression intracrânienne, sans qu'aucune lésion cérébrale ne soit détectable à l'imagerie [11,12].
Contrairement à ce que suggère son nom, cette pathologie n'est pas toujours "bénigne". En effet, elle peut provoquer des troubles visuels permanents et impacter significativement la qualité de vie des patients. Le terme "pseudotumor cerebri" illustre bien cette réalité : les symptômes ressemblent à ceux d'une tumeur cérébrale, mais aucune masse n'est présente [3,4].
La pression intracrânienne normale se situe entre 5 et 15 mmHg chez l'adulte. Dans cette pathologie, elle dépasse souvent 25 mmHg, créant une souffrance des structures cérébrales. Cette augmentation de pression affecte particulièrement le nerf optique, expliquant pourquoi les troubles visuels constituent souvent le premier signe d'alarme [8,9].
L'important à retenir, c'est que cette maladie touche préférentiellement certaines populations. Les femmes en âge de procréer, particulièrement celles présentant un surpoids, sont les plus concernées. Mais attention, cette pathologie peut également survenir chez l'homme et à tout âge [5,6].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, l'incidence annuelle du syndrome d'hypertension intracrânienne bénigne est estimée à 1 à 2 cas pour 100 000 habitants dans la population générale [3,4]. Cependant, cette prévalence grimpe spectaculairement chez les femmes obèses en âge de procréer, atteignant 19 à 21 cas pour 100 000 femmes [11,12].
Les données épidémiologiques récentes montrent une augmentation préoccupante de cette pathologie. D'ailleurs, cette tendance s'explique en partie par l'épidémie d'obésité que connaissent les pays développés. En effet, le surpoids constitue le principal facteur de risque modifiable de cette maladie [4,5].
Au niveau international, les États-Unis rapportent des chiffres similaires, avec une incidence de 0,9 cas pour 100 000 habitants. Mais chez les femmes obèses de 20 à 44 ans, ce taux explose littéralement pour atteindre 13 à 19 cas pour 100 000 [1,2]. Ces données soulignent l'importance du facteur pondéral dans le développement de cette pathologie.
L'âge moyen au diagnostic se situe autour de 30 ans, avec un pic d'incidence entre 20 et 40 ans. Concrètement, 90% des patients sont des femmes, et 80% d'entre elles présentent un indice de masse corporelle supérieur à 30 kg/m² [3,8]. Ces chiffres illustrent parfaitement le profil type de la patiente à risque.
Les Causes et Facteurs de Risque
Bien que qualifiée d'"idiopathique", cette pathologie présente des facteurs de risque bien identifiés. L'obésité arrive en tête de liste, multipliant par 5 à 10 le risque de développer la maladie [3,4]. Mais pourquoi cette association ? L'excès de poids perturbe la circulation du liquide céphalorachidien et augmente la pression abdominale, qui se répercute sur la pression intracrânienne.
Les facteurs hormonaux jouent également un rôle crucial. La grossesse, les contraceptifs oraux, les traitements hormonaux substitutifs peuvent tous déclencher ou aggraver la pathologie [5,6]. D'ailleurs, certaines femmes voient leurs symptômes fluctuer avec leur cycle menstruel, confirmant l'implication hormonale.
Certains médicaments constituent des facteurs de risque reconnus. Les tétracyclines, la vitamine A à forte dose, les corticoïdes (paradoxalement, aussi bien leur prise que leur arrêt), ou encore certains anticoagulants peuvent favoriser l'apparition de la maladie [8,9]. Il est donc essentiel d'informer votre médecin de tous vos traitements.
D'autres pathologies peuvent s'associer à cette maladie. Le syndrome d'apnées du sommeil, l'insuffisance rénale chronique, certaines maladies auto-immunes comme le lupus érythémateux disséminé constituent autant de facteurs favorisants [5,10]. Heureusement, la prise en charge de ces pathologies associées peut améliorer significativement les symptômes.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les céphalées constituent le symptôme le plus fréquent, touchant plus de 90% des patients [11,12]. Ces maux de tête présentent des caractéristiques particulières : ils sont souvent matinaux, s'aggravent en position couchée et s'accompagnent de nausées. Vous pourriez également ressentir une aggravation lors d'efforts, de toux ou d'éternuements.
Les troubles visuels représentent le signe d'alarme majeur de cette pathologie. Ils peuvent se manifester par une vision floue, des éclipses visuelles transitoires, ou une perte du champ visuel périphérique [8,9]. Certains patients décrivent des "voiles" devant les yeux ou des difficultés à voir dans l'obscurité. Ces symptômes nécessitent une consultation ophtalmologique urgente.
D'autres symptômes peuvent accompagner le tableau clinique. Les acouphènes pulsatiles - ces bruits rythmés dans l'oreille synchrones avec les battements cardiaques - touchent environ 60% des patients [3,4]. Vous pourriez aussi ressentir des vertiges, une fatigue inhabituelle, ou des troubles de la concentration.
Il est important de noter que certains patients présentent une forme atypique sans œdème papillaire visible [8]. Dans ces cas, le diagnostic peut être plus difficile à établir, d'où l'importance de consulter rapidement en cas de céphalées persistantes associées à des troubles visuels.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic du syndrome d'hypertension intracrânienne bénigne repose sur des critères précis établis par la communauté scientifique internationale [11,12]. La première étape consiste en un examen neurologique complet, incluant une évaluation de la fonction visuelle et un fond d'œil à la recherche d'un œdème papillaire.
L'imagerie cérébrale constitue une étape incontournable pour éliminer une cause secondaire. L'IRM cérébrale avec injection de gadolinium permet d'exclure une tumeur, une thrombose veineuse cérébrale ou une malformation [3,4]. Certains signes radiologiques peuvent orienter vers le diagnostic : selle turcique vide, dilatation des gaines du nerf optique, ou aplatissement de la partie postérieure du globe oculaire.
La ponction lombaire reste l'examen de référence pour confirmer le diagnostic. Elle permet de mesurer directement la pression du liquide céphalorachidien et d'analyser sa composition [8,9]. Une pression supérieure à 25 cmH2O (ou 20 cmH2O chez l'enfant) confirme l'hypertension intracrânienne. Rassurez-vous, cet examen, bien que désagréable, est généralement bien toléré.
L'examen ophtalmologique spécialisé complète le bilan diagnostique. Il comprend une mesure de l'acuité visuelle, un champ visuel automatisé et une tomographie par cohérence optique (OCT) du nerf optique [10,13]. Ces examens permettent d'évaluer le retentissement de la maladie sur la vision et de suivre son évolution.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement du syndrome d'hypertension intracrânienne bénigne s'articule autour de plusieurs axes thérapeutiques [11,12]. L'acétazolamide (Diamox®) constitue le traitement de première ligne, à la dose de 1 à 4 grammes par jour. Ce médicament diminue la production de liquide céphalorachidien en inhibant l'anhydrase carbonique.
La perte de poids représente un élément thérapeutique fondamental, particulièrement chez les patients obèses [3,4]. Une réduction pondérale de 5 à 10% peut suffire à améliorer significativement les symptômes. D'ailleurs, certains patients voient leurs symptômes disparaître complètement après une perte de poids importante.
En cas d'échec du traitement médical, des options chirurgicales existent. La dérivation lombo-péritonéale permet de drainer l'excès de liquide céphalorachidien vers la cavité abdominale [7,10]. Cette intervention, bien que plus invasive, peut être très efficace chez les patients réfractaires au traitement médical.
Le stenting du sinus latéral représente une technique innovante pour certains patients sélectionnés [7]. Cette procédure endovasculaire vise à lever une sténose veineuse qui pourrait contribuer à l'hypertension intracrânienne. Les résultats préliminaires sont encourageants, mais cette technique reste réservée à des centres spécialisés.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les innovations thérapeutiques 2024-2025 ouvrent de nouvelles perspectives dans la prise en charge de cette pathologie . Les dernières recherches se concentrent sur une meilleure compréhension des mécanismes physiopathologiques, permettant d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques [2].
Le développement de nouveaux inhibiteurs de l'anhydrase carbonique plus spécifiques et mieux tolérés fait l'objet d'essais cliniques prometteurs [1,2]. Ces molécules de nouvelle génération pourraient réduire les effets secondaires tout en maintenant une efficacité optimale sur la réduction de la pression intracrânienne.
Les techniques d'imagerie avancée révolutionnent également le diagnostic et le suivi des patients . L'IRM de diffusion et les séquences spécialisées permettent désormais de visualiser plus précisément les modifications de la circulation du liquide céphalorachidien et d'adapter les traitements en conséquence.
La médecine personnalisée commence à faire son entrée dans cette pathologie [1]. L'identification de biomarqueurs spécifiques pourrait permettre de prédire la réponse aux différents traitements et d'optimiser la prise en charge de chaque patient. Ces avancées laissent entrevoir un avenir plus prometteur pour les personnes atteintes de cette maladie.
Vivre au Quotidien avec le Syndrome d'hypertension intracrânienne bénigne
Vivre avec cette pathologie nécessite certains ajustements dans votre quotidien [11,12]. La gestion des céphalées chroniques peut impacter significativement votre qualité de vie professionnelle et personnelle. Il est important d'identifier vos facteurs déclenchants : stress, manque de sommeil, certains aliments, pour mieux les éviter.
L'activité physique adaptée joue un rôle bénéfique multiple [3,4]. Elle contribue à la perte de poids, améliore la circulation du liquide céphalorachidien et réduit le stress. Privilégiez les activités douces comme la marche, la natation ou le yoga. Évitez les sports avec des changements de position brusques ou des efforts en apnée.
La surveillance ophtalmologique régulière constitue un élément crucial du suivi [8,9]. Des contrôles tous les 3 à 6 mois permettent de détecter précocement toute aggravation des troubles visuels. N'hésitez pas à consulter rapidement si vous constatez une modification de votre vision.
Le soutien psychologique ne doit pas être négligé. Cette maladie chronique peut générer anxiété et dépression. L'accompagnement par un psychologue ou la participation à des groupes de patients peut vous aider à mieux gérer l'impact émotionnel de la pathologie [10,13].
Les Complications Possibles
Bien que qualifiée de "bénigne", cette pathologie peut entraîner des complications graves si elle n'est pas correctement prise en charge [11,12]. La perte visuelle permanente constitue la complication la plus redoutée, touchant 10 à 25% des patients selon les séries [8,9]. Cette atteinte peut être irréversible, d'où l'importance d'un diagnostic et d'un traitement précoces.
L'œdème papillaire chronique peut évoluer vers une atrophie optique si la pression intracrânienne reste élevée [3,4]. Cette complication se manifeste par une diminution progressive de l'acuité visuelle et un rétrécissement du champ visuel. Heureusement, un traitement adapté permet généralement de prévenir cette évolution.
Certains patients développent des complications neurologiques plus rares mais préoccupantes [5,6]. Les paralysies oculomotrices, particulièrement du nerf abducens (VI), peuvent survenir et entraîner une diplopie gênante. Ces complications sont généralement réversibles avec un traitement approprié.
Les complications liées aux traitements doivent également être prises en compte [10,13]. L'acétazolamide peut provoquer des calculs rénaux, une acidose métabolique ou des troubles électrolytiques. Les interventions chirurgicales comportent leurs propres risques : infection, dysfonctionnement de la dérivation, ou complications liées à l'anesthésie.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic du syndrome d'hypertension intracrânienne bénigne est généralement favorable avec une prise en charge adaptée [11,12]. La majorité des patients voient leurs symptômes s'améliorer significativement sous traitement médical bien conduit. Cependant, cette pathologie nécessite souvent un suivi prolongé, parfois sur plusieurs années.
La rémission spontanée est possible, particulièrement chez les patients qui parviennent à perdre du poids de façon significative [3,4]. Environ 10 à 20% des patients connaissent une guérison complète sans récidive. Cette évolution favorable est plus fréquente chez les femmes jeunes après une grossesse ou une perte de poids importante.
Le pronostic visuel dépend largement de la précocité du diagnostic et de la qualité du suivi ophtalmologique [8,9]. Les patients diagnostiqués tôt et correctement traités conservent généralement une vision normale. En revanche, un retard diagnostique ou un mauvais contrôle de la pression intracrânienne peut entraîner des séquelles visuelles définitives.
Les facteurs pronostiques incluent l'âge au diagnostic, la sévérité initiale de l'œdème papillaire, la réponse au traitement médical et l'observance thérapeutique [5,6]. Les patients jeunes, avec un œdème papillaire modéré et une bonne réponse à l'acétazolamide, ont généralement un excellent pronostic à long terme.
Peut-on Prévenir le Syndrome d'hypertension intracrânienne bénigne ?
La prévention primaire de cette pathologie repose essentiellement sur le contrôle des facteurs de risque modifiables [11,12]. Le maintien d'un poids corporel normal constitue la mesure préventive la plus efficace, particulièrement chez les femmes en âge de procréer. Une alimentation équilibrée et une activité physique régulière sont vos meilleurs alliés.
La surveillance médicamenteuse joue également un rôle préventif important [3,4]. Si vous devez prendre des tétracyclines, de la vitamine A à forte dose, ou des corticoïdes, informez votre médecin de vos antécédents. Une surveillance clinique rapprochée peut permettre de détecter précocement l'apparition de symptômes.
Chez les femmes à risque, la contraception doit être choisie avec précaution [5,6]. Les contraceptifs œstroprogestatifs peuvent favoriser l'apparition de la maladie chez les femmes prédisposées. Discutez avec votre gynécologue des alternatives contraceptives si vous présentez des facteurs de risque.
La prévention secondaire vise à éviter les récidives chez les patients ayant déjà présenté un épisode [8,9]. Elle repose sur le maintien d'un poids stable, la surveillance ophtalmologique régulière et l'évitement des facteurs déclenchants identifiés. Un suivi médical prolongé est souvent nécessaire pour détecter précocement toute récidive.
Recommandations des Autorités de Santé
Les recommandations françaises pour la prise en charge du syndrome d'hypertension intracrânienne bénigne s'appuient sur les données scientifiques les plus récentes [3,4]. La Société Française de Neurologie préconise une approche multidisciplinaire associant neurologues, ophtalmologues et, si nécessaire, neurochirurgiens.
L'Haute Autorité de Santé (HAS) souligne l'importance du diagnostic précoce et de la surveillance ophtalmologique régulière [11,12]. Les recommandations insistent sur la nécessité d'un bilan ophtalmologique complet au diagnostic, puis tous les 3 à 6 mois selon l'évolution clinique.
Au niveau international, l'American Academy of Neurology et l'European Federation of Neurological Societies ont publié des guidelines convergentes [8,9]. Ces recommandations mettent l'accent sur l'importance de la perte de poids comme traitement de première intention chez les patients obèses.
Les critères diagnostiques ont été récemment actualisés pour tenir compte des avancées en imagerie [5,6]. Les nouvelles recommandations intègrent l'utilisation de l'IRM avec séquences spécialisées et précisent les indications de la ponction lombaire. Ces évolutions permettent un diagnostic plus précis et une meilleure stratification des patients.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations de patients peuvent vous accompagner dans votre parcours avec cette pathologie [11,12]. L'Association Française contre les Myopathies (AFM-Téléthon) propose des ressources sur les maladies neurologiques rares, incluant des informations sur l'hypertension intracrânienne idiopathique.
Les réseaux sociaux spécialisés constituent une source précieuse de soutien et d'information [3,4]. Des groupes Facebook dédiés permettent d'échanger avec d'autres patients, de partager des expériences et de trouver du réconfort dans les moments difficiles. Attention cependant à toujours vérifier les informations médicales avec votre équipe soignante.
Les centres de référence pour les maladies neurologiques rares peuvent vous orienter vers des spécialistes expérimentés [8,9]. Ces centres, répartis sur le territoire français, disposent d'une expertise particulière dans la prise en charge de cette pathologie et peuvent vous proposer des traitements innovants.
N'oubliez pas les ressources en ligne fiables comme le site de l'Inserm, de la Société Française de Neurologie ou du ministère de la Santé [10,13]. Ces sources officielles vous attendussent des informations médicales validées et régulièrement mises à jour. Méfiez-vous des sites non officiels qui peuvent véhiculer des informations erronées.
Nos Conseils Pratiques
Pour mieux gérer votre quotidien avec cette pathologie, voici nos conseils pratiques basés sur l'expérience clinique [11,12]. Tenez un carnet de suivi de vos symptômes : notez l'intensité des céphalées, les troubles visuels, les facteurs déclenchants. Ces informations seront précieuses lors de vos consultations médicales.
Concernant l'alimentation, privilégiez une approche anti-inflammatoire [3,4]. Réduisez votre consommation de sel, qui peut aggraver la rétention d'eau et augmenter la pression intracrânienne. Augmentez vos apports en oméga-3, fruits et légumes riches en antioxydants. Hydratez-vous suffisamment mais sans excès.
Pour l'activité physique, adaptez vos exercices à votre état [8,9]. Évitez les positions tête en bas (yoga inversé, certains exercices de musculation), les sports de contact et les activités avec variations de pression importantes (plongée sous-marine). Privilégiez la marche, la natation douce, le vélo d'appartement.
Au niveau professionnel, n'hésitez pas à discuter avec votre médecin du travail si vos symptômes impactent votre activité [5,6]. Des aménagements peuvent être envisagés : pauses plus fréquentes, évitement des écrans prolongés, adaptation de l'éclairage. Votre santé doit rester la priorité.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes d'alarme nécessitent une consultation médicale urgente [11,12]. Si vous présentez des céphalées soudaines et intenses, différentes de vos maux de tête habituels, consultez immédiatement. De même, toute modification brutale de votre vision - baisse d'acuité, perte de champ visuel, diplopie - constitue une urgence ophtalmologique.
Les céphalées matinales persistantes, accompagnées de nausées et vomissements, doivent vous alerter [3,4]. Particulièrement si elles s'aggravent en position couchée ou lors d'efforts. Ces symptômes peuvent révéler une hypertension intracrânienne débutante nécessitant une prise en charge rapide.
Si vous êtes déjà suivi pour cette pathologie, consultez rapidement en cas de récidive des symptômes [8,9]. Une aggravation des céphalées, l'apparition de nouveaux troubles visuels, ou une modification de vos acouphènes peuvent signaler une poussée de la maladie nécessitant un ajustement thérapeutique.
N'attendez pas pour consulter si vous présentez des facteurs de risque et des symptômes évocateurs [5,6]. Femme jeune en surpoids avec céphalées récentes et troubles visuels ? Prenez rendez-vous rapidement avec votre médecin traitant qui vous orientera si nécessaire vers un spécialiste. Un diagnostic précoce améliore considérablement le pronostic.
Questions Fréquentes
Cette maladie est-elle vraiment bénigne ?
Malgré son nom, cette pathologie peut entraîner des complications graves, notamment visuelles. Le terme 'bénigne' signifie qu'il n'y a pas de tumeur, mais la maladie nécessite une prise en charge sérieuse.
Puis-je avoir des enfants avec cette maladie ?
La grossesse est possible mais nécessite une surveillance spécialisée. Certains médicaments comme l'acétazolamide doivent être arrêtés. Discutez de votre projet de grossesse avec votre neurologue et votre gynécologue.
Le traitement est-il à vie ?
Pas nécessairement. Certains patients peuvent arrêter leur traitement après une rémission prolongée, particulièrement s'ils ont perdu du poids. L'arrêt doit toujours se faire sous surveillance médicale.
Cette maladie est-elle héréditaire ?
Il n'existe pas de transmission héréditaire clairement établie. Cependant, certains facteurs de prédisposition (obésité, facteurs hormonaux) peuvent être familiaux.
Puis-je conduire avec cette maladie ?
Cela dépend de votre état visuel. Si vos troubles visuels sont contrôlés et que votre champ visuel est normal, la conduite reste possible. Un certificat médical peut être nécessaire.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] JNLF 2025. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] Programme 2025. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] Programme Déroulé. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] Pseudotumor Cerebri Market | Growth | Share | Size. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [5] Current Understanding of the Pathophysiology of Idiopathic. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [6] F Robelin, M Lenfant. Hypertension intracrânienne idiopathique: des mécanismes physiopathologiques à la décision thérapeutique. 2022Lien
- [7] M Malangu, A Adjamou. HYPERTENSION INTRA CRANIENNE IDIOPATHIQUE: A PROPOS D'UN CAS ET REVUE DE LA LITERRATURE. 2023Lien
- [8] SM Belateche, M Slaouti. Lupus érythémateux disséminé associé à une hypertension intracrânienne idiopathique. 2023Lien
- [9] C Benkhelifa, L Azouaou. Hypertension intracrânienne idiopathique chez l'hémodialysé. 2022Lien
- [10] V Barrot, J Caroff. Comment je fais un stenting du sinus latéral avec un accès artériel et veineux par le bras dans le cadre d'une hypertension intracrânienne idiopathique? 2023Lien
- [11] S Belarbi, N Akretche. Hypertension intracrânienne idiopathique atypique sans œdème papillaire. 2023Lien
- [12] FZ Ahsayen, Z Haddadi. Hypertension intracranienne idiopathique. 2023Lien
- [13] MA Essafi, FZ Melki. LA RHINORRHÉE CÉRÉBRO-SPINALE NON TRAUMATIQUE RÉVÉLANT UNE SELLE TURCIQUE VIDE PRIMITIVE ASSOCIÉE À UNE HTIC IDIOPATHIQUE. 2022Lien
- [14] Hypertension intracrânienne idiopathique. MSD ManualsLien
- [15] Hypertension intracrânienne : définition, symptômes. Deuxième AvisLien
- [16] Hypertension artérielle intracrânienne (HTIC). ElsanLien
Publications scientifiques
- Hypertension intracrânienne idiopathique: des mécanismes physiopathologiques à la décision thérapeutique (2022)
- HYPERTENSION INTRA CRANIENNE IDIOPATHIQUE: A PROPOS D'UN CAS ET REVUE DE LA LITERRATURE (2023)
- Lupus érythémateux disséminé associé à une hypertension intracrânienne idiopathique (2023)
- Hypertension intracrânienne idiopathique chez l'hémodialysé (2022)
- Comment je fais un stenting du sinus latéral avec un accès artériel et veineux par le bras dans le cadre d'une hypertension intracrânienne idiopathique? (2023)
Ressources web
- Hypertension intracrânienne idiopathique (msdmanuals.com)
La céphalée peut être accompagnée de nausées, de vision double ou trouble, et de bruits lancinants dans la tête qui se produisent avec chaque battement du pouls ...
- Hypertension intracrânienne : définition, symptômes et ... (deuxiemeavis.fr)
16 avr. 2024 — Les tests courants pour diagnostiquer cette condition incluent un examen ophtalmologique, une imagerie cérébrale par résonance magnétique (IRM) ...
- Hypertension artérielle intracrânienne (HTIC) (elsan.care)
Les symptômes incluent des maux de tête persistants, des nausées et des troubles visuels comme le flou visuel et le rétrécissement du champ visuel. Les patients ...
- Hypertension intracrânienne bénigne (em-consulte.com)
Le symptôme le plus fréquent est la céphalée qui est fréquemment associée à des acouphènes et à un oedème papillaire bilatéral. La " bénignité " de cette ...
- Hypertension intracrânienne | Société canadienne du cancer (cancer.ca)
Symptômes · nausées; · vomissements; · étourdissements; · changements de comportement; · mauvaise mémoire; · agitation; · troubles du système nerveux, dont : faiblesse ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
