Thromboses des Sinus Intracrâniens : Guide Complet 2025 | Symptômes, Traitements
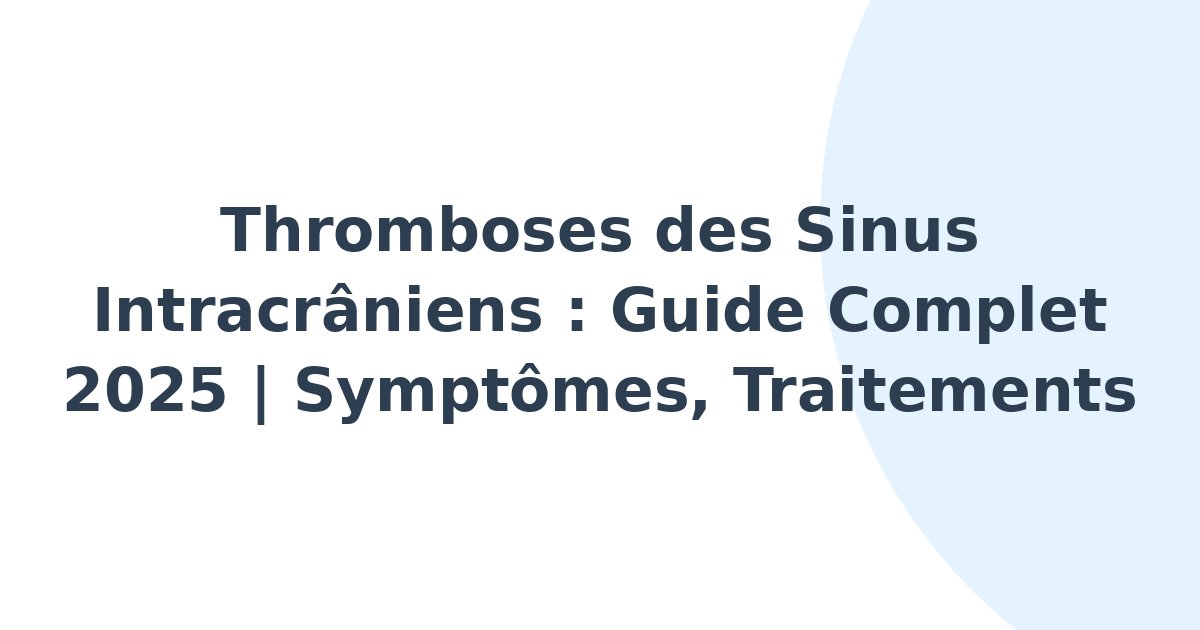
Les thromboses des sinus intracrâniens représentent une pathologie vasculaire cérébrale rare mais potentiellement grave. Cette maladie touche environ 3 à 4 personnes sur 1 million chaque année en France [1,2]. Contrairement aux AVC classiques, elle affecte le système veineux du cerveau. Heureusement, avec un diagnostic précoce et un traitement adapté, le pronostic reste favorable dans la majorité des cas.
Téléconsultation et Thromboses des sinus intracrâniens
Téléconsultation non recommandéeLa thrombose des sinus intracrâniens est une urgence neurologique potentiellement mortelle nécessitant un diagnostic rapide par imagerie cérébrale et une prise en charge hospitalière immédiate. Les symptômes peuvent être trompeurs et l'examen neurologique approfondi ainsi que les examens complémentaires urgents sont indispensables.
Ce qui peut être évalué à distance
Description détaillée des céphalées et de leur évolution temporelle, évaluation des troubles visuels ou neurologiques rapportés par le patient, analyse de l'historique des facteurs de risque thromboemboliques, orientation diagnostique initiale en cas de suspicion, coordination avec les services d'urgence pour une prise en charge rapide.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen neurologique complet avec évaluation du fond d'œil, imagerie cérébrale en urgence (IRM veineuse ou angio-scanner), ponction lombaire si indiquée, bilan de coagulation complet, prise en charge thérapeutique anticoagulante en milieu hospitalier.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion de thrombose des sinus intracrâniens nécessitant une imagerie cérébrale urgente, céphalées inhabituelles avec signes neurologiques associés, œdème papillaire suspecté au fond d'œil, nécessité d'un bilan étiologique complet incluant recherche de thrombophilie.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Céphalées d'installation brutale ou d'aggravation rapide avec signes neurologiques, troubles de la conscience ou convulsions, signes d'hypertension intracrânienne avec vomissements et troubles visuels.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Céphalées d'installation brutale ou d'aggravation rapide associées à des troubles neurologiques
- Troubles de la conscience, confusion ou altération de l'état mental
- Crises convulsives généralisées ou focales
- Troubles visuels soudains avec œdème papillaire ou diplopie
- Signes d'hypertension intracrânienne : vomissements en jet, photophobie intense
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Neurologue — consultation en présentiel indispensable
La thrombose des sinus intracrâniens nécessite une expertise neurologique spécialisée pour le diagnostic et la prise en charge. Une consultation en présentiel est obligatoire pour l'examen neurologique complet et la coordination des examens d'imagerie urgents.
Thromboses des sinus intracrâniens : Définition et Vue d'Ensemble
La thrombose des sinus intracrâniens est une pathologie vasculaire qui se caractérise par la formation d'un caillot sanguin dans les veines du cerveau. Plus précisément, ce caillot obstrue les sinus veineux duraux, ces canaux qui drainent le sang du cerveau vers le cœur [14,15].
Imaginez le système veineux cérébral comme un réseau de canalisations. Quand l'une d'elles se bouche, le sang s'accumule et crée une pression anormale dans le cerveau. C'est exactement ce qui se passe lors d'une thrombose veineuse cérébrale [8,10].
Cette maladie diffère fondamentalement des accidents vasculaires cérébraux classiques. En effet, ces derniers touchent les artères qui apportent le sang au cerveau, tandis que la thrombose veineuse affecte les veines qui l'évacuent [1,2]. Cette distinction est cruciale pour comprendre les symptômes et les traitements.
Les sinus veineux les plus fréquemment touchés sont le sinus sagittal supérieur, les sinus transverses et le sinus caverneux. Chacun a ses particularités cliniques. D'ailleurs, la localisation du caillot influence directement les symptômes que vous pourriez ressentir [14].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, les thromboses des sinus intracrâniens touchent environ 3 à 4 personnes par million d'habitants chaque année [1,2]. Cette incidence reste stable depuis une décennie, mais le diagnostic s'améliore grâce aux progrès de l'imagerie médicale.
Les femmes sont plus fréquemment touchées que les hommes, avec un ratio de 3:1. Cette prédominance féminine s'explique principalement par les facteurs hormonaux : grossesse, contraception orale et traitement hormonal substitutif [9,11]. L'âge moyen au diagnostic se situe autour de 35-40 ans, mais la pathologie peut survenir à tout âge.
Comparativement aux autres pays européens, la France présente une incidence similaire à celle observée en Allemagne ou au Royaume-Uni. Cependant, les pays en développement rapportent des taux plus élevés, souvent liés à des infections non traitées . Les données du Ministère de la Santé montrent une légère augmentation des diagnostics depuis 2020, probablement due à une meilleure reconnaissance de la maladie .
L'impact économique sur le système de santé français est estimé à environ 15 millions d'euros annuels, incluant les hospitalisations, les examens d'imagerie et les traitements [1,2]. Cette pathologie représente moins de 1% de tous les accidents vasculaires cérébraux, mais sa prise en charge nécessite souvent des séjours hospitaliers prolongés.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes des thromboses des sinus intracrâniens sont multiples et souvent intriquées. Chez les femmes, les facteurs hormonaux dominent largement : grossesse, post-partum, contraception œstroprogestative et traitement hormonal de la ménopause [9,11].
Les infections représentent une autre cause majeure, particulièrement les otites, mastoïdites et sinusites qui peuvent s'étendre aux sinus veineux adjacents . Les infections systémiques comme la septicémie peuvent également déclencher une thrombose par activation de la coagulation.
Certaines maladies systémiques augmentent significativement le risque. La maladie de Behçet, les connectivites et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin créent un état pro-thrombotique [12]. Les cancers, notamment les tumeurs cérébrales, peuvent comprimer les veines ou libérer des substances favorisant la coagulation.
D'autres facteurs incluent la déshydratation sévère, l'anémie ferriprive importante [11], et certains médicaments comme les corticoïdes à forte dose. Bon à savoir : dans environ 20% des cas, aucune cause n'est identifiée, on parle alors de thrombose idiopathique [10,15].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes des thromboses des sinus intracrâniens sont souvent trompeurs car ils peuvent évoluer de façon progressive ou brutale. Le mal de tête constitue le symptôme le plus fréquent, présent dans 90% des cas [14,15]. Mais attention, il ne s'agit pas d'une céphalée ordinaire.
Cette céphalée présente des caractéristiques particulières : elle est souvent intense, persistante, et s'aggrave progressivement. Elle peut s'accompagner de nausées et vomissements, évoquant une hypertension intracrânienne [8]. Contrairement aux migraines habituelles, elle ne cède pas aux antalgiques usuels.
D'autres symptômes peuvent apparaître selon la localisation de la thrombose. Les troubles visuels sont fréquents : vision floue, diplopie ou perte du champ visuel . Des crises d'épilepsie surviennent dans environ 40% des cas, parfois révélatrices de la maladie [10].
Les signes neurologiques focaux dépendent de la zone cérébrale affectée : faiblesse d'un membre, troubles du langage ou de la coordination. Dans les formes sévères, des troubles de la conscience peuvent apparaître, nécessitant une prise en charge urgente [15]. Il est crucial de consulter rapidement devant ces symptômes, car un diagnostic précoce améliore considérablement le pronostic.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des thromboses des sinus intracrâniens repose sur l'imagerie médicale, mais le parcours commence toujours par un examen clinique minutieux. Votre médecin recherchera les facteurs de risque et analysera vos symptômes [14,15].
L'IRM cérébrale avec séquences veineuses constitue l'examen de référence. Elle permet de visualiser directement le caillot dans les sinus veineux et d'évaluer les conséquences sur le tissu cérébral [7]. La phlébographie par résonance magnétique (ARM veineuse) complète souvent cet examen en montrant précisément l'anatomie veineuse.
Le scanner cérébral peut être réalisé en urgence, mais il est moins sensible que l'IRM pour détecter les thromboses veineuses. Cependant, il peut révéler des signes indirects comme un œdème cérébral ou des hémorragies [7]. L'angioscanner avec injection de produit de contraste améliore la détection.
Les examens biologiques recherchent une cause sous-jacente : bilan de coagulation, recherche de thrombophilie, marqueurs inflammatoires. Une ponction lombaire peut être nécessaire pour mesurer la pression intracrânienne et éliminer une méningite [15]. L'important à retenir : ces examens permettent non seulement de confirmer le diagnostic, mais aussi d'adapter le traitement à votre situation particulière.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement des thromboses des sinus intracrâniens repose principalement sur l'anticoagulation. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les anticoagulants sont efficaces même en présence d'hémorragie cérébrale associée [15]. L'héparine, puis les antivitamines K ou les anticoagulants oraux directs constituent le traitement de référence.
La durée du traitement anticoagulant varie selon la cause identifiée. En cas de facteur déclenchant transitoire (grossesse, infection), 3 à 6 mois suffisent généralement. Pour les thrombophilies ou les causes persistantes, le traitement peut s'étendre sur 12 mois ou plus [14,15].
Dans les cas sévères avec hypertension intracrânienne menaçante, des traitements spécifiques sont nécessaires. Les diurétiques osmotiques comme le mannitol réduisent rapidement la pression. Parfois, une dérivation du liquide céphalorachidien ou une craniectomie décompressive s'avèrent indispensables [8].
Les traitements symptomatiques ne sont pas négligés : antiépileptiques en cas de crises, antalgiques pour les céphalées, et prise en charge des facteurs déclenchants. La rééducation neurologique peut être nécessaire en cas de séquelles. Rassurez-vous, avec un traitement adapté, la majorité des patients récupèrent complètement [10,15].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les innovations thérapeutiques 2024-2025 dans le domaine des thromboses veineuses cérébrales sont prometteuses. Les techniques de thrombectomie mécanique se développent rapidement, notamment la thrombectomie assistée par ballonnet glissant qui permet d'extraire directement les caillots des sinus veineux [6].
Les Journées de Neurologie de Langue Française 2025 ont présenté des avancées significatives dans l'imagerie diagnostique [3,4]. Les nouvelles séquences IRM permettent une détection plus précoce et plus précise des thromboses, même dans les petites veines corticales. Cette amélioration diagnostique change la donne pour les formes débutantes.
La Semaine du Cerveau 2025 a mis en lumière les recherches sur les biomarqueurs sanguins spécifiques [4]. Ces marqueurs pourraient permettre un diagnostic plus rapide, particulièrement utile dans les services d'urgence où l'IRM n'est pas toujours immédiatement disponible.
En matière de traitement, les nouveaux anticoagulants oraux directs montrent une efficacité comparable aux traitements classiques avec moins d'effets secondaires [3,5]. Les études en cours évaluent également l'intérêt de la thrombolyse locale dans les formes les plus sévères. Ces innovations offrent de nouveaux espoirs pour améliorer le pronostic et réduire les séquelles [5,6].
Vivre au Quotidien avec une Thrombose des Sinus Intracrâniens
Vivre avec les séquelles d'une thrombose des sinus intracrâniens nécessite souvent des adaptations, mais la plupart des patients retrouvent une vie normale. Les céphalées résiduelles constituent la plainte la plus fréquente, touchant environ 30% des patients à long terme [10].
La gestion de ces maux de tête chroniques passe par une approche multimodale : médicaments préventifs, techniques de relaxation, et parfois consultation dans un centre spécialisé de la douleur. Il est important de maintenir un rythme de sommeil régulier et d'éviter les facteurs déclenchants identifiés.
Pour les patients sous anticoagulants au long cours, certaines précautions s'imposent. Évitez les sports à risque de traumatisme, surveillez les signes de saignement, et informez tous vos soignants de votre traitement. Les contrôles biologiques réguliers permettent d'ajuster les doses [15].
L'aspect psychologique ne doit pas être négligé. Beaucoup de patients développent une anxiété liée à la peur de récidive. Un suivi psychologique peut être bénéfique, ainsi que la participation à des groupes de patients. Concrètement, la reprise du travail est possible dans la majorité des cas, parfois avec des aménagements temporaires [10,15].
Les Complications Possibles
Les complications des thromboses des sinus intracrâniens peuvent être précoces ou tardives. L'hypertension intracrânienne représente la complication la plus fréquente et potentiellement la plus grave [8]. Elle se manifeste par des céphalées intenses, des troubles visuels et parfois un œdème papillaire.
Les hémorragies cérébrales surviennent dans environ 30% des cas, paradoxalement liées à la thrombose veineuse. Elles résultent de la rupture de petites veines sous pression. Heureusement, ces hémorragies sont souvent de petite taille et bien tolérées [15].
Les crises d'épilepsie peuvent persister après la phase aiguë, nécessitant un traitement antiépileptique prolongé. Environ 10% des patients développent une épilepsie chronique [10]. Les troubles cognitifs légers sont possibles, particulièrement en cas d'atteinte bilatérale ou d'hémorragie associée.
À long terme, certains patients développent une hypertension intracrânienne chronique, nécessitant parfois des interventions comme la pose d'un stent dans les sinus veineux [13]. Cette complication, bien que rare, peut altérer significativement la qualité de vie. La surveillance ophtalmologique régulière permet de dépister précocement ces complications [8,13].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des thromboses des sinus intracrâniens s'est considérablement amélioré ces dernières décennies. Avec un diagnostic précoce et un traitement adapté, plus de 85% des patients récupèrent complètement sans séquelles [15]. Cette évolution favorable contraste avec la gravité potentielle de la maladie.
Plusieurs facteurs influencent le pronostic. L'âge joue un rôle important : les patients jeunes récupèrent généralement mieux. La rapidité du diagnostic et de la mise en route du traitement constitue un facteur pronostique majeur [10,15]. Les formes avec coma initial ou crises d'épilepsie répétées ont un pronostic plus réservé.
La mortalité reste faible, inférieure à 5% dans les séries récentes. Elle concerne principalement les formes avec engagement cérébral ou complications hémorragiques majeures. Les décès surviennent généralement dans les premiers jours, d'où l'importance d'une prise en charge précoce [15].
Concernant les récidives, elles restent exceptionnelles (moins de 2% des cas) lorsque le traitement anticoagulant est bien conduit. La plupart des patients peuvent reprendre leurs activités habituelles dans les 3 à 6 mois suivant l'épisode aigu. Bon à savoir : même en cas de séquelles, des améliorations sont possibles plusieurs mois après l'accident initial [10,15].
Peut-on Prévenir les Thromboses des Sinus Intracrâniens ?
La prévention des thromboses des sinus intracrâniens passe d'abord par l'identification et la gestion des facteurs de risque modifiables. Chez les femmes, le choix de la contraception doit être adapté, particulièrement en cas d'antécédents familiaux de thrombose [11].
La prévention des infections ORL constitue un axe important, surtout chez l'enfant. Un traitement précoce des otites, sinusites et mastoïdites réduit significativement le risque d'extension aux sinus veineux . Une bonne hygiène dentaire participe également à cette prévention.
Pour les patients à risque élevé (thrombophilie connue, maladie auto-immune), une prophylaxie anticoagulante peut être envisagée dans certaines situations : grossesse, chirurgie majeure, immobilisation prolongée. Cette décision nécessite toujours une évaluation spécialisée [12].
L'hygiène de vie joue un rôle non négligeable : maintenir une bonne hydratation, éviter l'immobilisation prolongée, traiter l'anémie ferriprive. Chez les voyageurs, les recommandations sanitaires incluent la prévention de la déshydratation et des infections . Cependant, il faut reconnaître que certaines thromboses surviennent sans facteur de risque identifiable, rendant la prévention parfois impossible [10].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités de santé françaises ont émis des recommandations précises concernant la prise en charge des thromboses des sinus intracrâniens. L'Assurance Maladie souligne l'importance du diagnostic différentiel avec les AVC artériels, nécessitant une imagerie spécialisée [1,2].
Le Ministère de la Santé insiste sur la formation des professionnels de santé à la reconnaissance de cette pathologie rare. Les recommandations 2024-2025 préconisent un accès facilité à l'IRM dans les services d'urgence pour améliorer le diagnostic précoce .
Concernant le traitement anticoagulant, les recommandations françaises s'alignent sur les guidelines européennes : héparine en phase aiguë, puis relais par anticoagulants oraux. La durée minimale de traitement est fixée à 3 mois, avec adaptation selon la cause [1,2].
Les centres de référence pour les maladies vasculaires rares ont été renforcés en 2024. Ils assurent la prise en charge des cas complexes et la formation des équipes locales. Un réseau de télémédecine permet aux hôpitaux périphériques de bénéficier d'avis spécialisés . Ces mesures visent à réduire les inégalités territoriales dans l'accès aux soins spécialisés.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations de patients accompagnent les personnes touchées par les thromboses des sinus intracrâniens. L'Association France AVC propose des groupes de parole spécifiques aux accidents vasculaires cérébraux veineux, souvent méconnus du grand public.
La Fondation pour la Recherche sur les AVC finance des projets de recherche sur les thromboses veineuses cérébrales. Elle met à disposition des patients des brochures d'information et organise des conférences grand public pour sensibiliser à cette pathologie rare.
Les réseaux sociaux jouent un rôle croissant dans l'entraide entre patients. Des groupes Facebook dédiés permettent d'échanger expériences et conseils pratiques. Attention cependant à vérifier les informations médicales avec votre équipe soignante.
Au niveau local, de nombreux centres hospitaliers organisent des consultations multidisciplinaires post-AVC incluant neurologues, rééducateurs et psychologues. Ces consultations facilitent le suivi à long terme et l'adaptation du traitement. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre neurologue sur les ressources disponibles dans votre région.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour mieux vivre avec une thrombose des sinus intracrâniens. Tenez un carnet de suivi de vos symptômes, particulièrement des céphalées. Cela aide votre médecin à ajuster le traitement et à détecter d'éventuelles complications.
Si vous êtes sous anticoagulants, portez toujours sur vous votre carte de traitement anticoagulant. Informez systématiquement tous vos soignants (dentiste, kinésithérapeute, pharmacien) de votre traitement. Évitez l'automédication, certains médicaments pouvant interagir dangereusement.
Concernant l'activité physique, reprenez progressivement selon les conseils de votre médecin. La marche, la natation et le vélo sont généralement bien tolérés. Évitez les sports de contact ou à risque de chute tant que vous êtes sous anticoagulants.
Pour gérer les céphalées résiduelles, identifiez vos facteurs déclenchants : stress, manque de sommeil, certains aliments. Les techniques de relaxation, la méditation ou l'acupuncture peuvent apporter un soulagement complémentaire. Maintenez un rythme de vie régulier et n'hésitez pas à demander de l'aide à votre entourage pendant la convalescence.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes d'alarme nécessitent une consultation médicale urgente. Toute céphalée inhabituelle, intense et persistante doit vous alerter, surtout si elle s'accompagne de nausées, vomissements ou troubles visuels [14,15].
Consultez immédiatement si vous présentez des troubles neurologiques nouveaux : faiblesse d'un membre, troubles de la parole, perte d'équilibre ou crises convulsives. Ces symptômes peuvent révéler une thrombose veineuse cérébrale ou ses complications [10].
Pour les patients déjà traités, surveillez les signes de saignement : ecchymoses spontanées, saignements de nez répétés, selles noires. Ces symptômes peuvent indiquer un surdosage des anticoagulants nécessitant un ajustement rapide [15].
N'attendez pas pour consulter en cas de récidive des symptômes initiaux, même sous traitement. Bien que les récidives soient rares, elles restent possibles et nécessitent une réévaluation complète. En cas de doute, contactez votre neurologue ou rendez-vous aux urgences. Il vaut mieux consulter pour rien que de passer à côté d'une complication [14,15].
Questions Fréquentes
Quelle est la différence entre une thrombose veineuse cérébrale et un AVC classique ?
La thrombose veineuse cérébrale affecte les veines qui drainent le sang du cerveau, tandis que l'AVC classique touche les artères qui l'alimentent. Les symptômes et traitements diffèrent significativement.
Combien de temps dure le traitement anticoagulant ?
La durée varie de 3 mois à plus d'un an selon la cause identifiée. Les facteurs transitoires nécessitent un traitement plus court que les causes persistantes.
Peut-on guérir complètement d'une thrombose des sinus intracrâniens ?
Oui, plus de 85% des patients récupèrent complètement sans séquelles avec un diagnostic précoce et un traitement adapté.
Y a-t-il des restrictions alimentaires sous anticoagulants ?
Avec les nouveaux anticoagulants oraux, il n'y a généralement pas de restrictions alimentaires majeures. Votre médecin vous donnera des conseils spécifiques selon votre traitement.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Comprendre l'accident vasculaire cérébral et l'AVC - Données épidémiologiques françaises 2024-2025Lien
- [2] Comprendre l'accident vasculaire cérébral et l'AVC - Statistiques nationalesLien
- [3] Recommandations sanitaires aux voyageurs 2024-2025Lien
- [4] JNLF 2025 - Innovations thérapeutiques en neurologieLien
- [5] Semaine du Cerveau 2025 - Avancées diagnostiquesLien
- [6] JNLF 2024 - Nouveaux anticoagulants orauxLien
- [7] Thrombectomie assistée par ballonnet glissant - Innovation 2024-2025Lien
- [8] Imagerie de la thrombose veineuse cérébrale - Techniques diagnostiquesLien
- [9] Hypertension intracrânienne chronique secondaire à une thrombose veineuse cérébraleLien
- [10] Manifestations oculaires des fistules artérioveineuses duralesLien
- [11] Thrombose veineuse cérébrale révélée au cours d'une acidocétose diabétique - 2024Lien
- [12] Thrombose veineuse cérébrale multifocale - Revue Médicale de Liège 2023Lien
- [13] Thrombose veineuse cérébrale et anémie ferriprive sévère - 2025Lien
- [14] Les otomastoïdites aigues : du diagnostic à la prise en charge - 2025Lien
- [15] Atteinte vasculaire de la maladie de Behçet chez l'enfantLien
- [16] Stenting du sinus latéral dans l'hypertension intracrânienne idiopathique - 2023Lien
- [17] Thrombose du sinus caverneux - Manuel MSDLien
- [18] Thrombophlébites cérébrales : aspects cliniques - SRLFLien
Publications scientifiques
- [PDF][PDF] Hypertension intracrânienne chronique secondaire à une thrombose veineuse cérébrale [PDF]
- [PDF][PDF] Manifestations oculaires provoquées par les fistules artérioveineuses durales sans implication du sinus caverneux: une série de cas avec revue de la littérature
- Thrombose veineuse cérébrale révélée au cours d'une acidocétose diabétique: à propos d'un cas (2024)
- Thrombose veineuse cérébrale multifocale. (2023)[PDF]
- Thrombose veineuse cérébrale et anémie ferriprive sévère: complexité diagnostique et prise en charge (2025)
Ressources web
- Thrombose du sinus caverneux - Troubles oculaires (msdmanuals.com)
Les premiers symptômes de la thrombose du sinus caverneux sont des céphalées devenant progressivement intenses ou des douleurs faciales, habituellement unilaté ...
- Thrombophlébites cérébrales : aspects cliniques, ... (srlf.org)
de C Arquizan · 2001 · Cité 51 fois — Le diagnostic est plus difficile lorsqu'une partie du sinus n'est pas opacifiée ou est irrégulière, ce qui donne tout son intérêt aux signes indirects. En.
- Thrombose veineuse cérébrale (fr.wikipedia.org)
Elle se traduit cliniquement par des céphalées, parfois des déficits neurologiques et des crises épileptiques. Le diagnostic se fait par l'IRM et le traitement ...
- Thrombose veineuse cérébrale - Revue MIR (revue-mir.srlf.org)
Le traitement repose sur l'anticoagulation efficace, c'est- à-dire actuellement l'héparine, dont l'objectif est de favori- ser la recanalisation des sinus ou ...
- Thrombose du sinus caverneux : symptômes, causes et ... (apollohospitals.com)
19 févr. 2025 — Des maux de tête sévères et un gonflement ou un bombement d'un ou des deux yeux sont quelques-uns des premiers signes d'une thrombose du sinus ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
