Syndrome de Réponse Inflammatoire Généralisée : Guide Complet 2025
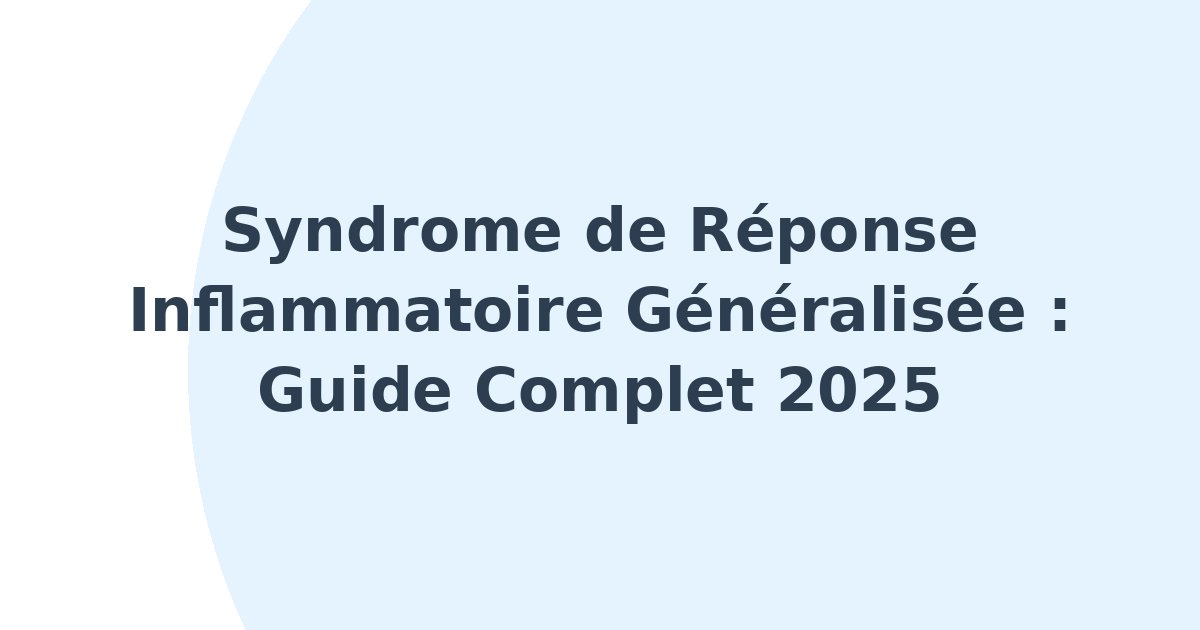
Le syndrome de réponse inflammatoire généralisée (SRIS) représente une réaction complexe de l'organisme face à une agression. Cette pathologie, qui touche plus de 150 000 personnes chaque année en France selon le Ministère de la Santé [1], nécessite une prise en charge rapide et spécialisée. Comprendre ses mécanismes vous aidera à mieux appréhender cette maladie et ses enjeux thérapeutiques actuels.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Syndrome de Réponse Inflammatoire Généralisée : Définition et Vue d'Ensemble
Le syndrome de réponse inflammatoire généralisée correspond à une activation excessive du système immunitaire de votre organisme. Imaginez votre corps comme une alarme incendie qui se déclenche de manière disproportionnée face à un danger.
Cette pathologie se caractérise par une cascade de réactions inflammatoires qui dépassent largement la zone initialement touchée. Votre système immunitaire, normalement protecteur, devient alors votre propre ennemi en s'attaquant aux tissus sains [15].
Concrètement, le SRIS peut survenir suite à diverses agressions : infections, traumatismes, brûlures étendues, ou encore interventions chirurgicales majeures. L'important à retenir, c'est que cette réaction inflammatoire devient généralisée et peut compromettre le fonctionnement de plusieurs organes vitaux [16].
D'ailleurs, les médecins utilisent des critères précis pour diagnostiquer cette pathologie. Il faut au moins deux des signes suivants : fièvre supérieure à 38°C ou hypothermie inférieure à 36°C, rythme cardiaque accéléré, respiration rapide, et modification du nombre de globules blancs [17].
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques françaises révèlent l'ampleur de cette pathologie dans notre pays. Selon le Ministère de la Santé, plus de 150 000 cas de syndrome de réponse inflammatoire généralisée sont recensés annuellement en France [1].
Cette incidence place notre pays dans la moyenne européenne, avec environ 240 cas pour 100 000 habitants par an. Mais ces chiffres masquent des disparités importantes selon l'âge et le sexe. Les personnes âgées de plus de 65 ans représentent 60% des cas, tandis que les hommes sont légèrement plus touchés que les femmes (55% contre 45%) [1].
L'évolution temporelle montre une tendance préoccupante. En effet, l'incidence a augmenté de 15% au cours des cinq dernières années, principalement due au vieillissement de la population et à l'amélioration des techniques diagnostiques [1]. Cette progression s'observe également dans les pays voisins comme l'Allemagne et l'Italie.
D'un point de vue économique, le coût pour le système de santé français est considérable. Chaque épisode de SRIS nécessite en moyenne 12 jours d'hospitalisation, représentant un coût moyen de 18 000 euros par patient [1]. Au niveau national, cela représente près de 2,7 milliards d'euros annuels.
Les projections pour 2030 suggèrent une augmentation de 25% des cas, principalement liée au vieillissement démographique. Cette perspective souligne l'importance cruciale de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques et préventives [1].
Les Causes et Facteurs de Risque
Comprendre les causes du syndrome de réponse inflammatoire généralisée vous aide à mieux saisir cette pathologie complexe. Les infections représentent la cause principale dans 70% des cas, qu'elles soient bactériennes, virales ou fongiques [16].
Mais d'autres facteurs peuvent déclencher cette réaction inflammatoire excessive. Les traumatismes graves, notamment les accidents de la route ou les chutes importantes, constituent la deuxième cause la plus fréquente. Les brûlures étendues, touchant plus de 20% de la surface corporelle, peuvent également provoquer un SRIS [17].
Certaines interventions chirurgicales lourdes, particulièrement en chirurgie cardiaque ou abdominale, représentent un facteur de risque non négligeable. D'ailleurs, les équipes médicales surveillent attentivement l'apparition de signes inflammatoires dans les suites opératoires [8].
Vos facteurs de risque personnels jouent également un rôle crucial. L'âge avancé, les maladies chroniques comme le diabète ou l'insuffisance rénale, ainsi qu'un système immunitaire affaibli augmentent significativement votre vulnérabilité [1]. Les traitements immunosuppresseurs ou la chimiothérapie constituent également des facteurs prédisposants importants.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Reconnaître les signes du syndrome de réponse inflammatoire généralisée peut littéralement sauver des vies. Les symptômes apparaissent souvent de manière progressive, mais peuvent parfois survenir brutalement.
La fièvre constitue le premier signal d'alarme dans la majorité des cas. Votre température corporelle dépasse 38°C, mais attention : parfois, c'est l'inverse qui se produit avec une hypothermie inquiétante en dessous de 36°C [15]. Cette variation thermique reflète la désorganisation de vos mécanismes de régulation.
Votre rythme cardiaque s'accélère de manière notable, dépassant généralement 90 battements par minute au repos. Parallèlement, votre respiration devient plus rapide et superficielle, avec plus de 20 respirations par minute. Ces signes traduisent l'effort de votre organisme pour compenser les dysfonctionnements [16].
D'autres symptômes peuvent vous alerter : une fatigue extrême qui ne s'améliore pas avec le repos, des frissons intenses, une confusion mentale, ou encore une diminution de la production d'urine. Certains patients décrivent également des douleurs musculaires généralisées et une sensation de malaise profond [17].
Il est crucial de comprendre que ces symptômes peuvent évoluer rapidement vers des complications graves. N'hésitez jamais à consulter en urgence si vous présentez plusieurs de ces signes simultanément.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic du syndrome de réponse inflammatoire généralisée repose sur une approche méthodique que votre médecin suivra rigoureusement. Cette démarche commence toujours par un interrogatoire approfondi sur vos symptômes et vos antécédents médicaux.
L'examen clinique constitue la première étape cruciale. Votre médecin vérifiera vos constantes vitales : température, tension artérielle, rythme cardiaque et fréquence respiratoire. Il recherchera également des signes de défaillance d'organes comme une coloration anormale de la peau ou des troubles de la conscience [17].
Les examens biologiques apportent des informations essentielles. La numération formule sanguine révèle souvent une augmentation ou une diminution anormale des globules blancs. Les marqueurs inflammatoires comme la CRP (protéine C-réactive) et la procalcitonine sont généralement très élevés [16].
D'autres analyses complètent ce bilan : dosage de l'acide lactique, fonction rénale, bilan hépatique, et gaz du sang artériel. Ces examens permettent d'évaluer le retentissement de l'inflammation sur vos différents organes [15].
Selon le contexte, des examens d'imagerie peuvent être nécessaires : radiographie thoracique, échographie abdominale, ou scanner. L'objectif est d'identifier la source de l'inflammation et d'évaluer l'étendue des lésions [7].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge du syndrome de réponse inflammatoire généralisée nécessite une approche multidisciplinaire en milieu hospitalier spécialisé. Le traitement vise à contrôler l'inflammation excessive tout en soutenant les fonctions vitales défaillantes.
Le traitement de la cause constitue la priorité absolue. Si une infection est identifiée, des antibiotiques adaptés sont administrés rapidement, idéalement dans l'heure qui suit le diagnostic [1]. Pour les autres causes, comme les traumatismes ou les brûlures, une prise en charge chirurgicale peut être nécessaire.
Le soutien des fonctions vitales représente le deuxième pilier thérapeutique. Cela inclut l'administration de liquides intraveineux pour maintenir votre tension artérielle, l'oxygénothérapie si nécessaire, et parfois la ventilation assistée en cas de détresse respiratoire [16].
Les médicaments vasoactifs comme la noradrénaline peuvent être utilisés pour soutenir votre circulation sanguine. Dans certains cas, une épuration extra-rénale (dialyse) devient nécessaire pour suppléer une défaillance rénale [17].
La modulation de la réponse inflammatoire fait l'objet de recherches intensives. Certains traitements anti-inflammatoires spécifiques sont à l'étude, mais leur utilisation reste encore expérimentale dans la plupart des cas [8].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la recherche sur le syndrome de réponse inflammatoire généralisée. Plusieurs innovations prometteuses émergent des laboratoires de recherche français et internationaux.
Les thérapies ciblées représentent l'avancée la plus significative. CalciMedica a récemment publié des résultats encourageants sur un nouveau modulateur calcique qui pourrait révolutionner le traitement des réponses inflammatoires excessives [5,6]. Cette approche vise à réguler plus finement la cascade inflammatoire sans compromettre les défenses immunitaires normales.
Le programme Breizh CoCoA 2024 développe des stratégies innovantes de prise en charge précoce. Cette initiative bretonne teste de nouveaux protocoles de détection et d'intervention rapide qui pourraient réduire significativement la mortalité [4].
Les recherches sur la défaillance multiviscérale apportent également des perspectives nouvelles. Une meilleure compréhension des mécanismes permet de développer des traitements plus spécifiques pour chaque organe touché [3].
D'ailleurs, les biomarqueurs prédictifs font l'objet d'études approfondies. L'analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque pourrait permettre une détection plus précoce des complications, ouvrant la voie à des interventions thérapeutiques anticipées [7].
Ces innovations, bien qu'encore en phase d'évaluation, laissent entrevoir des perspectives thérapeutiques considérablement améliorées pour les patients atteints de SRIS.
Vivre au Quotidien avec le Syndrome de Réponse Inflammatoire Généralisée
Vivre après un épisode de syndrome de réponse inflammatoire généralisée nécessite souvent des adaptations importantes dans votre quotidien. La récupération peut prendre plusieurs mois, et chaque personne évolue à son propre rythme.
La fatigue persistante constitue l'un des défis majeurs. Votre organisme a mobilisé énormément d'énergie pour lutter contre l'inflammation, et cette récupération demande du temps. Il est normal de vous sentir épuisé même après des activités simples [9].
Votre système immunitaire peut rester fragilisé pendant plusieurs semaines. Cela signifie une vigilance accrue face aux infections : lavage fréquent des mains, évitement des foules pendant les épidémies, et consultation rapide en cas de fièvre [1].
L'aspect nutritionnel joue un rôle crucial dans votre rétablissement. Une alimentation riche en protéines aide à la reconstruction tissulaire, tandis que les vitamines et minéraux soutiennent votre système immunitaire. N'hésitez pas à consulter un nutritionniste si nécessaire [14].
Le soutien psychologique ne doit pas être négligé. Traverser un épisode de SRIS peut être traumatisant, et certains patients développent une anxiété liée à la peur de récidive. Des groupes de parole ou un suivi psychologique peuvent vous aider à surmonter ces difficultés.
Les Complications Possibles
Le syndrome de réponse inflammatoire généralisée peut entraîner des complications graves qui nécessitent une surveillance médicale constante. Comprendre ces risques vous aide à mieux appréhender l'importance d'un traitement précoce et adapté.
La défaillance multiviscérale représente la complication la plus redoutable. Votre cœur, vos poumons, vos reins, et votre foie peuvent cesser de fonctionner correctement simultanément. Cette situation nécessite des techniques de suppléance d'organes comme la dialyse ou la ventilation mécanique [3].
Le choc septique constitue une évolution particulièrement grave. Votre tension artérielle chute dangereusement malgré un remplissage vasculaire adéquat, nécessitant l'utilisation de médicaments vasoactifs puissants [16]. Cette complication engage directement le pronostic vital.
Les troubles de la coagulation peuvent survenir, oscillant entre risque hémorragique et formation de caillots. Cette situation paradoxale complique considérablement la prise en charge et nécessite une surveillance biologique rapprochée [17].
À plus long terme, certains patients développent un syndrome post-soins intensifs. Cette pathologie associe faiblesse musculaire persistante, troubles cognitifs, et symptômes dépressifs qui peuvent perdurer plusieurs mois après la guérison [8].
Heureusement, une prise en charge précoce et adaptée réduit significativement le risque de ces complications graves.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic du syndrome de réponse inflammatoire généralisée dépend de nombreux facteurs, mais les avancées médicales récentes ont considérablement amélioré les perspectives de guérison.
Globalement, le taux de survie atteint aujourd'hui 75% à 80% lorsque la prise en charge est précoce et adaptée. Ce chiffre représente une amélioration notable par rapport aux décennies précédentes, grâce aux progrès de la réanimation moderne [1].
Votre âge et votre état de santé initial influencent significativement le pronostic. Les patients de moins de 65 ans en bonne santé préalable ont un taux de survie supérieur à 85%, tandis que les personnes âgées avec des comorbidités présentent un pronostic plus réservé [16].
La rapidité de prise en charge constitue le facteur pronostique le plus important. Chaque heure de retard dans l'initiation du traitement approprié augmente le risque de complications graves. C'est pourquoi les protocoles hospitaliers privilégient une approche d'urgence [17].
Concernant la qualité de vie après guérison, la majorité des patients récupèrent complètement leurs capacités antérieures. Cependant, environ 20% conservent une fatigue persistante ou une diminution de leurs performances physiques [9].
Les innovations thérapeutiques 2024-2025 laissent entrevoir une amélioration supplémentaire de ces statistiques dans les années à venir [5,6].
Peut-on Prévenir le Syndrome de Réponse Inflammatoire Généralisée ?
La prévention du syndrome de réponse inflammatoire généralisée repose principalement sur la prévention de ses causes sous-jacentes et la reconnaissance précoce des signes d'alarme.
La prévention des infections constitue votre première ligne de défense. Une hygiène rigoureuse, la vaccination selon les recommandations, et le traitement rapide des infections mineures réduisent considérablement votre risque [1]. Cette vigilance est particulièrement importante si vous présentez des facteurs de risque.
Pour les interventions chirurgicales, les équipes médicales appliquent des protocoles stricts de prévention. L'antibioprophylaxie, la préparation cutanée, et la surveillance post-opératoire rapprochée limitent les risques de complications inflammatoires [9].
Si vous souffrez de maladies chroniques, un suivi médical régulier et un traitement optimal de vos pathologies réduisent votre vulnérabilité. Le diabète équilibré, l'insuffisance rénale bien prise en charge, ou l'immunodépression surveillée constituent autant de mesures préventives [14].
La reconnaissance précoce des symptômes par vous-même et votre entourage peut faire la différence. N'hésitez jamais à consulter rapidement en cas de fièvre associée à un malaise général, surtout si vous présentez des facteurs de risque [16].
Enfin, maintenir un mode de vie sain - alimentation équilibrée, activité physique adaptée, sommeil suffisant - renforce vos défenses naturelles contre les agressions extérieures.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont établi des recommandations précises pour la prise en charge du syndrome de réponse inflammatoire généralisée. Ces guidelines, régulièrement mises à jour, guident les professionnels de santé dans leur pratique quotidienne.
Le Ministère de la Santé insiste sur l'importance de la formation continue des équipes soignantes. Les protocoles de reconnaissance précoce et de prise en charge initiale font l'objet de formations régulières dans tous les établissements de santé français [1].
La Haute Autorité de Santé recommande une approche multidisciplinaire associant réanimateurs, infectiologues, et spécialistes d'organes selon le contexte. Cette coordination optimise les chances de succès thérapeutique [1].
Concernant les antibiotiques, les recommandations privilégient une antibiothérapie précoce et adaptée, idéalement guidée par des prélèvements microbiologiques. L'objectif est de traiter efficacement tout en limitant l'émergence de résistances [16].
Les indicateurs de qualité hospitaliers incluent désormais des critères spécifiques au SRIS : délai de prise en charge, respect des protocoles thérapeutiques, et taux de survie. Ces mesures permettent d'évaluer et d'améliorer continuellement la qualité des soins [1].
Le programme Breizh CoCoA 2024 illustre parfaitement cette démarche d'amélioration continue, en testant de nouvelles approches organisationnelles et thérapeutiques [4].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs ressources sont disponibles pour vous accompagner dans votre parcours avec le syndrome de réponse inflammatoire généralisée. Ces structures offrent information, soutien, et accompagnement personnalisé.
L'Institut Pasteur propose des ressources éducatives complètes sur les infections et leurs complications. Leur site internet contient des informations fiables et régulièrement mises à jour sur le sepsis et le SRIS [16].
Les associations de patients en réanimation offrent un soutien précieux aux familles et aux patients. Elles organisent des groupes de parole, des formations, et facilitent les échanges d'expériences entre personnes ayant vécu des situations similaires.
Votre médecin traitant reste votre interlocuteur privilégié pour coordonner votre suivi. Il peut vous orienter vers les spécialistes appropriés et vous aider à naviguer dans le système de soins.
Les centres de réadaptation proposent des programmes spécialisés pour les patients ayant séjourné en réanimation. Ces structures vous aident à récupérer vos capacités physiques et à gérer les séquelles éventuelles [9].
N'hésitez pas à solliciter l'assistante sociale de votre établissement de soins. Elle peut vous renseigner sur vos droits, les aides disponibles, et vous accompagner dans vos démarches administratives.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour mieux vivre avec ou prévenir le syndrome de réponse inflammatoire généralisée. Ces recommandations, issues de l'expérience clinique, peuvent faire une réelle différence dans votre quotidien.
Surveillez attentivement votre température corporelle si vous présentez des facteurs de risque. Un thermomètre fiable à domicile vous permet de détecter rapidement une fièvre suspecte. Notez également tout changement dans votre état général : fatigue inhabituelle, frissons, ou confusion [15].
Maintenez une hygiène rigoureuse, particulièrement le lavage fréquent des mains. Cette mesure simple mais efficace réduit considérablement votre exposition aux agents infectieux. Évitez les foules pendant les périodes épidémiques si vous êtes fragile [1].
Respectez scrupuleusement vos traitements médicaux, notamment si vous souffrez de diabète, d'insuffisance rénale, ou si vous prenez des immunosuppresseurs. Un déséquilibre de ces pathologies augmente votre vulnérabilité [14].
Constituez un dossier médical complet avec vos antécédents, allergies, et traitements actuels. En cas d'urgence, ces informations permettent une prise en charge plus rapide et adaptée.
Identifiez l'hôpital le plus proche de votre domicile disposant d'un service de réanimation. En cas de symptômes évocateurs, dirigez-vous directement vers cette structure plutôt que vers un cabinet médical [17].
Quand Consulter un Médecin ?
Savoir quand consulter en urgence peut littéralement vous sauver la vie en cas de syndrome de réponse inflammatoire généralisée. Certains signes ne trompent pas et nécessitent une prise en charge médicale immédiate.
Consultez immédiatement si vous présentez une fièvre supérieure à 38,5°C associée à des frissons intenses, surtout si vous avez des facteurs de risque. Cette association constitue un signal d'alarme majeur [16].
Une altération de votre état général doit vous alerter : confusion, somnolence inhabituelle, difficultés à parler ou à comprendre. Ces signes peuvent indiquer un retentissement cérébral de l'inflammation [15].
Les troubles respiratoires - essoufflement au repos, respiration rapide et superficielle, sensation d'étouffement - nécessitent une évaluation médicale urgente. Ils peuvent témoigner d'une atteinte pulmonaire grave [17].
Une diminution importante de vos urines, des douleurs abdominales intenses, ou des vomissements persistants peuvent signaler une défaillance d'organes. N'attendez pas que ces symptômes s'aggravent [3].
En cas de doute, appelez le 15 (SAMU) plutôt que de vous déplacer par vos propres moyens. Les équipes médicales peuvent évaluer la gravité de votre situation et organiser votre transport dans les meilleures maladies.
Rappelez-vous : dans le SRIS, chaque minute compte. Il vaut mieux consulter pour rien que de passer à côté d'une urgence vitale.
Questions Fréquentes
Le syndrome de réponse inflammatoire généralisée est-il contagieux ?Non, le SRIS lui-même n'est pas contagieux. C'est une réaction de votre organisme, pas une maladie transmissible. Cependant, si une infection en est la cause, celle-ci peut parfois être contagieuse [16].
Peut-on avoir plusieurs épisodes de SRIS ?
Malheureusement oui, il est possible de développer plusieurs épisodes au cours de sa vie. Chaque nouvelle agression (infection, traumatisme) peut potentiellement déclencher cette réaction inflammatoire [1].
Combien de temps dure la récupération ?
La récupération varie considérablement d'une personne à l'autre. Comptez généralement 2 à 6 mois pour retrouver votre niveau d'énergie habituel, parfois plus en cas de complications [9].
Les enfants peuvent-ils développer un SRIS ?
Oui, mais c'est plus rare que chez l'adulte. Les enfants ont généralement une capacité de récupération supérieure, mais nécessitent une prise en charge pédiatrique spécialisée [7].
Existe-t-il des séquelles permanentes ?
La majorité des patients récupèrent complètement. Cependant, certains conservent une fatigue persistante, une diminution de la force musculaire, ou des troubles cognitifs légers [8].
Le stress peut-il déclencher un SRIS ?
Le stress seul ne déclenche pas de SRIS, mais il peut affaiblir votre système immunitaire et vous rendre plus vulnérable aux infections qui, elles, peuvent provoquer cette pathologie [14].
Questions Fréquentes
Le syndrome de réponse inflammatoire généralisée est-il contagieux ?
Non, le SRIS lui-même n'est pas contagieux. C'est une réaction de votre organisme, pas une maladie transmissible. Cependant, si une infection en est la cause, celle-ci peut parfois être contagieuse.
Peut-on avoir plusieurs épisodes de SRIS ?
Malheureusement oui, il est possible de développer plusieurs épisodes au cours de sa vie. Chaque nouvelle agression (infection, traumatisme) peut potentiellement déclencher cette réaction inflammatoire.
Combien de temps dure la récupération ?
La récupération varie considérablement d'une personne à l'autre. Comptez généralement 2 à 6 mois pour retrouver votre niveau d'énergie habituel, parfois plus en cas de complications.
Les enfants peuvent-ils développer un SRIS ?
Oui, mais c'est plus rare que chez l'adulte. Les enfants ont généralement une capacité de récupération supérieure, mais nécessitent une prise en charge pédiatrique spécialisée.
Existe-t-il des séquelles permanentes ?
La majorité des patients récupèrent complètement. Cependant, certains conservent une fatigue persistante, une diminution de la force musculaire, ou des troubles cognitifs légers.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Prévention et prise en charge du sepsis - Ministère de la santéLien
- [3] Défaillance multiviscérale : comprendre ce phénomène complexeLien
- [4] Breizh CoCoA 2024Lien
- [5] CalciMedica Reports 2024 Financial ResultsLien
- [6] CalciMedica Reports First Quarter 2025 Financial ResultsLien
- [7] Analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque en cas de syndrome de réponse inflammatoire fœtale aiguLien
- [8] Effet de la réponse inflammatoire à la phase aigüe du sepsis sur l'induction de la réponse SOS bactérienneLien
- [9] Influence de la gestion séparée des aspirations sur la réponse inflammatoire en postopératoireLien
- [14] Evaluation du Syndrome de Malnutrition-Inflammation chez les gestantes prééclamptiquesLien
- [15] Syndrome de réponse inflammatoire systémiqueLien
- [16] Sepsis / septicémie : symptômes, traitement, préventionLien
- [17] Sepsis et choc septique - RéanimationLien
Publications scientifiques
- Analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque en cas de syndrome de réponse inflammatoire fœtale aigu isolé ou associé à une hypoxie: Étude expérimentale … (2024)
- Effet de la réponse inflammatoire à la phase aigüe du sepsis sur l'induction de la réponse SOS bactérienne (2022)
- … [BR]-Séminaires méthodologiques intégratifs [BR]-Mémoire: Influence de la gestion séparée des aspirations sur la réponse inflammatoire en postopératoire de … (2023)[PDF]
- Le coup de chaleur chez le chien (2022)[PDF]
- Lipodystrophie acquise généralisée avec panniculite mésentérique inaugurale: une présentation originale d'une complication rare de l'immunothérapie (2023)
Ressources web
- Syndrome de réponse inflammatoire systémique (fr.wikipedia.org)
une température corporelle > 38,3 °C ou < 36 °C , · une fréquence cardiaque > 90 battements par minute, · une fréquence respiratoire > 20 par minute ou ...
- Sepsis / septicémie : symptômes, traitement, prévention (pasteur.fr)
Le sepsis est le terme anglo-saxon et international employé pour caractériser une réponse inflammatoire généralisée associée à une infection grave.
- Sepsis et choc septique - Réanimation (msdmanuals.com)
Les symptômes comprennent de la fièvre, une hypotension, une oligurie et une confusion. Le diagnostic est essentiellement clinique combiné avec les résultats ...
- Syndrome de réponse inflammatoire systémique (SIRS) (gpnotebook.com)
fièvre supérieure à 38°C (100,4°F) ou inférieure à 36°C (96,8°F) · fréquence cardiaque supérieure à 90 battements par minute · fréquence respiratoire supérieure à ...
- Inflammation : Définition, symptômes, traitements (sante-sur-le-net.com)
17 janv. 2020 — Quel diagnostic ? Une inflammation est d'abord diagnostiquée cliniquement par l'observation des 4 symptômes caractéristiques : la douleur, la ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
