Pneumonie associée aux soins : Symptômes, Traitements et Prévention 2025
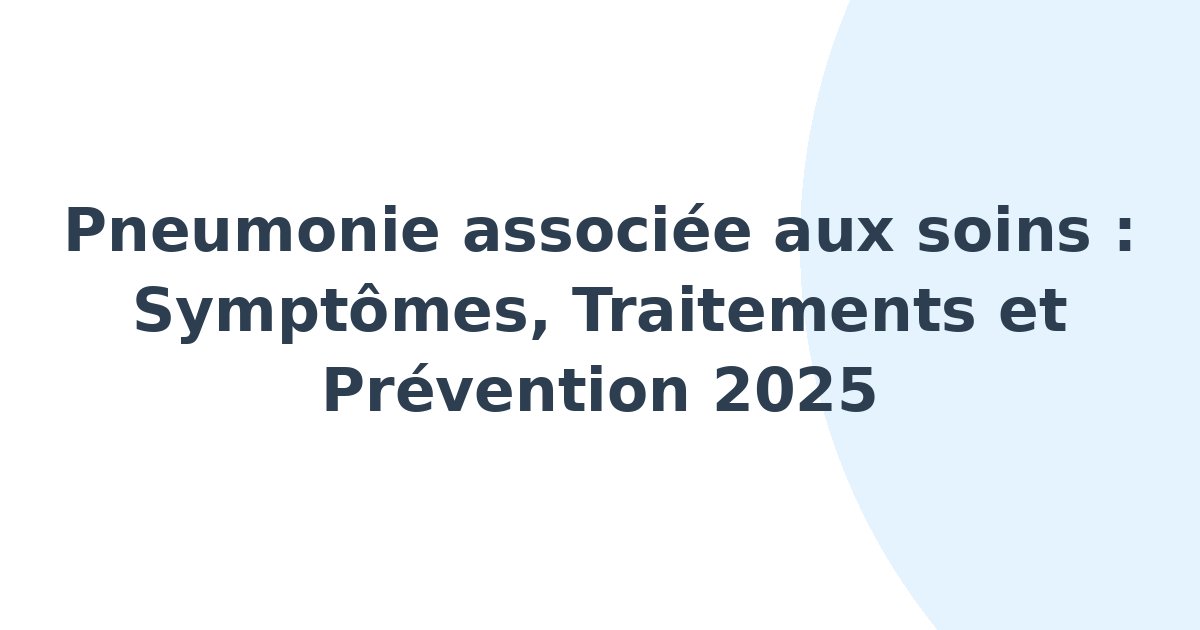
La pneumonie associée aux soins représente une infection pulmonaire contractée lors d'un séjour hospitalier ou dans un établissement de santé. Cette pathologie touche environ 5 à 10% des patients hospitalisés en France selon l'INSERM [1]. Contrairement à la pneumonie communautaire, elle implique souvent des bactéries résistantes aux antibiotiques, rendant le traitement plus complexe. Comprendre cette maladie vous aide à mieux appréhender les enjeux de votre prise en charge médicale.
Téléconsultation et Pneumonie associée aux soins
Téléconsultation non recommandéeLa pneumonie associée aux soins nécessite impérativement un examen clinique approfondi avec auscultation pulmonaire, évaluation de l'état respiratoire et souvent des examens complémentaires urgents (radiographie thoracique, gazométrie, bilan biologique). Cette pathologie potentiellement grave, survenant chez des patients fragiles en milieu de soins, requiert une prise en charge hospitalière immédiate.
Ce qui peut être évalué à distance
Évaluation de l'évolution des symptômes respiratoires depuis l'hospitalisation ou le séjour en établissement de soins, analyse du contexte d'acquisition (durée du séjour, dispositifs invasifs utilisés), revue des traitements antibiotiques déjà reçus, évaluation de la tolérance aux traitements en cours, orientation vers une prise en charge hospitalière urgente.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Auscultation pulmonaire pour détecter les râles crépitants ou les signes de consolidation, évaluation de la détresse respiratoire et de l'oxygénation, réalisation d'une radiographie thoracique, prélèvements microbiologiques (expectorations, hémocultures), bilan biologique complet avec marqueurs inflammatoires.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion de pneumonie nosocomiale chez un patient hospitalisé nécessitant une évaluation clinique immédiate, aggravation respiratoire avec signes de détresse, fièvre persistante malgré un traitement antibiotique bien conduit, nécessité d'ajustement thérapeutique basé sur des prélèvements microbiologiques.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Détresse respiratoire aiguë avec dyspnée de repos, fièvre élevée avec frissons et altération de l'état général, suspicion de complications (pleurésie, abcès pulmonaire), choc septique avec instabilité hémodynamique.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Difficultés respiratoires importantes avec essoufflement au repos ou impossibilité de parler en phrases complètes
- Fièvre élevée persistante (>39°C) avec frissons intenses et altération importante de l'état général
- Douleurs thoraciques intenses et oppression thoracique
- Confusion, désorientation ou troubles de la conscience chez une personne âgée
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Pneumologue — consultation en présentiel indispensable
La pneumonie associée aux soins nécessite une expertise pneumologique ou infectiologique avec hospitalisation immédiate. L'examen clinique, l'imagerie thoracique et les prélèvements microbiologiques sont indispensables pour le diagnostic et l'adaptation thérapeutique.
Pneumonie associée aux soins : Définition et Vue d'Ensemble
La pneumonie associée aux soins désigne une infection pulmonaire qui se développe chez des patients ayant été en contact récent avec le système de santé. Elle diffère de la pneumonie communautaire par ses caractéristiques microbiologiques et sa résistance aux traitements [13].
Cette pathologie survient typiquement chez des personnes ayant été hospitalisées dans les 90 jours précédents, résidant en établissement de soins de longue durée, ou ayant reçu des soins médicaux récents [3]. Les germes responsables sont souvent plus résistants que ceux des pneumonies classiques.
Concrètement, votre système immunitaire peut être affaibli par votre séjour hospitalier ou vos traitements. Les bactéries présentes dans l'environnement hospitalier ont développé des résistances aux antibiotiques couramment utilisés [1]. C'est pourquoi cette forme de pneumonie nécessite une approche thérapeutique spécifique.
L'important à retenir : cette maladie n'est pas de votre faute. Elle résulte d'une exposition à un environnement où circulent des micro-organismes particuliers. Heureusement, les équipes médicales sont formées pour la reconnaître et la traiter efficacement.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, les infections nosocomiales touchent environ 5% des patients hospitalisés, soit près de 750 000 personnes par an selon l'INSERM [1]. Parmi ces infections, les pneumonies représentent la deuxième cause la plus fréquente après les infections urinaires.
Les données de Santé Publique France révèlent une incidence de 2 à 8 cas pour 1000 journées d'hospitalisation [2]. Cette variabilité dépend du type de service : les unités de soins intensifs enregistrent des taux plus élevés, atteignant parfois 15 à 20 cas pour 1000 journées [7].
Mais ces chiffres cachent des disparités importantes. Les patients âgés de plus de 65 ans représentent 60% des cas, tandis que les hommes sont légèrement plus touchés que les femmes [10]. D'ailleurs, certaines régions françaises montrent des taux d'incidence supérieurs, notamment en raison de la densité hospitalière et des pratiques de soins [8].
Au niveau international, la France se situe dans la moyenne européenne. Cependant, des pays comme les Pays-Bas ou la Scandinavie affichent des taux inférieurs grâce à leurs programmes de prévention renforcés [12]. À l'inverse, certains pays émergents connaissent des taux deux à trois fois supérieurs [5].
L'évolution sur les dix dernières années montre une stabilisation, voire une légère diminution des cas en France. Cette amélioration résulte des efforts de prévention et des nouvelles recommandations d'hygiène hospitalière [4]. Les projections pour 2025-2030 suggèrent une poursuite de cette tendance positive, à maladie de maintenir la vigilance.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les bactéries responsables de cette pneumonie diffèrent de celles des infections communautaires. On retrouve principalement Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM), et diverses entérobactéries productrices de bêta-lactamases [13].
Plusieurs facteurs augmentent votre risque de développer cette pathologie. L'âge avancé constitue le premier facteur : après 70 ans, le système immunitaire devient moins efficace [3]. Les maladies chroniques comme le diabète, l'insuffisance cardiaque ou les pathologies pulmonaires préexistantes fragilisent également vos défenses.
Votre parcours de soins influence aussi ce risque. Une hospitalisation récente, l'utilisation d'antibiotiques dans les trois mois précédents, ou la présence de dispositifs médicaux invasifs (sonde, cathéter) favorisent l'infection [7]. En fait, chaque geste médical peut potentiellement introduire des bactéries dans votre organisme.
D'autres éléments entrent en jeu : la dénutrition, l'immobilisation prolongée, ou certains traitements immunosuppresseurs. Bon à savoir : connaître ces facteurs permet à votre équipe médicale d'adapter votre surveillance et votre traitement préventif.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de cette pneumonie ressemblent à ceux d'une pneumonie classique, mais peuvent être plus sévères ou atypiques. Vous pourriez ressentir une fièvre élevée, souvent supérieure à 38,5°C, accompagnée de frissons intenses [3].
La toux constitue un symptôme majeur, souvent productive avec des expectorations purulentes ou parfois teintées de sang. Vous pourriez également éprouver des difficultés respiratoires, une sensation d'essoufflement même au repos, et des douleurs thoraciques qui s'intensifient lors de la respiration profonde.
Mais attention : chez les personnes âgées ou immunodéprimées, les symptômes peuvent être trompeurs. Parfois, seule une confusion mentale, une fatigue extrême ou une chute inexpliquée signalent la maladie [13]. C'est pourquoi il est crucial de signaler tout changement de votre état à l'équipe soignante.
D'autres signes peuvent apparaître : maux de tête, douleurs musculaires, perte d'appétit ou nausées. Concrètement, si vous développez ces symptômes pendant ou après un séjour hospitalier, n'hésitez pas à en parler rapidement. Un diagnostic précoce améliore considérablement le pronostic.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic commence par un examen clinique approfondi. Votre médecin ausculte vos poumons à la recherche de râles ou de diminution du murmure vésiculaire, signes caractéristiques de l'infection pulmonaire [3].
La radiographie thoracique constitue l'examen de première intention. Elle révèle généralement des opacités pulmonaires, mais leur aspect peut varier selon le germe responsable. Dans certains cas complexes, un scanner thoracique apporte des informations complémentaires plus précises [13].
Les examens biologiques jouent un rôle crucial. Une prise de sang révèle souvent une élévation des globules blancs et des marqueurs inflammatoires comme la CRP ou la procalcitonine. Ces analyses aident à confirmer l'infection et à évaluer sa gravité [11].
L'identification du germe responsable nécessite des prélèvements spécifiques. L'analyse des expectorations, quand elle est possible, ou un prélèvement bronchique permettent de déterminer la bactérie en cause et sa sensibilité aux antibiotiques [7]. Cette étape est fondamentale pour adapter le traitement.
Enfin, l'évaluation de la gravité utilise des scores comme le CURB-65, qui prend en compte votre âge, votre état de conscience, et certains paramètres biologiques [11]. Cette évaluation guide la décision d'hospitalisation et l'intensité du traitement.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement antibiotique constitue la pierre angulaire de la prise en charge. Contrairement aux pneumonies communautaires, cette pathologie nécessite des antibiotiques à large spectre, actifs contre les bactéries résistantes [13].
Initialement, votre médecin prescrit un traitement probabiliste, c'est-à-dire avant de connaître le germe exact. Les associations couramment utilisées incluent une bêta-lactamine avec un inhibiteur de bêta-lactamase, parfois associée à un aminoside ou une fluoroquinolone [3].
Une fois le germe identifié, le traitement devient ciblé. Cette adaptation, appelée désescalade thérapeutique, permet d'optimiser l'efficacité tout en réduisant les effets secondaires et le risque de résistance [9]. La durée du traitement varie généralement de 7 à 14 jours selon la gravité et votre réponse clinique.
Les traitements de support accompagnent l'antibiothérapie. L'oxygénothérapie peut être nécessaire si vous présentez une insuffisance respiratoire. La kinésithérapie respiratoire aide à évacuer les sécrétions et améliore la ventilation [6].
Dans les cas sévères, une hospitalisation en soins intensifs devient indispensable. Parfois, une ventilation mécanique temporaire soutient votre fonction respiratoire le temps que les antibiotiques agissent. Rassurez-vous : ces mesures intensives sont temporaires et visent à vous donner toutes les chances de guérison.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les innovations 2024-2025 transforment la prise en charge de cette pathologie. La Société Française de Microbiologie rapporte des avancées significatives dans la prévention des infections et la lutte contre l'antibiorésistance [4].
Le programme PNEUMOSHORT, développé en 2024, évalue l'efficacité d'antibiothérapies courtes de 5 jours versus les traitements standards [9]. Cette approche révolutionnaire pourrait réduire les effets secondaires et limiter l'émergence de résistances, tout en maintenant une efficacité optimale.
Les nouvelles molécules offrent des perspectives encourageantes. Un essai de phase III publié en 2024 démontre la non-infériorité d'un nouvel antibiotique contre les bactéries multirésistantes . Cette innovation pourrait révolutionner le traitement des formes les plus sévères.
La recherche européenne, synthétisée dans le bulletin ERS 2024, met l'accent sur les biomarqueurs prédictifs . Ces outils permettront bientôt d'identifier plus rapidement les patients à risque de complications et d'adapter précocement leur traitement.
D'ailleurs, les techniques de diagnostic rapide évoluent constamment. Les nouveaux tests moléculaires peuvent identifier le germe responsable en moins de 2 heures, contre 48 à 72 heures pour les méthodes traditionnelles . Cette rapidité change complètement la donne thérapeutique.
Enfin, l'intelligence artificielle commence à s'implanter dans l'analyse des images radiologiques. Ces outils d'aide au diagnostic promettent une détection plus précoce et plus précise des pneumonies nosocomiales.
Vivre au Quotidien avec une Pneumonie associée aux soins
La convalescence après cette pneumonie demande du temps et de la patience. Votre organisme a combattu une infection sérieuse et a besoin de récupérer progressivement. Il est normal de ressentir une fatigue persistante pendant plusieurs semaines [3].
Pendant votre rétablissement, respectez scrupuleusement votre traitement antibiotique, même si vous vous sentez mieux. L'arrêt prématuré pourrait favoriser une rechute ou l'émergence de résistances. Hydratez-vous suffisamment et maintenez une alimentation équilibrée pour soutenir votre système immunitaire.
La reprise d'activité doit être progressive. Commencez par de courtes promenades, puis augmentez graduellement l'intensité selon votre tolérance. Évitez les efforts intenses pendant au moins un mois après la guérison complète.
Surveillez l'apparition de nouveaux symptômes : fièvre, toux persistante, essoufflement inhabituel. Ces signes pourraient indiquer une complication ou une rechute nécessitant une consultation rapide. N'hésitez jamais à contacter votre médecin en cas de doute.
Les Complications Possibles
Bien que la plupart des patients guérissent complètement, certaines complications peuvent survenir. L'insuffisance respiratoire aiguë représente la complication la plus redoutée, nécessitant parfois une ventilation mécanique temporaire [13].
La septicémie constitue une autre complication grave. L'infection peut se propager dans le sang et atteindre d'autres organes. Cette situation nécessite une prise en charge en soins intensifs avec des antibiotiques intraveineux à haute dose [3].
Certains patients développent un abcès pulmonaire ou un épanchement pleural. Ces complications locales peuvent nécessiter un drainage ou une intervention chirurgicale spécialisée. Heureusement, elles restent relativement rares avec les traitements actuels.
Les séquelles respiratoires à long terme touchent principalement les patients ayant présenté des formes sévères. Une diminution de la capacité pulmonaire ou une fibrose cicatricielle peuvent persister. Un suivi pneumologique régulier permet de détecter et traiter ces séquelles.
Il faut savoir que le risque de complications dépend largement de votre état général initial et de la rapidité du diagnostic. Un traitement précoce et adapté réduit considérablement ces risques.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de cette pneumonie dépend de plusieurs facteurs. Globalement, avec un traitement adapté, plus de 80% des patients guérissent complètement sans séquelles [3]. Cependant, cette pathologie reste plus grave qu'une pneumonie communautaire classique.
Votre âge influence significativement l'évolution. Les patients de moins de 65 ans en bonne santé générale ont un excellent pronostic, avec un taux de guérison supérieur à 95%. Après 75 ans, ou en présence de maladies chroniques multiples, la surveillance doit être renforcée [13].
La précocité du diagnostic joue un rôle crucial. Un traitement débuté dans les 24 premières heures améliore considérablement les chances de guérison rapide. À l'inverse, un retard diagnostique peut compliquer l'évolution et prolonger la convalescence.
Le type de bactérie responsable influence aussi le pronostic. Les infections à Pseudomonas ou à staphylocoque résistant nécessitent des traitements plus longs et présentent un risque de complications légèrement supérieur [7].
Rassurez-vous : les progrès thérapeutiques récents améliorent constamment ces statistiques. Les nouvelles molécules et les protocoles de soins optimisés offrent de meilleures perspectives de guérison, même dans les cas complexes.
Peut-on Prévenir la Pneumonie associée aux soins ?
La prévention constitue l'arme la plus efficace contre cette pathologie. Les établissements de santé français ont mis en place des protocoles stricts d'hygiène hospitalière, contribuant à la diminution des cas observée ces dernières années [1].
L'hygiène des mains reste la mesure préventive fondamentale. Le personnel soignant applique rigoureusement les protocoles de lavage et de désinfection. En tant que patient, vous pouvez également contribuer en vous lavant régulièrement les mains et en utilisant les solutions hydroalcooliques mises à disposition.
La vaccination joue un rôle préventif important. Le vaccin antipneumococcique est recommandé chez les personnes âgées et celles présentant des facteurs de risque. La vaccination antigrippale annuelle réduit aussi indirectement le risque de surinfection bactérienne [2].
Certaines mesures spécifiques s'appliquent pendant votre hospitalisation. La mobilisation précoce, quand elle est possible, prévient la stagnation des sécrétions pulmonaires. Une bonne hydratation et une alimentation adaptée soutiennent vos défenses immunitaires [12].
Les programmes de surveillance des infections nosocomiales permettent de détecter rapidement les épidémies et d'adapter les mesures préventives [8]. Ces systèmes de veille contribuent significativement à la sécurité des patients.
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024 des recommandations actualisées pour la prise en charge de cette pathologie . Ces guidelines intègrent les dernières données scientifiques et les innovations thérapeutiques récentes.
L'INSERM souligne l'importance d'une approche multidisciplinaire associant infectiologues, pneumologues et hygiénistes [1]. Cette coordination améliore la qualité des soins et réduit le risque de complications. Les équipes mobiles d'hygiène hospitalière jouent un rôle central dans cette démarche.
Santé Publique France recommande un renforcement de la surveillance épidémiologique, particulièrement dans les services à haut risque [2]. Les données collectées permettent d'adapter les stratégies préventives et d'identifier les émergences de résistance.
Les sociétés savantes insistent sur la formation continue du personnel soignant. Les protocoles évoluent régulièrement en fonction des nouvelles connaissances scientifiques et de l'évolution de la résistance bactérienne [4].
Au niveau européen, les recommandations convergent vers une harmonisation des pratiques. Cette standardisation facilite les échanges d'expérience et améliore la qualité des soins dans tous les pays membres [12].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations peuvent vous accompagner pendant votre parcours de soins. La Fédération Française de Pneumologie dispose d'un réseau de patients experts qui partagent leur expérience et prodiguent des conseils pratiques.
Les centres de référence en infectiologie proposent des consultations spécialisées pour les cas complexes ou les infections récidivantes. Ces structures disposent d'une expertise particulière dans la prise en charge des bactéries multirésistantes.
De nombreuses ressources en ligne fournissent des informations fiables. Le site de l'Assurance Maladie propose des fiches explicatives détaillées sur les pneumonies et leur prise en charge [3]. Les sites institutionnels comme celui de l'INSERM offrent des contenus scientifiques vulgarisés [1].
Les groupes de soutien locaux permettent d'échanger avec d'autres patients ayant vécu une expérience similaire. Ces rencontres, souvent organisées dans les hôpitaux, créent des liens précieux et apportent un soutien moral important.
N'hésitez pas à solliciter l'assistante sociale de votre établissement. Elle peut vous orienter vers les ressources adaptées à votre situation et vous aider dans vos démarches administratives.
Nos Conseils Pratiques
Pendant votre hospitalisation, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à l'équipe soignante. Comprendre votre traitement et son évolution vous aide à mieux vivre cette période difficile. Tenez un carnet de vos symptômes pour faciliter le suivi médical.
Maintenez une hygiène rigoureuse : lavez-vous les mains fréquemment, utilisez les solutions hydroalcooliques disponibles, et respectez les consignes d'isolement si elles sont prescrites. Ces gestes simples protègent votre entourage et accélèrent votre guérison.
Pendant la convalescence, écoutez votre corps. Reposez-vous suffisamment et ne forcez pas la reprise d'activité. Une alimentation riche en protéines et en vitamines soutient votre récupération. Évitez le tabac qui retarde la cicatrisation pulmonaire.
Organisez votre suivi médical : programmez les consultations de contrôle, respectez les rendez-vous de radiographie, et conservez tous vos documents médicaux. Un carnet de santé numérique peut vous aider à centraliser ces informations.
Enfin, restez vigilant aux signes de rechute pendant les trois mois suivant votre guérison. Une fièvre, une toux persistante ou un essoufflement inhabituel justifient une consultation rapide.
Quand Consulter un Médecin ?
Consultez immédiatement si vous développez une fièvre supérieure à 38,5°C dans les semaines suivant un séjour hospitalier. Ce symptôme, associé à une toux ou des difficultés respiratoires, peut signaler cette pneumonie [3].
D'autres signes d'alarme nécessitent une consultation urgente : essoufflement au repos, douleurs thoraciques intenses, expectorations sanglantes, ou altération de l'état général avec confusion. Ces symptômes peuvent indiquer une complication grave [13].
Pendant votre traitement, surveillez l'apparition d'effets secondaires des antibiotiques : éruption cutanée, diarrhées importantes, ou troubles digestifs sévères. Certaines réactions allergiques nécessitent un changement de traitement.
En cas de doute, n'hésitez jamais à contacter votre médecin traitant ou le service hospitalier qui vous a pris en charge. Il vaut mieux une consultation de précaution qu'une complication négligée. Les professionnels de santé préfèrent être sollicités pour rien plutôt que de passer à côté d'un problème sérieux.
Gardez toujours à portée de main les coordonnées de votre médecin référent et du service d'urgences le plus proche. En cas de détresse respiratoire aiguë, appelez immédiatement le 15 (SAMU).
Questions Fréquentes
Quelle est la différence entre pneumonie associée aux soins et pneumonie communautaire ?
La pneumonie associée aux soins survient chez des patients ayant eu un contact récent avec le système de santé (hospitalisation, soins à domicile). Elle implique souvent des bactéries plus résistantes aux antibiotiques que la pneumonie communautaire, nécessitant des traitements spécifiques plus puissants.
Combien de temps dure le traitement ?
Le traitement antibiotique dure généralement 7 à 14 jours selon la gravité de l'infection et votre réponse au traitement. Les innovations 2024 comme le programme PNEUMOSHORT étudient des traitements plus courts de 5 jours pour certains cas.
Peut-on prévenir cette pneumonie ?
Oui, plusieurs mesures préventives existent : hygiène des mains rigoureuse, vaccination antipneumococcique et antigrippale, mobilisation précoce pendant l'hospitalisation, et respect des protocoles d'hygiène hospitalière.
Quels sont les signes d'alarme ?
Consultez immédiatement en cas de fièvre supérieure à 38,5°C après un séjour hospitalier, d'essoufflement au repos, de douleurs thoraciques intenses, d'expectorations sanglantes ou de confusion mentale.
Le pronostic est-il bon ?
Avec un traitement adapté, plus de 80% des patients guérissent complètement. Le pronostic dépend de l'âge, de l'état général, de la précocité du diagnostic et du type de bactérie responsable.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Infections nosocomiales · Inserm, La science pour la santé. INSERM. 2024-2025.Lien
- [2] Infections respiratoires aiguës (grippe, bronchiolite, COVID .... Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [3] Rapport d'activité 2024. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [4] Pneumonie ou pneumopathie bactérienne : symptômes, .... www.ameli.fr.Lien
- [5] Actualités Prévention des Infections et de l'antibiorésistance. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] Bulletin de recherche ERS 2024. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [7] A phase III, randomized, controlled noninferiority trial to .... Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [8] Healthcare-Associated Infection Rates in Türkiye (2014 .... Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [9] MA Nay, R Hindré. Effet du décubitus ventral vigile chez des patients hospitalisés hors réanimation pour une pneumonie hypoxémiante à COVID-19: un essai randomisé multicentrique. 2023.Lien
- [10] YJW Fopossi. Etude des profils bactériologies des infections associées aux soins dans le service de réanimation du CHU Gabriel Toure. 2024.Lien
- [11] E Poirier, V Boulanger. [PDF][PDF] Programmes nationaux de surveillance des infections associées aux soins de santé: un examen de la portée. 2022.Lien
- [12] L Bouyakoub, A Dinh. Antibiothérapie courte au cours de la pneumonie: PNEUMOSHORT. 2024.Lien
- [13] MB Diallo, A Camara. Prévalence et facteurs de risque des infections associées aux soins dans trois hôpitaux nationaux de la ville de Conakry. Guinée. 2022.Lien
- [14] A Allouche, JB Amar. Le score CURB-65 appliqué à la pneumonie COVID-19: quel apport?. 2023.Lien
- [15] W Zingg, A Metsini. [PDF][PDF] Enquête suisse sur la prévalence des infections associées aux soins de santé et sur l'utilisation des antimicrobiens. s.d..Lien
- [17] Pneumonie nosocomiale - Troubles pulmonaires et des .... www.msdmanuals.com.Lien
Publications scientifiques
- Effet du décubitus ventral vigile chez des patients hospitalisés hors réanimation pour une pneumonie hypoxémiante à COVID-19: un essai randomisé multicentrique (2023)[PDF]
- Etude des profils bactériologies des infections associées aux soins dans le service de réanimation du CHU Gabriel Toure (2024)[PDF]
- [PDF][PDF] Programmes nationaux de surveillance des infections associées aux soins de santé: un examen de la portée (2022)[PDF]
- Antibiothérapie courte au cours de la pneumonie: PNEUMOSHORT (2024)
- Prévalence et facteurs de risque des infections associées aux soins dans trois hôpitaux nationaux de la ville de Conakry. Guinée (2022)3 citations
Ressources web
- Pneumonie nosocomiale - Troubles pulmonaires et des ... (msdmanuals.com)
Le symptôme le plus fréquent est une toux productive, mais une douleur thoracique, des frissons, de la fièvre et un essoufflement sont également des symptômes ...
- Pneumonie nosocomiale - Troubles pulmonaires (msdmanuals.com)
Le diagnostic est suspecté en fonction de la clinique et de l'imagerie du thorax et il est confirmé par une hémoculture ou un prélèvement bronchoscopique au ...
- Pneumonie ou pneumopathie bactérienne : symptômes, ... (ameli.fr)
Une personne atteinte de pneumonie ou pneumopathie bactérienne présente divers symptômes : fièvre, toux, douleurs thoraciques, essoufflement, maux de tête, ...
- Pneumonie - symptômes, causes, traitements et prévention (vidal.fr)
23 mai 2024 — La pneumonie est une inflammation des poumons habituellement causée par une infection virale ou bactérienne. Lorsque les poumons sont infectés, ...
- pneumonies!associées!aux!soins!de!réanimation! (srlf.org)
de M Leone · Cité 25 fois — La! pneumonie! associée! aux! soins! est! l'infection! la! plus! fréquente! en! réanimation.! Cette! infection!
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
