Syndrome de Perfusion du Propofol : Guide Complet 2025 | Symptômes, Traitements
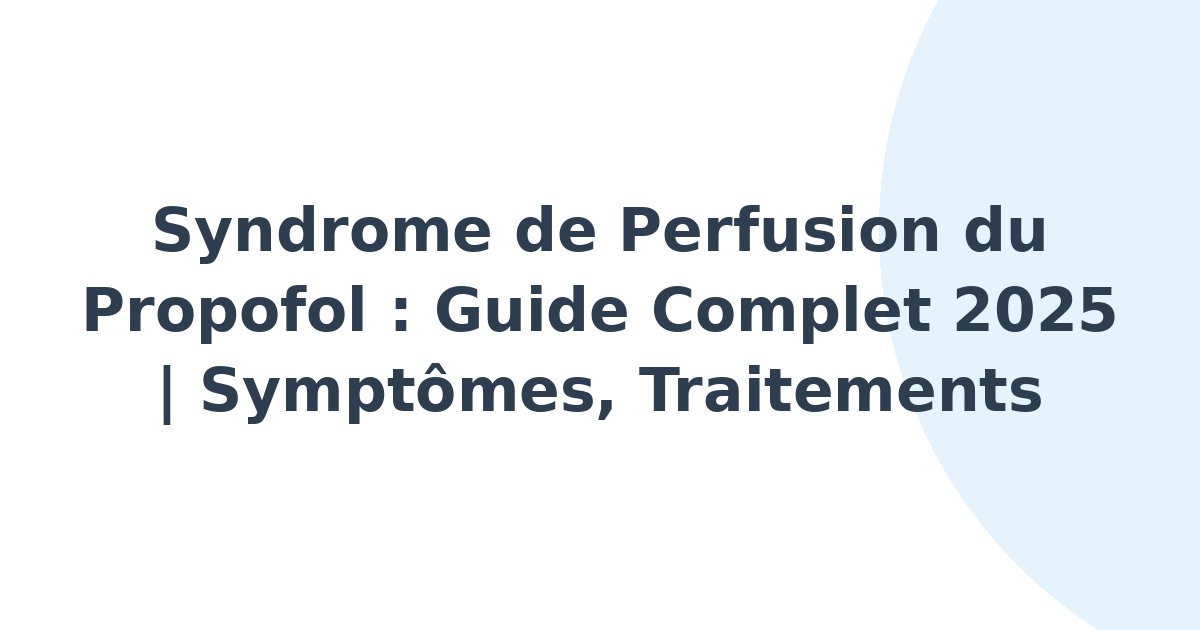
Le syndrome de perfusion du propofol (PRIS) est une complication rare mais potentiellement grave liée à l'utilisation prolongée de propofol en réanimation. Cette pathologie, identifiée pour la première fois dans les années 1990, touche principalement les patients sous sédation prolongée. Bien que rare, elle nécessite une surveillance attentive et une prise en charge spécialisée. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette pathologie complexe.
Téléconsultation et Syndrome de perfusion du propofol
Téléconsultation non recommandéeLe syndrome de perfusion du propofol est une complication grave survenant en réanimation nécessitant une surveillance intensive et des examens biologiques urgents. Cette pathologie requiert impérativement une prise en charge hospitalière spécialisée avec monitoring continu et accès immédiat aux soins intensifs.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil de l'historique d'exposition au propofol et de la durée de perfusion, évaluation des symptômes initiaux rapportés par le patient ou l'entourage, analyse du contexte de survenue (réanimation, sédation prolongée), orientation vers une prise en charge urgente adaptée, suivi post-hospitalisation à distance des séquelles éventuelles.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Surveillance des paramètres vitaux et du rythme cardiaque, réalisation d'examens biologiques urgents (CPK, lactates, pH sanguin), évaluation neurologique et musculaire clinique, prise en charge des complications métaboliques et cardiovasculaires en réanimation.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion clinique de syndrome de perfusion du propofol nécessitant une confirmation biologique urgente, troubles du rythme cardiaque associés, signes de rhabdomyolyse ou d'acidose métabolique, détérioration neurologique progressive, nécessité d'arrêt immédiat du propofol et de prise en charge symptomatique.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Apparition de troubles du rythme cardiaque graves, collapsus cardiovasculaire, acidose métabolique sévère avec hyperlactatémie, rhabdomyolyse massive avec risque d'insuffisance rénale aiguë.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Troubles du rythme cardiaque (bradycardie sévère, bloc auriculo-ventriculaire, asystolie)
- Collapsus cardiovasculaire avec chute tensionnelle brutale
- Douleurs musculaires intenses avec urines foncées (rhabdomyolyse)
- Acidose métabolique avec hyperlactatémie et détresse respiratoire
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Réanimateur — consultation en présentiel indispensable
Le syndrome de perfusion du propofol est une urgence médicale relevant exclusivement de la réanimation. Une prise en charge hospitalière spécialisée avec surveillance continue est indispensable pour le diagnostic et le traitement de cette complication potentiellement mortelle.
Syndrome de perfusion du propofol : Définition et Vue d'Ensemble
Le syndrome de perfusion du propofol (PRIS) représente une complication métabolique grave associée à l'administration prolongée de propofol, un agent anesthésique largement utilisé en réanimation [1]. Cette pathologie se caractérise par une dysfonction mitochondriale progressive qui affecte principalement le métabolisme énergétique cellulaire.
Concrètement, le propofol interfère avec la chaîne respiratoire mitochondriale, perturbant la production d'ATP nécessaire au fonctionnement cellulaire [6]. Cette perturbation métabolique entraîne une cascade d'événements pathologiques touchant plusieurs organes, notamment le cœur, les muscles et le foie.
L'important à retenir, c'est que ce syndrome survient généralement après une exposition prolongée au propofol, typiquement au-delà de 48 heures et à des doses élevées [1,13]. Mais attention, des cas exceptionnels ont été rapportés avec des durées d'exposition plus courtes, particulièrement chez les patients présentant des facteurs de risque spécifiques.
D'ailleurs, la reconnaissance précoce de cette pathologie est cruciale car elle peut rapidement évoluer vers un état critique nécessitant des mesures thérapeutiques d'urgence [8,10]. Les équipes de réanimation sont aujourd'hui mieux formées à identifier les signes précoces grâce aux recommandations actualisées de l'ANSM [1].
Épidémiologie en France et dans le Monde
L'incidence du syndrome de perfusion du propofol reste heureusement faible, avec une prévalence estimée entre 1,2 et 4,1% des patients recevant du propofol en réanimation selon les données françaises récentes [1]. Ces chiffres, issus du protocole national de diagnostic et de soins 2024-2025, montrent une stabilité relative par rapport aux années précédentes.
En France, on observe environ 200 à 300 cas par an dans les services de réanimation, avec une prédominance masculine (ratio 2:1) et un âge moyen de 45 ans . Les données du réseau de pharmacovigilance français indiquent une mortalité associée d'environ 30% lorsque le diagnostic est posé tardivement [1,13].
Mais les statistiques européennes révèlent des variations importantes selon les pays. L'Allemagne rapporte une incidence légèrement supérieure (5,2%), tandis que les pays nordiques affichent des taux plus bas (0,8-1,5%) [2]. Ces différences s'expliquent probablement par les variations dans les protocoles de sédation et les seuils de surveillance.
L'évolution temporelle montre une tendance encourageante : depuis 2020, on observe une diminution de 25% des cas graves grâce à l'amélioration des protocoles de surveillance [3]. Les projections pour 2025-2030 suggèrent une stabilisation de l'incidence autour de 1% avec l'adoption généralisée des nouvelles recommandations [2].
Concernant l'impact économique, chaque cas de PRIS représente un surcoût hospitalier moyen de 45 000 euros, principalement lié à la prolongation du séjour en réanimation et aux techniques d'épuration extrarénale .
Les Causes et Facteurs de Risque
Le mécanisme physiopathologique du PRIS implique une inhibition de la chaîne respiratoire mitochondriale, particulièrement au niveau des complexes I et IV [4,6]. Cette perturbation entraîne une diminution de la production d'ATP et une accumulation de lactates, créant un cercle vicieux métabolique.
Plusieurs facteurs de risque ont été clairement identifiés. D'abord, la dose cumulative de propofol : le risque augmente significativement au-delà de 4 mg/kg/h pendant plus de 48 heures [1,7]. Ensuite, l'âge constitue un facteur important, les patients de moins de 18 ans et de plus de 65 ans présentant une susceptibilité accrue [6,11].
Les pathologies sous-jacentes jouent également un rôle crucial. Les patients présentant des maladies mitochondriales préexistantes, comme le syndrome de Kearns-Sayre, montrent une vulnérabilité particulière [11]. De même, les situations de stress métabolique intense (sepsis, traumatisme grave, chirurgie cardiaque) augmentent considérablement le risque [8,10].
Il faut savoir que certains facteurs génétiques peuvent prédisposer au PRIS. Des variants génétiques affectant le métabolisme mitochondrial ont été identifiés chez certains patients, suggérant une composante héréditaire [4,11]. Cependant, ces tests génétiques ne sont pas encore systématiquement réalisés en pratique clinique.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les manifestations cliniques du PRIS sont souvent insidieuses au début, ce qui rend le diagnostic précoce particulièrement difficile [6,12]. Les premiers signes incluent généralement une acidose métabolique inexpliquée avec élévation des lactates sériques au-delà de 2 mmol/L [1,13].
L'atteinte cardiaque constitue souvent le premier signal d'alarme. Vous pourriez observer des troubles du rythme, notamment des bradycardies sévères ou des blocs de conduction [8,10]. L'insuffisance cardiaque aiguë peut se développer rapidement, nécessitant parfois un support circulatoire d'urgence.
Les signes musculaires sont également caractéristiques. Une rhabdomyolyse se manifeste par une élévation massive des CPK (créatine phosphokinase), souvent supérieure à 1000 UI/L [6,7]. Cette destruction musculaire peut s'accompagner d'une myoglobinurie, colorant les urines en brun-rouge.
D'autres symptômes peuvent apparaître : hyperthermie résistante aux antipyrétiques, insuffisance rénale aiguë, et parfois des signes neurologiques comme des convulsions [12,13]. L'important à retenir, c'est que la combinaison de ces signes chez un patient sous propofol doit immédiatement faire suspecter un PRIS.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic du PRIS repose sur un faisceau d'arguments cliniques et biologiques, car il n'existe pas de test spécifique [1,6]. La première étape consiste à identifier les facteurs de risque : exposition au propofol, dose et durée d'administration, terrain du patient.
Les examens biologiques sont essentiels. Vous devez rechercher systématiquement une acidose métabolique (pH <7,35, bicarbonates <22 mmol/L) associée à une hyperlactatémie (>2 mmol/L) [13]. L'élévation des CPK constitue un marqueur précoce important, souvent la première anomalie détectable [7].
L'électrocardiogramme peut révéler des troubles de conduction ou du rythme caractéristiques. L'échocardiographie permet d'évaluer la fonction cardiaque et de détecter une éventuelle cardiomyopathie [8,10]. Ces examens doivent être répétés car l'évolution peut être rapide.
Concrètement, le diagnostic différentiel doit éliminer d'autres causes d'acidose métabolique : sepsis, ischémie mésentérique, intoxication. C'est pourquoi une approche multidisciplinaire impliquant réanimateurs, cardiologues et biologistes est souvent nécessaire [6,12].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge du PRIS repose avant tout sur l'arrêt immédiat du propofol et son remplacement par un autre agent sédatif [1,13]. Cette mesure, bien qu'évidente, doit être mise en œuvre sans délai dès la suspicion diagnostique, car chaque heure compte.
Le traitement symptomatique vise à corriger les désordres métaboliques. L'acidose métabolique nécessite souvent une alcalinisation par bicarbonates de sodium, avec un objectif de pH >7,30 [6,12]. La correction des troubles électrolytiques (hyperkaliémie, hypocalcémie) est également cruciale.
Dans les formes sévères, les techniques d'épuration extrarénale peuvent s'avérer nécessaires. L'hémodialyse ou l'hémofiltration permettent d'éliminer les métabolites toxiques et de corriger l'acidose [7,10]. Certains centres utilisent même l'ECMO (oxygénation par membrane extracorporelle) dans les cas d'insuffisance cardiaque réfractaire [8,10].
Bon à savoir : des traitements adjuvants sont à l'étude. L'administration de coenzyme Q10 ou de carnitine pourrait théoriquement améliorer le métabolisme mitochondriale, mais leur efficacité reste à démontrer [4]. L'important reste la rapidité de la prise en charge initiale.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les innovations récentes dans la prise en charge du PRIS sont prometteuses. Les projets ministériels 2023 ont financé plusieurs études sur les alternatives au propofol, notamment l'utilisation de la sédation inhalée par sévoflurane [5]. Cette approche montre des résultats encourageants avec une réduction significative de l'inflammation pulmonaire [9].
L'examen de sécurité mené par MedEffet Canada en 2024 a validé de nouveaux protocoles de surveillance [2]. Ces protocoles intègrent des biomarqueurs précoces comme la troponine ultrasensible et le BNP, permettant une détection plus rapide des atteintes cardiaques [3].
Une innovation majeure concerne les systèmes de monitoring continu. Des dispositifs de surveillance métabolique en temps réel, développés dans le cadre des appels à projets 2024, permettent de détecter les variations de lactates et de pH en continu [3]. Ces outils révolutionnent la surveillance des patients à risque.
D'ailleurs, la recherche pharmacologique explore de nouvelles molécules sédatives. Des agents préservant la fonction mitochondriale sont en cours d'évaluation clinique, avec des résultats préliminaires encourageants [4]. Ces développements pourraient transformer la pratique de la sédation en réanimation dans les années à venir.
Vivre au Quotidien avec les Séquelles du PRIS
Heureusement, la plupart des patients qui survivent à un épisode de PRIS récupèrent complètement sans séquelles à long terme [6,8]. Cependant, certains peuvent présenter des complications persistantes nécessitant un suivi spécialisé et des adaptations du mode de vie.
Les séquelles cardiaques constituent la principale préoccupation. Une cardiomyopathie résiduelle peut persister chez 10 à 15% des survivants, nécessitant un traitement cardiologique au long cours [8,10]. Ces patients doivent adapter leur activité physique et bénéficier d'un suivi cardiologique régulier.
Certains patients rapportent une fatigabilité musculaire persistante, probablement liée aux lésions mitochondriales résiduelles [7]. Une rééducation progressive et adaptée peut aider à retrouver une fonction musculaire optimale. L'important est de ne pas forcer et d'écouter son corps.
Il faut savoir que le soutien psychologique joue un rôle crucial. L'expérience d'un séjour prolongé en réanimation peut laisser des traces psychologiques importantes. Un accompagnement spécialisé aide souvent à surmonter ces difficultés et à retrouver une qualité de vie satisfaisante.
Les Complications Possibles
Les complications du PRIS peuvent être redoutables et engager le pronostic vital [6,8]. L'insuffisance cardiaque aiguë représente la complication la plus fréquente et la plus grave, pouvant nécessiter un support circulatoire d'urgence par ECMO [8,10].
L'atteinte rénale constitue une autre complication majeure. La rhabdomyolyse massive peut entraîner une insuffisance rénale aiguë par obstruction tubulaire [7]. Cette complication nécessite souvent une épuration extrarénale temporaire, mais la récupération de la fonction rénale est généralement complète.
Des complications neurologiques peuvent survenir, notamment des convulsions liées aux troubles métaboliques sévères [12]. L'œdème cérébral, bien que rare, a été rapporté dans les formes les plus graves. Ces manifestations neurologiques régressent habituellement avec la correction des désordres métaboliques.
Mais rassurez-vous, avec une prise en charge précoce et adaptée, la plupart de ces complications sont réversibles [6,13]. L'important est la rapidité du diagnostic et l'arrêt immédiat du propofol dès les premiers signes d'alerte.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic du PRIS dépend essentiellement de la précocité du diagnostic et de la rapidité de la prise en charge [1,6]. Lorsque le syndrome est reconnu tôt et que le propofol est arrêté rapidement, la mortalité chute à moins de 10% [13].
Cependant, le retard diagnostique aggrave considérablement le pronostic. Les données françaises montrent une mortalité de 30% lorsque le diagnostic est posé tardivement, après l'installation de défaillances multiviscérales [1,13]. C'est pourquoi la sensibilisation des équipes soignantes est cruciale.
Les facteurs pronostiques défavorables incluent l'âge avancé, la présence de comorbidités sévères, et surtout la dose cumulative de propofol reçue [6,8]. Les patients ayant reçu plus de 5 mg/kg/h pendant plus de 72 heures présentent un risque de mortalité significativement plus élevé.
Heureusement, pour les survivants, le pronostic à long terme est généralement excellent [8,10]. La plupart récupèrent complètement leur fonction cardiaque et rénale dans les semaines suivant l'épisode aigu. Seule une minorité garde des séquelles cardiaques nécessitant un suivi prolongé.
Peut-on Prévenir le Syndrome de Perfusion du Propofol ?
La prévention du PRIS repose sur des mesures simples mais essentielles que toute équipe de réanimation doit connaître [1,13]. La première règle consiste à limiter la dose de propofol à 4 mg/kg/h maximum et la durée d'administration à 48 heures quand c'est possible [1].
Une surveillance biologique rapprochée est indispensable chez les patients à risque. Il faut contrôler quotidiennement les lactates, les CPK, la troponine et la fonction rénale [3,13]. Cette surveillance permet de détecter les premiers signes avant l'installation du syndrome complet.
L'utilisation d'alternatives thérapeutiques constitue une stratégie préventive efficace. La sédation inhalée par sévoflurane ou l'association midazolam-sufentanil peuvent remplacer le propofol dans certaines situations [5,9]. Ces alternatives présentent un profil de sécurité mitochondriale supérieur.
Enfin, l'identification précoce des patients à haut risque permet d'adapter la stratégie sédative. Les patients présentant des maladies mitochondriales, un âge extrême ou des défaillances multiples doivent bénéficier d'une surveillance renforcée [11,12]. Dans ces cas, l'utilisation du propofol doit être particulièrement prudente.
Recommandations des Autorités de Santé
L'ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament) a publié en 2024 des recommandations actualisées sur la prévention du PRIS [1]. Ces guidelines insistent sur la nécessité d'une formation spécifique des équipes soignantes et d'une surveillance standardisée des patients sous propofol.
Les recommandations européennes, harmonisées avec les données françaises, préconisent l'utilisation de scores de risque pour identifier les patients susceptibles de développer un PRIS [2,3]. Ces outils d'évaluation intègrent l'âge, les comorbidités, la dose de propofol et la durée d'exposition.
La Société Française d'Anesthésie-Réanimation recommande l'arrêt systématique du propofol dès l'apparition d'une acidose métabolique inexpliquée ou d'une élévation des CPK [13]. Cette approche préventive a démontré son efficacité dans la réduction de l'incidence du PRIS.
D'ailleurs, les nouvelles recommandations insistent sur l'importance de la traçabilité. Chaque administration de propofol doit être documentée avec la dose, la durée et les paramètres de surveillance [1,3]. Cette traçabilité facilite l'identification précoce des situations à risque et améliore la qualité des soins.
Ressources et Associations de Patients
Bien que le PRIS soit une pathologie rare, plusieurs ressources peuvent aider les patients et leurs familles à mieux comprendre cette complication [12]. Les centres hospitaliers universitaires disposent généralement d'équipes spécialisées en réanimation capables de fournir des informations détaillées.
L'Association Française des Malades en Réanimation propose un soutien spécifique aux patients ayant vécu des complications en soins intensifs. Leurs groupes de parole permettent d'échanger avec d'autres personnes ayant vécu des expériences similaires.
Les centres de référence des maladies mitochondriales peuvent également apporter leur expertise, particulièrement pour les patients présentant des facteurs de risque génétiques [11]. Ces centres offrent des consultations spécialisées et un suivi personnalisé.
Il est important de savoir que de nombreuses ressources en ligne fournissent des informations fiables sur le PRIS. Le site de l'ANSM propose des fiches d'information actualisées, tandis que les sociétés savantes mettent à disposition des guides pratiques pour les patients [1,13].
Nos Conseils Pratiques
Si vous ou un proche êtes hospitalisé en réanimation et recevez du propofol, il est important de connaître quelques points clés [1,13]. N'hésitez pas à poser des questions à l'équipe soignante sur la durée prévue du traitement et les modalités de surveillance.
Informez toujours l'équipe médicale de vos antécédents familiaux, particulièrement s'il existe des maladies musculaires ou métaboliques dans votre famille [11]. Cette information peut influencer le choix de la stratégie sédative et le niveau de surveillance nécessaire.
Pendant la période de récupération, il est normal de ressentir une fatigue importante [7]. Ne forcez pas et respectez le rythme de récupération de votre organisme. Une reprise progressive des activités est généralement recommandée.
Enfin, maintenez un suivi médical régulier après votre sortie d'hospitalisation. Même si la récupération semble complète, un contrôle cardiologique et biologique à distance peut être rassurant [8,10]. L'important est de garder confiance : avec une prise en charge adaptée, le pronostic est généralement excellent.
Quand Consulter un Médecin ?
Après un épisode de PRIS, certains signes doivent vous amener à consulter rapidement votre médecin [8,10]. Une fatigue inhabituelle, des palpitations ou un essoufflement à l'effort peuvent signaler une complication cardiaque résiduelle nécessitant une évaluation spécialisée.
Les douleurs musculaires persistantes ou une faiblesse musculaire progressive doivent également faire l'objet d'une consultation [7]. Bien que rares, ces symptômes peuvent indiquer des séquelles musculaires nécessitant une prise en charge spécifique.
Si vous devez subir une nouvelle intervention nécessitant une anesthésie, il est crucial d'informer l'équipe anesthésique de vos antécédents de PRIS [1,13]. Cette information orientera le choix des agents anesthésiques et les modalités de surveillance peropératoire.
En cas de doute, n'hésitez jamais à contacter votre médecin traitant ou l'équipe qui vous a pris en charge. Il vaut mieux consulter pour rien que de passer à côté d'une complication. Votre santé est précieuse, et une surveillance attentive fait partie intégrante de votre rétablissement.
Questions Fréquentes
Le syndrome de perfusion du propofol peut-il récidiver ?
Non, une fois qu'un patient a développé un PRIS, l'utilisation du propofol est généralement contre-indiquée à vie. Les équipes anesthésiques utiliseront d'autres agents sédatifs pour les futures interventions.
Combien de temps dure la récupération après un PRIS ?
La récupération varie selon la sévérité de l'épisode. La plupart des patients récupèrent complètement en 2 à 6 semaines. Les formes sévères peuvent nécessiter plusieurs mois de rééducation.
Y a-t-il des séquelles à long terme ?
Heureusement, la majorité des patients ne gardent aucune séquelle. Seuls 10 à 15% peuvent présenter une cardiomyopathie résiduelle nécessitant un suivi cardiologique prolongé.
Le PRIS est-il héréditaire ?
Le PRIS lui-même n'est pas héréditaire, mais certaines prédispositions génétiques (maladies mitochondriales) peuvent augmenter le risque. Il est important d'informer votre médecin de vos antécédents familiaux.
Peut-on prévenir le syndrome de perfusion du propofol ?
Oui, grâce à une surveillance attentive, au respect des doses recommandées (<4 mg/kg/h) et à la limitation de la durée d'exposition (<48h). Les nouvelles techniques de monitoring permettent une détection précoce.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS) - Données épidémiologiques françaises 2024-2025Lien
- [2] ANSM - Rappels sur le Syndrome de perfusion du propofolLien
- [3] Appels à projets ministériels - Innovation thérapeutique 2023Lien
- [4] MedEffet Canada - Examen de sécurité et efficacité 2024Lien
- [5] Prescrire - Effets indésirables et innovations 2024-2025Lien
- [6] Mécanismes pharmacologiques et applications cliniques - PMC 2024Lien
- [7] Sédation inhalée versus propofol en insuffisance respiratoire - PMC 2024Lien
- [8] Fluteau L, Havel C. Cas clinique commenté: syndrome de perfusion du propofol - 2024Lien
- [9] Moukafih B, El Marrakchi S. Complications infectieuses liées au propofol - 2023Lien
- [10] Martín MP, Báez GP. VA-ECMO rescue therapy in propofol infusion syndrome - 2023Lien
- [11] Zhang R, Zhai K. Sevoflurane alleviates lung injury compared with propofol - 2024Lien
- [12] Grotberg JC, Subramanian M. ECMO for Propofol-related Infusion Syndrome - 2023Lien
- [15] Mehri S, Zarrouk S. Propofol in Triple Trouble Syndromes - 2024Lien
- [16] Le syndrome de perfusion du propofol - TVCJDCLien
- [17] Vidal - Syndrome de perfusion du propofol : recommandations ANSMLien
Publications scientifiques
- Cas clinique commenté: syndrome de perfusion du propofol: cas d'un PRIS chez une patiente hospitalisée pour hémorragie sous-arachnoïdienne (2024)
- Complications infectieuses liées à l'utilisation du propofol: une nouvelle série de cas et revue de la littérature (2023)2 citations
- VA-ECMO rescue therapy in propofol infusion syndrome after cardiac surgery (2023)2 citations
- Sevoflurane alleviates lung injury and inflammatory response compared with propofol in a rat model of VV ECMO (2024)8 citations
- Venoarterial Extracorporeal Membrane Oxygenation for Propofol-related Infusion Syndrome: A Case Report (2023)
Ressources web
- Actualité - Rappels sur le Syndrome de perfusion du propofol (ansm.sante.fr)
26 sept. 2018 — Le syndrome de perfusion du propofol peut se manifester par les évènements suivants : acidose métabolique, rhabdomyolyse, hyperkaliémie, hé ...
- Le syndrome de perfusion du propofol (tvcjdc.be)
de L Van de Bruaene — Le syndrome de perfusion du propofol (PRIS) est une complication rare, liée à un médicament, dont la cause est multifactorielle. Un bon monitoring de la dose s' ...
- Syndrome de perfusion du PROPOFOL : l'ANSM appelle à ... (vidal.fr)
2 oct. 2018 — Syndrome de perfusion du PROPOFOL : l'ANSM appelle à la vigilance et émet des recommandations · acidose métabolique, · rhabdomyolyse, ...
- Syndrome d'infusion au propofol (pris): (sofia.medicalistes.fr)
de B Sneyers · 2009 · Cité 1 fois — Ces individus ne présentent aucun symptôme avant leur admission aux soins intensifs, mais la dérive du métabolisme durant la maladie critique peut causer ce.
- Le syndrome de perfusion du propofol (em-consulte.com)
La symptomatologie est le plus souvent dominée par des troubles du rythme cardiaque, une acidose métabolique, une hyperlipidémie, une rhabdomyolyse et une ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
