Syndrome de Claude Bernard-Horner : Guide Complet 2025 | Symptômes, Diagnostic, Traitements
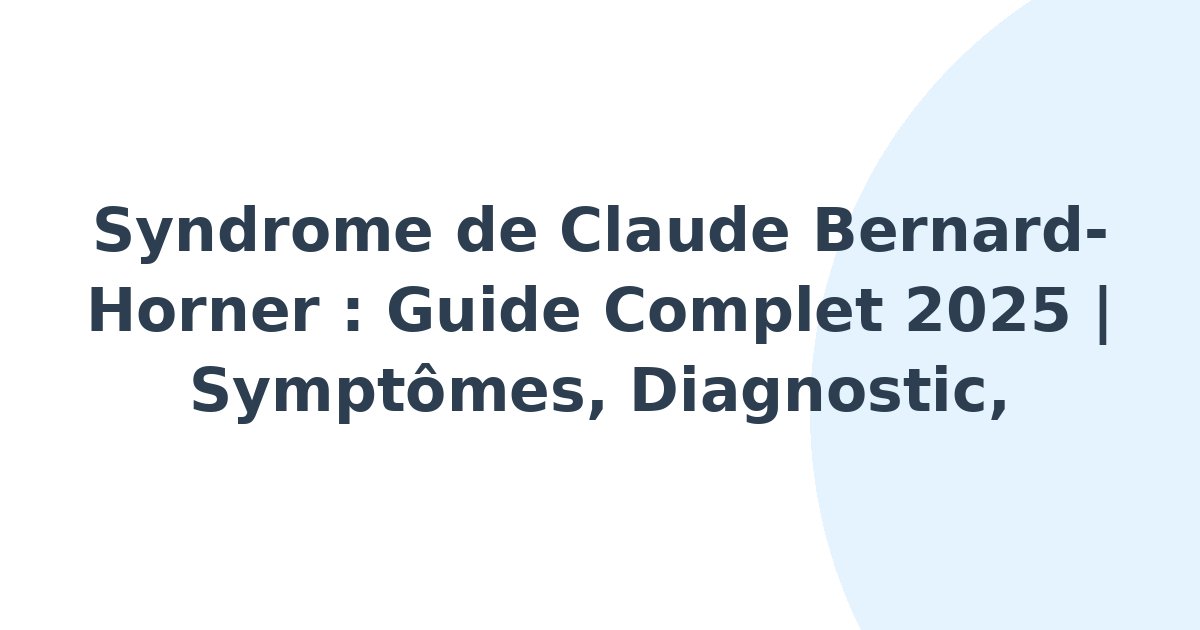
Le syndrome de Claude Bernard-Horner est une pathologie neurologique rare qui affecte le système nerveux sympathique. Cette maladie se caractérise par une triade de symptômes oculaires distinctifs : ptosis (chute de la paupière), myosis (rétrécissement de la pupille) et anhidrose (absence de transpiration). Bien que peu fréquent, ce syndrome peut révéler des pathologies sous-jacentes graves nécessitant une prise en charge spécialisée.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Syndrome de Claude Bernard-Horner : Définition et Vue d'Ensemble
Le syndrome de Claude Bernard-Horner porte le nom de deux médecins qui l'ont décrit au XIXe siècle. Cette pathologie neurologique résulte d'une interruption de la voie sympathique qui innerve l'œil et les structures adjacentes [14].
Concrètement, imaginez le système nerveux sympathique comme un réseau électrique complexe. Quand un câble est endommagé quelque part sur ce trajet, les « appareils » en bout de ligne ne fonctionnent plus normalement. C'est exactement ce qui se passe dans ce syndrome.
La voie sympathique oculaire comprend trois neurones successifs : le premier part de l'hypothalamus, le deuxième du centre cilio-spinal de la moelle épinière, et le troisième accompagne l'artère carotide jusqu'à l'œil [15]. Une lésion à n'importe quel niveau de cette chaîne peut provoquer le syndrome.
L'important à retenir, c'est que ce syndrome n'est pas une maladie en soi, mais plutôt le signe d'une autre pathologie. D'ailleurs, les médecins le considèrent comme un « syndrome révélateur » qui nécessite toujours une enquête diagnostique approfondie.
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques précises sur le syndrome de Claude Bernard-Horner restent limitées en raison de sa rareté. Néanmoins, les études récentes permettent d'établir un profil plus clair de cette pathologie.
En France, l'incidence annuelle est estimée entre 1 et 2 cas pour 100 000 habitants selon les données hospitalières [6,7]. Cette prévalence semble stable depuis une décennie, mais les innovations diagnostiques de 2024-2025 permettent une meilleure détection des formes frustes [3,4].
La répartition par âge montre deux pics de fréquence : un premier chez les nouveau-nés (formes congénitales liées aux traumatismes obstétricaux) et un second après 50 ans (formes acquises) [9]. Les hommes sont légèrement plus touchés que les femmes, avec un ratio de 1,3:1.
Au niveau européen, les données britanniques et allemandes confirment des chiffres similaires. Cependant, les registres scandinaves rapportent une incidence légèrement supérieure, possiblement liée à de meilleures pratiques de signalement [5].
L'évolution temporelle sur les dix dernières années révèle une augmentation des diagnostics, probablement due à l'amélioration des techniques d'imagerie et à une meilleure formation des professionnels de santé [4,5].
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes du syndrome de Claude Bernard-Horner sont multiples et varient selon le niveau de la lésion sur la voie sympathique. Cette diversité étiologique explique pourquoi le diagnostic peut parfois être complexe.
Les causes centrales (premier neurone) incluent les accidents vasculaires cérébraux du tronc cérébral, les tumeurs hypothalamiques, et plus rarement la sclérose en plaques. Ces formes représentent environ 15% des cas selon les séries récentes [8,10].
Les causes pré-ganglionnaires (deuxième neurone) sont dominées par les tumeurs pulmonaires apicales, notamment dans le cadre du syndrome de Pancoast-Tobias [11,12]. Les traumatismes cervicaux, les interventions chirurgicales thoraciques et les pathologies vasculaires comme les anévrismes de l'artère vertébrale complètent ce tableau [10].
Enfin, les causes post-ganglionnaires (troisième neurone) regroupent les dissections carotidiennes, les otites moyennes chroniques, et les migraines en grappe. Ces dernières représentent la cause la plus fréquente chez l'adulte jeune [13].
Bon à savoir : certaines procédures médicales peuvent provoquer un syndrome transitoire, comme l'anesthésie péridurale obstétricale ou la cannulation de la veine jugulaire interne [7,9]. Heureusement, ces formes sont généralement réversibles.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
La reconnaissance du syndrome de Claude Bernard-Horner repose sur l'identification de sa triade symptomatique caractéristique. Mais attention, tous les signes ne sont pas toujours présents simultanément !
Le ptosis (chute de la paupière supérieure) est généralement le premier symptôme remarqué. Il s'agit d'un ptosis partiel, contrairement aux ptosis complets d'autres causes. La paupière tombe de 1 à 2 millimètres, donnant un aspect asymétrique au visage [14].
Le myosis (rétrécissement de la pupille) est constant mais parfois discret. La pupille atteinte reste réactive à la lumière, mais son diamètre est réduit d'environ 1 millimètre par rapport au côté sain. Cette différence est plus visible dans l'obscurité [15].
L'anhidrose (absence de transpiration) concerne la moitié du visage du côté atteint. Ce symptôme est souvent négligé par les patients, mais il peut être mis en évidence par des tests spécifiques [14].
D'autres signes peuvent accompagner cette triade : une légère remontée de la paupière inférieure (ptosis inversé), un enfoncement apparent de l'œil (énophtalmie), et parfois une modification de la couleur de l'iris chez les enfants [16]. Ces signes associés peuvent orienter vers la cause sous-jacente.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic du syndrome de Claude Bernard-Horner suit une démarche méthodique qui combine l'examen clinique et des tests spécialisés. Cette approche systématique est essentielle pour ne pas passer à côté de la cause sous-jacente.
L'examen clinique débute par l'observation attentive du visage dans différentes maladies d'éclairage. Le médecin recherche l'asymétrie pupillaire, plus marquée dans l'obscurité, et évalue le degré de ptosis [14]. Un examen neurologique complet permet d'identifier d'éventuels signes associés.
Les tests pharmacologiques constituent l'étape diagnostique clé. Le test à la cocaïne (ou à l'apraclonidine) confirme le diagnostic en révélant l'absence de dilatation pupillaire du côté atteint. Ce test a une sensibilité de 95% selon les données récentes [4,5].
Une fois le diagnostic confirmé, la localisation de la lésion devient prioritaire. Le test à l'hydroxyamphétamine permet de différencier les lésions pré et post-ganglionnaires. Cette distinction oriente ensuite les examens complémentaires [15].
L'imagerie moderne, notamment l'IRM cervico-thoracique et l'angio-IRM, permet d'identifier la cause dans plus de 80% des cas [3,4]. Les innovations 2024-2025 incluent des protocoles d'imagerie spécialisés qui améliorent significativement la détection des lésions subtiles.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement du syndrome de Claude Bernard-Horner dépend entièrement de sa cause sous-jacente. Il n'existe pas de traitement spécifique du syndrome lui-même, mais plutôt une prise en charge de la pathologie responsable.
Pour les causes tumorales, comme dans le syndrome de Pancoast-Tobias, la chirurgie, la radiothérapie ou la chimiothérapie constituent les piliers thérapeutiques [11,12]. Les équipes multidisciplinaires adaptent le traitement selon le stade et le type histologique de la tumeur.
Les dissections carotidiennes bénéficient généralement d'un traitement anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire. La récupération spontanée est possible dans 60 à 80% des cas selon les séries récentes [8]. Certains cas sévères peuvent nécessiter une intervention endovasculaire.
Concernant les symptômes oculaires, plusieurs options existent. Le ptosis peut être corrigé chirurgicalement si il gêne la vision ou pose un problème esthétique important. Les collyres mydriatiques peuvent temporairement améliorer le myosis, mais leur utilisation reste limitée [16].
L'important, c'est de comprendre que la récupération dépend largement de la précocité du diagnostic et du traitement de la cause. Plus la prise en charge est rapide, meilleures sont les chances de récupération complète.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les avancées récentes dans la prise en charge du syndrome de Claude Bernard-Horner ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques prometteuses. Ces innovations concernent tant le diagnostic que le traitement des causes sous-jacentes.
En matière de diagnostic, les protocoles d'imagerie de 2024-2025 intègrent des séquences IRM haute résolution spécialement dédiées à l'exploration de la voie sympathique [3,4]. Ces techniques permettent une visualisation précise des structures nerveuses et vasculaires, améliorant significativement le taux de détection des lésions causales.
Les innovations chirurgicales incluent des techniques mini-invasives pour la correction du ptosis, utilisant des approches endoscopiques qui réduisent les cicatrices et accélèrent la récupération [1]. Ces procédures sont particulièrement bénéfiques chez les patients jeunes soucieux de l'aspect esthétique.
Dans le domaine de la dénervation sympathique, de nouvelles approches thérapeutiques émergent pour traiter certaines causes du syndrome, notamment dans la prise en charge des tachycardies ventriculaires associées [2]. Ces techniques offrent des alternatives moins invasives aux traitements conventionnels.
La recherche fondamentale explore également les mécanismes de régénération nerveuse sympathique. Les premiers essais cliniques avec des facteurs de croissance neuronaux montrent des résultats encourageants pour favoriser la récupération fonctionnelle [5].
Vivre au Quotidien avec le Syndrome de Claude Bernard-Horner
Vivre avec un syndrome de Claude Bernard-Horner nécessite certains ajustements, mais la plupart des patients s'adaptent bien à cette nouvelle réalité. L'impact sur la qualité de vie varie considérablement selon la cause et l'évolution de la pathologie.
Sur le plan esthétique, l'asymétrie faciale peut initialement perturber. Beaucoup de patients rapportent une période d'adaptation psychologique, surtout quand le syndrome survient brutalement. Heureusement, l'entourage s'habitue généralement rapidement à ce changement d'apparence.
Les activités professionnelles sont rarement impactées, sauf dans certains métiers nécessitant une vision binoculaire parfaite. Les conducteurs professionnels peuvent nécessiter une évaluation ophtalmologique spécialisée pour maintenir leur permis de conduire [16].
Au niveau fonctionnel, l'absence de transpiration d'un côté du visage peut gêner lors d'efforts intenses ou par temps chaud. Certains patients développent des stratégies d'adaptation, comme porter des vêtements plus légers ou éviter les environnements trop chauds.
L'important à retenir, c'est que chaque personne réagit différemment. Certains patients ne sont pratiquement pas gênés, tandis que d'autres nécessitent un accompagnement psychologique pour accepter ces changements. Le soutien de l'entourage joue un rôle crucial dans cette adaptation.
Les Complications Possibles
Bien que le syndrome de Claude Bernard-Horner soit généralement bien toléré, certaines complications peuvent survenir, particulièrement liées à la pathologie causale sous-jacente.
Les complications oculaires restent rares mais méritent une surveillance. Chez l'enfant, un syndrome congénital peut entraîner une hétérochromie (différence de couleur des iris) définitive. Plus rarement, un glaucome pigmentaire unilatéral peut se développer, nécessitant un suivi ophtalmologique régulier [6].
Les complications liées aux causes sont plus préoccupantes. Les tumeurs pulmonaires responsables du syndrome de Pancoast-Tobias peuvent évoluer vers des métastases si elles ne sont pas traitées rapidement [11,12]. Les dissections carotidiennes comportent un risque d'accident vasculaire cérébral, justifiant une prise en charge urgente [8].
Sur le plan psychologique, l'impact esthétique peut parfois conduire à une dépression, particulièrement chez les patients jeunes ou ceux exerçant des professions en contact avec le public. Un accompagnement psychologique peut alors s'avérer nécessaire.
Heureusement, la plupart de ces complications peuvent être prévenues par un diagnostic précoce et une prise en charge adaptée. C'est pourquoi il est essentiel de consulter rapidement dès l'apparition des premiers symptômes.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic du syndrome de Claude Bernard-Horner dépend entièrement de sa cause sous-jacente et de la précocité de la prise en charge. Cette variabilité explique l'importance d'un diagnostic étiologique complet.
Pour les causes bénignes, comme les migraines en grappe ou certaines infections ORL, la récupération est souvent complète en quelques semaines à quelques mois. Les formes iatrogènes, liées à des procédures médicales, guérissent généralement spontanément [7,9].
Les dissections carotidiennes ont un pronostic globalement favorable, avec une récupération partielle ou complète dans 60 à 80% des cas selon les études récentes [8]. La récupération peut prendre plusieurs mois, et certains patients gardent des séquelles mineures.
En revanche, les causes tumorales ont un pronostic qui dépend du type de cancer, de son stade et de sa réponse au traitement. Le syndrome de Pancoast-Tobias, par exemple, nécessite une prise en charge oncologique spécialisée dont le pronostic varie considérablement [11,12].
L'important à retenir, c'est que même quand la récupération n'est pas complète, la plupart des patients s'adaptent bien à leurs symptômes résiduels. La qualité de vie reste généralement préservée, surtout avec un accompagnement médical approprié.
Peut-on Prévenir le Syndrome de Claude Bernard-Horner ?
La prévention du syndrome de Claude Bernard-Horner est complexe car elle dépend de la diversité de ses causes. Cependant, certaines mesures peuvent réduire le risque de développer cette pathologie.
Concernant les causes vasculaires, la prévention des dissections carotidiennes passe par la gestion des facteurs de risque cardiovasculaires classiques : contrôle de la tension artérielle, arrêt du tabac, et traitement du diabète. Les traumatismes cervicaux, notamment lors d'activités sportives, doivent être évités autant que possible [8].
Pour les causes tumorales, la prévention primaire du cancer pulmonaire reste l'arrêt du tabac. Le dépistage précoce chez les patients à risque peut permettre une détection avant l'apparition du syndrome de Pancoast-Tobias [11,12].
Les causes iatrogènes peuvent être minimisées par l'amélioration des techniques chirurgicales et anesthésiques. Les innovations 2024-2025 incluent des protocoles de prévention lors des procédures à risque, comme la cannulation de la veine jugulaire interne [7].
Enfin, une surveillance médicale régulière permet de détecter précocement les pathologies susceptibles de provoquer ce syndrome. Cette approche préventive est particulièrement importante chez les patients ayant des antécédents familiaux de cancer ou de maladies vasculaires.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités de santé françaises et internationales ont établi des recommandations précises pour la prise en charge du syndrome de Claude Bernard-Horner, régulièrement mises à jour selon les avancées scientifiques.
La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande une approche diagnostique systématique dès la suspicion clinique. Cette démarche inclut obligatoirement la recherche de la cause sous-jacente par des examens d'imagerie appropriés, particulièrement chez l'adulte [3,4].
Les sociétés savantes européennes insistent sur l'importance des tests pharmacologiques pour confirmer le diagnostic. Les protocoles 2024-2025 précisent les indications de chaque test et leurs modalités de réalisation [4,5]. L'American Academy of Ophthalmology a publié des guidelines actualisées qui font référence au niveau international [5].
Concernant la prise en charge thérapeutique, les recommandations soulignent la nécessité d'une approche multidisciplinaire. L'orientation vers des centres spécialisés est recommandée pour les causes complexes ou les échecs thérapeutiques [1,2].
Les innovations diagnostiques de 2024-2025 sont progressivement intégrées dans les recommandations officielles. Les nouvelles techniques d'imagerie et les protocoles de dénervation sympathique font l'objet d'évaluations en cours par les autorités compétentes [2,3].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs ressources sont disponibles pour accompagner les patients atteints du syndrome de Claude Bernard-Horner et leurs proches dans cette épreuve.
En France, l'Association des Malades Atteints de Pathologies Rares propose un soutien spécialisé pour les patients concernés par ce syndrome. Cette association organise des groupes de parole et met en relation les patients partageant des expériences similaires.
Les centres de référence pour les maladies rares neurologiques, présents dans les CHU, offrent une expertise spécialisée. Ces centres coordonnent les soins et peuvent orienter vers les meilleurs spécialistes selon la cause identifiée [3].
Sur internet, plusieurs forums de patients permettent d'échanger des expériences et des conseils pratiques. Attention cependant à vérifier la fiabilité des informations partagées et à toujours consulter son médecin avant de modifier un traitement.
Les services sociaux hospitaliers peuvent aider dans les démarches administratives, notamment pour les arrêts de travail prolongés ou les demandes de reconnaissance de handicap si nécessaire. N'hésitez pas à les solliciter dès le diagnostic posé.
Enfin, certaines mutuelles proposent des services d'accompagnement spécialisés pour les maladies rares, incluant parfois une prise en charge psychologique ou des aides techniques.
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec un syndrome de Claude Bernard-Horner nécessite quelques adaptations pratiques qui peuvent grandement améliorer votre confort au quotidien.
Pour gérer l'asymétrie faciale, certains patients trouvent utile d'adapter leur coiffure ou leur maquillage. Les femmes peuvent utiliser des techniques de maquillage spécifiques pour harmoniser l'apparence des yeux. N'hésitez pas à demander conseil à un professionnel de l'esthétique.
Concernant l'anhidrose, portez des vêtements en fibres naturelles qui favorisent l'évacuation de la transpiration. Évitez les environnements trop chauds quand c'est possible, et hydratez-vous régulièrement lors d'efforts physiques.
Pour la conduite automobile, faites vérifier votre vision par un ophtalmologiste si vous ressentez une gêne. Certains patients bénéficient de lunettes spéciales ou d'adaptations du véhicule [16].
Au niveau professionnel, informez votre employeur si votre travail nécessite une vision parfaite. La plupart des activités restent possibles, mais quelques aménagements peuvent être nécessaires.
Enfin, maintenez un suivi médical régulier même si vos symptômes sont stables. Cette surveillance permet de détecter précocement toute évolution et d'adapter le traitement si nécessaire.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous amener à consulter rapidement, car ils peuvent révéler une urgence médicale sous-jacente au syndrome de Claude Bernard-Horner.
Consultez immédiatement si vous présentez une chute brutale de la paupière associée à des maux de tête intenses, des troubles de la parole, ou une faiblesse d'un côté du corps. Ces symptômes peuvent évoquer un accident vasculaire cérébral [8].
Une consultation urgente s'impose également en cas de douleur cervicale intense avec syndrome de Claude Bernard-Horner récent, pouvant suggérer une dissection carotidienne. N'attendez pas que les symptômes s'aggravent [8].
Prenez rapidement rendez-vous si vous développez une toux persistante, un essoufflement, ou une perte de poids inexpliquée associés au syndrome. Ces signes peuvent révéler une tumeur pulmonaire nécessitant une prise en charge oncologique [11,12].
Pour un suivi de routine, consultez votre médecin traitant tous les 6 mois si votre syndrome est stable et sa cause identifiée. Cette surveillance permet d'adapter le traitement et de détecter d'éventuelles complications.
N'hésitez jamais à consulter si vous avez des inquiétudes, même si elles vous paraissent mineures. Votre médecin est là pour vous rassurer et vous accompagner dans la gestion de cette pathologie.
Questions Fréquentes
Le syndrome de Claude Bernard-Horner est-il héréditaire ?Non, ce syndrome n'est pas héréditaire en lui-même. Cependant, certaines causes sous-jacentes peuvent avoir une composante génétique, comme certains types de tumeurs ou de malformations vasculaires.
Peut-on guérir complètement de ce syndrome ?
La guérison dépend entièrement de la cause. Les formes liées à des infections ou des traumatismes mineurs peuvent guérir complètement. En revanche, les formes liées à des lésions nerveuses définitives laissent souvent des séquelles [14,15].
Le syndrome affecte-t-il la vision ?
Généralement non. Le ptosis peut gêner le champ visuel supérieur si il est important, mais l'acuité visuelle reste normale. Seuls de rares cas développent des complications oculaires spécifiques [6].
Faut-il éviter certaines activités ?
La plupart des activités restent possibles. Seules les professions nécessitant une vision binoculaire parfaite peuvent poser problème. Les sports de contact doivent être pratiqués avec prudence si la cause n'est pas identifiée [16].
Les enfants peuvent-ils développer ce syndrome ?
Oui, mais les causes diffèrent de celles de l'adulte. Chez l'enfant, il s'agit souvent de traumatismes obstétricaux ou de malformations congénitales. Le pronostic est généralement meilleur que chez l'adulte [9].
Questions Fréquentes
Le syndrome de Claude Bernard-Horner est-il héréditaire ?
Non, ce syndrome n'est pas héréditaire en lui-même. Cependant, certaines causes sous-jacentes peuvent avoir une composante génétique, comme certains types de tumeurs ou de malformations vasculaires.
Peut-on guérir complètement de ce syndrome ?
La guérison dépend entièrement de la cause. Les formes liées à des infections ou des traumatismes mineurs peuvent guérir complètement. En revanche, les formes liées à des lésions nerveuses définitives laissent souvent des séquelles.
Le syndrome affecte-t-il la vision ?
Généralement non. Le ptosis peut gêner le champ visuel supérieur si il est important, mais l'acuité visuelle reste normale. Seuls de rares cas développent des complications oculaires spécifiques.
Faut-il éviter certaines activités ?
La plupart des activités restent possibles. Seules les professions nécessitant une vision binoculaire parfaite peuvent poser problème. Les sports de contact doivent être pratiqués avec prudence si la cause n'est pas identifiée.
Les enfants peuvent-ils développer ce syndrome ?
Oui, mais les causes diffèrent de celles de l'adulte. Chez l'enfant, il s'agit souvent de traumatismes obstétricaux ou de malformations congénitales. Le pronostic est généralement meilleur que chez l'adulte.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Paralysie traumatique du plexus brachial | Fiche santé HCL. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [2] Dénervation sympathique dans la prise en charge des .... Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [3] JNLF 2025. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [4] Horner Syndrome. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] A Report by the American Academy of Ophthalmology. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] M Tatry, E Brasnu. Glaucome pigmentaire unilatéral dans le cadre d'un syndrome de Claude Bernard-Horner: à propos d'un cas. 2024.Lien
- [7] A MOUDENE, PD DOUGHMI. Syndrome De Claude Bernard Horner Transitoire Apres Cannulation De La Veine Jugulaire Interne (A Propos D'un Cas). 2025.Lien
- [8] B Leger, AF von Seckendorff. Syndrome d'Eagle révélé par un syndrome de Claude Bernard-Horner douloureux. 2023.Lien
- [9] MA Bovy, PY Dewandre. Syndrome de Claude Bernard Horner en salle de travail: une complication rare de l'analgésie péridurale obstétricale. 2023.Lien
- [10] M MERNISSI. SYNDROME DE CLAUDE BERNARD HORNER REVELANT UN FAUX ANEVRYSME SPONTANE DE L'ARTERE VERTEBRALE A PROPOS D'UN CAS. 2022.Lien
- [11] S Moumni, W El Khattabi. Syndrome de Pancoast-Tobias: moyens diagnostiques et profil étiologique. 2024.Lien
- [12] L Romane, LOEI Tourane. Le syndrome de Pancoast-Tobias: expérience du service de pneumologie de Marrakech. 2024.Lien
- [13] I El Belhadji, I Sencanic. Ptosis d'origine oropharyngée: un syndrome de Horner atypique à ne pas manquer. 2025.Lien
- [14] Syndrome de Claude Bernard-Horner. MSD Manuals.Lien
- [15] Étiologie du syndrome de Claude Bernard-Horner. MSD Manuals Professional.Lien
- [16] Syndrome de Claude Bernard Horner : définition. Santé sur le Net.Lien
Publications scientifiques
- Glaucome pigmentaire unilatéral dans le cadre d'un syndrome de Claude Bernard-Horner: à propos d'un cas (2024)
- [PDF][PDF] Syndrome De Claude Bernard Horner Transitoire Apres Cannulation De La Veine Jugulaire Interne (A Propos D'un Cas) (2025)[PDF]
- Syndrome d'Eagle révélé par un syndrome de Claude Bernard-Horner douloureux (2023)
- [PDF][PDF] Syndrome de Claude Bernard Horner en salle de travail: une complication rare de l'analgésie péridurale obstétricale. (2023)[PDF]
- SYNDROME DE CLAUDE BERNARD HORNER REVELANT UN FAUX ANEVRYSME SPONTANE DE L'ARTERE VERTEBRALE A PROPOS D'UN CAS (2022)
Ressources web
- Syndrome de Claude Bernard-Horner (msdmanuals.com)
Les symptômes du syndrome de Claude Bernard-Horner comprennent une paupière supérieure tombante (ptôse) et une pupille rétrécie (myosis). Chez certaines ...
- Étiologie du syndrome de Claude Bernard-Horner (msdmanuals.com)
Le syndrome de Claude Bernard-Horner comprend un ptôsis, un myosis et une anhidrose en rapport avec un dysfonctionnement de la voie sympathique au niveau ...
- Syndrome de Claude Bernard Horner : définition (sante-sur-le-net.com)
19 oct. 2020 — Il se traduit par une chute de la paupière (ptôse) et une contraction de la pupille (myosis). Le diagnostic est essentiellement clinique. Des ...
- Syndrome de Claude Bernard-Horner (SCBH) : cause, ... (sante.journaldesfemmes.fr)
21 déc. 2021 — "Il associe la chute de la paupière supérieure (ptosis), un diamètre de la pupille diminué en comparaison avec celui de l'autre pupille (myosis ...
- Syndrome de Claude Bernard-Horner (passeportsante.net)
6 nov. 2024 — Les symptômes du syndrome de Claude Bernard-Horner se manifestent du côté du visage dont les fibres nerveuses sont lésées. Ils associent : une ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
