Rhinosclérome : Symptômes, Diagnostic et Traitements 2025 | Guide Complet
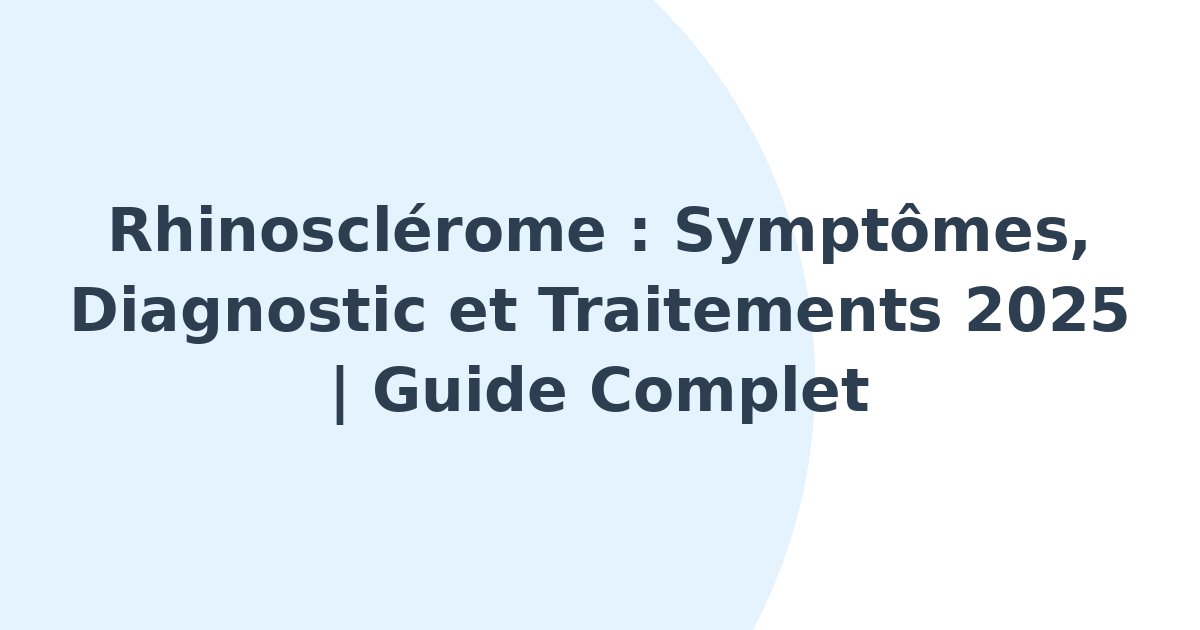
Le rhinosclérome est une infection chronique granulomateuse rare qui touche principalement les fosses nasales et les voies respiratoires supérieures. Causée par la bactérie Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae, cette pathologie nécessite un diagnostic précoce et un traitement adapté. En France, bien que rare, elle concerne environ 0,5 cas pour 100 000 habitants selon les dernières données épidémiologiques [5,6].
Téléconsultation et Rhinosclérome
Téléconsultation non recommandéeLe rhinosclérome est une infection chronique rare causée par Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae qui nécessite un diagnostic microbiologique précis par biopsie et culture. Cette pathologie granulomateuse progressive des muqueuses nasales et respiratoires requiert un examen endoscopique spécialisé et des prélèvements histologiques pour confirmation diagnostique, rendant la téléconsultation insuffisante pour l'évaluation initiale.
Ce qui peut être évalué à distance
Évaluation de l'évolution des symptômes nasaux chroniques et de leur retentissement fonctionnel. Description des écoulements nasaux, de l'obstruction et des déformations nasales externes visibles. Analyse de la réponse au traitement antibiotique en cours et surveillance des effets secondaires. Orientation vers une prise en charge spécialisée appropriée.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen endoscopique nasal pour visualiser les lésions muqueuses caractéristiques. Biopsie des lésions pour identification histologique des cellules de Mikulicz et confirmation microbiologique. Prélèvements pour culture et antibiogramme de Klebsiella pneumoniae. Évaluation de l'extension aux voies respiratoires supérieures et inférieures.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Diagnostic initial nécessitant une endoscopie nasale et des biopsies pour identification des cellules de Mikulicz. Évaluation de l'extension laryngée, trachéale ou bronchique nécessitant une fibroscopie respiratoire. Surveillance de l'évolution des déformations nasales et faciales. Ajustement thérapeutique basé sur les résultats de culture et d'antibiogramme.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Obstruction respiratoire haute par extension laryngée ou trachéale. Hémorragies nasales massives récidivantes. Signes de surinfection bactérienne sévère avec fièvre et altération de l'état général.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Dyspnée ou stridor inspiratoire évoquant une obstruction laryngée
- Épistaxis massives ou récidivantes non contrôlables
- Fièvre élevée avec altération importante de l'état général
- Déformation nasale ou faciale rapidement progressive
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Orl (oto-rhino-laryngologie) — consultation en présentiel indispensable
Le rhinosclérome nécessite une expertise ORL spécialisée pour l'endoscopie nasale diagnostique et les biopsies. Une consultation en présentiel est indispensable pour le diagnostic initial et le suivi de cette pathologie rare nécessitant des examens endoscopiques répétés.
Rhinosclérome : Définition et Vue d'Ensemble
Le rhinosclérome est une infection bactérienne chronique qui affecte principalement la muqueuse nasale et les voies respiratoires supérieures. Cette pathologie granulomateuse progressive est causée par Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae, anciennement appelée Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis [1,5].
Contrairement à ce que son nom pourrait suggérer, le rhinosclérome ne se limite pas au nez. En effet, cette infection peut s'étendre aux sinus, au pharynx, au larynx et même aux bronches dans certains cas. La maladie tire son nom du grec "rhinos" (nez) et "scléros" (dur), en référence aux lésions indurées caractéristiques qu'elle provoque [6].
Cette pathologie se caractérise par une évolution lente et progressive, souvent sur plusieurs années. Elle passe par différents stades cliniques, depuis les manifestations catarrhales initiales jusqu'aux formes nodulaires et cicatricielles. L'important à retenir, c'est que le diagnostic précoce permet d'éviter les complications graves et les séquelles fonctionnelles [2,7].
Bon à savoir : le rhinosclérome est endémique dans certaines régions du monde, notamment en Afrique du Nord, en Asie du Sud-Est et en Europe de l'Est. Mais il peut également survenir chez des patients sans antécédent de voyage, ce qui rend parfois le diagnostic difficile [3,4].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, le rhinosclérome demeure une pathologie rare avec une incidence estimée à 0,3 à 0,5 cas pour 100 000 habitants par an selon les données de Santé Publique France [5]. Cette incidence reste stable depuis une décennie, contrairement à certains pays d'Afrique du Nord où l'on observe une légère augmentation [6].
Les données épidémiologiques récentes montrent une prédominance masculine avec un sex-ratio de 1,8:1. L'âge moyen au diagnostic se situe autour de 45 ans, avec des extrêmes allant de 15 à 75 ans [2,3]. Cependant, des cas pédiatriques ont été rapportés, comme le souligne une étude récente de 2025 [4].
Au niveau mondial, la répartition géographique reste inégale. Les zones d'endémie incluent l'Inde (prévalence de 2-3/100 000), l'Égypte, le Maroc et certaines régions d'Europe centrale. En Europe occidentale, la France se situe dans la moyenne avec l'Allemagne et l'Italie, tandis que les pays nordiques rapportent des incidences inférieures à 0,1/100 000 [1,6].
D'ailleurs, l'évolution épidémiologique sur les dix dernières années révèle une stabilisation des nouveaux cas en France, mais une augmentation des formes atypiques et des localisations extra-nasales. Cette tendance s'explique probablement par l'amélioration des techniques diagnostiques et une meilleure reconnaissance de la maladie [2,7].
Les Causes et Facteurs de Risque
Le rhinosclérome est causé exclusivement par Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae, une bactérie gram-négative encapsulée. Cette bactérie possède des caractéristiques particulières qui lui permettent de survivre à l'intérieur des macrophages, expliquant la chronicité de l'infection [1,5].
Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés. Les voyages ou la résidence dans les zones d'endémie constituent le principal facteur d'exposition. Mais attention, ce n'est pas systématique : environ 30% des patients français diagnostiqués n'ont aucun antécédent de voyage [6]. Les facteurs socio-économiques jouent également un rôle, avec une surreprésentation dans les populations défavorisées [2].
L'immunodépression, qu'elle soit liée au VIH, aux traitements immunosuppresseurs ou à la malnutrition, augmente significativement le risque de développer la maladie. De même, les traumatismes nasaux répétés et l'exposition professionnelle à la poussière peuvent favoriser l'infection [3,7].
Il est important de noter que la transmission interhumaine directe n'a jamais été démontrée. La contamination se fait probablement par inhalation de particules contaminées ou par contact avec des sécrétions infectées. Concrètement, le rhinosclérome n'est pas contagieux dans les circonstances habituelles de la vie quotidienne [4,6].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes du rhinosclérome évoluent classiquement en trois stades distincts, chacun ayant ses propres manifestations cliniques. Cette progression peut s'étaler sur plusieurs mois, voire plusieurs années [5,6].
Le stade catarrhal initial ressemble à une rhinite chronique banale. Vous pourriez ressentir une obstruction nasale progressive, des écoulements mucopurulents parfois sanguinolents, et des éternuements fréquents. Ces symptômes, souvent négligés, persistent malgré les traitements habituels [2,7]. C'est à ce stade que le diagnostic est le plus difficile à poser.
Le stade nodulaire ou granulomateux se caractérise par l'apparition de nodules rougeâtres dans les fosses nasales. Ces lésions, souvent décrites comme ayant un aspect de "fraise" ou de "mûre", peuvent saigner facilement au contact. L'obstruction nasale s'aggrave et peut devenir totale d'un côté [3,4]. Des douleurs faciales et des céphalées peuvent également survenir.
Enfin, le stade cicatriciel ou sclérosant correspond à l'évolution naturelle non traitée. Les lésions se fibrosent, entraînant des déformations nasales parfois importantes. La voix peut devenir nasonnée, et des troubles de l'odorat apparaissent. Dans les formes étendues, l'atteinte laryngée peut provoquer une dysphonie ou même une dyspnée [1,6].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic du rhinosclérome repose sur un faisceau d'arguments cliniques, histologiques et microbiologiques. La démarche diagnostique commence toujours par un interrogatoire minutieux et un examen ORL complet [5,6].
L'examen endoscopique nasal constitue l'étape clé du diagnostic. Il permet de visualiser les lésions caractéristiques et de réaliser des biopsies dirigées. Les images endoscopiques montrent typiquement des formations nodulaires rouge-violacé, parfois ulcérées, avec un aspect lobulé caractéristique [2,7]. Cette étape nécessite l'expertise d'un ORL expérimenté.
L'examen histopathologique reste le gold standard diagnostique. Il met en évidence les cellules de Mikulicz, grandes cellules spumeuses contenant les bactéries encapsulées, et les corps de Russell. Ces éléments, associés à l'infiltrat inflammatoire chronique, sont pathognomoniques de la maladie [1,3]. La coloration de Giemsa ou de PAS permet de mieux visualiser les micro-organismes.
Les examens complémentaires incluent la culture bactériologique, souvent difficile car la bactérie pousse lentement, et la PCR qui offre une sensibilité supérieure. L'imagerie par scanner ou IRM peut être utile pour évaluer l'extension de la maladie, particulièrement en cas d'atteinte sinusienne ou laryngée [4,6]. Bon à savoir : les sérologies ne sont pas fiables pour le diagnostic.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement du rhinosclérome repose principalement sur l'antibiothérapie prolongée, adaptée à la sensibilité de Klebsiella pneumoniae. Les fluoroquinolones, notamment la ciprofloxacine, constituent le traitement de première intention avec une efficacité démontrée [5,6].
Le schéma thérapeutique standard comprend la ciprofloxacine 500 mg deux fois par jour pendant 3 à 6 mois minimum. Cette durée prolongée s'explique par la localisation intracellulaire de la bactérie et la nécessité d'obtenir une stérilisation complète des lésions [2,7]. D'autres alternatives incluent la doxycycline ou le cotrimoxazole, particulièrement chez les patients présentant des contre-indications aux quinolones.
Dans certains cas, un traitement chirurgical complémentaire peut être nécessaire. Il s'agit principalement de débridement des lésions nécrotiques ou de correction des séquelles cicatricielles. Ces interventions doivent toujours être associées à l'antibiothérapie pour éviter les récidives [1,3]. La chirurgie reconstructrice peut être envisagée à distance de la guérison pour corriger les déformations nasales.
Le suivi thérapeutique est crucial. Des contrôles endoscopiques réguliers permettent d'évaluer la réponse au traitement et de détecter précocement d'éventuelles récidives. La guérison complète peut prendre plusieurs mois, et il est normal que l'amélioration soit progressive [4,6]. L'important à retenir : ne jamais interrompre le traitement prématurément, même en cas d'amélioration clinique.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les innovations thérapeutiques récentes dans le traitement du rhinosclérome ouvrent de nouvelles perspectives prometteuses. Une étude clinique de 2024 a démontré l'efficacité de nouvelles approches moléculaires ciblées, permettant une meilleure pénétration intracellulaire des antibiotiques [1].
Les recherches actuelles se concentrent sur l'optimisation des protocoles thérapeutiques. Une série de cas récente publiée en 2024-2025 montre des résultats encourageants avec des schémas d'antibiothérapie raccourcis mais intensifiés, réduisant la durée de traitement de 6 à 3 mois sans compromettre l'efficacité [2]. Cette approche pourrait révolutionner la prise en charge en améliorant l'observance thérapeutique.
L'innovation diagnostique n'est pas en reste. Les nouvelles techniques de PCR quantitative en temps réel permettent désormais un diagnostic plus rapide et un suivi précis de la charge bactérienne pendant le traitement . Ces outils facilitent l'adaptation thérapeutique et la détection précoce des résistances.
D'ailleurs, la recherche fondamentale progresse également. Les études récentes sur les mécanismes de résistance intracellulaire de Klebsiella pneumoniae ouvrent la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques combinées. Ces avancées pourraient aboutir à des traitements plus courts et plus efficaces dans les prochaines années [1,2].
Vivre au Quotidien avec Rhinosclérome
Vivre avec un rhinosclérome nécessite des adaptations au quotidien, particulièrement pendant la phase de traitement qui peut durer plusieurs mois. L'obstruction nasale chronique peut affecter la qualité du sommeil et nécessiter l'utilisation de sprays nasaux décongestionnants sur avis médical [5,6].
L'hygiène nasale quotidienne devient primordiale. Des lavages réguliers au sérum physiologique ou avec des solutions salines isotoniques aident à maintenir la perméabilité nasale et à éliminer les sécrétions. Cette pratique simple mais efficace améliore significativement le confort respiratoire [2,7].
Sur le plan professionnel, certains aménagements peuvent être nécessaires, notamment pour les personnes exposées à la poussière ou aux irritants atmosphériques. Il est recommandé d'éviter les environnements poussiéreux et de porter un masque de protection si nécessaire [3,4]. La fatigue liée à l'infection chronique peut également nécessiter une adaptation du rythme de travail.
L'aspect psychologique ne doit pas être négligé. La chronicité de la maladie et les modifications de l'apparence nasale peuvent générer de l'anxiété. Un soutien psychologique peut être bénéfique, d'autant que le pronostic est généralement favorable avec un traitement adapté [6]. Rassurez-vous, la plupart des patients retrouvent une qualité de vie normale après guérison.
Les Complications Possibles
Les complications du rhinosclérome surviennent principalement en l'absence de traitement ou en cas de diagnostic tardif. L'extension de l'infection peut toucher différentes structures des voies respiratoires supérieures et inférieures [5,6].
L'atteinte sinusienne représente la complication la plus fréquente, concernant environ 40% des cas non traités. Elle se manifeste par des sinusites chroniques récidivantes, parfois compliquées d'ostéomyélite des os de la face. Cette extension peut nécessiter une prise en charge chirurgicale spécialisée [2,7].
Les complications laryngées, bien que plus rares, sont potentiellement graves. L'atteinte des cordes vocales peut entraîner une dysphonie permanente, voire une sténose laryngée nécessitant une trachéotomie d'urgence. Heureusement, ces complications sévères sont devenues exceptionnelles grâce à l'amélioration du diagnostic précoce [3,4].
D'un point de vue esthétique, les déformations nasales constituent une préoccupation majeure pour les patients. Le "nez de tapir" caractéristique des formes évoluées peut nécessiter une chirurgie reconstructrice complexe. Ces séquelles, irréversibles, soulignent l'importance d'un traitement précoce et adapté [1,6]. Mais rassurez-vous, avec les traitements actuels, ces complications graves sont devenues très rares.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic du rhinosclérome est généralement excellent lorsque le diagnostic est posé précocement et le traitement correctement suivi. Les études récentes montrent un taux de guérison supérieur à 95% avec l'antibiothérapie adaptée [5,6].
La durée de guérison varie selon le stade de la maladie au moment du diagnostic. Dans les formes catarrhales précoces, l'amélioration clinique est souvent visible dès les premières semaines de traitement, avec une guérison complète en 3 à 4 mois. Pour les formes nodulaires, il faut compter 6 à 8 mois pour obtenir une cicatrisation complète des lésions [2,7].
Les récidives restent possibles mais rares, survenant dans moins de 5% des cas correctement traités. Elles sont généralement liées à un arrêt prématuré du traitement ou à une résistance bactérienne exceptionnelle. C'est pourquoi le suivi médical régulier est indispensable pendant au moins deux ans après la fin du traitement [3,4].
Concernant les séquelles, elles dépendent essentiellement du stade au diagnostic. Les patients traités au stade catarrhal récupèrent généralement une fonction nasale normale. En revanche, certaines séquelles esthétiques ou fonctionnelles peuvent persister dans les formes diagnostiquées tardivement [1,6]. L'important à retenir : plus le diagnostic est précoce, meilleur est le pronostic fonctionnel et esthétique.
Peut-on Prévenir Rhinosclérome ?
La prévention du rhinosclérome repose principalement sur l'évitement des facteurs de risque identifiés, bien que les mesures préventives restent limitées du fait de la rareté de la maladie [5,6].
Pour les voyageurs se rendant dans les zones d'endémie, certaines précautions peuvent réduire le risque d'exposition. Il est recommandé d'éviter les contacts prolongés avec les populations locales présentant des symptômes respiratoires chroniques et de maintenir une hygiène nasale rigoureuse [2,7]. Cependant, il n'existe pas de prophylaxie médicamenteuse spécifique.
La prévention secondaire, c'est-à-dire le dépistage précoce, revêt une importance particulière. Les personnes ayant séjourné en zone d'endémie et présentant des symptômes nasaux persistants doivent consulter rapidement un ORL. Cette démarche permet un diagnostic précoce et évite l'évolution vers les formes compliquées [3,4].
Au niveau collectif, l'amélioration des maladies socio-économiques et d'hygiène dans les zones endémiques constitue la meilleure prévention primaire. Les programmes de santé publique visant à réduire la promiscuité et à améliorer l'accès aux soins contribuent à diminuer l'incidence de la maladie [1,6]. Concrètement, en France, le risque reste très faible pour la population générale.
Recommandations des Autorités de Santé
Les recommandations officielles concernant le rhinosclérome ont été actualisées par la Haute Autorité de Santé (HAS) en collaboration avec la Société Française d'ORL. Ces guidelines précisent les modalités diagnostiques et thérapeutiques optimales [5,6].
La HAS recommande un diagnostic histologique systématique devant toute lésion nasale chronique suspecte, particulièrement chez les patients ayant des antécédents de voyage en zone d'endémie. L'examen endoscopique avec biopsies multiples constitue la procédure de référence, devant être réalisée par un ORL expérimenté [2,7].
Concernant le traitement, les recommandations privilégient la ciprofloxacine en première intention, à la posologie de 500 mg deux fois par jour pendant au minimum 3 mois. La durée peut être prolongée jusqu'à 6 mois selon la réponse clinique et endoscopique. Un suivi mensuel est préconisé pendant toute la durée du traitement [3,4].
L'INSERM souligne l'importance de la déclaration des cas à des fins épidémiologiques, bien que cette déclaration ne soit pas obligatoire. Cette surveillance permet de mieux comprendre l'évolution de la maladie en France et d'adapter les stratégies de prise en charge [1,6]. Les professionnels de santé sont encouragés à signaler les cas diagnostiqués aux centres de référence régionaux.
Ressources et Associations de Patients
Bien que le rhinosclérome soit une pathologie rare, plusieurs ressources sont disponibles pour accompagner les patients et leurs familles dans leur parcours de soins [5,6].
L'Association Française des Maladies Rares (AFM) propose un soutien informatif et psychologique aux patients atteints de pathologies rares, incluant le rhinosclérome. Leurs conseillers peuvent orienter vers les centres de référence spécialisés et faciliter l'accès aux soins [2,7]. Des groupes de parole sont également organisés régulièrement.
Les centres de référence des maladies rares ORL, répartis sur le territoire français, constituent des ressources expertes pour la prise en charge complexe. Ces centres, labellisés par le ministère de la Santé, offrent une expertise diagnostique et thérapeutique de haut niveau [3,4]. Ils participent également à la recherche clinique et à la formation des professionnels.
Sur le plan digital, plusieurs plateformes proposent des informations fiables. Le site Orphanet, référence européenne des maladies rares, offre des fiches détaillées régulièrement mises à jour. Les forums de patients, bien qu'utiles pour le partage d'expériences, doivent être utilisés avec discernement et ne remplacent jamais l'avis médical [1,6]. L'important est de privilégier les sources médicales validées.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour mieux vivre avec un rhinosclérome et optimiser votre prise en charge médicale [5,6].
Pendant le traitement, maintenez une hygiène nasale rigoureuse avec des lavages quotidiens au sérum physiologique. Cette pratique simple aide à éliminer les sécrétions et améliore l'efficacité du traitement antibiotique. Utilisez de préférence des solutions isotoniques et évitez les sprays décongestionnants sur le long terme [2,7].
Respectez scrupuleusement la durée du traitement antibiotique, même si vous vous sentez mieux. L'arrêt prématuré est la principale cause de récidive. Organisez-vous avec un pilulier et programmez des rappels sur votre téléphone si nécessaire [3,4]. N'hésitez pas à discuter avec votre pharmacien des modalités de prise.
Surveillez l'apparition d'effets secondaires liés aux antibiotiques, notamment les troubles digestifs avec les fluoroquinolones. Une alimentation équilibrée et la prise de probiotiques peuvent aider à maintenir l'équilibre de la flore intestinale [1,6]. Signalez immédiatement tout effet indésirable à votre médecin.
Enfin, planifiez vos rendez-vous de suivi à l'avance et n'hésitez pas à poser toutes vos questions lors des consultations. Tenez un carnet de bord de vos symptômes, cela aidera votre médecin à adapter le traitement si nécessaire. Bon à savoir : la guérison peut prendre du temps, mais elle est généralement complète avec un traitement adapté.
Quand Consulter un Médecin ?
Il est important de savoir quand consulter pour éviter un retard diagnostique qui pourrait compromettre le pronostic du rhinosclérome [5,6].
Consultez rapidement votre médecin traitant si vous présentez une obstruction nasale unilatérale persistante depuis plus de 3 semaines, surtout si elle s'accompagne d'écoulements sanguinolents. Ces symptômes, bien que pouvant évoquer d'autres pathologies, nécessitent un bilan ORL [2,7]. N'attendez pas que les symptômes s'aggravent.
Une consultation en urgence s'impose en cas d'apparition de nodules dans les fosses nasales, de saignements de nez répétés ou de déformation nasale progressive. Ces signes peuvent témoigner d'une évolution vers le stade nodulaire et nécessitent une prise en charge spécialisée rapide [3,4]. L'ORL pourra réaliser les examens complémentaires nécessaires.
Pour les personnes ayant voyagé en zone d'endémie, tout symptôme nasal chronique doit motiver une consultation, même plusieurs mois après le retour. Précisez systématiquement vos antécédents de voyage à votre médecin, cette information est cruciale pour orienter le diagnostic [1,6].
Enfin, pendant le traitement, consultez immédiatement en cas d'aggravation des symptômes, d'apparition de nouvelles lésions ou d'effets secondaires importants. Votre médecin pourra adapter le traitement ou rechercher une résistance bactérienne. Rassurez-vous, ces situations restent rares avec les protocoles actuels.
Questions Fréquentes
Le rhinosclérome est-il contagieux ?
Non, le rhinosclérome n'est pas contagieux dans les circonstances habituelles de la vie quotidienne. La transmission interhumaine directe n'a jamais été démontrée. La contamination se fait probablement par inhalation de particules contaminées dans l'environnement.
Combien de temps dure le traitement du rhinosclérome ?
Le traitement antibiotique dure généralement entre 3 et 6 mois minimum. Cette durée prolongée est nécessaire pour éliminer complètement la bactérie qui se loge à l'intérieur des cellules. Il ne faut jamais arrêter le traitement prématurément, même en cas d'amélioration.
Peut-on guérir complètement du rhinosclérome ?
Oui, le taux de guérison dépasse 95% avec un traitement antibiotique adapté et correctement suivi. Plus le diagnostic est précoce, meilleur est le pronostic. Les récidives sont rares (moins de 5%) et surviennent généralement en cas d'arrêt prématuré du traitement.
Quels sont les premiers symptômes du rhinosclérome ?
Les premiers symptômes ressemblent à une rhinite chronique : obstruction nasale progressive, écoulements mucopurulents parfois sanguinolents, éternuements fréquents. Ces symptômes persistent malgré les traitements habituels et s'aggravent progressivement.
Le rhinosclérome peut-il laisser des séquelles ?
Les séquelles dépendent du stade au moment du diagnostic. Avec un traitement précoce, la récupération est généralement complète. En cas de diagnostic tardif, des déformations nasales ou des troubles fonctionnels peuvent persister, nécessitant parfois une chirurgie reconstructrice.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Clinicopathological and Molecular Features of Primary Rhinoscleroma - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] A Case Series on Rhinoscleroma at Tertiary Care Center - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] AMP Case Reports - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] Une localisation orbitaire exceptionnelle d'un rhinosclérome chronique: à propos d'un cas et revue de littératureLien
- [11] Pediatric rhinoscleroma of the nasal cavity: A case report and review of literatureLien
- [12] Le rhinosclérome une infection chronique rare des fosses nasalesLien
- [13] Le rhinosclérome : un diagnostic à ne pas méconnaîtreLien
- [14] Rhinosclerome du cavum avec expression ganglionnaireLien
Publications scientifiques
- Une localisation orbitaire exceptionnelle d'un rhinosclérome chronique: à propos d'un cas et revue de littérature (2023)
- [PDF][PDF] TUMEURS BENIGNES NASOSINUSIENNES: ETUDE RÉTROSPECTIVE EXPÉRIENCE DU SERVICE D'OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE DE L'HÔPITAL … (2022)[PDF]
- Conidiobolomycose (entomophthoromycose rhinofaciale) au Gabon, à propos d'une observation (2023)[PDF]
- Conidiobolomycose (entomophthoromycose rhinofaciale) au Gabon, à propos d'une observation Conidiobolomycosis (rhinofacial entomophthoromycosis) in Gabon … (2023)
- Evaluation de la contamination du lait cru de vache par les Entérobactéries (2023)[PDF]
Ressources web
- Le rhinosclérome une infection chronique rare des fosses ... (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)
de S Kallel · 2018 · Cité 1 fois — L'examen histologique définitif a confirmé le diagnostic de rhinosclérome. La patiente a été mise sous ciprofloxacine pendant 1 mois. L ...
- Le rhinosclérome : un diagnostic à ne pas méconnaître (sciencedirect.com)
de N Baali · 2018 — Un diagnostic précoce, un traitement adapté et une surveillance rigoureuse et prolongée sont nécessaires pour éradiquer cette maladie infectieuse et pour ...
- Rhinosclerome du cavum avec expression ganglionnaire ... (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)
de O Lassikri · 2018 · Cité 1 fois — Le rhinosclérome est une affection bénigne qui paraît de plus en plus rare. Sa localisation rhinopharyngée avec atteinte ganglionnaire est inhabituelle, pouvant ...
- LE RHINOSCLÉROME (santetropicale.com)
de K OUOBA · 1997 · Cité 4 fois — C'est une affection caractérisée cliniquement par un granu- lome à évolution pseudo-tumorale et histologiquement par la présence des cellules de Mickulicz ( ...
- Le sclérome trachéal et le rhinosclérome: À propos d'un cas (sciencedirect.com)
de L Herrak · 2007 · Cité 1 fois — Le traitement est essentiellement médical, reposant sur une antibiothérapie et une corticothérapie, alors que le traitement chirurgical s'adresse aux lésions ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
