Résistance à la Maladie : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
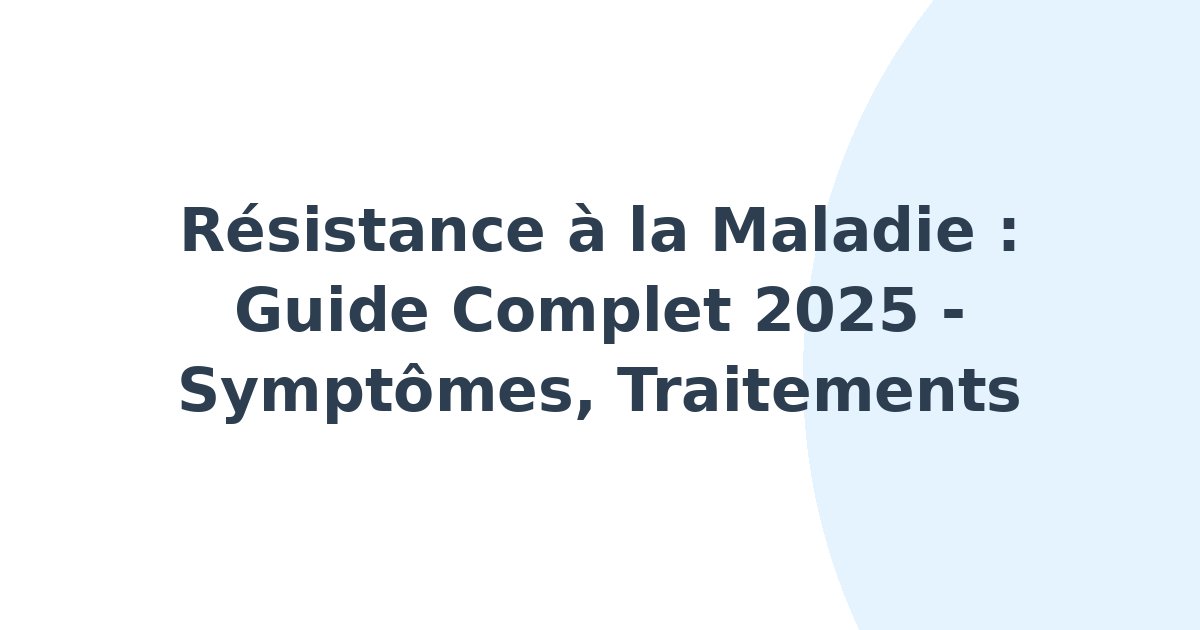
La résistance à la maladie représente un défi majeur de santé publique qui touche des millions de personnes en France. Cette pathologie complexe, caractérisée par la capacité réduite de l'organisme à lutter contre les infections et maladies, nécessite une prise en charge adaptée. Découvrez dans ce guide complet les dernières avancées thérapeutiques 2025 et les stratégies pour mieux vivre avec cette pathologie.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Résistance à la maladie : Définition et Vue d'Ensemble
La résistance à la maladie désigne la capacité naturelle ou acquise d'un organisme à résister aux agents pathogènes et aux maladies. Mais cette définition cache une réalité bien plus complexe que vous pourriez l'imaginer.
Concrètement, il s'agit d'un ensemble de mécanismes biologiques qui permettent à votre corps de se défendre contre les infections bactériennes, virales, fongiques ou parasitaires [16]. Cette résistance peut être innée, c'est-à-dire présente dès la naissance, ou acquise au cours de la vie par exposition aux pathogènes ou par vaccination.
D'ailleurs, la résistance aux antimicrobiens constitue aujourd'hui l'une des principales préoccupations de santé publique mondiale [3]. En effet, lorsque cette résistance fait défaut ou devient insuffisante, l'organisme devient vulnérable à des infections qui pourraient normalement être contrôlées.
Il faut savoir que cette pathologie peut se manifester de différentes manières. Certaines personnes présentent une susceptibilité accrue aux infections récurrentes, tandis que d'autres développent des formes sévères de maladies habituellement bénignes. L'important à retenir, c'est que chaque cas est unique et nécessite une approche personnalisée [17].
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques françaises révèlent une situation préoccupante concernant la résistance aux maladies infectieuses. Selon Santé Publique France, la surveillance de la résistance bactérienne aux antibiotiques montre une augmentation constante depuis 2020 [1].
En France, on estime que près de 125 000 infections résistantes aux antibiotiques surviennent chaque année, causant environ 5 500 décès [1,2]. Ces chiffres placent notre pays dans une situation intermédiaire par rapport aux autres nations européennes. D'ailleurs, la consommation d'antibiotiques en établissements de santé a évolué de manière significative entre 2022 et 2023 [2].
Mais les données varient considérablement selon les régions françaises. Les départements d'outre-mer présentent des taux de résistance particulièrement élevés, notamment pour certaines bactéries comme le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline [1]. Cette disparité s'explique par des facteurs socio-économiques, climatiques et d'accès aux soins.
Au niveau mondial, l'Organisation mondiale de la santé estime que la résistance antimicrobienne pourrait causer 10 millions de décès par an d'ici 2050 si aucune action n'est entreprise [3]. L'Afrique subsaharienne présente des taux particulièrement alarmants, avec une prévalence de résistance pouvant atteindre 80% pour certains antibiotiques [13].
Concernant les projections futures, les modèles épidémiologiques suggèrent une augmentation de 15 à 20% des cas de résistance d'ici 2030 en France, principalement due au vieillissement de la population et à l'usage inapproprié des antimicrobiens [1,3].
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes de la résistance à la maladie sont multifactorielles et souvent interconnectées. L'usage inapproprié des antibiotiques constitue le principal facteur de développement de résistances bactériennes [1,16].
Parmi les facteurs de risque majeurs, on retrouve l'âge avancé, les maladies chroniques comme le diabète ou l'insuffisance rénale, et les traitements immunosuppresseurs [14]. En effet, ces pathologies affaiblissent le système immunitaire et favorisent le développement de résistances.
D'un autre côté, certains facteurs génétiques prédisposent à une susceptibilité accrue aux infections. Les recherches récentes ont identifié des gènes candidats impliqués dans la résistance quantitative à diverses pathologies [8]. Ces découvertes ouvrent de nouvelles perspectives pour la médecine personnalisée.
Il faut également considérer les facteurs environnementaux et comportementaux. L'exposition répétée aux agents pathogènes, les maladies d'hygiène précaires, et le stress chronique peuvent tous contribuer à affaiblir les défenses naturelles de l'organisme [9].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Reconnaître les signes d'une résistance à la maladie peut s'avérer délicat car les symptômes varient considérablement d'une personne à l'autre. Néanmoins, certains signaux d'alarme doivent vous alerter.
Les infections récurrentes constituent le symptôme le plus caractéristique. Si vous développez fréquemment des infections respiratoires, urinaires ou cutanées, cela peut indiquer une défaillance de vos mécanismes de défense [17]. Ces infections ont tendance à être plus sévères et plus longues à guérir que la normale.
D'ailleurs, la fatigue chronique et inexpliquée représente souvent un signe précoce. Votre organisme, constamment sollicité pour lutter contre les pathogènes, s'épuise progressivement. Cette fatigue s'accompagne généralement de troubles du sommeil et d'une diminution des performances physiques et intellectuelles.
Bon à savoir : les symptômes peuvent également inclure une cicatrisation lente des plaies, des épisodes fébriles fréquents sans cause apparente, et une sensibilité accrue aux changements de température [16,17]. Certains patients rapportent aussi des troubles digestifs récurrents et une perte de poids inexpliquée.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de la résistance à la maladie nécessite une approche méthodique et souvent multidisciplinaire. Votre médecin commencera par un interrogatoire détaillé sur vos antécédents médicaux et familiaux [17].
La première étape consiste en un bilan biologique complet. Celui-ci inclut une numération formule sanguine, un dosage des protéines inflammatoires, et une évaluation de votre statut immunitaire. Ces examens permettent d'identifier d'éventuelles anomalies dans vos défenses naturelles.
Ensuite, des tests de sensibilité aux antimicrobiens peuvent être réalisés. Ces antibiogrammes déterminent quels antibiotiques restent efficaces contre les bactéries présentes dans votre organisme [1,2]. Cette étape est cruciale pour adapter le traitement.
Dans certains cas, des examens plus spécialisés sont nécessaires. L'analyse génétique peut révéler des prédispositions héréditaires à la résistance [8]. De même, l'évaluation de votre microbiote intestinal aide à comprendre l'équilibre de votre flore bactérienne [12].
Il est important de noter que le diagnostic peut prendre plusieurs semaines. Chaque étape apporte des informations complémentaires qui permettent d'affiner la prise en charge thérapeutique.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge de la résistance à la maladie repose sur une approche personnalisée qui combine plusieurs stratégies thérapeutiques. Le choix du traitement dépend de la cause sous-jacente et de la sévérité de votre pathologie.
Les antibiotiques de dernière génération constituent souvent la première ligne de traitement pour les infections résistantes. Cependant, leur utilisation doit être rigoureusement encadrée pour éviter l'émergence de nouvelles résistances [1,2]. Votre médecin s'appuiera sur les résultats de l'antibiogramme pour sélectionner la molécule la plus appropriée.
Parallèlement, les immunomodulateurs peuvent être prescrits pour renforcer vos défenses naturelles. Ces médicaments agissent en stimulant certaines composantes de votre système immunitaire, améliorant ainsi votre capacité à lutter contre les infections [17].
D'ailleurs, les probiotiques et postbiotiques montrent des résultats prometteurs dans la restauration de l'équilibre du microbiote [12]. Ces traitements adjuvants aident à reconstituer une flore bactérienne protectrice, particulièrement après des traitements antibiotiques intensifs.
Concrètement, votre traitement pourra également inclure des mesures de soutien : supplémentation vitaminique, correction des carences nutritionnelles, et prise en charge des pathologies associées comme le diabète ou l'insuffisance rénale [14].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la prise en charge de la résistance à la maladie avec l'émergence de thérapies révolutionnaires. Les centres de recherche français, notamment Gustave Roussy, développent des approches innovantes qui transforment le paysage thérapeutique [4].
Les anticorps conjugués représentent l'une des avancées les plus prometteuses. La Commission européenne a récemment approuvé un régime quadruple à base de daratumumab sous-cutané pour le traitement de patients nouvellement diagnostiqués [5,7]. Cette innovation permet une administration plus simple et une meilleure tolérance.
Par ailleurs, les recherches sur les anticorps ciblant B7-H3 ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques [6]. Ces molécules innovantes montrent une efficacité remarquable dans le traitement de certaines formes de résistance, avec des taux de réponse supérieurs aux traitements conventionnels.
Mais ce qui révolutionne vraiment la prise en charge, c'est l'approche de médecine personnalisée basée sur l'analyse génétique. Les travaux récents sur l'identification de gènes candidats dans la résistance permettent désormais de prédire la réponse aux traitements [8]. Cette approche sur mesure améliore considérablement les chances de succès thérapeutique.
Heureusement, ces innovations ne restent pas confinées aux laboratoires. Plusieurs de ces traitements sont déjà disponibles dans les centres hospitaliers universitaires français, offrant de nouveaux espoirs aux patients les plus sévèrement atteints.
Vivre au Quotidien avec Résistance à la Maladie
Vivre avec une résistance à la maladie nécessite des adaptations importantes dans votre quotidien, mais rassurez-vous, de nombreuses stratégies peuvent vous aider à maintenir une qualité de vie satisfaisante.
L'hygiène personnelle devient primordiale. Un lavage fréquent des mains, la désinfection régulière des surfaces, et l'évitement des foules pendant les périodes d'épidémie constituent des mesures préventives essentielles [16]. Ces gestes simples réduisent significativement votre exposition aux agents pathogènes.
Votre alimentation joue également un rôle crucial. Une nutrition équilibrée, riche en vitamines et minéraux, soutient votre système immunitaire. L'intégration de probiotiques naturels comme les yaourts fermentés peut contribuer à maintenir un microbiote sain [12].
D'un autre côté, l'exercice physique adapté renforce vos défenses naturelles. Même si certaines maladies musculaires peuvent limiter vos capacités, des activités douces comme la marche ou la natation restent bénéfiques [15]. L'important est de trouver un équilibre entre activité et repos.
Il faut aussi considérer l'impact psychologique de cette pathologie. Le soutien de vos proches, la participation à des groupes de patients, et parfois un accompagnement psychologique peuvent vous aider à mieux gérer l'anxiété liée aux infections récurrentes.
Les Complications Possibles
La résistance à la maladie peut entraîner diverses complications qu'il est important de connaître pour mieux les prévenir et les traiter. Ces complications varient selon la sévérité de votre pathologie et les organes affectés.
Les infections systémiques représentent la complication la plus redoutable. Lorsque les bactéries résistantes pénètrent dans la circulation sanguine, elles peuvent provoquer une septicémie potentiellement mortelle [1,16]. Cette situation nécessite une hospitalisation en urgence et un traitement antibiotique intraveineux intensif.
Au niveau respiratoire, les pneumonies récurrentes peuvent conduire à une insuffisance respiratoire chronique. Ces infections répétées fragilisent le tissu pulmonaire et peuvent nécessiter une oxygénothérapie à long terme [17]. D'ailleurs, certains patients développent des bronchectasies, dilatations anormales des bronches qui favorisent la stagnation des sécrétions.
Les complications rénales ne sont pas rares, particulièrement chez les patients diabétiques. L'association diabète et résistance aux infections peut accélérer l'évolution vers une maladie rénale chronique [14]. Cette progression nécessite un suivi néphrologique régulier et parfois une dialyse.
Enfin, l'impact sur la qualité de vie peut être considérable. La fatigue chronique, les hospitalisations répétées, et l'anxiété liée aux infections peuvent conduire à un isolement social et parfois à une dépression [11].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la résistance à la maladie dépend de nombreux facteurs, mais il faut savoir que les perspectives se sont considérablement améliorées ces dernières années grâce aux avancées thérapeutiques.
Avec une prise en charge précoce et adaptée, la majorité des patients peuvent maintenir une qualité de vie acceptable. Les données récentes montrent que 70 à 80% des personnes suivies régulièrement évitent les complications majeures [1,2]. L'essentiel réside dans l'observance thérapeutique et le respect des mesures préventives.
Cependant, certains facteurs influencent négativement le pronostic. L'âge avancé, la présence de comorbidités comme le diabète ou l'insuffisance cardiaque, et un statut socio-économique défavorable sont associés à une évolution moins favorable [14]. Ces patients nécessitent un suivi renforcé et parfois des hospitalisations plus fréquentes.
Heureusement, les innovations thérapeutiques 2024-2025 transforment le pronostic à long terme. Les nouveaux anticorps conjugués et les approches de médecine personnalisée offrent des perspectives d'amélioration significative, même pour les cas les plus complexes [4,5,6].
Il est important de noter que le concept de résilience joue un rôle crucial dans l'évolution. Certains patients développent des mécanismes d'adaptation qui leur permettent de mieux résister aux infections malgré leur vulnérabilité initiale [11].
Peut-on Prévenir Résistance à la Maladie ?
La prévention de la résistance à la maladie repose sur une approche globale qui combine mesures individuelles et actions de santé publique. Bien que certains facteurs génétiques ne puissent être modifiés, de nombreuses stratégies préventives sont à votre portée.
L'usage rationnel des antibiotiques constitue la pierre angulaire de la prévention. Ne jamais interrompre un traitement antibiotique avant la fin, éviter l'automédication, et respecter scrupuleusement les prescriptions médicales sont des gestes essentiels [1,3]. Cette approche limite l'émergence de nouvelles résistances.
La vaccination joue également un rôle préventif majeur. Maintenir à jour vos vaccinations, notamment contre la grippe, le pneumocoque, et les infections à méningocoques, réduit significativement votre risque d'infections sévères [16]. Ces vaccins sont particulièrement recommandés si vous présentez des facteurs de risque.
D'un point de vue nutritionnel, une alimentation riche en antioxydants et en probiotiques naturels soutient vos défenses immunitaires. L'intégration régulière de fruits, légumes, et aliments fermentés contribue à maintenir un microbiote équilibré [12].
Enfin, la gestion du stress et un sommeil de qualité sont cruciaux. Le stress chronique affaiblit le système immunitaire et favorise la susceptibilité aux infections. Des techniques de relaxation, une activité physique régulière, et un rythme de sommeil stable renforcent vos défenses naturelles [15].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont renforcé leurs recommandations concernant la résistance à la maladie, particulièrement suite aux enseignements de la pandémie COVID-19. Santé Publique France coordonne désormais une surveillance renforcée des résistances antimicrobiennes [1,2].
La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise une approche de médecine personnalisée pour la prise en charge des patients à risque. Cette stratégie inclut l'évaluation systématique du statut immunitaire, la réalisation d'antibiogrammes avant toute antibiothérapie, et l'adaptation des traitements selon les profils de résistance [17].
Au niveau international, la France s'engage activement dans la lutte contre la résistance antimicrobienne. Le gouvernement a renforcé son engagement international avec des investissements significatifs dans la recherche et le développement de nouveaux antimicrobiens [3]. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan national de lutte contre l'antibiorésistance.
Concrètement, les recommandations actuelles incluent la mise en place de programmes de bon usage des antibiotiques dans tous les établissements de santé. Ces programmes visent à réduire de 25% la consommation d'antibiotiques d'ici 2027 [2]. Parallèlement, le renforcement de la surveillance épidémiologique permet un suivi en temps réel de l'évolution des résistances.
Pour les professionnels de santé, la formation continue sur l'antibiothérapie et la prescription raisonnée devient obligatoire. Cette mesure vise à harmoniser les pratiques et à limiter les prescriptions inappropriées qui favorisent l'émergence de résistances [1,3].
Ressources et Associations de Patients
De nombreuses ressources sont disponibles pour vous accompagner dans votre parcours avec la résistance à la maladie. Ces structures offrent information, soutien et entraide entre patients.
L'Institut Pasteur propose des fiches d'information détaillées sur la résistance aux antibiotiques et les maladies infectieuses [16,18]. Ces ressources, régulièrement mises à jour, constituent une source fiable d'information médicale accessible au grand public.
Au niveau associatif, plusieurs organisations se spécialisent dans l'accompagnement des patients immunodéprimés. Ces associations organisent des groupes de parole, des conférences d'information, et proposent un soutien psychologique adapté. Elles jouent également un rôle de plaidoyer auprès des autorités sanitaires.
Les centres de référence maladies rares, présents dans les CHU, constituent des ressources expertes pour les formes complexes de résistance à la maladie. Ces centres proposent des consultations spécialisées, des bilans approfondis, et coordonnent la prise en charge multidisciplinaire.
D'ailleurs, les plateformes numériques de santé se développent rapidement. Certaines applications mobiles permettent de suivre vos symptômes, de gérer vos traitements, et de communiquer avec votre équipe soignante. Ces outils facilitent le suivi à domicile et l'observance thérapeutique.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour mieux vivre au quotidien avec une résistance à la maladie. Ces recommandations, issues de l'expérience clinique et des témoignages de patients, peuvent considérablement améliorer votre qualité de vie.
Tenez un carnet de santé détaillé. Notez vos symptômes, les traitements pris, et leur efficacité. Cette information sera précieuse lors de vos consultations médicales et permettra d'adapter plus rapidement votre prise en charge [17].
Organisez votre environnement domestique. Désinfectez régulièrement les surfaces, aérez quotidiennement votre logement, et maintenez une température stable. Ces mesures simples réduisent la charge microbienne de votre environnement [16].
Planifiez vos sorties en fonction des périodes d'épidémie. Évitez les lieux bondés pendant les pics de grippe ou de gastro-entérite. Privilégiez les activités en extérieur quand c'est possible, l'air libre étant moins chargé en agents pathogènes.
Constituez une trousse de premiers secours adaptée. Incluez un thermomètre, des solutions hydroalcooliques, des masques chirurgicaux, et les médicaments prescrits par votre médecin. Cette préparation vous permet de réagir rapidement en cas de symptômes.
Enfin, maintenez un réseau social actif malgré les contraintes. Les relations sociales, même adaptées, sont essentielles pour votre bien-être psychologique. N'hésitez pas à expliquer votre situation à vos proches pour qu'ils comprennent vos précautions.
Quand Consulter un Médecin ?
Savoir quand consulter un médecin est crucial lorsque vous vivez avec une résistance à la maladie. Certains signaux d'alarme nécessitent une consultation en urgence, tandis que d'autres justifient un rendez-vous programmé.
Consultez immédiatement si vous présentez une fièvre élevée (supérieure à 38,5°C) persistante, des frissons intenses, ou des difficultés respiratoires. Ces symptômes peuvent indiquer une infection systémique nécessitant un traitement antibiotique urgent [16,17].
D'autres signes doivent vous alerter : vomissements répétés empêchant l'hydratation, douleurs abdominales intenses, ou modification brutale de votre état général. Dans ces situations, n'hésitez pas à vous rendre aux urgences ou à contacter le 15.
Pour un suivi programmé, consultez votre médecin traitant si vous observez une augmentation de la fréquence de vos infections, une fatigue inhabituelle persistant plus d'une semaine, ou l'apparition de nouveaux symptômes. Ces éléments peuvent nécessiter un ajustement de votre traitement [17].
Il est également important de maintenir un suivi régulier avec votre spécialiste, même en l'absence de symptômes. Ces consultations permettent d'évaluer l'efficacité de votre traitement, de dépister précocement d'éventuelles complications, et d'adapter votre prise en charge aux évolutions thérapeutiques récentes [1,2].
N'oubliez pas que votre pharmacien peut également vous conseiller pour des symptômes mineurs et vous orienter vers une consultation médicale si nécessaire.
Questions Fréquentes
La résistance à la maladie est-elle héréditaire ?Partiellement. Certains facteurs génétiques prédisposent à une susceptibilité accrue aux infections, mais l'environnement et le mode de vie jouent également un rôle majeur [8,9].
Peut-on guérir complètement de cette pathologie ?
La guérison dépend de la cause sous-jacente. Certaines formes acquises peuvent être améliorées significativement, tandis que les formes génétiques nécessitent une prise en charge à vie [11,17].
Les probiotiques sont-ils vraiment efficaces ?
Les études récentes montrent un intérêt des probiotiques et postbiotiques dans la restauration de l'équilibre du microbiote, particulièrement après des traitements antibiotiques [12].
Quels sont les nouveaux traitements disponibles en 2025 ?
Les anticorps conjugués, notamment le daratumumab sous-cutané, et les thérapies ciblant B7-H3 représentent les principales innovations thérapeutiques [4,5,6,7].
Comment éviter la transmission aux proches ?
Les mesures d'hygiène standard (lavage des mains, port du masque en cas de symptômes) suffisent généralement. La résistance elle-même n'est pas contagieuse, seules les infections peuvent l'être [16].
Questions Fréquentes
La résistance à la maladie est-elle héréditaire ?
Partiellement. Certains facteurs génétiques prédisposent à une susceptibilité accrue aux infections, mais l'environnement et le mode de vie jouent également un rôle majeur.
Peut-on guérir complètement de cette pathologie ?
La guérison dépend de la cause sous-jacente. Certaines formes acquises peuvent être améliorées significativement, tandis que les formes génétiques nécessitent une prise en charge à vie.
Les probiotiques sont-ils vraiment efficaces ?
Les études récentes montrent un intérêt des probiotiques et postbiotiques dans la restauration de l'équilibre du microbiote, particulièrement après des traitements antibiotiques.
Quels sont les nouveaux traitements disponibles en 2025 ?
Les anticorps conjugués, notamment le daratumumab sous-cutané, et les thérapies ciblant B7-H3 représentent les principales innovations thérapeutiques.
Comment éviter la transmission aux proches ?
Les mesures d'hygiène standard (lavage des mains, port du masque en cas de symptômes) suffisent généralement. La résistance elle-même n'est pas contagieuse, seules les infections peuvent l'être.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Surveillance de la résistance bactérienne aux antibiotiques en soins de ville et en établissements pour personnes âgées dépendantesLien
- [2] Surveillance de la consommation des antibiotiques et des résistances bactériennes en établissement de santéLien
- [3] Résistance aux antimicrobiens : la France renforce son engagement internationalLien
- [4] Innovation thérapeutique Gustave Roussy 2024-2025Lien
- [5] European Commission approves Johnson & Johnson's subcutaneous DARZALEX® (daratumumab) based quadruplet regimenLien
- [6] Clinical progress of B7-H3 targeted antibody drug conjugatesLien
- [7] Daratumumab Combo Earns EU Approval in Newly Diagnosed Multiple MyelomaLien
- [8] Identification de gènes candidats dans la résistance quantitative du rosier à la maladie des taches noiresLien
- [9] Une expérience de sélection pour la résistance non-spécifique aux maladiesLien
- [10] De la dysfonction du tissu adipeux à l'adiposité viscérale et à la stéatopathie métabolique, les chemins de l'insulino-résistanceLien
- [11] Réserve, maintien, résistance et résilience au cours du vieillissementLien
- [12] Intérêt des probiotiques et des postbiotiques dans les maladies métaboliquesLien
- [13] État des lieux de la résistance aux antibiotiques en Afrique subsaharienneLien
- [14] Maladie rénale chronique et diabète de type 2. Histologie, pathogénie et stades évolutifsLien
- [15] Effets de l'exercice physique sur les maladies musculairesLien
- [16] Résistance aux antibiotiques : symptômes, traitementLien
- [17] Diagnostic d'une maladie infectieuseLien
- [18] Nos fiches maladiesLien
Publications scientifiques
- Identification de gènes candidats dans la résistance quantitative du rosier à la maladie des taches noires causée par le champignon Diplocarpon rosae (2024)
- Une experience de selection pour la résistance non-spécifique aux maladies (2023)1 citations
- … la triglycéridémie: impact métabolique. De la dysfonction du tissu adipeux à l'adiposité viscérale et à la stéatopathie métabolique, les chemins de l'insulino-résistance (2022)1 citations
- Réserve, maintien, résistance et résilience au cours du vieillissement (2022)1 citations
- Intérêt des probiotiques et des postbiotiques dans les maladies métaboliques (2024)1 citations
Ressources web
- Résistance aux antibiotiques : symptômes, traitement ... (pasteur.fr)
Retrouvez toutes les informations sur la résistance aux antibiotiques : transmission, causes, symptômes, diagnostic, traitement, prévention, épidémiologie.
- Diagnostic d'une maladie infectieuse - Infections (msdmanuals.com)
Parfois, des tests génétiques peuvent être utilisés pour détecter les gènes du micro-organisme responsables de la résistance à certains médicaments ...
- Nos fiches maladies (pasteur.fr)
Les bactéries peuvent devenir insensibles à ces drogues : on parle alors de résistance aux antibiotiques et de bactéries résistantes.
- Maladies - symptômes, diagnostic, traitements, prévention (vidal.fr)
Maladies : fièvre, hyperactivité, digestion difficile, acouphènes, etc. VIDAL vous propose une information validée sur plus de 200 pathologies.
- Diagnostic, traitement et évolution de la mononucléose ... (ameli.fr)
Le diagnostic de la mononucléose infectieuse est réalisé par le médecin traitant. Aucun traitement particulier n'est prescrit pour cette maladie virale.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
