Pyélite : Symptômes, Causes et Traitements - Guide Complet 2025
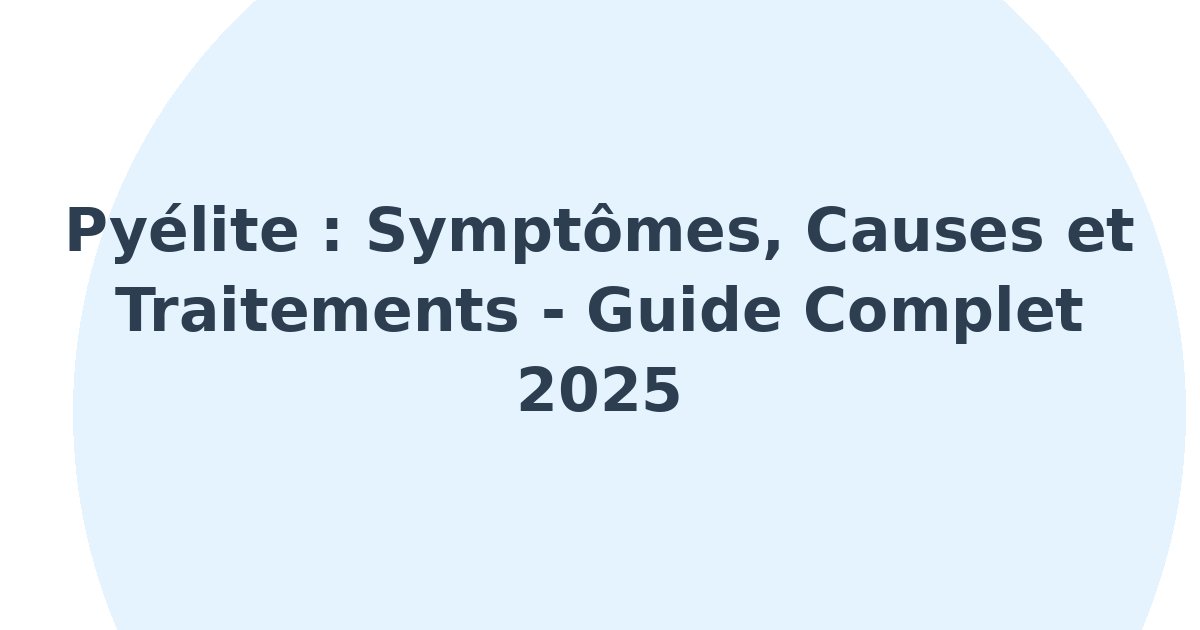
La pyélite, inflammation du bassinet rénal, touche principalement les femmes et peut évoluer vers une pyélonéphrite si elle n'est pas traitée rapidement. Cette pathologie urinaire, souvent confondue avec une simple cystite, nécessite une prise en charge médicale spécialisée pour éviter les complications rénales graves.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Pyélite : Définition et Vue d'Ensemble
La pyélite désigne une inflammation du bassinet rénal, cette cavité située au centre du rein qui collecte l'urine avant qu'elle ne s'évacue vers l'uretère. Contrairement à la pyélonéphrite qui affecte également le parenchyme rénal, la pyélite se limite initialement au système collecteur [1,2].
Cette pathologie représente souvent le stade précoce d'une infection rénale ascendante. En effet, les bactéries remontent depuis la vessie via l'uretère pour atteindre le bassinet. Sans traitement approprié, l'infection peut s'étendre au tissu rénal lui-même, évoluant alors vers une pyélonéphrite aiguë [1].
Il est important de comprendre que la pyélite n'est pas une maladie bénigne. Bien qu'elle puisse sembler moins grave qu'une pyélonéphrite, elle nécessite une surveillance médicale étroite. D'ailleurs, les symptômes peuvent être trompeurs et ressembler à ceux d'une infection urinaire basse classique [2].
La distinction entre pyélite et pyélonéphrite repose principalement sur l'imagerie médicale et l'évolution clinique. Cependant, dans la pratique courante, ces deux termes sont souvent utilisés de manière interchangeable par les professionnels de santé [14,15].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, les infections du haut appareil urinaire, incluant la pyélite, touchent environ 250 000 personnes chaque année selon l'Assurance Maladie [1]. Cette incidence représente une augmentation de 15% par rapport aux données de 2019, probablement liée à l'amélioration du diagnostic et au vieillissement de la population.
Les femmes sont particulièrement concernées, avec un ratio de 5 femmes pour 1 homme. Cette prédominance féminine s'explique par l'anatomie : l'urètre féminin, plus court, facilite la remontée bactérienne [1,2]. L'âge moyen de survenue se situe entre 25 et 65 ans, avec deux pics de fréquence : chez les femmes jeunes sexuellement actives et après 50 ans [13].
Au niveau européen, la France présente des taux similaires à l'Allemagne et à l'Italie, mais légèrement supérieurs aux pays nordiques. Cette différence pourrait s'expliquer par des facteurs génétiques et environnementaux encore mal compris [10,12].
Les projections épidémiologiques pour 2025-2030 suggèrent une stabilisation de l'incidence chez les jeunes adultes, mais une augmentation chez les personnes âgées de plus de 70 ans. Cette évolution s'explique par l'allongement de l'espérance de vie et l'augmentation des facteurs de risque liés à l'âge [1].
L'impact économique sur le système de santé français est estimé à 180 millions d'euros annuels, incluant les hospitalisations, les traitements ambulatoires et les arrêts de travail. Ce coût a augmenté de 12% depuis 2020, principalement en raison de l'émergence de résistances bactériennes nécessitant des traitements plus longs [12,13].
Les Causes et Facteurs de Risque
La principale cause de pyélite reste l'infection bactérienne ascendante. Escherichia coli représente 80% des cas, suivie par Klebsiella pneumoniae et Enterococcus faecalis [10,11]. Ces bactéries, normalement présentes dans l'intestin, migrent vers l'appareil urinaire par voie périnéale.
Plusieurs facteurs favorisent cette migration bactérienne. Chez la femme, les rapports sexuels constituent un facteur de risque majeur, particulièrement en l'absence de miction post-coïtale [1,2]. La grossesse multiplie par 6 le risque d'infection rénale en raison des modifications anatomiques et hormonales [10].
Les anomalies anatomiques prédisposent également à la pyélite. Un reflux vésico-urétéral, des calculs rénaux ou une sténose urétérale créent des maladies favorables à la stagnation urinaire et à la prolifération bactérienne [14,15]. D'ailleurs, toute obstruction des voies urinaires doit être recherchée systématiquement [7].
Certaines pathologies augmentent significativement le risque. Le diabète, en modifiant la composition urinaire, favorise les infections récidivantes [11,12]. L'immunodépression, qu'elle soit médicamenteuse ou pathologique, constitue également un facteur de risque important, comme l'illustrent les cas de pyélite sur greffon rénal [6].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de la pyélite peuvent être trompeurs et varier considérablement d'une personne à l'autre. La fièvre constitue le signe d'alarme principal, souvent supérieure à 38,5°C et accompagnée de frissons [1,2]. Contrairement à une simple cystite, cette fièvre témoigne de l'atteinte du haut appareil urinaire.
La douleur lombaire représente le deuxième symptôme caractéristique. Elle siège typiquement dans la fosse lombaire, du côté du rein atteint, et peut irradier vers l'abdomen ou les organes génitaux [2,14]. Cette douleur s'intensifie souvent lors des mouvements ou de la palpation de la région rénale.
Les signes urinaires accompagnent généralement les symptômes précédents. Brûlures mictionnelles, envies fréquentes d'uriner et parfois hématurie (sang dans les urines) peuvent être présents [1,15]. Cependant, il faut savoir que ces symptômes peuvent être absents dans 20% des cas, particulièrement chez les personnes âgées.
Chez certains patients, les symptômes peuvent être plus subtils. Fatigue inexpliquée, nausées ou vomissements, troubles digestifs peuvent être les seules manifestations, rendant le diagnostic plus difficile [2]. C'est pourquoi il est essentiel de consulter rapidement en cas de fièvre associée à des troubles urinaires, même minimes.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de pyélite repose sur une démarche clinique et paraclinique rigoureuse. L'examen clinique débute par la recherche du signe de Giordano : une douleur provoquée par la percussion de la fosse lombaire [2,14]. Ce signe, bien que non spécifique, oriente fortement vers une atteinte rénale.
L'analyse d'urine constitue l'examen de première intention. Elle révèle typiquement une leucocyturie supérieure à 10⁴/ml, parfois associée à une hématurie microscopique [1,2]. L'examen cytobactériologique des urines (ECBU) permet d'identifier le germe responsable et de tester sa sensibilité aux antibiotiques [15].
Les examens biologiques sanguins complètent le bilan. Une élévation des marqueurs inflammatoires (CRP, procalcitonine) confirme le processus infectieux [14]. La créatininémie évalue la fonction rénale, particulièrement importante en cas de pyélite compliquée [2].
L'imagerie médicale s'avère souvent nécessaire. L'échographie rénale recherche des signes de dilatation des cavités pyélocalicielles ou des anomalies anatomiques [15]. En cas de doute diagnostique, la scintigraphie rénale au DMSA peut détecter des lésions précoces, comme l'illustrent les récentes publications sur le diagnostic des pyélonéphrites sur greffon [6].
Les innovations diagnostiques 2024-2025 incluent le développement du modèle ROSIE (Rapid Onset Sepsis Identification in Emergency), qui permet une évaluation prédictive plus précise du risque de complications [3]. Cette approche révolutionnaire améliore significativement la prise en charge précoce des patients.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de la pyélite repose principalement sur l'antibiothérapie, adaptée au germe identifié et à sa sensibilité [1,15]. En première intention, les fluoroquinolones (ciprofloxacine, lévofloxacine) restent les molécules de référence pour leur excellente diffusion rénale [14].
La durée du traitement varie selon la sévérité et le terrain. Pour une pyélite simple, 7 à 10 jours suffisent généralement [1,2]. Cependant, chez les patients immunodéprimés ou en cas de facteurs de complication, la durée peut être prolongée à 14-21 jours [15].
L'hospitalisation devient nécessaire dans certaines situations. Fièvre élevée persistante, vomissements empêchant la prise orale, terrain fragile ou suspicion de complication justifient une prise en charge hospitalière [2,14]. Le traitement intraveineux permet alors une action plus rapide et plus efficace.
Les traitements symptomatiques accompagnent l'antibiothérapie. Antalgiques et antipyrétiques soulagent la douleur et la fièvre [1]. Une hydratation abondante favorise l'élimination bactérienne, sauf contre-indication cardiaque ou rénale [15].
La surveillance thérapeutique s'avère cruciale. L'amélioration clinique doit être constatée dans les 48-72 heures suivant l'initiation du traitement [2]. En l'absence d'amélioration, une réévaluation complète avec imagerie est nécessaire pour rechercher une complication ou une résistance bactérienne [14].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la prise en charge de la pyélite avec plusieurs innovations majeures. Le développement du modèle prédictif ROSIE révolutionne l'évaluation du risque de complications [3]. Cette intelligence artificielle analyse en temps réel les paramètres cliniques et biologiques pour prédire l'évolution de la maladie.
Les nouvelles techniques d'évaluation de la réponse thérapeutique transforment également le suivi des patients [5]. L'utilisation de biomarqueurs spécifiques permet désormais de prédire plus précisément l'efficacité du traitement dès les premières 24 heures, optimisant ainsi les protocoles thérapeutiques.
Une découverte particulièrement intéressante concerne la pyélite incrustante associée à l'hyperammoniémie [4]. Cette forme rare, récemment décrite, nécessite une approche thérapeutique spécifique combinant antibiothérapie et correction des troubles métaboliques. Cette avancée ouvre de nouvelles perspectives pour les formes compliquées.
La recherche française contribue significativement à ces progrès. Les travaux sur la détection précoce par scintigraphie au DMSA chez les patients greffés rénaux [6] permettent un diagnostic plus précoce et une prise en charge optimisée de cette population particulièrement fragile.
L'émergence de nouvelles résistances bactériennes stimule également la recherche de traitements alternatifs [11]. Les études comparatives entre traitements conventionnels et approches innovantes montrent des résultats prometteurs, particulièrement pour les souches d'E. coli multirésistantes.
Vivre au Quotidien avec Pyélite
Vivre avec une pyélite, même guérie, implique souvent des adaptations dans la vie quotidienne. La fatigue post-infectieuse peut persister plusieurs semaines après la guérison [1,2]. Il est normal de se sentir épuisé et d'avoir besoin de plus de repos que d'habitude pendant cette période de récupération.
L'hydratation devient un élément central du quotidien. Boire au moins 2 litres d'eau par jour aide à prévenir les récidives en maintenant un flux urinaire régulier [14,15]. Certains patients trouvent utile de programmer des rappels pour s'assurer de boire suffisamment tout au long de la journée.
Les habitudes d'hygiène intime prennent une importance particulière. Miction après les rapports sexuels, essuyage d'avant en arrière, éviter les produits irritants sont autant de gestes simples mais efficaces [1]. Ces mesures, bien qu'évidentes, sont souvent négligées et méritent d'être rappelées.
L'impact psychologique ne doit pas être sous-estimé. L'anxiété de récidive est fréquente, particulièrement chez les patients ayant présenté des complications [2]. Certains développent une véritable phobie des infections urinaires, nécessitant parfois un accompagnement psychologique.
La reprise des activités professionnelles doit être progressive. Les métiers physiquement exigeants ou exposant à des facteurs de risque (froid, humidité) peuvent nécessiter des aménagements temporaires [14]. La communication avec l'employeur et la médecine du travail s'avère souvent bénéfique.
Les Complications Possibles
Les complications de la pyélite, bien que rares avec un traitement approprié, peuvent être graves et nécessitent une vigilance particulière. L'abcès rénal représente la complication la plus redoutable, survenant dans 1 à 3% des cas [1,2]. Cette collection purulente nécessite souvent un drainage chirurgical en plus de l'antibiothérapie prolongée.
La septicémie constitue une urgence vitale pouvant compliquer une pyélite mal traitée ou diagnostiquée tardivement [14]. Les signes d'alarme incluent une fièvre persistante malgré le traitement, des troubles de la conscience ou une chute tensionnelle [1]. Cette complication justifie une hospitalisation immédiate en réanimation.
L'insuffisance rénale aiguë peut survenir, particulièrement chez les patients âgés ou présentant une pathologie rénale préexistante [2,15]. La surveillance de la créatininémie s'avère donc cruciale pendant toute la durée du traitement. Heureusement, cette complication est généralement réversible avec une prise en charge adaptée.
Chez les patients immunodéprimés, notamment les greffés rénaux, les complications sont plus fréquentes et plus sévères [6]. La pyélite peut compromettre la fonction du greffon et nécessiter une adaptation du traitement immunosuppresseur. Ces situations particulières requièrent une expertise spécialisée.
Les formes particulières comme la pyélite incrustante, récemment décrite, peuvent s'accompagner de troubles métaboliques complexes [4]. L'hyperammoniémie associée nécessite une prise en charge spécifique et un suivi neurologique étroit.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la pyélite est généralement excellent lorsque le diagnostic est posé précocement et le traitement adapté [1,2]. Dans plus de 95% des cas, la guérison complète est obtenue sans séquelle rénale. Cette statistique rassurante ne doit cependant pas faire oublier l'importance d'un traitement approprié.
La durée de récupération varie selon plusieurs facteurs. Chez les patients jeunes et en bonne santé, l'amélioration clinique survient généralement dans les 48-72 heures suivant l'initiation du traitement [14]. La normalisation complète des paramètres biologiques peut néanmoins prendre 7 à 10 jours [15].
Certains facteurs influencent défavorablement le pronostic. L'âge avancé, le diabète, l'immunodépression ou la présence d'anomalies anatomiques peuvent prolonger la durée de traitement et augmenter le risque de complications [1,2]. Ces patients nécessitent une surveillance plus étroite et parfois une hospitalisation.
Le risque de récidive mérite une attention particulière. Environ 20% des patients présentent un nouvel épisode dans l'année suivante [13]. Ce risque est particulièrement élevé chez les femmes jeunes sexuellement actives et les patients présentant des facteurs de risque persistants [10].
Les innovations récentes, notamment les modèles prédictifs comme ROSIE, permettent désormais d'identifier précocement les patients à risque de complications [3]. Cette approche personnalisée améliore significativement le pronostic en adaptant la prise en charge au profil de risque individuel.
Peut-on Prévenir Pyélite ?
La prévention de la pyélite repose sur des mesures simples mais efficaces, particulièrement importantes chez les personnes à risque. L'hydratation abondante constitue la mesure préventive la plus importante : boire au moins 2 litres d'eau par jour maintient un flux urinaire régulier qui limite la prolifération bactérienne [1,14].
Les règles d'hygiène intime jouent un rôle crucial. La miction post-coïtale réduit de 80% le risque d'infection urinaire chez la femme [1,2]. L'essuyage d'avant en arrière après les selles évite la contamination de l'urètre par les bactéries intestinales [15].
Certaines habitudes vestimentaires méritent d'être modifiées. Porter des sous-vêtements en coton, éviter les vêtements trop serrés et changer régulièrement de protection intime pendant les règles limitent la macération et la prolifération bactérienne [14]. Ces conseils, bien qu'élémentaires, sont souvent négligés.
Chez les patients à risque élevé de récidive, une antibioprophylaxie peut être envisagée [15]. Cette approche, réservée aux cas particuliers, consiste en la prise d'une faible dose d'antibiotique au long cours. Elle nécessite une évaluation spécialisée du rapport bénéfice-risque [1].
Les innovations préventives incluent le développement de probiotiques spécifiques et de vaccins contre les souches d'E. coli uropathogènes [11,12]. Ces approches, encore en cours d'évaluation, pourraient révolutionner la prévention des infections urinaires récidivantes dans les années à venir.
Recommandations des Autorités de Santé
L'Assurance Maladie a publié en 2024 des recommandations actualisées concernant la prise en charge de la pyélonéphrite aiguë, incluant la pyélite [1]. Ces guidelines soulignent l'importance du diagnostic précoce et de l'adaptation thérapeutique selon le profil du patient et la résistance bactérienne locale.
La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande une approche graduée du traitement. Pour les formes simples, un traitement ambulatoire de 7 jours par fluoroquinolones reste la référence [1,2]. L'hospitalisation est réservée aux formes compliquées ou aux terrains fragiles, conformément aux critères précis établis par les sociétés savantes [14].
Les recommandations européennes, harmonisées en 2024, insistent sur la nécessité d'adapter l'antibiothérapie selon l'antibiogramme [15]. Cette approche personnalisée vise à limiter l'émergence de résistances tout en optimisant l'efficacité thérapeutique. La France s'inscrit pleinement dans cette démarche de médecine personnalisée.
Concernant la prévention, les autorités sanitaires françaises recommandent une approche éducative renforcée [1]. Les campagnes d'information ciblent particulièrement les femmes jeunes et les patients diabétiques, populations à risque élevé de récidive [10,13].
L'intégration des innovations diagnostiques, notamment le modèle ROSIE, fait l'objet d'une évaluation par la HAS [3]. Cette technologie pourrait être intégrée dans les recommandations officielles dès 2025, révolutionnant la prise en charge précoce des patients à risque de complications.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations françaises accompagnent les patients souffrant de pathologies rénales et urinaires. L'Association pour l'Information et la Recherche sur les maladies Rénales Génétiques (AIRG) propose des ressources documentaires et un soutien aux patients [1]. Bien qu'orientée vers les maladies génétiques, elle offre des conseils utiles pour la prévention des complications rénales.
La Fédération Nationale d'Aide aux Insuffisants Rénaux (FNAIR) dispose d'antennes régionales proposant information et soutien psychologique. Leurs permanences téléphoniques permettent d'obtenir des conseils pratiques sur la gestion quotidienne des pathologies rénales [14].
Les centres hospitaliers universitaires proposent souvent des consultations d'éducation thérapeutique. Ces programmes, remboursés par l'Assurance Maladie, permettent d'acquérir les connaissances nécessaires pour prévenir les récidives et gérer les traitements [1,2].
Les forums en ligne, bien que ne remplaçant pas l'avis médical, offrent un espace d'échange entre patients. Il convient cependant de rester vigilant sur la qualité des informations partagées et de toujours valider les conseils avec un professionnel de santé [15].
Les applications mobiles de suivi hydrique se développent et peuvent aider à maintenir une hydratation adéquate. Certaines, validées médicalement, intègrent des rappels personnalisés et un suivi des symptômes utile lors des consultations de suivi [14].
Nos Conseils Pratiques
Adopter de bonnes habitudes au quotidien peut considérablement réduire le risque de pyélite. Commencez par installer une routine d'hydratation : gardez toujours une bouteille d'eau à portée de main et programmez des rappels sur votre téléphone si nécessaire [1,14]. L'objectif de 2 litres par jour peut sembler important, mais réparti sur la journée, il devient facilement atteignable.
Créez un environnement favorable dans votre salle de bain. Utilisez des savons doux, sans parfum, pour l'hygiène intime [15]. Évitez les douches vaginales et les produits antiseptiques qui perturbent la flore naturelle protectrice. Un simple savon neutre suffit amplement pour maintenir une hygiène appropriée [1].
Organisez votre garde-robe en privilégiant les matières naturelles. Les sous-vêtements en coton permettent une meilleure aération que les matières synthétiques [14]. Changez-les quotidiennement et après chaque activité sportive. Ces gestes simples limitent la macération et la prolifération bactérienne.
Développez des réflexes préventifs lors des rapports sexuels. La miction dans l'heure qui suit élimine les bactéries potentiellement remontées dans l'urètre [1,2]. Cette habitude, bien qu'elle puisse paraître contraignante, réduit drastiquement le risque d'infection urinaire.
Tenez un carnet de suivi si vous êtes sujet aux récidives. Notez vos symptômes, votre consommation hydrique et les éventuels facteurs déclenchants [15]. Ces informations s'avèrent précieuses lors des consultations médicales et permettent d'identifier des patterns personnels.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous alerter et motiver une consultation médicale rapide. La fièvre supérieure à 38°C associée à des troubles urinaires constitue un signal d'alarme majeur [1,2]. N'attendez pas que les symptômes s'aggravent : une prise en charge précoce améliore considérablement le pronostic.
Les douleurs lombaires intenses, particulièrement si elles irradient vers l'abdomen ou les organes génitaux, nécessitent une évaluation médicale [14]. Ces douleurs, différentes des lombalgies classiques, témoignent souvent d'une atteinte rénale qui ne doit pas être négligée [15].
Consultez en urgence si vous présentez des signes de gravité : vomissements persistants empêchant l'hydratation, troubles de la conscience, frissons importants ou chute tensionnelle [1]. Ces symptômes peuvent témoigner d'une complication grave nécessitant une hospitalisation immédiate [2].
Les patients à risque (diabétiques, immunodéprimés, femmes enceintes) doivent consulter dès l'apparition des premiers symptômes urinaires [10,13]. Chez ces populations fragiles, l'évolution peut être plus rapide et plus sévère, justifiant une surveillance médicale étroite.
N'hésitez pas à recontacter votre médecin si l'amélioration n'est pas constatée dans les 48-72 heures suivant l'initiation du traitement [14,15]. Cette absence d'amélioration peut témoigner d'une résistance bactérienne ou d'une complication nécessitant une réévaluation complète du traitement.
Questions Fréquentes
La pyélite est-elle contagieuse ?Non, la pyélite n'est pas contagieuse. Il s'agit d'une infection causée par des bactéries normalement présentes dans votre organisme qui remontent vers les reins [1,2]. Vous ne pouvez pas la transmettre à votre entourage.
Peut-on avoir des relations sexuelles pendant le traitement ?
Il est préférable d'éviter les rapports sexuels pendant la phase aiguë de l'infection. Une fois l'amélioration constatée et avec l'accord de votre médecin, vous pouvez reprendre progressivement une activité sexuelle normale [14,15].
Les antibiotiques peuvent-ils provoquer des effets secondaires ?
Comme tous les médicaments, les antibiotiques peuvent occasionner des effets indésirables : troubles digestifs, mycoses, réactions allergiques [1]. Signalez immédiatement tout effet inhabituel à votre médecin.
Faut-il suivre un régime alimentaire particulier ?
Aucun régime spécifique n'est nécessaire. Maintenez une alimentation équilibrée et augmentez votre consommation d'eau [2,14]. Évitez l'alcool pendant le traitement antibiotique.
La pyélite peut-elle récidiver ?
Oui, environ 20% des patients présentent une récidive dans l'année [13]. C'est pourquoi les mesures préventives sont essentielles : hydratation, hygiène appropriée et suivi médical régulier [1,15].
Les innovations 2024-2025 changent-elles la prise en charge ?
Les nouveaux outils diagnostiques comme le modèle ROSIE permettent une évaluation plus précise du risque [3]. Ces innovations améliorent la personnalisation des traitements sans révolutionner fondamentalement la prise en charge [5].
Questions Fréquentes
La pyélite est-elle contagieuse ?
Non, la pyélite n'est pas contagieuse. Il s'agit d'une infection causée par des bactéries normalement présentes dans votre organisme.
Peut-on avoir des relations sexuelles pendant le traitement ?
Il est préférable d'éviter les rapports sexuels pendant la phase aiguë. Reprise possible après amélioration et accord médical.
La pyélite peut-elle récidiver ?
Oui, environ 20% des patients présentent une récidive dans l'année. D'où l'importance des mesures préventives.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Comprendre la pyélonéphrite aiguë (infection rénale). Assurance Maladie. 2024-2025.Lien
- [2] Infection au niveau d'un rein (pyélonéphrite aiguë). www.ameli.fr.Lien
- [3] The Development of a Diagnostic Prediction Model (ROSIE). Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [4] Encrusted pyelitis and hyperammonemia due to .... Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] Treatment response assessment of acute pyelonephritis. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] EM Kpekpeou, A Muhoza. Un cas de pyélonéphrite aiguë sur greffon rénal détecté à la scintigraphie rénale au DMSA. 2025.Lien
- [10] TM José, KK Marcel. Identification et analyse des germes responsables d'infections urinaires chez les femmes enceintes à Mbujimayi. 2023.Lien
- [11] N Ouadah, A Kaddouri. Etude comparative in vitro entre les traitements alternatifs et les traitements conventionnels vis-à-vis d'E. coli responsable d'infection urinaire chez l'homme. 2022.Lien
- [12] B Djalila, Y Rania. LES INFECTIONS URINAIRES (ORIGINES ET TRAITEMENTS).. 2024.Lien
- [13] M Arabska, ML Girardin. Profils de résistance des germes responsables d'infections urinaires fébriles de l'enfant et protocoles d'antibiothérapie probabiliste. 2022.Lien
- [14] Pyélonéphrite : causes, symptômes, diagnostic et traitements. www.medecindirect.fr.Lien
- [15] Diagnostic et traitement de la pyélonéphrite. www.vidal.fr.Lien
Publications scientifiques
- Un cas de pyélonéphrite aiguë sur greffon rénal détecté à la scintigraphie rénale au DMSA (2025)
- Obstruction urétérale chez un chien, quand l'urolithiase révèle une affection sous-jacente (2023)
- [LIVRE][B] Mon Pédiatre est homéopathe-Les premiers soins (2023)
- André, un coupable insoupçonné (2023)
- Identification et analyse des germes responsables d'infections urinaires chez les femmes enceintes à Mbujimayi (2023)
Ressources web
- Infection au niveau d'un rein (pyélonéphrite aiguë) (ameli.fr)
9 avr. 2025 — Une pyélonéphrite aiguë est suspectée devant la survenue brutale d'une fièvre et d'une douleur lombaire d'un seul côté. Le diagnostic ...
- Pyélonéphrite : causes, symptômes, diagnostic et traitements (medecindirect.fr)
Symptômes de la pyélonéphrite · fièvre élevée (supérieure à 38°C) ; · frissons ; · douleurs lombaires intenses, d'un seul côté ou des deux ; · douleur à la ...
- Diagnostic et traitement de la pyélonéphrite (vidal.fr)
14 nov. 2023 — Ce traitement repose sur l'administration d'un antibiotique adapté à la bactérie responsable et à sa sensibilité aux différents antibiotiques.
- Pyélonéphrite : définition, causes, traitements (elsan.care)
La pyélonéphrite s'accompagne de symptômes comme le frissons, la fièvre, une douleur généralement dans un seul côté, des nausées, une douleur lorsque l'on urine ...
- Pyélonéphrite (infection urinaire) : symptômes, diagnostic, ... (qare.fr)
17 juil. 2023 — Infection urinaire : quels sont les symptômes de la pyélonéphrite ? · fièvre supérieure à 38,5°C ; · frissons ; · malaise général ; · douleurs ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
