Polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique : Guide Complet 2025
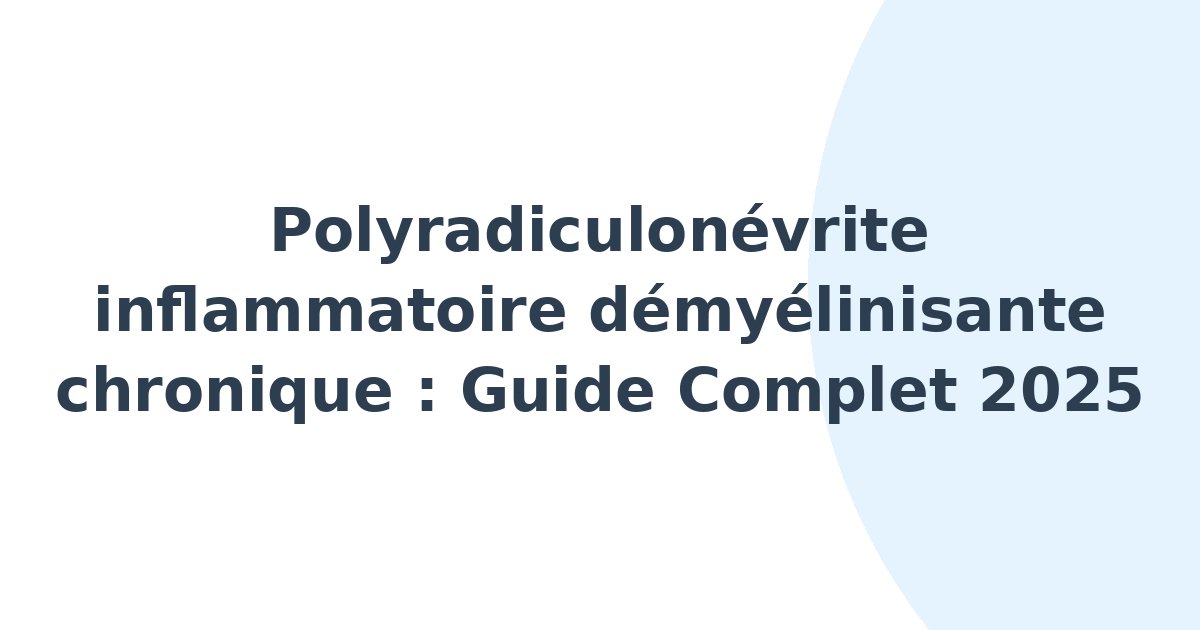
La polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC) est une maladie neurologique rare qui affecte les nerfs périphériques. Cette pathologie auto-immune provoque une inflammation et une destruction progressive de la gaine de myéline qui entoure les fibres nerveuses. Bien que méconnue du grand public, la PIDC touche environ 2 à 8 personnes sur 100 000 en France selon les dernières données de la HAS [1,2]. Heureusement, de nouveaux traitements prometteurs émergent en 2024-2025.
Téléconsultation et Polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique
Téléconsultation non recommandéeLa polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique est une maladie neurologique complexe nécessitant un examen neurologique complet avec tests de la force musculaire, réflexes ostéotendineux et sensibilité. Le diagnostic repose sur des examens complémentaires spécialisés (électromyogramme, ponction lombaire) et nécessite une prise en charge neurologique spécialisée immédiate.
Ce qui peut être évalué à distance
Description précise de l'évolution des symptômes (faiblesse progressive, troubles sensitifs), analyse de l'historique des symptômes et de leur progression temporelle, évaluation de l'impact fonctionnel sur les activités quotidiennes, discussion des antécédents familiaux de maladies auto-immunes, orientation vers une prise en charge neurologique spécialisée urgente.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen neurologique complet avec évaluation de la force musculaire segmentaire, test des réflexes ostéotendineux et de la sensibilité, réalisation d'électromyogramme et études de conduction nerveuse, ponction lombaire pour analyse du liquide céphalorachidien, mise en place du traitement immunosuppresseur ou d'immunoglobulines intraveineuses.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Première suspicion diagnostique nécessitant un examen neurologique complet, aggravation rapide de la faiblesse musculaire nécessitant une réévaluation urgente, mise en place ou adaptation des traitements immunosuppresseurs, surveillance des effets secondaires des immunoglobulines ou corticostéroïdes, évaluation de l'efficacité thérapeutique par testing musculaire.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Faiblesse musculaire rapidement progressive avec risque de paralysie, troubles respiratoires par atteinte des muscles respiratoires, troubles de la déglutition avec risque de fausse route, douleurs neuropathiques intenses non contrôlées.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Faiblesse musculaire rapidement progressive s'étendant aux membres supérieurs
- Difficultés respiratoires ou essoufflement inhabituel
- Troubles de la déglutition avec difficultés à avaler
- Paralysie faciale ou troubles de l'élocution
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Neurologue — consultation en présentiel indispensable
La polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique est une maladie neurologique complexe nécessitant une expertise spécialisée pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique. L'examen neurologique complet et les examens complémentaires spécialisés sont indispensables.
Polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique : Définition et Vue d'Ensemble
La polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique, plus communément appelée PIDC, représente une maladie neurologique complexe qui s'attaque directement à votre système nerveux périphérique [6]. Concrètement, votre système immunitaire se trompe d'ennemi et attaque par erreur la gaine de myéline qui protège vos nerfs.
Imaginez vos nerfs comme des câbles électriques. La myéline joue le rôle de l'isolant plastique qui entoure le fil de cuivre. Quand cette protection se détériore, les signaux électriques ne passent plus correctement entre votre cerveau et vos muscles [14]. D'ailleurs, c'est exactement ce qui explique les symptômes que vous pourriez ressentir : faiblesse musculaire, fourmillements, difficultés à marcher.
Mais attention, ne confondez pas la PIDC avec d'autres neuropathies ! Cette pathologie se distingue par son évolution chronique, c'est-à-dire qu'elle progresse lentement sur plusieurs mois, voire années [15]. L'important à retenir : contrairement à certaines idées reçues, la PIDC n'est pas une maladie héréditaire mais bien une maladie auto-immune acquise.
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les chiffres récents de la HAS révèlent une prévalence de la PIDC comprise entre 2 et 8 cas pour 100 000 habitants en France [1,2]. Cette fourchette peut sembler large, mais elle s'explique par les difficultés diagnostiques de cette pathologie rare. En effet, de nombreux cas restent probablement non diagnostiqués ou mal étiquetés.
L'incidence annuelle, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas chaque année, oscille autour de 0,5 à 2 nouveaux patients pour 100 000 habitants selon les données européennes [13]. Cela représente environ 300 à 1200 nouveaux cas par an en France. Bon à savoir : ces chiffres sont en légère augmentation depuis 10 ans, probablement grâce à une meilleure reconnaissance de la maladie par les neurologues.
Concernant la répartition par âge et sexe, la PIDC touche légèrement plus les hommes que les femmes, avec un ratio d'environ 1,5:1 [11]. L'âge moyen au diagnostic se situe autour de 50 ans, mais la maladie peut survenir à tout âge, y compris chez l'enfant [11,12]. D'ailleurs, les formes pédiatriques représentent environ 10% des cas totaux.
Au niveau international, la prévalence varie selon les régions : plus élevée en Europe du Nord (jusqu'à 10/100 000) et plus faible en Asie (1-3/100 000). Ces variations géographiques suggèrent l'existence de facteurs environnementaux ou génétiques encore mal compris [6].
Les Causes et Facteurs de Risque
Pourquoi développe-t-on une PIDC ? Voilà une question que se posent tous les patients et leurs proches. La vérité, c'est qu'on ne connaît pas encore la cause exacte de cette maladie [6]. Mais les recherches récentes nous éclairent sur plusieurs pistes prometteuses.
Le mécanisme principal implique un dérèglement du système immunitaire. Vos cellules de défense, normalement chargées de vous protéger contre les infections, se mettent à attaquer vos propres nerfs [14]. Ce phénomène, appelé auto-immunité, reste mystérieux. Certains chercheurs suspectent qu'une infection virale ou bactérienne pourrait déclencher cette réaction en chaîne chez des personnes prédisposées.
Les facteurs de risque identifiés incluent certaines prédispositions génétiques, notamment des variants du système HLA [10]. Cependant, rassurez-vous : avoir ces variants ne signifie pas que vous développerez forcément la maladie. Il s'agit plutôt d'une susceptibilité accrue. D'autres facteurs comme le stress, certaines vaccinations ou infections peuvent potentiellement jouer un rôle déclencheur, mais les preuves restent limitées [13].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les premiers signes de la PIDC sont souvent subtils et progressifs, ce qui explique pourquoi le diagnostic peut prendre du temps [7]. Vous pourriez d'abord remarquer une faiblesse musculaire qui commence généralement par les mains et les pieds. Cette faiblesse s'installe insidieusement : vous avez peut-être du mal à ouvrir un bocal, à tenir fermement un stylo, ou vous trébuchez plus souvent.
Les troubles sensitifs accompagnent fréquemment la faiblesse motrice. Concrètement, vous pourriez ressentir des fourmillements, des engourdissements ou une sensation de « gants et chaussettes » [15]. Certains patients décrivent aussi des douleurs neuropathiques, parfois décrites comme des brûlures ou des décharges électriques.
Mais attention, chaque personne est différente ! Certains patients présentent principalement des symptômes moteurs, d'autres des troubles sensitifs prédominants [8]. L'évolution est typiquement lente, sur plusieurs mois, contrairement au syndrome de Guillain-Barré qui évolue rapidement en quelques semaines. Il est normal de s'inquiéter face à ces symptômes, mais sachez que plus le diagnostic est posé tôt, meilleur sera le pronostic.
Les réflexes tendineux sont généralement diminués ou absents, ce que votre médecin vérifiera lors de l'examen clinique. Dans les formes avancées, une atrophie musculaire peut apparaître, particulièrement visible au niveau des mains [6].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de PIDC repose sur une démarche méthodique qui combine plusieurs examens complémentaires [2]. Votre neurologue commencera par un examen clinique approfondi, évaluant votre force musculaire, vos réflexes et votre sensibilité. Cette première étape permet d'orienter le diagnostic et d'éliminer d'autres causes de neuropathie.
L'électroneuromyogramme (ENMG) constitue l'examen clé du diagnostic [8]. Cet examen, bien qu'un peu désagréable, mesure la vitesse de conduction de l'influx nerveux dans vos nerfs. Dans la PIDC, on observe typiquement un ralentissement de la conduction nerveuse, des blocs de conduction et une augmentation des latences distales. Ces anomalies reflètent directement l'atteinte de la myéline.
La ponction lombaire peut être nécessaire pour analyser le liquide céphalorachidien [2]. On y recherche une augmentation des protéines (généralement > 0,45 g/L) avec un nombre de cellules normal ou légèrement élevé. Cet examen aide à confirmer le processus inflammatoire et à éliminer d'autres pathologies.
L'IRM des plexus nerveux, technique d'imagerie de plus en plus utilisée, peut montrer un épaississement et un rehaussement des racines nerveuses [8]. Cette approche non invasive complète utilement le bilan diagnostic, particulièrement dans les formes atypiques.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Heureusement, plusieurs options thérapeutiques efficaces existent pour traiter la PIDC [1,3]. Le traitement de première ligne repose généralement sur les immunoglobulines intraveineuses (IgIV). Ces anticorps, administrés par perfusion, modulent votre système immunitaire et réduisent l'inflammation des nerfs. La dose habituelle est de 2 g/kg répartie sur 2 à 5 jours, puis des cures d'entretien toutes les 3 à 4 semaines.
Les corticoïdes représentent une alternative ou un complément aux IgIV [6]. La prednisolone, généralement prescrite à 1 mg/kg/jour puis progressivement diminuée, peut être très efficace chez certains patients. Cependant, les effets secondaires à long terme limitent parfois leur utilisation prolongée.
La plasmaphérèse constitue une troisième option thérapeutique. Cette technique consiste à filtrer votre sang pour éliminer les anticorps pathogènes [15]. Bien qu'efficace, elle est plus contraignante que les autres traitements et généralement réservée aux formes sévères ou résistantes.
Pour les cas réfractaires, des immunosuppresseurs comme l'azathioprine, le méthotrexate ou le cyclophosphamide peuvent être proposés [13]. Ces traitements nécessitent une surveillance biologique régulière mais peuvent permettre de réduire les doses de corticoïdes ou d'IgIV.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la prise en charge de la PIDC avec l'émergence de nouvelles approches thérapeutiques prometteuses [3,4,5]. Le rituximab, un anticorps monoclonal dirigé contre les lymphocytes B, fait l'objet d'essais cliniques encourageants. Les résultats préliminaires montrent une efficacité comparable aux traitements conventionnels avec potentiellement moins d'effets secondaires [4].
Une innovation majeure concerne le développement du riliprubart, une nouvelle molécule ciblant spécifiquement les mécanismes inflammatoires de la PIDC [5]. Ce traitement, actuellement en phase d'essais cliniques avancés, pourrait révolutionner la prise en charge en offrant une alternative orale aux perfusions d'immunoglobulines.
Les biomarqueurs représentent également un axe de recherche majeur en 2024 [9]. L'identification de marqueurs sanguins permettrait de mieux prédire la réponse aux traitements et d'adapter la thérapie de manière personnalisée. Cette approche de médecine de précision pourrait considérablement améliorer l'efficacité thérapeutique.
D'ailleurs, les nouvelles formulations d'immunoglobulines sous-cutanées, comme HYQVIA, offrent déjà une meilleure qualité de vie aux patients en permettant une administration à domicile [1]. Cette innovation réduit significativement les contraintes liées aux hospitalisations répétées.
Vivre au Quotidien avec la PIDC
Vivre avec une PIDC nécessite certains ajustements, mais rassurez-vous : de nombreux patients mènent une vie épanouie [7]. L'important est d'adapter votre rythme et d'écouter votre corps. La fatigue étant un symptôme fréquent, il est essentiel de planifier vos activités et de prévoir des temps de repos.
La kinésithérapie joue un rôle crucial dans votre prise en charge. Des exercices adaptés permettent de maintenir votre force musculaire et votre mobilité [16]. Votre kinésithérapeute vous proposera un programme personnalisé, incluant des exercices de renforcement musculaire doux et des étirements. N'hésitez pas à lui faire part de vos difficultés spécifiques.
Au niveau professionnel, des aménagements peuvent être nécessaires. Selon votre métier, vous pourriez bénéficier d'un poste adapté, d'horaires flexibles ou d'aides techniques [7]. La reconnaissance en tant que travailleur handicapé peut ouvrir des droits et faciliter ces adaptations. Concrètement, de nombreux patients continuent à travailler avec quelques ajustements.
Les activités physiques restent possibles et même recommandées ! Privilégiez les sports doux comme la natation, le vélo ou la marche. Ces activités entretiennent votre maladie physique sans surcharger vos nerfs fragilisés. L'important à retenir : restez actif dans la mesure de vos possibilités.
Les Complications Possibles
Bien que la plupart des patients répondent bien aux traitements, certaines complications peuvent survenir [6]. La faiblesse musculaire sévère représente la complication la plus redoutée, pouvant dans de rares cas nécessiter une assistance respiratoire. Heureusement, cette situation reste exceptionnelle avec les traitements actuels.
Les troubles de la marche constituent une préoccupation fréquente. Environ 20% des patients développent des difficultés de déambulation nécessitant une aide technique (canne, déambulateur) [15]. Ces troubles résultent de la combinaison entre faiblesse musculaire et troubles sensitifs, affectant l'équilibre et la proprioception.
Les complications liées aux traitements méritent également votre attention. Les corticoïdes au long cours peuvent provoquer ostéoporose, diabète ou hypertension artérielle [13]. Les immunoglobulines, bien que généralement bien tolérées, peuvent occasionnellement causer des réactions allergiques ou des maux de tête. C'est pourquoi un suivi médical régulier est indispensable.
Certains patients développent une résistance aux traitements conventionnels [10]. Cette situation, observée chez environ 10-15% des patients, nécessite le recours à des thérapies de seconde ligne ou à des protocoles expérimentaux. Mais ne vous découragez pas : de nouvelles options thérapeutiques émergent régulièrement.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la PIDC s'est considérablement amélioré ces dernières décennies grâce aux avancées thérapeutiques [3]. Environ 70 à 80% des patients répondent favorablement aux traitements de première ligne et retrouvent une qualité de vie satisfaisante [6]. Cette statistique encourageante doit vous rassurer sur l'évolution possible de votre maladie.
L'évolution varie selon plusieurs facteurs pronostiques. Un diagnostic précoce et une prise en charge rapide améliorent significativement le pronostic [2]. Les patients jeunes, sans comorbidités importantes, ont généralement une meilleure réponse thérapeutique. À l'inverse, un âge avancé au diagnostic ou la présence d'une atrophie musculaire importante peuvent compliquer la récupération.
La plupart des patients nécessitent un traitement d'entretien au long cours pour maintenir leur amélioration [1]. Cependant, environ 20% des patients peuvent arrêter leur traitement après plusieurs années sans rechute. Cette rémission spontanée reste imprévisible et nécessite une surveillance médicale étroite.
Concrètement, de nombreux patients reprennent leurs activités professionnelles et personnelles normales. Certains peuvent même pratiquer des sports ou voyager sans contrainte majeure. L'important à retenir : avec un traitement adapté et un suivi régulier, la PIDC est compatible avec une vie épanouie [7].
Peut-on Prévenir la PIDC ?
Malheureusement, il n'existe actuellement aucun moyen de prévenir la survenue d'une PIDC [14]. Cette maladie auto-immune survient de manière imprévisible, sans facteur déclenchant clairement identifié dans la plupart des cas. Cependant, certaines mesures peuvent potentiellement réduire les risques de rechute ou d'aggravation.
Le maintien d'un mode de vie sain reste votre meilleur atout. Une alimentation équilibrée, un sommeil suffisant et une activité physique adaptée renforcent votre système immunitaire et votre résistance générale [16]. Ces habitudes ne préviendront pas la maladie, mais elles optimiseront votre capacité à y faire face.
La gestion du stress mérite une attention particulière. Bien qu'aucune étude ne prouve formellement le lien entre stress et PIDC, de nombreux patients rapportent des poussées lors de périodes stressantes [7]. Des techniques de relaxation, de méditation ou un suivi psychologique peuvent vous aider à mieux gérer ces situations.
Concernant les vaccinations, les recommandations restent nuancées. Certains vaccins peuvent théoriquement déclencher une réaction auto-immune, mais le bénéfice-risque reste généralement favorable [13]. Discutez toujours avec votre neurologue avant toute vaccination, particulièrement si vous êtes sous traitement immunosuppresseur.
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024 des recommandations actualisées pour la prise en charge de la PIDC [1,2]. Ces guidelines précisent les critères diagnostiques, les modalités thérapeutiques et le suivi des patients. Elles constituent la référence pour tous les professionnels de santé français impliqués dans votre prise en charge.
Les critères diagnostiques ont été affinés pour améliorer la précocité du diagnostic [2]. La HAS recommande la réalisation d'un ENMG dans les 6 semaines suivant l'apparition des premiers symptômes chez tout patient suspect de neuropathie inflammatoire. Cette approche vise à réduire l'errance diagnostique encore trop fréquente.
Concernant les traitements, la HAS privilégie une approche personnalisée [1]. Les immunoglobulines intraveineuses restent le traitement de première intention, mais les modalités d'administration peuvent être adaptées selon votre profil. Les nouvelles formulations sous-cutanées sont désormais reconnues comme une alternative valable pour certains patients.
Le suivi médical doit être structuré selon les recommandations. Une consultation neurologique tous les 3 à 6 mois est préconisée, avec réalisation d'un ENMG annuel pour évaluer l'évolution [2]. Cette surveillance permet d'adapter le traitement et de détecter précocement toute complication.
Ressources et Associations de Patients
Vous n'êtes pas seul face à la PIDC ! Plusieurs associations de patients peuvent vous accompagner dans votre parcours [16]. L'Association Française contre les Myopathies (AFM-Téléthon) dispose d'une section dédiée aux neuropathies périphériques. Elle propose des informations actualisées, un soutien psychologique et des conseils pratiques.
L'association "Rare à l'écoute" offre également un accompagnement spécialisé pour les maladies rares comme la PIDC [16]. Leurs bénévoles, souvent patients eux-mêmes, comprennent vos difficultés et peuvent partager leur expérience. Ils organisent régulièrement des rencontres et des webinaires informatifs.
Au niveau international, la GBS/CIDP Foundation constitue une ressource précieuse. Bien qu'américaine, cette fondation propose des informations scientifiques de qualité et finance de nombreuses recherches sur la PIDC. Leur site web contient une mine d'informations pratiques traduites en français.
N'oubliez pas les réseaux sociaux ! De nombreux groupes Facebook ou forums permettent d'échanger avec d'autres patients. Ces communautés virtuelles offrent un soutien moral précieux et des conseils pratiques du quotidien. Cependant, gardez votre esprit critique et vérifiez toujours les informations médicales avec votre neurologue.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils concrets pour mieux vivre avec votre PIDC au quotidien. Premièrement, tenez un carnet de symptômes. Notez vos sensations, votre niveau de fatigue et l'efficacité de vos traitements. Ces informations précieuses aideront votre neurologue à adapter votre prise en charge.
Organisez votre environnement domestique pour compenser vos difficultés. Des barres d'appui dans la salle de bain, des ouvre-bocaux automatiques en cuisine, ou un siège de douche peuvent considérablement faciliter votre quotidien. Ces aménagements simples préservent votre autonomie et votre sécurité.
Planifiez vos activités selon votre énergie. La fatigue étant imprévisible, prévoyez des alternatives à vos projets. Gardez des activités "de secours" moins fatigantes pour les jours difficiles. Cette flexibilité vous évitera frustrations et déceptions.
Communiquez ouvertement avec votre entourage professionnel et familial. Expliquez votre maladie avec des mots simples, sans dramatiser mais sans minimiser non plus. Cette transparence favorise la compréhension et l'adaptation de tous. N'hésitez pas à demander de l'aide quand vous en avez besoin : c'est un signe de sagesse, pas de faiblesse !
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous alerter et justifier une consultation médicale urgente. Une aggravation rapide de votre faiblesse musculaire, particulièrement si elle affecte votre respiration ou votre déglutition, nécessite un avis médical immédiat [15]. Ces symptômes peuvent signaler une poussée sévère nécessitant une hospitalisation.
Les troubles sensitifs nouveaux ou qui s'aggravent brutalement méritent également une attention particulière. Des douleurs neuropathiques intenses, des fourmillements qui s'étendent ou une perte de sensibilité importante doivent vous amener à consulter rapidement votre neurologue [6].
N'attendez pas non plus si vous développez des effets secondaires liés à vos traitements. Fièvre après une perfusion d'immunoglobulines, signes d'infection sous immunosuppresseurs, ou complications des corticoïdes nécessitent une évaluation médicale prompte [1,13].
En dehors des urgences, consultez votre neurologue si vous ressentez une baisse d'efficacité de votre traitement habituel. Une rechute peut survenir même sous traitement bien conduit. Plus elle est détectée tôt, plus elle sera facile à traiter. Votre médecin pourra alors ajuster votre thérapie ou proposer des alternatives.
Questions Fréquentes
La PIDC est-elle héréditaire ?
Non, la PIDC n'est pas une maladie héréditaire. Il s'agit d'une maladie auto-immune acquise. Cependant, certaines prédispositions génétiques peuvent augmenter légèrement le risque.
Peut-on guérir complètement de la PIDC ?
Environ 20% des patients peuvent arrêter leur traitement après plusieurs années sans rechute. Pour les autres, un traitement d'entretien reste nécessaire mais permet une vie normale.
La PIDC affecte-t-elle l'espérance de vie ?
Avec les traitements actuels, la PIDC n'affecte généralement pas l'espérance de vie. La plupart des patients vivent normalement avec leur maladie bien contrôlée.
Puis-je avoir des enfants avec une PIDC ?
Oui, la grossesse est possible chez les femmes atteintes de PIDC. Une surveillance médicale renforcée est nécessaire et certains traitements devront être adaptés.
Les vaccins sont-ils dangereux ?
Les vaccins ne sont généralement pas contre-indiqués, mais discutez toujours avec votre neurologue avant toute vaccination, surtout sous traitement immunosuppresseur.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] HYQVIA 100 mg/mL - Données épidémiologiques et thérapeutiques actualiséesLien
- [2] Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS) - Recommandations HAS 2024Lien
- [3] Treatment of Chronic Inflammatory Demyelinating - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] Rituximab versus placebo for chronic inflammatory - Essai clinique 2024Lien
- [5] Riliprubart - Drug Targets, Indications, Patents - Nouvelle molécule 2025Lien
- [6] Polyradiculoneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique: physiopathologie et traitement 2025Lien
- [7] Le point de vue d'un patient atteint de PIDC - Témoignage médical 2023Lien
- [8] PIDC: Aspect IRM du plexus brachial et sacré - Imagerie diagnostique 2024Lien
- [9] Monitoring des immunoglobulines dans la PIDC: biomarqueurs 2024Lien
- [10] Analyse du gène TTR: patients avec PIDC-résistante - Génétique 2022Lien
- [11] PIDC de l'enfant: étude clinique et évolutive - Pédiatrie 2022Lien
- [12] PIDC juvénile: diagnostic différentiel - Cas clinique 2023Lien
- [13] Neuropathies périphériques et maladies de système - Revue 2023Lien
- [14] Polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique - OrphanetLien
- [15] Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique - MSD ManualsLien
- [16] PIDC - Ressources patients et accompagnement - Rare à l'écouteLien
Publications scientifiques
- Polyradiculoneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique: qu'avons-nous appris de la physiopathologie et du traitement? (2025)
- [HTML][HTML] Le point de vue d'un patient atteint de polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique (2023)
- POLYRADICULONÉVRITE INFLAMMATOIRE CHRONIQUE: ASPECT IRM DU PLEXUS BRACHIAL ET SACRÉ (2024)
- Monitoring des effets à court terme des immunoglobulines intraveineuses dans la PIDC: quels sont les biomarqueurs les plus pertinents? (2024)
- Enquête sur analyse du gène TTR: patients avec PIDC-résistante (2022)
Ressources web
- Polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique (orpha.net)
Les signes cliniques incluent: faiblesse symétrique progressive des muscles proximaux et distaux des membres inférieurs et/ou supérieurs avec récupération ...
- Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique ... (msdmanuals.com)
L'électromyographie, les études de conduction nerveuse et l'analyse du liquide céphalorachidien peuvent aider à confirmer le diagnostic. Le traitement peut ...
- PIDC – Polyradiculonévrite Inflammatoire Démyélinisante ... (rarealecoute.com)
9 févr. 2022 — Les symptômes de la PIDC ressemblent à ceux du syndrome de Guillain-Barré (le système immunitaire du patient attaque les nerfs périphériques) : ...
- Polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique (gbs-cidp.org)
Les symptômes, les causes des lésions nerveuses, les tests permettant de confirmer le diagnostic et les divers traitements disponibles sont présentés dans ...
- Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS) ... (has-sante.fr)
La PIDC est une maladie auto-immune du système nerveux périphérique affectant primitivement (le plus souvent) la gaine de myéline. Il s'agit d'une maladie rare ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
