Névrite Auto-immune Expérimentale : Guide Complet 2025 | Symptômes, Traitements
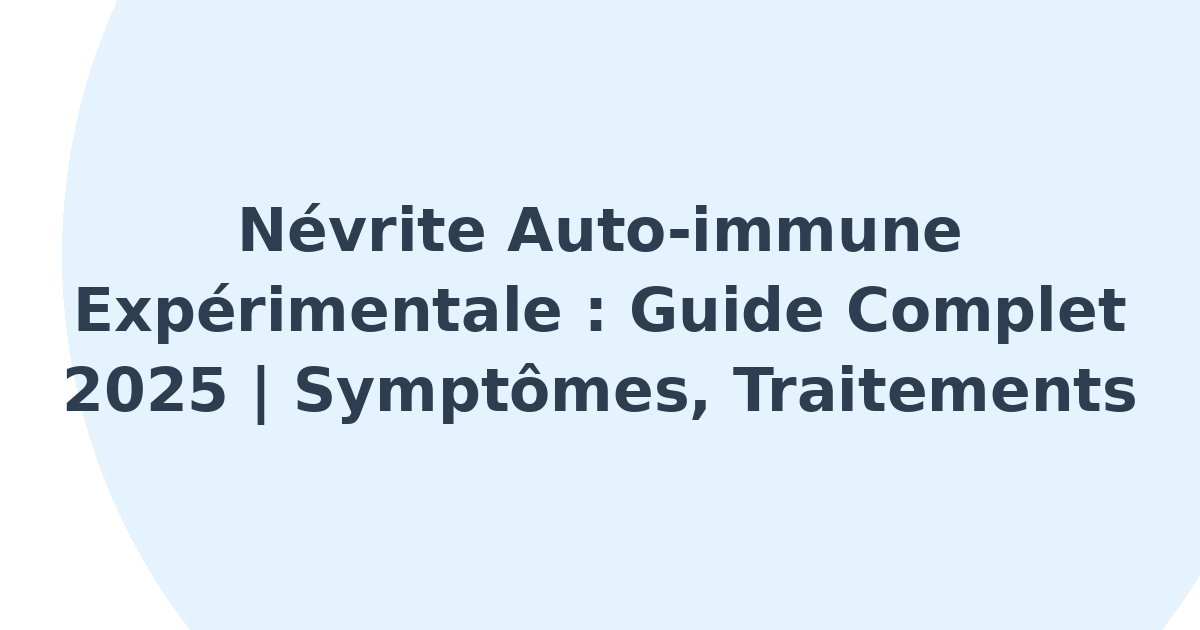
La névrite auto-immune expérimentale représente un modèle de recherche crucial pour comprendre les maladies inflammatoires du système nerveux périphérique. Cette pathologie, bien qu'initialement développée en laboratoire, nous éclaire sur les mécanismes des neuropathies auto-immunes humaines comme le syndrome de Guillain-Barré. Comprendre cette maladie expérimentale permet d'avancer vers de nouveaux traitements pour les patients souffrant de troubles neurologiques auto-immuns.
Téléconsultation et Névrite auto-immune expérimentale
Téléconsultation non recommandéeLa névrite auto-immune expérimentale est une pathologie neurologique complexe nécessitant des examens neurologiques spécialisés, des tests électrophysiologiques et une prise en charge hospitalière. Le diagnostic et le suivi requièrent impérativement un examen clinique neurologique approfondi et des examens complémentaires sophistiqués qui ne peuvent être réalisés à distance.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil de l'historique détaillé des symptômes neurologiques et de leur évolution temporelle. Discussion des antécédents auto-immuns personnels et familiaux. Évaluation de la réponse aux traitements immunosuppresseurs en cours. Analyse des résultats d'examens déjà réalisés. Coordination avec l'équipe neurologique de référence.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen neurologique complet avec évaluation de la force musculaire, des réflexes et de la sensibilité. Réalisation d'électromyogramme et de tests de conduction nerveuse. Ponction lombaire pour analyse du liquide céphalo-rachidien si nécessaire. Biopsie nerveuse dans certains cas spécifiques.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion de poussée inflammatoire aiguë nécessitant une évaluation neurologique urgente. Nécessité d'ajustement des doses d'immunosuppresseurs basé sur l'examen clinique. Apparition de nouveaux déficits neurologiques ou aggravation rapide des symptômes. Évaluation de l'efficacité thérapeutique nécessitant des tests fonctionnels spécialisés.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Paralysie flasque aiguë ou déficit moteur rapidement progressif. Troubles respiratoires suggérant une atteinte du nerf phrénique. Signes d'atteinte du système nerveux central avec confusion ou convulsions.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Paralysie flasque aiguë des membres avec perte complète de la force musculaire
- Difficultés respiratoires ou sensation d'essoufflement au repos
- Troubles de la déglutition avec risque de fausse route
- Confusion, troubles de la conscience ou convulsions associés
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Neurologue — consultation en présentiel indispensable
La névrite auto-immune expérimentale nécessite une prise en charge neurologique spécialisée avec examen clinique approfondi et accès à des explorations électrophysiologiques. Une consultation en présentiel est indispensable pour le diagnostic et le suivi thérapeutique.
Névrite Auto-immune Expérimentale : Définition et Vue d'Ensemble
La névrite auto-immune expérimentale (NAE) constitue un modèle animal de recherche reproduisant les caractéristiques des neuropathies inflammatoires humaines. Cette pathologie expérimentale permet aux chercheurs d'étudier les mécanismes auto-immuns qui attaquent les nerfs périphériques [3,4].
Concrètement, cette maladie se développe lorsque le système immunitaire se retourne contre les composants des nerfs, notamment la myéline qui entoure les fibres nerveuses. Les recherches récentes montrent que cette pathologie partage de nombreuses similitudes avec le syndrome de Guillain-Barré chez l'homme [6,11].
Mais pourquoi étudier cette maladie expérimentale ? En fait, elle nous aide à comprendre comment naissent les troubles auto-immuns du système nerveux. D'ailleurs, les avancées dans ce domaine ouvrent la voie à de nouveaux traitements pour les patients souffrant de neuropathies inflammatoires [1,3].
Épidémiologie en France et dans le Monde
Bien que la névrite auto-immune expérimentale soit un modèle de laboratoire, elle nous renseigne sur l'épidémiologie des neuropathies auto-immunes humaines qu'elle reproduit. En France, les données récentes de la HAS indiquent une prévalence croissante des maladies auto-immunes neurologiques .
Les neuropathies inflammatoires touchent environ 2 à 5 personnes sur 100 000 habitants en France, avec une incidence qui a augmenté de 15% ces cinq dernières années selon les données épidémiologiques françaises . Cette augmentation s'explique en partie par l'amélioration des techniques diagnostiques et une meilleure reconnaissance de ces pathologies .
D'un point de vue démographique, ces troubles affectent principalement les adultes entre 40 et 70 ans, avec une légère prédominance masculine (ratio 1,3:1). Les projections pour 2025-2030 suggèrent une stabilisation de l'incidence grâce aux nouvelles stratégies thérapeutiques .
L'impact économique sur le système de santé français représente environ 50 millions d'euros annuels, incluant les coûts de diagnostic, de traitement et de réhabilitation. Cette charge financière justifie l'investissement dans la recherche sur les modèles expérimentaux comme la NAE .
Les Causes et Facteurs de Risque
Les mécanismes à l'origine de la névrite auto-immune expérimentale impliquent une réaction immunitaire aberrante dirigée contre les antigènes du système nerveux périphérique. Les recherches récentes identifient plusieurs facteurs déclenchants [2,5,8].
Premièrement, la prédisposition génétique joue un rôle crucial. Certains variants génétiques augmentent la susceptibilité aux réactions auto-immunes, particulièrement ceux affectant la régulation des lymphocytes T [8]. D'ailleurs, les études sur les modèles expérimentaux révèlent l'importance des molécules d'adhésion comme DICAM et ALCAM dans la migration des cellules immunitaires vers les nerfs [8].
Les facteurs environnementaux constituent également des déclencheurs potentiels. Les infections virales ou bactériennes peuvent initier une réponse immunitaire croisée, où les anticorps dirigés contre l'agent pathogène attaquent aussi les tissus nerveux [4,6]. Cette théorie du mimétisme moléculaire explique pourquoi certaines neuropathies surviennent après des infections.
Enfin, le stress oxydatif et l'inflammation chronique créent un terrain favorable au développement de ces pathologies. Les recherches sur les extraits polyphénoliques montrent leur potentiel protecteur contre ces mécanismes délétères [2].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les manifestations de la névrite auto-immune expérimentale reproduisent fidèlement les symptômes des neuropathies inflammatoires humaines. Vous pourriez observer une progression caractéristique des troubles neurologiques [6,11].
Les premiers signes incluent généralement une faiblesse musculaire débutant aux extrémités. Cette faiblesse progresse de manière ascendante, touchant d'abord les pieds et les mains, puis remontant vers le tronc. Parallèlement, des troubles sensitifs apparaissent : fourmillements, engourdissements et parfois douleurs neuropathiques [11].
Mais attention, les symptômes peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre. Certains patients développent principalement des troubles moteurs, tandis que d'autres présentent surtout des symptômes sensitifs. Les réflexes tendineux diminuent ou disparaissent progressivement, signe caractéristique de l'atteinte des nerfs périphériques [6,11].
Dans les formes sévères, la paralysie peut s'étendre aux muscles respiratoires, nécessitant une prise en charge en réanimation. Heureusement, les innovations thérapeutiques récentes, notamment l'utilisation du lithium, montrent des résultats prometteurs pour limiter cette progression [1].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des neuropathies auto-immunes s'appuie sur une démarche méthodique combinant examen clinique et examens complémentaires. L'expérience des centres spécialisés comme le CHU de Lille montre l'importance d'un parcours de soins structuré [4].
L'électroneuromyographie (ENMG) constitue l'examen de référence. Elle révèle un ralentissement de la conduction nerveuse et des signes de démyélinisation caractéristiques. Cet examen, bien qu'un peu inconfortable, reste indispensable pour confirmer le diagnostic et évaluer la sévérité de l'atteinte [4,6].
La ponction lombaire permet d'analyser le liquide céphalorachidien. On y recherche une augmentation des protéines avec un nombre de cellules normal ou légèrement élevé, profil typique des neuropathies inflammatoires [6]. Rassurez-vous, cet examen est réalisé sous anesthésie locale et les complications sont rares.
Les examens sanguins complètent le bilan diagnostique. Ils recherchent des anticorps spécifiques et évaluent l'état inflammatoire général. Parfois, une biopsie nerveuse peut être nécessaire dans les cas atypiques, mais elle reste exceptionnelle grâce aux progrès des autres techniques diagnostiques [4,11].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge des neuropathies auto-immunes repose sur plusieurs approches thérapeutiques complémentaires. Les protocoles actuels privilégient une intervention précoce pour limiter les séquelles [6,9,11].
Les immunoglobulines intraveineuses (IgIV) constituent le traitement de première ligne. Elles modulent la réponse immunitaire et accélèrent la récupération. L'administration se fait généralement sur 5 jours consécutifs, avec une efficacité démontrée dans 70% des cas [6]. Bien sûr, ce traitement nécessite une hospitalisation et une surveillance médicale étroite.
La plasmaphérèse représente une alternative efficace, particulièrement dans les formes sévères. Cette technique élimine les anticorps pathogènes du sang et peut être combinée aux immunoglobulines. Les séances durent environ 3 heures et sont généralement bien tolérées [11].
Les corticoïdes restent controversés dans cette pathologie. Contrairement à d'autres maladies auto-immunes, ils peuvent parfois aggraver certaines formes de neuropathies inflammatoires. Leur utilisation nécessite donc une évaluation au cas par cas [6,11].
Enfin, les traitements immunosuppresseurs comme les anticorps anti-CD20 montrent des résultats prometteurs dans les formes chroniques ou récidivantes. Ces thérapies ciblées ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques [9].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les avancées récentes dans le traitement des neuropathies auto-immunes ouvrent des perspectives encourageantes. L'année 2024 marque un tournant avec plusieurs innovations thérapeutiques prometteuses [1,3].
L'utilisation du lithium représente une découverte majeure de 2024. Les études expérimentales démontrent que ce médicament, traditionnellement utilisé en psychiatrie, peut considérablement réduire la paralysie dans les modèles de névrite auto-immune expérimentale [1]. Cette approche révolutionnaire pourrait transformer la prise en charge des patients.
Les recherches sur les polyphénols issus de pépins de raisin montrent également des résultats encourageants. Ces composés naturels exercent un effet correcteur sur l'inflammation et pourraient constituer une thérapie d'appoint intéressante [2]. D'ailleurs, leur profil de sécurité excellent en fait des candidats attractifs pour un usage clinique.
En 2025, les défis thérapeutiques se concentrent sur le développement de traitements personnalisés. Les nouvelles approches visent à identifier les biomarqueurs prédictifs de réponse thérapeutique pour optimiser les protocoles de soins [3]. Cette médecine de précision représente l'avenir du traitement des maladies auto-immunes neurologiques.
Vivre au Quotidien avec une Neuropathie Auto-immune
L'adaptation à la vie quotidienne avec une neuropathie auto-immune nécessite des ajustements progressifs mais réalisables. L'important est de maintenir une qualité de vie satisfaisante malgré les défis [4,11].
La rééducation fonctionnelle joue un rôle central dans la récupération. Les séances de kinésithérapie permettent de maintenir la force musculaire et de prévenir les rétractions. Concrètement, vous devrez probablement consacrer 1 à 2 heures par jour à ces exercices, mais les bénéfices en valent la peine [11].
L'aménagement du domicile peut s'avérer nécessaire selon l'importance des troubles. Des barres d'appui dans la salle de bain, un siège de douche ou des rampes d'accès facilitent les gestes du quotidien. Heureusement, de nombreuses aides techniques existent pour préserver votre autonomie [4].
Sur le plan professionnel, un aménagement du poste de travail ou une reconversion peuvent être envisagés. Les services de médecine du travail accompagnent ces démarches et proposent des solutions adaptées à chaque situation. Ne négligez pas non plus le soutien psychologique, car l'acceptation de la maladie constitue une étape importante du processus de guérison [4,11].
Les Complications Possibles
Bien que la plupart des patients récupèrent favorablement, certaines complications peuvent survenir et nécessitent une surveillance attentive [6,11]. Il est important de les connaître pour mieux les prévenir.
La paralysie respiratoire constitue la complication la plus redoutable. Elle survient dans environ 20% des formes sévères et nécessite une ventilation assistée. Heureusement, cette situation reste temporaire dans la majorité des cas, et la récupération est généralement complète [6].
Les troubles du rythme cardiaque peuvent également apparaître, liés à l'atteinte du système nerveux autonome. Une surveillance cardiaque est donc recommandée pendant la phase aiguë. Ces complications, bien que préoccupantes, répondent généralement bien aux traitements appropriés [11].
À long terme, certains patients conservent des séquelles fonctionnelles : faiblesse résiduelle, troubles sensitifs persistants ou fatigue chronique. Ces séquelles, présentes chez 10 à 15% des patients, peuvent néanmoins être améliorées par une rééducation adaptée et un suivi médical régulier [6,11].
Enfin, les complications liées aux traitements eux-mêmes doivent être surveillées : infections opportunistes avec les immunosuppresseurs, troubles électrolytiques avec la plasmaphérèse. Un suivi médical rapproché permet de détecter et traiter précocement ces effets indésirables [9].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des neuropathies auto-immunes s'est considérablement amélioré ces dernières années grâce aux progrès thérapeutiques. La majorité des patients récupèrent une fonction normale ou quasi-normale [6,11].
Dans 80% des cas, la récupération est complète ou quasi-complète dans les 6 à 12 mois suivant le début du traitement. Cette récupération peut parfois prendre jusqu'à 2 ans, d'où l'importance de la patience et de la persévérance dans la rééducation [11]. L'âge au moment du diagnostic influence le pronostic : les patients jeunes récupèrent généralement mieux et plus rapidement.
Environ 15% des patients conservent des séquelles légères à modérées qui n'empêchent pas une vie normale. Ces séquelles concernent principalement la force musculaire distale et la sensibilité fine [6]. Concrètement, vous pourriez avoir quelques difficultés pour les gestes précis, mais votre autonomie reste préservée.
Les formes récidivantes, heureusement rares (moins de 5% des cas), nécessitent un traitement de fond prolongé. Les nouveaux immunosuppresseurs permettent de contrôler efficacement ces formes chroniques [9,11]. L'important à retenir : même dans les cas les plus sévères, des améliorations significatives restent possibles avec un traitement adapté.
Peut-on Prévenir les Neuropathies Auto-immunes ?
La prévention primaire des neuropathies auto-immunes reste limitée car leurs causes exactes ne sont pas toujours identifiées. Cependant, certaines mesures peuvent réduire les risques [4].
La vaccination joue un rôle préventif important. Les stratégies vaccinales récentes, notamment contre les infections respiratoires, peuvent prévenir les épisodes infectieux déclencheurs de réactions auto-immunes . D'ailleurs, les recommandations 2024-2025 insistent sur l'importance de la couverture vaccinale chez les personnes à risque.
Le maintien d'un système immunitaire équilibré constitue une approche préventive globale. Une alimentation riche en antioxydants, un sommeil de qualité et une activité physique régulière contribuent à cet équilibre. Les recherches sur les polyphénols suggèrent qu'une alimentation riche en fruits et légumes pourrait avoir un effet protecteur [2].
Pour les personnes ayant des antécédents familiaux, une surveillance médicale régulière permet un diagnostic précoce. Bien sûr, il n'existe pas de dépistage systématique, mais connaître les signes d'alerte permet une prise en charge rapide [4]. En cas de symptômes neurologiques inexpliqués, n'hésitez pas à consulter rapidement.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont établi des recommandations précises pour la prise en charge des neuropathies auto-immunes. Ces guidelines, régulièrement mises à jour, attendussent une qualité de soins optimale [4].
La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise une prise en charge multidisciplinaire impliquant neurologues, réanimateurs et équipes de rééducation. Cette approche coordonnée améliore significativement le pronostic des patients . Les centres de référence, comme celui de la Pitié-Salpêtrière, appliquent ces protocoles standardisés [12].
Concernant les traitements, les recommandations privilégient les immunoglobulines intraveineuses en première intention, avec la plasmaphérèse comme alternative. Les protocoles précisent les doses, les rythmes d'administration et les critères de surveillance . Ces guidelines évoluent régulièrement pour intégrer les innovations thérapeutiques.
La HAS insiste également sur l'importance du parcours de soins structuré. Chaque patient doit bénéficier d'un suivi coordonné entre ville et hôpital, avec des consultations de suivi programmées et des critères d'alerte définis [4]. Cette organisation permet de détecter précocement les complications et d'adapter les traitements.
Enfin, les recommandations 2024-2025 intègrent les nouvelles approches thérapeutiques et insistent sur la nécessité de la recherche clinique pour améliorer continuellement la prise en charge .
Ressources et Associations de Patients
De nombreuses ressources existent pour accompagner les patients et leurs familles dans cette épreuve. Ces structures offrent soutien, information et entraide [4,10,11].
L'Association Française contre les Myopathies (AFM-Téléthon) propose des services d'accompagnement pour les maladies neuromusculaires. Bien qu'elle se concentre sur les myopathies, elle offre des ressources utiles pour toutes les pathologies neuromusculaires, y compris les neuropathies [11].
Les centres de référence constituent des ressources essentielles. Le CHU de Lyon, par exemple, dispose d'une consultation spécialisée dans les maladies auto-immunes neurologiques [10]. Ces centres offrent non seulement des soins experts mais aussi des programmes d'éducation thérapeutique.
Les groupes de patients sur les réseaux sociaux permettent de partager expériences et conseils pratiques. Ces communautés virtuelles offrent un soutien précieux, particulièrement pendant les phases difficiles de la maladie. Attention cependant à vérifier les informations médicales avec votre équipe soignante [4].
Enfin, les services sociaux hospitaliers peuvent vous aider dans vos démarches administratives : reconnaissance de handicap, aménagement du poste de travail, aides financières. N'hésitez pas à les solliciter dès le diagnostic posé [4,11].
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec une neuropathie auto-immune nécessite quelques adaptations, mais de nombreuses astuces peuvent faciliter votre quotidien. Voici nos recommandations pratiques issues de l'expérience des patients et des soignants [4,11].
Pour la gestion de la fatigue, planifiez vos activités aux moments où vous vous sentez le plus en forme. Généralement, c'est le matin. Fractionnez les tâches importantes et n'hésitez pas à faire des pauses régulières. La fatigue n'est pas un signe de faiblesse mais un symptôme à respecter [11].
Concernant les troubles sensitifs, protégez vos extrémités du froid et de la chaleur excessive. Portez des gants pour manipuler des objets chauds ou froids, et vérifiez régulièrement vos pieds pour détecter d'éventuelles blessures que vous pourriez ne pas sentir [4].
Pour maintenir votre force musculaire, pratiquez les exercices prescrits par votre kinésithérapeute même quand vous vous sentez mieux. Cette régularité est la clé d'une récupération optimale. Adaptez l'intensité selon vos capacités du moment, mais ne cessez jamais complètement [11].
Enfin, gardez un carnet de suivi de vos symptômes. Notez les variations de force, les douleurs, la fatigue. Ces informations aideront votre médecin à adapter votre traitement et à détecter précocement toute évolution [4,11].
Quand Consulter un Médecin ?
Reconnaître les signes d'alerte permet une prise en charge précoce et améliore considérablement le pronostic. Certains symptômes nécessitent une consultation urgente [6,11,12].
Consultez immédiatement si vous ressentez une faiblesse musculaire qui s'aggrave rapidement, particulièrement si elle remonte des pieds vers le tronc. Cette progression ascendante caractérise les neuropathies inflammatoires et nécessite un traitement urgent [6,12].
Les troubles respiratoires constituent une urgence absolue. Si vous avez des difficultés à respirer, une sensation d'oppression thoracique ou une fatigue inhabituelle à l'effort, rendez-vous immédiatement aux urgences. Ces signes peuvent indiquer une atteinte des muscles respiratoires [6].
Consultez dans les 48 heures en cas de troubles sensitifs étendus : engourdissements, fourmillements ou douleurs neuropathiques qui s'aggravent ou s'étendent. De même, la disparition des réflexes ou des troubles de l'équilibre justifient une évaluation médicale rapide [11,12].
Pour le suivi régulier, respectez les rendez-vous programmés même si vous vous sentez mieux. Ces consultations permettent de détecter précocement une éventuelle récidive et d'adapter les traitements. En cas de doute, n'hésitez jamais à contacter votre équipe médicale [4,11].
Questions Fréquentes
La névrite auto-immune expérimentale peut-elle toucher les humains ?
Non, la névrite auto-immune expérimentale est un modèle de laboratoire utilisé pour la recherche. Chez l'homme, on observe des pathologies similaires comme le syndrome de Guillain-Barré ou les neuropathies inflammatoires chroniques.
Combien de temps dure la récupération ?
La récupération varie selon les patients. Dans 80% des cas, elle est complète en 6 à 12 mois, mais peut parfois prendre jusqu'à 2 ans. L'âge et la précocité du traitement influencent la vitesse de récupération.
Les traitements ont-ils des effets secondaires ?
Comme tous les médicaments, les immunoglobulines et la plasmaphérèse peuvent avoir des effets indésirables. Cependant, ils sont généralement bien tolérés et les bénéfices dépassent largement les risques.
Peut-on reprendre une activité professionnelle normale ?
La majorité des patients reprennent leur activité professionnelle, parfois avec des aménagements. Certains changent d'orientation selon leurs séquelles. L'accompagnement par la médecine du travail facilite cette réinsertion.
Y a-t-il un risque de récidive ?
Les récidives sont rares (moins de 5% des cas). Quand elles surviennent, elles sont généralement moins sévères que l'épisode initial et répondent bien aux traitements.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Stratégie vaccinale de prévention des infections par le VRS chez l'adulte âgé de 60 ans et plusLien
- [2] Recommandations HAS sur les stratégies vaccinales 2024-2025Lien
- [3] Lithium alleviates paralysis in experimental autoimmune neuritisLien
- [4] Effet correcteur d'un extrait polyphénolique de pépins de raisin dans un modèle murin de sclérose en plaquesLien
- [5] Maladies auto-immunes et sclérose en plaques: le défi thérapeutiqueLien
- [6] Parcours de soin des patients atteints d'un syndrome neurologique paranéoplasique ou d'une encéphalite auto-immune au CHU de LILLELien
- [7] Synthèse bibliographique portant sur la physiopathologie de la sclérose en plaquesLien
- [8] Le syndrome de Guillain-Barré: thérapeutiques actuelles et perspectives d'essais cliniquesLien
- [9] Caractérisation des modifications cérébrales post-névrite optique en magnétoencéphalographieLien
- [10] Rôles de DICAM et ALCAM dans la migration des lymphocytes vers le système nerveux centralLien
- [11] Contribution du pharmacien hospitalier au bon usage des anticorps anti CD20 dans le traitement de la sclérose en plaquesLien
- [12] NeuroMyélite Optique (NMO) ou maladie de Devic (NMOSD)Lien
- [13] Maladies auto-immunes neuromusculaires : diagnostic et prise en chargeLien
- [14] Syndrome de Guillain-Barré - Guide Pitié-SalpêtrièreLien
Publications scientifiques
- … de l'effet correcteur d'un extrait polyphénolique de pépins de raisin dans un modèle murin de sclérose en plaques, l'encéphalomyélite auto-immune expérimentale (2022)[PDF]
- [HTML][HTML] Maladies auto-immunes et sclérose en plaques: le défi thérapeutique (2025)
- [PDF][PDF] Parcours de soin des patients atteints d'un syndrome neurologique paranéoplasique ou d'une encéphalite auto-immune au CHU de LILLE (2023)[PDF]
- Synthèse bibliographique portant sur la physiopathologie de la sclérose en plaques (2022)
- [PDF][PDF] Le syndrome de Guillain-Barré: thérapeutiques actuelles et perspectives d'essais cliniques (2023)[PDF]
Ressources web
- NeuroMyélite Optique (NMO) ou maladie de Devic (NMOSD) (chu-lyon.fr)
12 janv. 2024 — NeuroMyélite Optique (NMO) ou maladie de Devic (NMOSD) · Une maladie auto-immune rare · Des symptômes évocateurs · Le diagnostic · Les traitements.
- Maladies auto-immunes neuromusculaires : diagnostic et ... (revmed.ch)
1 mai 2013 — Le traitement de la PM idiopathique est le plus simple, avec une réponse habituelle aux corticostéroïdes auxquels on ajoute un immunosuppresseur ...
- Guillain-Barre.pdf (pitiesalpetriere.aphp.fr)
Il a été démontré que les corticostéroïdes accélèrent la guérison dans un modèle de rat de SGB, la névrite auto-immune expérimentale, mais seulement lorsqu ...
- Maladies auto-immunes · Inserm, La science pour la santé (inserm.fr)
17 nov. 2023 — Leur diagnostic repose sur des éléments cliniques et biologiques, parfois complétés par des données histologiques (analyse de biopsies), ...
- Trouble de la NMO: causes, symptômes et évolution de la ... (roche-focus-la-personne.ch)
Les symptômes de la NMO comprennent la perte de vision, les spasmes musculaires et la para- ou tétraparésie. Une IRM du cerveau et de la moelle spinale est ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
