Polyradiculoneuropathie : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
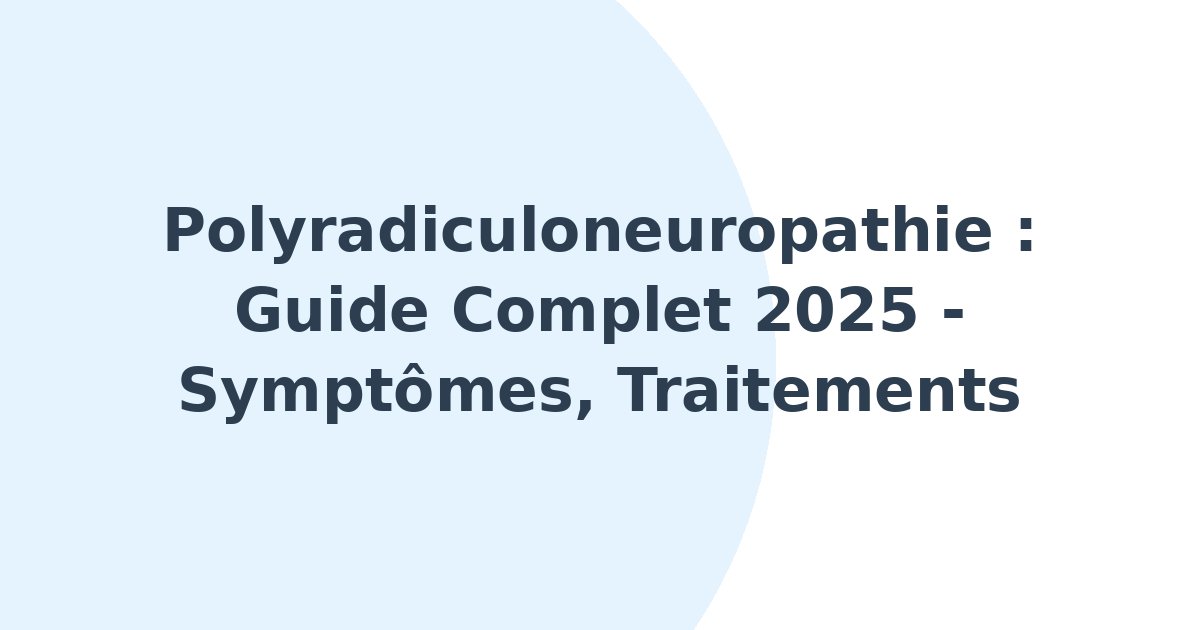
La polyradiculoneuropathie est une maladie neurologique qui touche les racines nerveuses et les nerfs périphériques. Cette pathologie inflammatoire peut considérablement impacter votre qualité de vie, mais des traitements efficaces existent aujourd'hui. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette maladie complexe, ses symptômes et les innovations thérapeutiques récentes.
Téléconsultation et Polyradiculoneuropathie
Téléconsultation non recommandéeLa polyradiculoneuropathie nécessite un examen neurologique approfondi avec tests de sensibilité, réflexes ostéotendineux et évaluation de la force musculaire qui ne peuvent être réalisés à distance. Le diagnostic repose sur des examens complémentaires spécialisés (électromyogramme, ponction lombaire) indispensables pour confirmer l'atteinte et identifier la cause sous-jacente.
Ce qui peut être évalué à distance
Description détaillée des symptômes sensitifs et moteurs par le patient, évaluation de l'évolution temporelle des troubles, analyse de l'historique médical et des traitements antérieurs, orientation diagnostique préliminaire basée sur l'interrogatoire, coordination avec les spécialistes pour le suivi.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen neurologique complet avec évaluation des réflexes, de la sensibilité et de la force musculaire, réalisation d'électromyogramme et études de conduction nerveuse, ponction lombaire si indiquée, examens d'imagerie spécialisés selon l'étiologie suspectée.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Première évaluation diagnostique nécessitant un examen neurologique complet, aggravation rapide des symptômes nécessitant une réévaluation clinique, indication de nouveaux examens complémentaires spécialisés, ajustement de traitements immunosuppresseurs nécessitant une surveillance clinique.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Développement d'une insuffisance respiratoire par atteinte des muscles respiratoires, troubles de déglutition sévères avec risque de fausse route, paralysie ascendante rapide évoquant un syndrome de Guillain-Barré.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Difficultés respiratoires ou essoufflement au repos
- Troubles de la déglutition avec fausses routes
- Paralysie ascendante rapide des membres
- Troubles de l'équilibre sévères avec chutes répétées
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Neurologue — consultation en présentiel indispensable
La polyradiculoneuropathie nécessite impérativement l'expertise d'un neurologue pour l'examen neurologique spécialisé et l'interprétation des examens électrophysiologiques. La consultation en présentiel est indispensable pour le diagnostic et le suivi de cette pathologie complexe.
Polyradiculoneuropathie : Définition et Vue d'Ensemble
La polyradiculoneuropathie désigne un groupe de maladies qui affectent simultanément les racines nerveuses et les nerfs périphériques. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous ?
Imaginez votre système nerveux comme un réseau électrique complexe. Les racines nerveuses sont les câbles principaux qui sortent de votre moelle épinière, tandis que les nerfs périphériques sont les fils plus fins qui transportent les signaux vers vos muscles et organes [13,14]. Quand cette maladie survient, c'est comme si plusieurs câbles étaient endommagés en même temps.
La forme la plus courante est la polyradiculoneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC). Cette pathologie attaque la gaine de myéline qui protège vos nerfs, un peu comme si l'isolant autour d'un fil électrique se détériorait [5,6]. D'ailleurs, cette démyélinisation explique pourquoi les signaux nerveux ne passent plus correctement.
Il existe aussi des formes aiguës, comme le syndrome de Guillain-Barré, qui évoluent rapidement sur quelques semaines [8,14]. Contrairement aux formes chroniques qui s'installent progressivement sur des mois ou des années, ces variants aigus nécessitent une prise en charge d'urgence.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, la polyradiculoneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique touche environ 2 à 8 personnes sur 100 000 habitants [1]. Ces chiffres peuvent sembler faibles, mais ils représentent plusieurs milliers de patients dans notre pays.
L'incidence annuelle - c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas chaque année - se situe entre 0,15 et 1,9 cas pour 100 000 personnes [5,6]. Concrètement, cela signifie qu'environ 500 à 1 200 nouveaux patients développent cette pathologie chaque année en France. Et ces chiffres sont en légère augmentation, probablement grâce à une meilleure reconnaissance de la maladie par les médecins.
Qui est le plus touché ? Les hommes sont légèrement plus concernés que les femmes, avec un ratio d'environ 1,5 pour 1 [9,10]. L'âge moyen au diagnostic se situe autour de 50-60 ans, mais la maladie peut survenir à tout âge, y compris chez l'enfant [8].
Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne des pays développés. Les pays nordiques rapportent des prévalences légèrement plus élevées, possiblement liées à des facteurs génétiques ou environnementaux spécifiques [4]. L'impact économique sur notre système de santé est considérable : le coût moyen par patient dépasse 30 000 euros par an, incluant les traitements immunomodulateurs et la prise en charge multidisciplinaire.
Les Causes et Facteurs de Risque
Pourquoi développe-t-on une polyradiculoneuropathie ? La réponse n'est pas simple, car cette maladie résulte d'un mécanisme auto-immun complexe [5,12].
Dans la plupart des cas, votre système immunitaire se trompe d'ennemi. Au lieu de protéger votre organisme, il attaque par erreur la myéline de vos propres nerfs [6,10]. C'est un peu comme si votre système de sécurité domestique se mettait à considérer les habitants de la maison comme des intrus.
Plusieurs facteurs peuvent déclencher cette réaction auto-immune. Les infections virales ou bactériennes sont souvent pointées du doigt : cytomégalovirus, virus d'Epstein-Barr, ou encore certaines bactéries comme Campylobacter jejuni [7,14]. Ces agents infectieux peuvent créer une confusion immunologique appelée "mimétisme moléculaire".
D'autres facteurs de risque incluent certains médicaments, notamment les inhibiteurs de checkpoint immunitaire utilisés en oncologie [11,12]. Le brentuximab-vedotin, un traitement contre certains lymphomes, peut également induire des polyradiculoneuropathies démyélinisantes [11]. Heureusement, ces formes médicamenteuses sont souvent réversibles à l'arrêt du traitement responsable.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les premiers signes de la polyradiculoneuropathie sont souvent subtils et progressifs. Vous pourriez d'abord remarquer une faiblesse musculaire qui commence généralement par les jambes [9,13].
"J'ai d'abord pensé que j'étais juste fatiguée", racontent souvent les patients. Cette faiblesse s'accompagne fréquemment de troubles sensitifs : fourmillements, engourdissements, ou sensation de "chaussettes" aux pieds [6,10]. Ces symptômes remontent progressivement vers les cuisses et peuvent toucher les bras.
Un signe caractéristique est la diminution ou l'absence des réflexes tendineux [5,9]. Votre médecin le remarquera en testant vos réflexes avec son petit marteau. D'ailleurs, c'est souvent ce qui l'alerte sur la nature de votre problème.
Dans les formes sévères, vous pouvez développer des difficultés à marcher, à monter les escaliers, ou même à tenir des objets [7,13]. Certains patients rapportent aussi des douleurs neuropathiques - ces douleurs particulières, souvent décrites comme des brûlures ou des décharges électriques.
Bon à savoir : contrairement à d'autres neuropathies, la polyradiculoneuropathie touche souvent les parties proximales (proches du tronc) autant que distales (extrémités) [6,9]. C'est un élément important pour le diagnostic différentiel.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de polyradiculoneuropathie nécessite une approche méthodique et plusieurs examens complémentaires [6,10]. Votre médecin commencera par un examen clinique approfondi, testant votre force musculaire, vos réflexes et votre sensibilité.
L'électromyogramme (EMG) est l'examen clé du diagnostic [6,9]. Cet examen mesure la conduction nerveuse et peut sembler impressionnant, mais il est généralement bien toléré. Il permet de confirmer le ralentissement de la conduction nerveuse caractéristique de la démyélinisation [5,6].
La ponction lombaire est souvent nécessaire pour analyser le liquide céphalorachidien [7,10]. Rassurez-vous, cet examen est réalisé sous anesthésie locale et les complications sont rares. On recherche une augmentation des protéines sans élévation significative des cellules - ce qu'on appelle une "dissociation albumino-cytologique".
D'autres examens peuvent être utiles : IRM de la moelle épinière, biopsie nerveuse dans certains cas complexes, ou recherche d'anticorps spécifiques [5,9]. Le diagnostic repose sur des critères précis établis par les sociétés savantes internationales, récemment mis à jour pour améliorer la précision diagnostique [6].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Heureusement, plusieurs traitements efficaces existent pour la polyradiculoneuropathie [1,2]. Le traitement de première ligne repose sur les immunoglobulines intraveineuses (IgIV), administrées généralement toutes les 3 à 4 semaines [1,5].
Ces immunoglobulines agissent comme des "pompiers" qui éteignent l'inflammation auto-immune. Environ 70% des patients répondent favorablement à ce traitement [2,5]. L'administration se fait en hôpital de jour et dure quelques heures. Certains patients peuvent ressentir des maux de tête ou de la fatigue après la perfusion, mais ces effets sont généralement temporaires.
Les corticoïdes constituent une alternative, particulièrement utiles dans les formes inflammatoires importantes [7,12]. Cependant, leur utilisation au long cours nécessite une surveillance étroite des effets secondaires : prise de poids, ostéoporose, diabète.
Pour les cas résistants, d'autres immunosuppresseurs peuvent être proposés : méthotrexate, azathioprine, ou cyclophosphamide [3,12]. La plasmaphérèse - une technique qui "nettoie" le sang des anticorps pathogènes - reste une option dans certaines situations aiguës [14].
L'important à retenir : le traitement doit être personnalisé selon votre profil, la sévérité de vos symptômes et votre réponse aux différentes thérapies [5,6].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans le traitement des polyradiculoneuropathies avec plusieurs avancées majeures [2]. L'étude ADVANCE-CIDP 3 de Takeda a démontré l'efficacité à long terme d'HYQVIA, une formulation sous-cutanée d'immunoglobulines [2].
Cette innovation représente une véritable révolution pour vous, patients. Fini les perfusions hospitalières toutes les 3 semaines ! HYQVIA permet une administration à domicile, toutes les 3 à 4 semaines, avec une efficacité comparable aux IgIV classiques [1,2]. Les données à long terme montrent un maintien de l'efficacité sur 2 ans avec un profil de sécurité excellent.
Autre innovation prometteuse : le rituximab, un anticorps monoclonal anti-CD20 [3]. Les résultats de l'étude randomisée contre placebo publiés fin 2024 montrent une efficacité intéressante dans les formes réfractaires [3]. Ce traitement cible spécifiquement les lymphocytes B responsables de la production d'anticorps pathogènes.
Les thérapies ciblées émergent également [4]. Les inhibiteurs du complément, les modulateurs des cellules T régulatrices, ou encore les thérapies géniques font l'objet de recherches intensives [4]. Le congrès JNLF 2024 a présenté des résultats encourageants sur ces nouvelles approches .
En parallèle, la recherche sur les biomarqueurs progresse rapidement [5]. L'objectif : identifier plus précocement les patients qui répondront à tel ou tel traitement, pour une médecine vraiment personnalisée.
Vivre au Quotidien avec Polyradiculoneuropathie
Vivre avec une polyradiculoneuropathie demande des ajustements, mais une vie épanouie reste tout à fait possible [13,15]. L'adaptation de votre environnement est souvent la première étape : barres d'appui dans la salle de bain, rampes d'escalier, chaussures adaptées.
La kinésithérapie joue un rôle central dans votre prise en charge [7,13]. Des exercices réguliers permettent de maintenir votre force musculaire et votre équilibre. Votre kinésithérapeute vous apprendra aussi des techniques de marche sécurisée et des exercices d'étirement pour prévenir les contractures.
L'ergothérapie vous aide à adapter vos gestes quotidiens [15]. Des outils simples peuvent considérablement faciliter votre vie : ouvre-bocaux ergonomiques, couverts adaptés, ou encore dispositifs d'aide à l'habillage. Ces professionnels évaluent aussi votre poste de travail si vous êtes encore en activité.
Sur le plan psychologique, il est normal de traverser des périodes difficiles. L'annonce du diagnostic, les limitations fonctionnelles, l'incertitude sur l'évolution... tout cela peut générer anxiété et dépression [13]. N'hésitez pas à en parler à votre équipe soignante ou à consulter un psychologue spécialisé.
Bon à savoir : de nombreux patients continuent à travailler, parfois avec des aménagements de poste. Le télétravail, les horaires flexibles, ou l'adaptation du matériel peuvent permettre de maintenir une activité professionnelle [15].
Les Complications Possibles
Bien que la plupart des patients vivent normalement avec leur polyradiculoneuropathie, certaines complications peuvent survenir [7,9]. La faiblesse musculaire sévère représente la complication la plus redoutée, pouvant conduire à une perte d'autonomie [13].
Les troubles respiratoires sont rares mais graves [8,14]. Ils surviennent quand la maladie touche les nerfs qui contrôlent les muscles respiratoires. C'est pourquoi votre médecin surveille régulièrement votre fonction respiratoire, notamment par des tests simples comme la mesure de votre capacité vitale.
Les douleurs neuropathiques chroniques affectent environ 30% des patients [10,13]. Ces douleurs particulières - brûlures, décharges électriques, fourmillements douloureux - peuvent considérablement altérer votre qualité de vie. Heureusement, des traitements spécifiques existent : gabapentine, prégabaline, ou certains antidépresseurs.
D'autres complications incluent les troubles de l'équilibre avec risque de chutes, les contractures musculaires, ou encore les troubles du sommeil liés aux douleurs [9,15]. La surveillance cardiaque peut être nécessaire dans certaines formes, car les nerfs du cœur peuvent parfois être touchés.
L'important : ces complications ne sont pas inéluctables. Un suivi médical régulier et un traitement adapté permettent de les prévenir ou de les traiter efficacement [5,6].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la polyradiculoneuropathie varie considérablement d'un patient à l'autre [5,9]. Dans la forme chronique (PIDC), environ 70% des patients répondent bien aux traitements immunomodulateurs [2,6].
Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Une réponse favorable se traduit par une amélioration de la force musculaire, une diminution des troubles sensitifs, et surtout un maintien ou une récupération de votre autonomie [1,5]. Certains patients retrouvent même une fonction quasi-normale.
Cependant, il faut être réaliste : la guérison complète est rare [6,9]. La plupart des patients nécessitent un traitement au long cours pour maintenir leur amélioration. C'est un peu comme le diabète ou l'hypertension - des maladies chroniques qui se contrôlent bien avec un traitement adapté.
Les facteurs de bon pronostic incluent : un diagnostic précoce, un début de traitement rapide, un âge jeune au diagnostic, et une bonne réponse initiale aux immunoglobulines [5,7]. À l'inverse, un retard diagnostic, une atteinte axonale sévère, ou une résistance aux traitements de première ligne peuvent assombrir le pronostic.
Les formes aiguës comme le Guillain-Barré ont généralement un meilleur pronostic à long terme [8,14]. Environ 80% des patients récupèrent complètement ou gardent des séquelles mineures, même si la phase aiguë peut être impressionnante.
Peut-on Prévenir Polyradiculoneuropathie ?
La prévention primaire de la polyradiculoneuropathie reste limitée, car ses causes exactes ne sont pas toujours identifiées [5,10]. Cependant, certaines mesures peuvent réduire votre risque ou prévenir les récidives.
La vaccination joue un rôle important, notamment contre les infections qui peuvent déclencher la maladie [14]. Les vaccins contre la grippe, le pneumocoque, ou encore le zona sont recommandés, mais toujours en concertation avec votre médecin car votre système immunitaire est particulier.
Si vous prenez des médicaments potentiellement responsables de neuropathies, une surveillance neurologique régulière est essentielle [11,12]. Votre oncologue et votre neurologue doivent travailler ensemble pour adapter vos traitements si nécessaire.
Pour la prévention secondaire - éviter les rechutes - le respect scrupuleux de votre traitement immunomodulateur est crucial [1,2]. Ne jamais arrêter brutalement vos immunoglobulines ou vos corticoïdes sans avis médical. Même si vous vous sentez mieux, votre maladie nécessite un traitement continu.
D'autres mesures générales peuvent aider : maintenir une activité physique adaptée, éviter le stress excessif, avoir une alimentation équilibrée riche en vitamines B [13,15]. Certains patients rapportent que la gestion du stress par la relaxation ou la méditation les aide à mieux vivre avec leur maladie.
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a récemment actualisé ses recommandations concernant la prise en charge des polyradiculoneuropathies [1]. Ces nouvelles directives intègrent les innovations thérapeutiques 2024-2025 et précisent les modalités de prescription des traitements.
Concernant HYQVIA, la HAS recommande son utilisation chez les patients stabilisés sous immunoglobulines intraveineuses [1]. Cette formulation sous-cutanée est particulièrement indiquée pour les patients ayant des difficultés d'accès veineux ou souhaitant plus d'autonomie dans leur traitement.
Les critères de prescription des immunoglobulines ont été précisés [1]. Le traitement doit être initié par un neurologue expérimenté, avec une évaluation de l'efficacité à 3 mois. La HAS insiste sur l'importance d'une approche multidisciplinaire incluant kinésithérapeute, ergothérapeute, et si nécessaire psychologue.
Pour les formes pédiatriques, des recommandations spécifiques ont été établies [8]. L'approche thérapeutique chez l'enfant nécessite des adaptations posologiques et un suivi particulier de la croissance et du développement psychomoteur.
La HAS recommande également la mise en place de centres de référence pour les maladies neuromusculaires rares . Ces centres assurent une expertise diagnostique et thérapeutique, ainsi qu'une coordination des soins sur l'ensemble du territoire français.
Ressources et Associations de Patients
Vous n'êtes pas seul face à la polyradiculoneuropathie. Plusieurs associations et ressources peuvent vous accompagner dans votre parcours [13,15].
L'Association Française contre les Myopathies (AFM-Téléthon) dispose d'un réseau de conseillers en génétique et de services d'accompagnement. Bien que spécialisée dans les myopathies, elle offre des ressources utiles pour toutes les maladies neuromusculaires.
La Fondation Hopale propose des informations détaillées sur les polyradiculoneuropathies et met en relation les patients [14]. Leur site web contient des fiches pratiques sur la vie quotidienne avec ces pathologies.
Au niveau européen, l'Organisation Européenne des Maladies Rares (EURORDIS) coordonne les actions de recherche et de soutien aux patients. Elle dispose d'une base de données complète sur les polyradiculoneuropathies [13].
N'oubliez pas les réseaux sociaux et forums spécialisés où vous pouvez échanger avec d'autres patients. Ces espaces permettent de partager expériences, conseils pratiques, et soutien moral. Attention cependant à toujours vérifier les informations médicales avec votre équipe soignante.
Votre centre hospitalier dispose probablement d'une assistante sociale spécialisée dans les maladies chroniques. Elle peut vous aider dans vos démarches administratives : reconnaissance de handicap, aménagement de poste, aides financières.
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec une polyradiculoneuropathie au quotidien nécessite quelques adaptations pratiques que nous avons compilées grâce à l'expérience de nombreux patients [13,15].
Pour la sécurité à domicile : installez des éclairages automatiques dans les couloirs, retirez les tapis glissants, et équipez votre douche d'un siège et de barres d'appui. Ces aménagements simples préviennent efficacement les chutes liées aux troubles de l'équilibre.
Concernant l'alimentation, privilégiez les aliments riches en vitamines B (céréales complètes, légumineuses, poissons gras). Certains patients rapportent une amélioration de leurs symptômes avec des compléments en vitamine B12, mais toujours sous contrôle médical [15].
Pour l'activité physique, la natation est souvent idéale car l'eau soutient votre corps tout en permettant un exercice complet [13]. La marche nordique, avec ses bâtons, offre également un bon équilibre entre exercice et sécurité. Évitez les sports à risque de chute comme le vélo en extérieur.
Au niveau professionnel, n'hésitez pas à demander des aménagements : siège ergonomique, repose-pieds, clavier adapté si vous avez des troubles de la dextérité [15]. La médecine du travail peut vous accompagner dans ces démarches.
Enfin, gardez toujours sur vous une carte d'urgence mentionnant votre maladie et vos traitements. En cas de problème, les secours sauront immédiatement comment vous prendre en charge.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous amener à consulter rapidement, que vous soyez déjà diagnostiqué ou non [7,14]. Si vous ressentez une faiblesse musculaire qui s'aggrave rapidement, surtout si elle touche vos bras et vos jambes simultanément, ne tardez pas.
Les troubles respiratoires constituent une urgence absolue [8,14]. Essoufflement au repos, difficulté à parler en phrases complètes, ou sensation d'étouffement nécessitent un appel immédiat au 15. Ces symptômes peuvent signaler une atteinte des nerfs respiratoires.
Pour les patients déjà traités, une aggravation brutale des symptômes malgré le traitement doit alerter [5,7]. Cela peut indiquer une résistance thérapeutique ou une complication. Votre neurologue pourra alors adapter votre prise en charge.
D'autres signes justifient une consultation programmée mais rapide : apparition de nouveaux troubles sensitifs, aggravation des douleurs neuropathiques, ou difficultés nouvelles dans les gestes quotidiens [9,13]. N'attendez pas votre consultation de suivi habituelle.
En cas de fièvre chez un patient traité par immunosuppresseurs, la consultation s'impose également [12]. Votre système immunitaire étant affaibli, les infections peuvent être plus graves et nécessiter un traitement précoce.
Bon à savoir : la plupart des centres hospitaliers disposent d'une consultation d'urgence neurologique. N'hésitez pas à les contacter si vous avez un doute sur l'urgence de votre situation.
Médicaments associés
Les médicaments suivants peuvent être prescrits dans le cadre de Polyradiculoneuropathie. Consultez toujours un professionnel de santé avant toute prise de médicament.
Questions Fréquentes
La polyradiculoneuropathie est-elle héréditaire ?
Non, les formes inflammatoires comme la PIDC ne sont pas héréditaires. Il existe des neuropathies héréditaires, mais ce sont des maladies différentes avec d'autres mécanismes.
Puis-je avoir des enfants avec cette maladie ?
Oui, la grossesse est possible mais nécessite un suivi spécialisé. Certains traitements devront être adaptés, et votre neurologue travaillera avec votre gynécologue.
Les immunoglobulines sont-elles dangereuses ?
Les immunoglobulines sont généralement très bien tolérées. Elles sont fabriquées à partir de plasma humain rigoureusement contrôlé. Les effets secondaires graves sont exceptionnels.
Combien de temps dure le traitement ?
La plupart des patients nécessitent un traitement au long cours. Cependant, certains peuvent espacer progressivement leurs perfusions après plusieurs années de stabilité.
Puis-je me faire vacciner ?
Oui, mais certaines précautions s'imposent. Les vaccins inactivés sont généralement sûrs, mais évitez les vaccins vivants. Discutez toujours avec votre médecin avant toute vaccination.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] HYQVIA 100 mg/mL - Avis de la Commission de TransparenceLien
- [2] Stratégie vaccinale de prévention des infections par le VRS chez l'adulte âgé de 60 ans et plusLien
- [3] JNLF 2024 - Programme des innovations thérapeutiquesLien
- [4] Takeda Presents Long-Term Data from ADVANCE-CIDP 3 Clinical TrialLien
- [5] Rituximab versus placebo for chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathyLien
- [6] Novel therapies in CIDPLien
- [7] Polyradiculoneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique: qu'avons-nous appris de la physiopathologie et du traitement?Lien
- [8] Comment j'explore une polyradiculoneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC): focus sur les critères diagnostiques ENMGLien
- [9] Aspects clinique et thérapeutique d'une polyradiculoneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC) à début aiguLien
- [10] Étude pronostique des polyradiculoneuropathies aiguës dans une série pédiatriqueLien
- [11] Chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathies (CIDP) with monotruncular onsetLien
- [12] Clinical and Electrophysiological Pitfalls in the Diagnosis of Acute and Chronic Inflammatory Demyelinating PolyradiculoneuropathiesLien
- [13] Prévalence et caractéristiques des polyradiculoneuropathies démyélinisantes associées au Brentuximab-VedotinLien
- [14] Le blocage de l'IL6: une approche efficace dans les neuropathies induites par les inhibiteurs de checkpoint immunitaireLien
- [15] Polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique - OrphanetLien
- [16] Polyradiculonévrite - Guillain Barré - Fondation HopaleLien
- [17] Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique - MSD ManualsLien
Publications scientifiques
- Polyradiculoneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique: qu'avons-nous appris de la physiopathologie et du traitement? (2025)
- Comment j'explore une polyradiculoneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC): focus sur les critères diagnostiques ENMG (2022)
- Aspects clinique et thérapeutique d'une polyradiculoneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC) à début aigu: à propos d'un cas dans le centre … (2024)
- Étude pronostique des polyradiculoneuropathies aiguës dans une série pédiatrique (2024)
- Chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathies (CIDP) with monotruncular onset: Frequency, clinical features, electrophysiology, and evolution (2025)1 citations
Ressources web
- Polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique (orpha.net)
Le diagnostic est envisagé devant une neuropathie démyélinisante progressive depuis 2 mois, avec chez certains patients des antécédents infectieux. Elle peut ...
- Polyradiculonévrite - Guillain Barré (fondation-hopale.org)
Des signes moteurs (paralysie, amyotrophie, disparition des réflexes, …). · Des signes sensitifs (douleurs à type de brûlures, d'étau, de décharges électriques, ...
- Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique ... (msdmanuals.com)
Les symptômes de la polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique sont similaires à ceux du syndrome de Guillain-Barré. La faiblesse est plus présente ...
- Prise en charge des polyradiculoneuropathies aiguës et ... (revmed.ch)
Les troubles sensitifs peuvent se caractériser par une hypoesthésie, des paresthésies (parfois douloureuses) ou une ataxie. Le patient est souvent gêné par des ...
- PIDC – Polyradiculonévrite Inflammatoire Démyélinisante ... (rarealecoute.com)
9 févr. 2022 — Les symptômes de la PIDC ressemblent à ceux du syndrome de Guillain-Barré (le système immunitaire du patient attaque les nerfs périphériques) : ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
