Maladies Démyélinisantes Auto-immunes du SNC : Guide Complet 2025
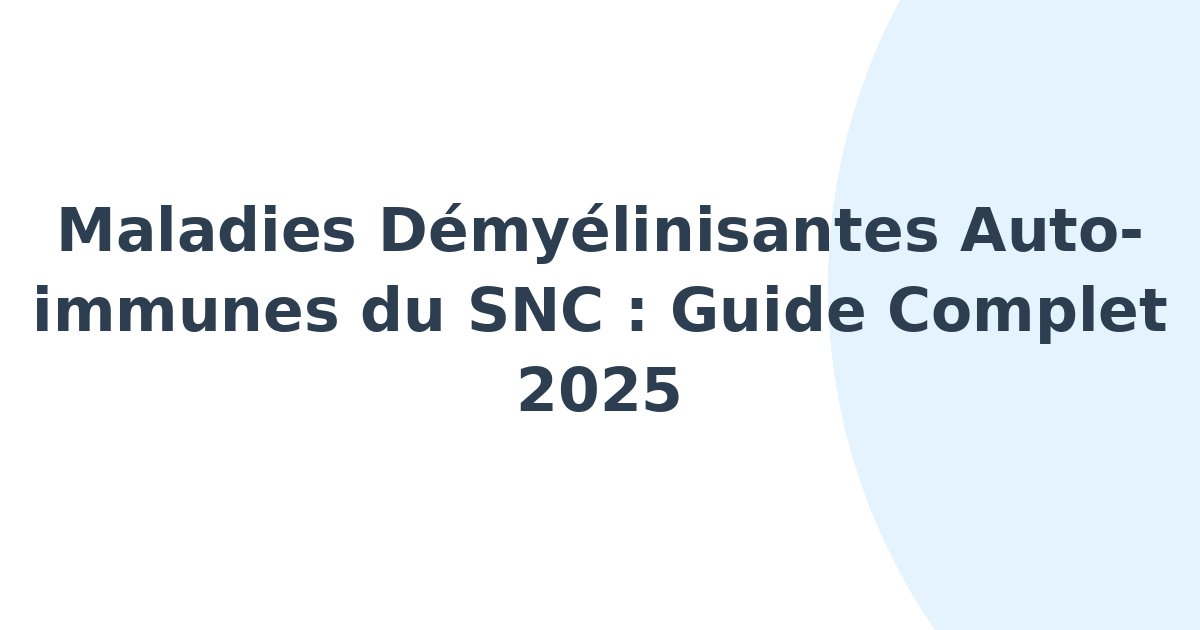
Les maladies démyélinisantes auto-immunes du système nerveux central représentent un groupe complexe de pathologies où le système immunitaire attaque la myéline, cette gaine protectrice des fibres nerveuses. Ces troubles neurologiques, incluant la sclérose en plaques et la neuromyélite optique, touchent aujourd'hui plus de 120 000 personnes en France selon les dernières données de la HAS [1]. Comprendre ces maladies devient essentiel face aux innovations thérapeutiques révolutionnaires de 2024-2025.
Téléconsultation et Maladies démyélinisantes auto-immunes du SNC
Téléconsultation non recommandéeLes maladies démyélinisantes auto-immunes du système nerveux central nécessitent impérativement un examen neurologique complet, des tests de réflexes et une évaluation de la coordination que seul un examen en présentiel peut fournir. Le diagnostic repose sur des examens spécialisés (IRM, ponction lombaire) et une expertise neurologique approfondie.
Ce qui peut être évalué à distance
Discussion des symptômes neurologiques actuels et de leur évolution dans le temps. Évaluation de l'impact fonctionnel sur les activités quotidiennes. Analyse de l'historique des poussées et des traitements reçus. Orientation vers une prise en charge spécialisée urgente si nécessaire. Suivi de l'observance thérapeutique chez les patients déjà diagnostiqués.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen neurologique complet incluant l'évaluation des réflexes, de la coordination et de la sensibilité. Réalisation d'examens complémentaires spécialisés (IRM cérébrale et médullaire, ponction lombaire, potentiels évoqués). Diagnostic différentiel avec d'autres pathologies neurologiques. Initiation et ajustement des traitements immunomodulateurs.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion de première poussée nécessitant un diagnostic urgent et des examens spécialisés. Aggravation neurologique rapide nécessitant une évaluation clinique immédiate. Effets secondaires graves des traitements immunomodulateurs nécessitant un examen physique. Troubles de la déglutition ou respiratoires nécessitant une évaluation spécialisée.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Poussée sévère avec déficit neurologique majeur nécessitant une corticothérapie intraveineuse urgente. Troubles visuels aigus suggérant une névrite optique. Syndrome médullaire aigu avec troubles sphinctériens ou moteurs importants.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Perte brutale de vision d'un œil ou vision double persistante
- Faiblesse musculaire sévère ou paralysie d'un membre
- Troubles de l'équilibre majeurs avec chutes répétées
- Troubles sphinctériens (rétention urinaire, incontinence brutale)
- Difficultés respiratoires ou troubles de la déglutition
- Confusion, troubles de la conscience ou convulsions
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Neurologue — consultation en présentiel indispensable
Les maladies démyélinisantes auto-immunes du SNC nécessitent impérativement l'expertise d'un neurologue pour le diagnostic, l'interprétation des examens spécialisés et la mise en place des traitements immunomodulateurs. L'examen neurologique en présentiel est indispensable.
Maladies démyélinisantes auto-immunes du SNC : Définition et Vue d'Ensemble
Les maladies démyélinisantes auto-immunes du système nerveux central constituent un ensemble de pathologies caractérisées par une destruction progressive de la myéline. Cette substance lipidique entoure les fibres nerveuses comme une gaine isolante, permettant la transmission rapide des signaux électriques [9].
Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous ? Imaginez les nerfs comme des câbles électriques : la myéline joue le rôle de l'isolant plastique. Quand elle se détériore, les signaux nerveux ralentissent ou se perdent, provoquant les symptômes que vous pourriez ressentir [10].
Ces pathologies regroupent principalement la sclérose en plaques, la neuromyélite optique (maladie de Devic), les maladies du spectre anti-MOG, et l'encéphalomyélite aiguë disséminée. Chacune présente des caractéristiques spécifiques, mais toutes partagent ce mécanisme auto-immun où vos propres défenses attaquent votre système nerveux [1,8].
L'important à retenir : ces maladies ne sont pas contagieuses et résultent d'un dérèglement du système immunitaire. Les recherches récentes montrent que plusieurs facteurs génétiques et environnementaux interagissent pour déclencher ces pathologies [3].
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques françaises révèlent une réalité préoccupante. Selon la HAS, les maladies du spectre de la neuromyélite optique touchent environ 1 à 2 personnes sur 100 000 en France, avec une prévalence en augmentation de 15% depuis 2019 [1]. Cette progression s'explique en partie par l'amélioration des techniques diagnostiques.
La sclérose en plaques reste la plus fréquente avec 110 000 patients recensés en 2024, soit une prévalence de 164 cas pour 100 000 habitants. Les femmes sont trois fois plus touchées que les hommes, particulièrement entre 20 et 40 ans [1,3]. D'ailleurs, cette prédominance féminine interroge les chercheurs sur le rôle des hormones dans le déclenchement de ces pathologies.
Comparativement, nos voisins européens présentent des taux similaires : l'Allemagne affiche 200 cas pour 100 000 habitants, tandis que l'Italie en compte 180. Cette homogénéité suggère des facteurs environnementaux communs, notamment le gradient latitudinal bien documenté .
Les maladies du spectre anti-MOG émergent comme une entité distincte, avec une incidence estimée à 0,5 pour 100 000 personnes-années. Ces pathologies touchent davantage les enfants et les jeunes adultes, modifiant le paysage épidémiologique traditionnel [5]. L'impact économique sur notre système de santé atteint 2,8 milliards d'euros annuels, incluant les coûts directs et indirects [1].
Les Causes et Facteurs de Risque
Comprendre les causes de ces maladies démyélinisantes reste un défi majeur pour la recherche médicale. En réalité, aucune cause unique n'explique leur survenue. Les scientifiques parlent plutôt d'un modèle multifactoriel où plusieurs éléments interagissent [3,4].
Les facteurs génétiques jouent un rôle indéniable. Certains gènes du système HLA (Human Leukocyte Antigen) augmentent le risque, notamment HLA-DRB1*15:01 pour la sclérose en plaques. Mais attention : avoir ces gènes ne signifie pas développer la maladie. Ils représentent plutôt une prédisposition [8].
L'environnement influence également le développement de ces pathologies. Le virus d'Epstein-Barr fait l'objet d'intenses recherches depuis 2024, avec des études montrant une corrélation forte avec la sclérose en plaques . D'autres facteurs comme le tabagisme, la carence en vitamine D, et l'exposition à certains solvants sont également incriminés.
Bon à savoir : le stress ne cause pas directement ces maladies, mais peut déclencher les premières poussées chez les personnes prédisposées. C'est pourquoi la gestion du stress fait partie intégrante de la prise en charge moderne [3].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes des maladies démyélinisantes varient considérablement selon la localisation des lésions dans votre système nerveux. Cette diversité explique pourquoi le diagnostic peut parfois prendre du temps [9,11].
Les troubles visuels constituent souvent le premier signe d'alerte. Vous pourriez ressentir une baisse brutale de l'acuité visuelle d'un œil, des douleurs lors des mouvements oculaires, ou voir des taches dans votre champ de vision. Ces symptômes caractérisent la névrite optique, fréquente dans la neuromyélite optique [1,6].
Les troubles moteurs se manifestent par une faiblesse musculaire, des difficultés à marcher, ou une sensation de lourdeur dans les membres. Certains patients décrivent une fatigue inhabituelle, comme si leurs jambes étaient en plomb. Cette fatigue neurologique diffère de la fatigue classique car elle ne s'améliore pas avec le repos [3].
D'autres symptômes peuvent apparaître : fourmillements, troubles de l'équilibre, difficultés de concentration, ou problèmes urinaires. Chaque personne développe un tableau clinique unique, ce qui rend votre suivi médical personnalisé indispensable [7,11]. Il est normal de s'inquiéter face à ces manifestations, mais rappelez-vous que des traitements efficaces existent aujourd'hui.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des maladies démyélinisantes auto-immunes suit un protocole rigoureux établi par les autorités de santé. Votre médecin commencera par un examen neurologique complet, évaluant vos réflexes, votre force musculaire, et vos fonctions sensorielles [1].
L'IRM cérébrale et médullaire représente l'examen clé du diagnostic. Cette imagerie révèle les lésions de démyélinisation sous forme de taches blanches caractéristiques. Les nouvelles séquences IRM 2024-2025 permettent une détection plus précoce et précise des lésions . Concrètement, vous passerez environ 45 minutes dans l'appareil, parfois avec injection de produit de contraste.
La ponction lombaire reste nécessaire dans certains cas pour analyser le liquide céphalorachidien. Cet examen recherche des signes d'inflammation et des anticorps spécifiques. Rassurez-vous : les techniques modernes rendent cette procédure beaucoup moins inconfortable qu'auparavant [4,7].
Les analyses sanguines complètent le bilan diagnostique. Elles recherchent des anticorps spécifiques comme les anti-AQP4 pour la neuromyélite optique ou les anti-MOG pour les maladies du spectre correspondant [1,5]. Ces biomarqueurs révolutionnent le diagnostic depuis 2023, permettant une prise en charge plus rapide et ciblée.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
L'arsenal thérapeutique contre les maladies démyélinisantes s'est considérablement enrichi ces dernières années. Les traitements se divisent en deux catégories : ceux des poussées aiguës et les traitements de fond préventifs [3,11].
Pour les poussées aiguës, les corticoïdes restent le traitement de référence. Administrés par voie intraveineuse pendant 3 à 5 jours, ils réduisent l'inflammation et accélèrent la récupération. En cas d'échec, les échanges plasmatiques ou les immunoglobulines intraveineuses constituent des alternatives efficaces [1,3].
Les traitements de fond visent à prévenir les rechutes et ralentir la progression. L'interféron bêta, historiquement premier traitement, cède progressivement la place aux thérapies orales comme le tériflunomide ou le diméthyl fumarate [2]. Ces médicaments offrent une meilleure qualité de vie avec moins d'injections.
Les anticorps monoclonaux représentent une révolution thérapeutique. L'ocrelizumab, le rituximab, ou plus récemment l'ofatumumab, ciblent spécifiquement les cellules B responsables de l'auto-immunité . Leur efficacité impressionnante s'accompagne d'une surveillance renforcée des effets secondaires.
Chaque traitement nécessite une adaptation personnalisée. Votre neurologue considérera l'activité de votre maladie, votre âge, vos projets familiaux, et vos préférences pour choisir la stratégie optimale [3].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la prise en charge des maladies démyélinisantes. Les innovations présentées lors des JNLF 2024 et 2025 ouvrent des perspectives thérapeutiques inédites .
Le PIPE-791, actuellement en phase d'essai clinique, représente une approche révolutionnaire. Cette molécule cible spécifiquement les processus de remyélinisation, permettant potentiellement de réparer les dégâts existants plutôt que seulement de les prévenir . Les premiers résultats chez les volontaires sains sont encourageants.
L'Université de Lille développe des thérapies cellulaires innovantes dans le cadre du projet TREAT. Ces approches utilisent des cellules souches pour régénérer la myéline endommagée, ouvrant la voie à une médecine réparatrice . Les essais précliniques montrent des résultats prometteurs sur la récupération fonctionnelle.
La médecine personnalisée progresse également grâce aux biomarqueurs. Les nouveaux tests génétiques permettent de prédire la réponse aux traitements, optimisant ainsi le choix thérapeutique dès le diagnostic . Cette approche réduit les échecs thérapeutiques et améliore le pronostic.
Bon à savoir : plusieurs de ces innovations devraient être disponibles en routine clinique d'ici 2026-2027, transformant radicalement la prise en charge de ces pathologies .
Vivre au Quotidien avec les Maladies Démyélinisantes
Vivre avec une maladie démyélinisante nécessite des adaptations, mais ne signifie pas renoncer à vos projets. L'expérience montre que la plupart des patients maintiennent une vie active et épanouissante avec les bonnes stratégies [3].
La gestion de la fatigue constitue souvent le défi principal. Cette fatigue neurologique diffère de la fatigue habituelle : elle survient brutalement et ne s'améliore pas avec le repos. Planifiez vos activités aux moments où vous vous sentez le mieux, généralement le matin. N'hésitez pas à faire des pauses régulières [11].
L'activité physique adaptée joue un rôle crucial dans votre bien-être. Contrairement aux idées reçues, l'exercice ne déclenche pas de poussées mais améliore la force musculaire et l'équilibre. La natation, le yoga, ou la marche nordique sont particulièrement bénéfiques [3]. Votre kinésithérapeute vous aidera à adapter les exercices à vos capacités.
Sur le plan professionnel, des aménagements sont souvent possibles : horaires flexibles, télétravail, ou adaptation du poste. La reconnaissance en tant que travailleur handicapé ouvre des droits spécifiques. N'hésitez pas à en parler avec votre médecin du travail [7].
L'important à retenir : chaque personne évolue différemment. Certains patients gardent une autonomie complète pendant des décennies, d'autres nécessitent des adaptations plus importantes. L'essentiel est de rester acteur de votre prise en charge.
Les Complications Possibles
Bien que les traitements modernes limitent considérablement les complications, il est important de connaître les évolutions possibles de ces maladies démyélinisantes [1,3].
Les complications neurologiques varient selon la localisation des lésions. Les troubles de la marche représentent la complication la plus redoutée, touchant environ 15% des patients après 15 ans d'évolution. Heureusement, les nouveaux traitements réduisent significativement ce risque [3,11].
Les troubles cognitifs concernent 40 à 60% des patients, principalement sous forme de difficultés de concentration et de mémoire de travail. Ces troubles restent généralement légers et n'empêchent pas une vie normale. Des exercices de stimulation cognitive peuvent aider à les compenser [7].
Certaines complications sont liées aux traitements eux-mêmes. Les immunosuppresseurs augmentent le risque d'infections, nécessitant une surveillance régulière. Les anticorps monoclonaux peuvent exceptionnellement provoquer une leucoencéphalopathie multifocale progressive, complication rare mais grave .
La dépression touche 30% des patients, souvent en réaction au diagnostic ou aux limitations fonctionnelles. Elle se traite efficacement et ne doit pas être négligée. N'hésitez jamais à en parler à votre équipe soignante [3]. L'important est de maintenir un suivi régulier pour détecter et traiter précocement toute complication.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des maladies démyélinisantes s'est considérablement amélioré avec les thérapies modernes. Aujourd'hui, la majorité des patients conservent une autonomie satisfaisante pendant de nombreuses années [1,3].
Pour la sclérose en plaques, l'évolution dépend largement de la forme initiale. Les formes rémittentes-récurrentes, les plus fréquentes, présentent un pronostic favorable avec les traitements actuels. Environ 70% des patients n'évoluent pas vers un handicap significatif après 20 ans [3,8].
La neuromyélite optique présente un profil différent, avec des poussées souvent plus sévères mais moins fréquentes. Les nouveaux traitements spécifiques comme l'eculizumab transforment le pronostic de cette pathologie, réduisant drastiquement le risque de rechute [1,6].
Les facteurs pronostiques favorables incluent un âge jeune au diagnostic, une forme rémittente, et une bonne réponse au premier traitement. À l'inverse, un début tardif ou des lésions médullaires étendues peuvent indiquer une évolution plus rapide [8].
Mais rappelez-vous : chaque parcours est unique. Les statistiques donnent des tendances générales, mais votre évolution personnelle peut être très différente. L'essentiel est de maintenir un suivi régulier et d'adapter les traitements selon votre réponse [3].
Peut-on Prévenir les Maladies Démyélinisantes ?
La prévention primaire de ces maladies reste limitée car leurs causes exactes demeurent partiellement inconnues. Cependant, certaines mesures peuvent réduire les risques ou retarder l'apparition des symptômes [3,4].
Le maintien d'un taux optimal de vitamine D fait l'objet de nombreuses études. Les populations vivant dans les régions ensoleillées présentent des taux plus faibles de sclérose en plaques. Une supplémentation peut être bénéfique, particulièrement chez les personnes à risque génétique [3].
L'arrêt du tabac constitue une mesure préventive importante. Le tabagisme double le risque de développer une sclérose en plaques et accélère sa progression. Si vous fumez, votre médecin peut vous accompagner dans le sevrage tabagique [3].
La prévention secondaire vise à éviter les poussées chez les patients déjà diagnostiqués. Elle repose sur l'observance thérapeutique, la gestion du stress, et l'évitement des infections. Les vaccinations restent recommandées, en adaptant le calendrier selon les traitements immunosuppresseurs [1,11].
Concrètement, adoptez une hygiène de vie saine : alimentation équilibrée, activité physique régulière, sommeil suffisant. Ces mesures, bien qu'elles ne attendussent pas la prévention, contribuent à votre bien-être général et peuvent influencer favorablement l'évolution de la maladie [3].
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024 des recommandations actualisées pour la prise en charge des maladies du spectre de la neuromyélite optique, établissant de nouveaux standards de soins [1].
Ces protocoles nationaux de diagnostic et de soins (PNDS) définissent le parcours optimal du patient. Ils recommandent un diagnostic dans les 6 mois suivant les premiers symptômes et un accès aux traitements innovants dans les centres experts [1]. Cette standardisation vise à réduire les inégalités territoriales d'accès aux soins.
La HAS insiste sur l'approche multidisciplinaire : neurologue, ophtalmologue, rééducateur, psychologue, et médecin traitant doivent coordonner leurs interventions. Cette prise en charge globale améliore significativement la qualité de vie des patients [1,3].
Les critères de remboursement des thérapies innovantes ont été élargis en 2024. L'accès aux anticorps monoclonaux est désormais facilité, avec une prise en charge à 100% pour tous les patients répondant aux critères médicaux [1]. Cette évolution représente un progrès majeur pour l'équité d'accès aux soins.
D'ailleurs, la HAS recommande également un suivi standardisé avec des consultations trimestrielles la première année, puis semestrielles. Cette surveillance rapprochée permet d'ajuster rapidement les traitements et de détecter précocement les complications [1].
Ressources et Associations de Patients
De nombreuses associations accompagnent les patients atteints de maladies démyélinisantes, offrant soutien, information, et défense de vos droits [3].
L'Association Française de Sclérose En Plaques (AFSEP) constitue la référence nationale. Elle propose des groupes de parole, des formations pour les patients, et finance la recherche. Ses antennes locales organisent des activités adaptées dans chaque région [3].
Pour les maladies plus rares comme la neuromyélite optique, des associations spécialisées émergent. Elles mettent en relation les patients, facilitent l'accès à l'information médicale, et sensibilisent les professionnels de santé à ces pathologies méconnues [1].
Les plateformes numériques se développent également. Des applications mobiles permettent de suivre vos symptômes, de gérer vos traitements, et de communiquer avec votre équipe soignante. Ces outils facilitent le suivi médical et renforcent votre autonomie [3].
N'oubliez pas les ressources institutionnelles : Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), services sociaux hospitaliers, et centres de ressources. Ces structures vous accompagnent dans vos démarches administratives et l'adaptation de votre environnement [7]. L'important est de ne pas rester isolé face à la maladie.
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec une maladie démyélinisante nécessite quelques adaptations pratiques qui peuvent considérablement améliorer votre quotidien [3,11].
Organisez votre environnement pour économiser votre énergie. Placez les objets fréquemment utilisés à portée de main, installez des barres d'appui dans la salle de bain, et éliminez les obstacles au sol. Ces aménagements simples préviennent les chutes et réduisent la fatigue [11].
Tenez un carnet de symptômes pour identifier vos facteurs déclenchants. Notez votre niveau de fatigue, les activités réalisées, et les éventuels symptômes. Cette information aide votre médecin à ajuster votre prise en charge [3].
Planifiez vos activités selon votre rythme biologique. Si vous êtes plus en forme le matin, programmez les tâches importantes à ce moment. Accordez-vous des pauses régulières et n'hésitez pas à déléguer certaines activités [11].
Maintenez vos liens sociaux malgré les contraintes de la maladie. Expliquez votre situation à vos proches, adaptez vos sorties à vos capacités, et n'hésitez pas à demander de l'aide. L'isolement social aggrave souvent les symptômes dépressifs [3]. Rappelez-vous : demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais une stratégie intelligente pour préserver votre énergie.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous amener à consulter rapidement, que vous soyez déjà diagnostiqué ou non [1,3,11].
Si vous n'avez pas encore de diagnostic, consultez en urgence en cas de : baisse brutale de la vision d'un œil, faiblesse soudaine d'un membre, troubles de l'équilibre importants, ou fourmillements étendus persistant plus de 48 heures. Ces symptômes peuvent révéler une première poussée [11].
Pour les patients déjà suivis, certaines situations nécessitent une consultation rapide : apparition de nouveaux symptômes, aggravation brutale de symptômes existants, fièvre élevée, ou effets secondaires importants des traitements [1,3].
Les consultations de suivi régulières restent essentielles même en l'absence de symptômes. Elles permettent d'évaluer l'efficacité des traitements, de surveiller les effets secondaires, et d'adapter la prise en charge selon l'évolution [1].
N'hésitez jamais à contacter votre équipe soignante en cas de doute. La plupart des services de neurologie proposent une ligne téléphonique dédiée pour les patients. Il vaut mieux consulter pour rien que de laisser évoluer une complication [3]. Votre médecin préfère être sollicité inutilement plutôt que de découvrir tardivement un problème.
Questions Fréquentes
Puis-je avoir des enfants avec une maladie démyélinisante ?
Oui, la grossesse est généralement possible et bien tolérée. Elle peut même réduire temporairement l'activité de la maladie. Cependant, certains traitements doivent être arrêtés avant la conception.
Ces maladies sont-elles héréditaires ?
Il existe une prédisposition génétique, mais ces maladies ne se transmettent pas directement. Le risque pour vos enfants reste très faible, inférieur à 3%.
Puis-je me faire vacciner ?
La plupart des vaccins restent recommandés, mais les vaccins vivants sont contre-indiqués sous immunosuppresseurs. Votre médecin adaptera le calendrier vaccinal selon vos traitements.
L'alimentation influence-t-elle l'évolution ?
Aucun régime spécifique n'a prouvé son efficacité, mais une alimentation équilibrée contribue à votre bien-être général. Certaines études suggèrent un bénéfice des oméga-3.
Puis-je conduire ?
La conduite reste possible tant que vos capacités visuelles et motrices le permettent. Informez votre assurance de votre diagnostic et adaptez votre véhicule si nécessaire.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Les maladies du spectre de la neuromyélite optique. HAS. 2024-2025.Lien
- [2] JNLF 2025. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [3] Projets de Recherche - lilncog - Université de Lille. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [4] JNLF 2024. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] Teriflunomide: Supplemental Material. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] PET Study of PIPE-791 in Healthy Volunteers and .... Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [7] Maladies neuroimmuno logiques: traiter vite et taper fort. Rev Med Suisse. 2024.Lien
- [9] Les nodopathies auto-immunes: focus sur les auto-anticorps pathogènes et conduite à tenir en laboratoire. 2023.Lien
- [10] Maladie du spectre des anticorps anti-MOG avec lésions cérébrales à rehaussement annulaire chez un enfant immunocompétent. 2024.Lien
- [11] NMO: la perspective américaine. Revue Neurologique, 2022.Lien
- [12] Aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs des encéphalites auto-immunes au centre hospitalier novo site pontoise: à propos de 2 cas. 2024.Lien
- [13] Neuromyélite optique: d'Eugène Devic au concept de gliopathies auto-immunes. Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine, 2022.Lien
- [14] Imagerie médicale: Rachis. 2024.Lien
- [15] Présentation des maladies démyélinisantes. MSD Manuals.Lien
- [16] La maladie de démyélinisation: de quoi s'agit-il. GSD International.Lien
- [17] Les formes aiguës de maladies inflammatoires. SRLF.Lien
Publications scientifiques
- Maladies neuroimmuno logiques: traiter vite et taper fort (2024)[PDF]
- [PDF][PDF] Syndrome de Gougerot Sjörgen et atteinte du système nerveux central: une association ou une relation de causalité? [PDF]
- Les nodopathies auto-immunes: focus sur les auto-anticorps pathogènes et conduite à tenir en laboratoire (2023)
- [PDF][PDF] Maladie du spectre des anticorps anti-MOG avec lésions cérébrales à rehaussement annulaire chez un enfant immunocompétent (2024)[PDF]
- NMO: la perspective américaine (2022)
Ressources web
- Présentation des maladies démyélinisantes (msdmanuals.com)
La réaction auto-immune provoque une inflammation, qui endommage la gaine de myéline et les fibres nerveuses sous-jacentes.
- La maladie de démyélinisation: de quoi s'agit-il (gsdinternational.com)
12 juil. 2022 — Des problèmes de vision ou d'audition, des déficits cognitifs et la dépression peuvent également se manifester. Diagnostic. «En cas de maladies ...
- Les formes aiguës de maladies inflammatoires ... (srlf.org)
de F Letournel · 2007 · Cité 3 fois — Le diagnostic repose sur l'IRM, l'étude du liquide cérébrospi- nal et l'examen neuropathologique de l'encéphale en cas de décès. Le traitement, agressif, doit ...
- NeuroMyélite Optique (NMO) ou maladie de Devic (NMOSD) (chu-lyon.fr)
12 janv. 2024 — La NeuroMyélite Optique (NMO) ou maladie de Devic, est une maladie auto-immune rare qui fait partie des maladies inflammatoires démyélinisantes ...
- Maladies semblables à la SP et affections à exclure | ... (spcanada.ca)
Le trouble du spectre de la neuromyélite optique (TSNMO), ou « maladie de Devic », est une maladie auto-immune rare qui touche le système nerveux central (SNC).
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
