Pertes Vaginales : Guide Complet 2025 - Causes, Traitements et Innovations
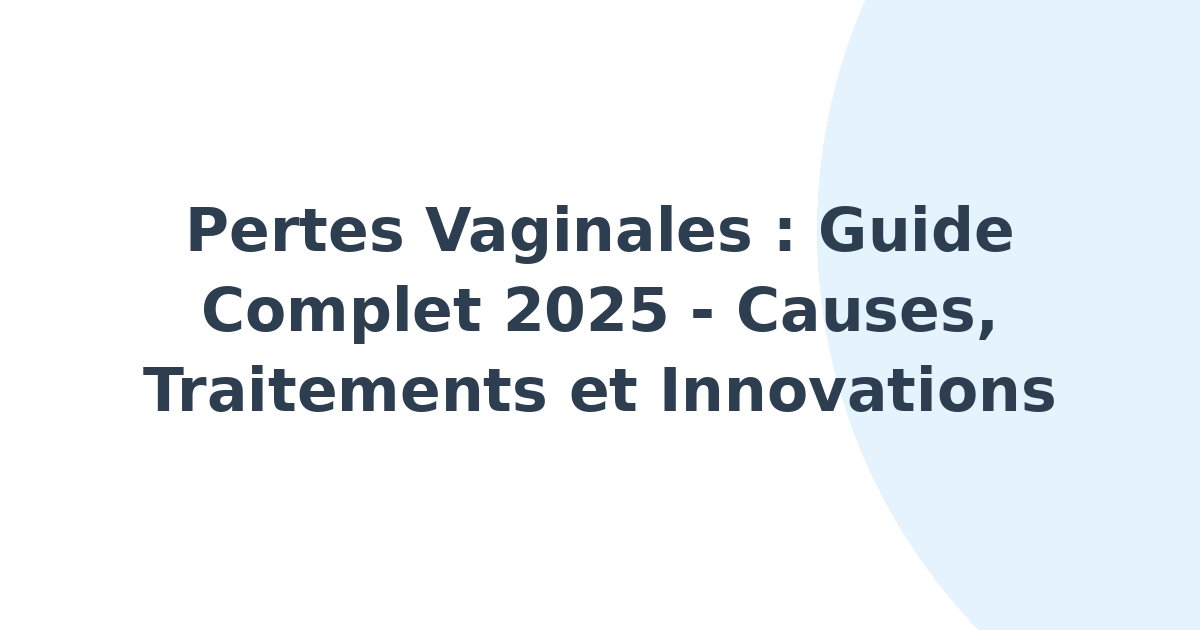
Les pertes vaginales concernent la majorité des femmes à un moment de leur vie. Phénomène naturel ou signal d'alarme ? Cette question préoccupe de nombreuses patientes. En France, plus de 75% des femmes consultent au moins une fois pour des pertes vaginales anormales [1]. Comprendre les différents types de pertes, leurs causes et leurs traitements vous permettra de mieux gérer votre santé intime.
Téléconsultation et Perte vaginale
Partiellement adaptée à la téléconsultationLes pertes vaginales peuvent être partiellement évaluées à distance par la description des symptômes (aspect, couleur, odeur, symptômes associés) et l'analyse des antécédents. Cependant, l'examen gynécologique et les prélèvements bactériologiques sont souvent nécessaires pour un diagnostic précis et une prise en charge adaptée.
Ce qui peut être évalué à distance
Description détaillée des caractéristiques des pertes (couleur, aspect, odeur, abondance), analyse des symptômes associés (démangeaisons, brûlures, douleurs), évaluation du contexte (cycle menstruel, activité sexuelle, hygiène), orientation diagnostique initiale selon les symptômes décrits, prescription d'un traitement probabiliste dans certains cas simples.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen gynécologique pour évaluer l'état de la vulve et du vagin, prélèvements vaginaux pour analyse bactériologique et mycologique, recherche d'infections sexuellement transmissibles si nécessaire, évaluation en cas de récidives fréquentes ou de résistance aux traitements.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Préparer votre téléconsultation
Pour que votre téléconsultation soit la plus efficace possible, préparez les éléments suivants :
- Symptômes et durée : Noter précisément l'aspect des pertes (couleur, consistance, odeur), leur abondance, la présence de démangeaisons, brûlures ou douleurs, la durée des symptômes et leur évolution, le lien avec le cycle menstruel.
- Traitements en cours : Mentionner les traitements antifongiques (fluconazole, éconazole), antibiotiques récents, contraceptifs hormonaux, traitements immunosuppresseurs, probiotiques ou soins d'hygiène intime utilisés.
- Antécédents médicaux pertinents : Antécédents d'infections vaginales récurrentes, diabète, immunodépression, allergies médicamenteuses, antécédents d'infections sexuellement transmissibles, nombre de partenaires sexuels.
- Examens récents disponibles : Résultats de prélèvements vaginaux récents, bilans biologiques (glycémie, sérologies), examens gynécologiques antérieurs, frottis cervico-utérin récent.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Pertes vaginales récidivantes malgré plusieurs traitements, suspicion d'infection sexuellement transmissible nécessitant des prélèvements, pertes associées à des douleurs pelviennes importantes, pertes hémorragiques en dehors des règles nécessitant un examen gynécologique.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Pertes associées à de la fièvre et des douleurs pelviennes intenses évoquant une infection pelvienne, saignements vaginaux abondants avec retentissement sur l'état général, pertes purulentes avec altération de l'état général.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Fièvre élevée associée aux pertes vaginales avec douleurs pelviennes intenses
- Saignements vaginaux abondants avec vertiges ou malaise
- Pertes purulentes avec altération importante de l'état général
- Douleurs pelviennes sévères irradiant dans le dos avec nausées et vomissements
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Gynécologue — consultation en présentiel recommandée
Le gynécologue est le spécialiste le plus adapté pour l'examen clinique et les prélèvements nécessaires. Une consultation en présentiel est généralement recommandée pour un diagnostic précis, sauf pour les récidives de mycoses simples déjà documentées.

- Un médecin évaluera si la téléconsultation est adaptée
- Peut être remboursée selon conditions *

Pertes Vaginales : Définition et Vue d'Ensemble
Les pertes vaginales désignent toute sécrétion provenant du vagin. Mais attention, toutes les pertes ne sont pas pathologiques ! En fait, le vagin produit naturellement des sécrétions pour maintenir son équilibre et sa protection [7,8].
Concrètement, on distingue deux types principaux : les pertes physiologiques (normales) et les pertes pathologiques (anormales). Les premières varient selon votre cycle menstruel, votre âge et vos hormones. D'ailleurs, ces variations sont parfaitement normales et témoignent du bon fonctionnement de votre système reproducteur.
Les pertes pathologiques, elles, s'accompagnent généralement de symptômes gênants. Démangeaisons, odeurs désagréables, brûlures ou changement de couleur doivent vous alerter [1,7]. L'important à retenir : votre corps vous parle, il faut savoir l'écouter.
Le microbiote vaginal joue un rôle crucial dans cet équilibre délicat. Composé principalement de lactobacilles, il maintient un pH acide protecteur [4]. Quand cet équilibre se rompt, les troubles apparaissent.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, les infections vaginales représentent un motif de consultation majeur en gynécologie. Selon les données récentes de l'Assurance Maladie, 75% des femmes présentent au moins un épisode de mycose vaginale au cours de leur vie [1]. Ces chiffres révèlent l'ampleur du problème de santé publique.
L'incidence annuelle des vaginites infectieuses atteint 15 à 20% chez les femmes en âge de procréer [5]. Mais ces données varient considérablement selon l'âge : les adolescentes et les femmes ménopausées présentent des profils différents. D'ailleurs, l'activité sexuelle influence directement ces statistiques.
Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne haute. Les pays nordiques affichent des taux légèrement inférieurs, probablement liés à des différences d'hygiène et d'habitudes vestimentaires. Cependant, les méthodes de diagnostic et de déclaration varient entre pays, rendant les comparaisons délicates .
L'évolution temporelle montre une stabilité relative sur les dix dernières années. Néanmoins, certains facteurs modernes comme le stress, l'alimentation industrielle et l'usage d'antibiotiques pourraient influencer ces tendances. Les projections pour 2025-2030 suggèrent une légère augmentation, notamment chez les jeunes femmes .
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes des pertes vaginales anormales sont multiples et souvent intriquées. Les infections représentent la première cause : mycoses (Candida), vaginoses bactériennes et infections sexuellement transmissibles [1,7]. Chaque type d'infection présente ses propres caractéristiques.
Les facteurs hormonaux jouent un rôle déterminant. Grossesse, contraception hormonale, ménopause : tous ces états modifient l'équilibre vaginal [4]. En effet, les œstrogènes influencent directement la composition du microbiote et la production de sécrétions.
Certaines habitudes quotidiennes favorisent les déséquilibres. Port de vêtements serrés, sous-vêtements synthétiques, douches vaginales excessives : autant de facteurs de risque souvent méconnus [1]. L'hygiène intime, paradoxalement, peut devenir problématique quand elle est excessive.
Les traitements médicamenteux, notamment les antibiotiques, perturbent fréquemment la flore vaginale [5]. Le diabète, le stress chronique et certaines maladies auto-immunes constituent également des facteurs prédisposants. Bon à savoir : l'alimentation riche en sucres peut favoriser les mycoses récidivantes.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Reconnaître les symptômes des pertes vaginales anormales nécessite d'observer plusieurs éléments. La couleur constitue le premier indice : pertes blanches épaisses (mycose), grisâtres malodorantes (vaginose), verdâtres (trichomonas) [7,8]. Chaque couleur raconte une histoire différente.
L'odeur représente un critère diagnostique majeur. Les pertes normales sont inodores ou légèrement acidulées. Une odeur de poisson évoque une vaginose bactérienne, tandis qu'une odeur sucrée peut suggérer un diabète sous-jacent [1]. Néanmoins, certaines femmes présentent naturellement des odeurs plus marquées.
Les démangeaisons et brûlures accompagnent fréquemment les infections. Intensité, localisation et moment d'apparition orientent le diagnostic. Les mycoses provoquent des démangeaisons intenses, surtout nocturnes. Les infections bactériennes causent plutôt des brûlures mictionnelles [7].
D'autres symptômes peuvent s'associer : douleurs pelviennes, saignements entre les règles, dyspareunie (douleurs lors des rapports). Ces signes nécessitent une consultation rapide car ils peuvent révéler des pathologies plus sérieuses [6,8].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des pertes vaginales anormales suit une démarche structurée. L'interrogatoire médical constitue la première étape cruciale. Votre médecin vous questionnera sur les caractéristiques des pertes, leur évolution, vos antécédents et vos habitudes [1,6].
L'examen clinique comprend l'inspection des organes génitaux externes et l'examen au spéculum. Cette étape permet d'observer directement les pertes et d'évaluer l'état de la muqueuse vaginale. Rassurez-vous, cet examen est généralement indolore et rapide [7].
Les prélèvements bactériologiques confirment le diagnostic. L'examen direct au microscope révèle immédiatement certains agents pathogènes. La culture bactérienne, plus longue, identifie précisément les germes et teste leur sensibilité aux antibiotiques [5]. Ces analyses sont essentielles pour un traitement ciblé.
Les innovations diagnostiques 2024-2025 révolutionnent la prise en charge. Le test Cobas® BV/CV permet un diagnostic rapide et fiable des vaginoses et candidoses [2]. Cette technologie améliore significativement la précision diagnostique et réduit les délais de traitement.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Les traitements des pertes vaginales varient selon la cause identifiée. Pour les mycoses, les antifongiques restent le traitement de référence : ovules, crèmes ou comprimés oraux [1,7]. L'efficacité atteint 90% avec un traitement adapté. Cependant, le choix de la forme galénique dépend de vos préférences et de la sévérité.
Les vaginoses bactériennes nécessitent des antibiotiques spécifiques. Métronidazole et clindamycine constituent les molécules de première intention [5]. Le traitement local (ovules, gels) présente moins d'effets secondaires que la voie orale. D'ailleurs, certaines femmes préfèrent cette approche pour éviter les troubles digestifs.
Les infections sexuellement transmissibles requièrent des protocoles particuliers. Trichomonas, chlamydia, gonorrhée : chaque agent pathogène a son traitement spécifique [7]. L'important : traiter simultanément le ou les partenaires pour éviter les réinfections.
Les probiotiques vaginaux gagnent en popularité comme traitement adjuvant. Ils restaurent l'équilibre du microbiote et préviennent les récidives [4]. Bien que leur efficacité soit encore débattue, de nombreuses patientes rapportent des bénéfices. Les souches de Lactobacillus crispatus et L. jensenii montrent les meilleurs résultats.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
La recherche sur les pertes vaginales connaît des avancées remarquables en 2024-2025. L'étude clinique sur l'effet de la curcumine ouvre de nouvelles perspectives thérapeutiques [3]. Cette épice aux propriétés anti-inflammatoires pourrait révolutionner le traitement des vaginites récidivantes.
Les résultats préliminaires montrent une réduction significative des symptômes chez 70% des patientes traitées par curcumine. Mais attention, ces données nécessitent confirmation par des études plus larges. Néanmoins, cette approche naturelle séduit de nombreuses femmes lassées des traitements conventionnels [3].
L'Elinzanetant représente une autre innovation majeure, particulièrement pour les femmes ménopausées . Ce médicament réduit les symptômes vasomoteurs et améliore l'équilibre hormonal vaginal. Les essais cliniques 2024 démontrent une efficacité supérieure aux traitements hormonaux classiques.
La médecine personnalisée fait également son entrée dans ce domaine. L'analyse du microbiome vaginal permet désormais de personnaliser les traitements [4]. Cette approche sur-mesure améliore l'efficacité thérapeutique et réduit les récidives. Concrètement, votre médecin pourra bientôt adapter le traitement à votre profil microbien unique.
Vivre au Quotidien avec des Pertes Vaginales
Vivre avec des pertes vaginales récurrentes impacte significativement la qualité de vie. L'inconfort physique s'accompagne souvent d'une gêne psychologique importante. Beaucoup de femmes développent une anxiété liée à l'intimité et aux relations sexuelles [6].
L'adaptation vestimentaire devient nécessaire. Privilégiez les sous-vêtements en coton, évitez les vêtements trop serrés et changez régulièrement de protection. Ces gestes simples réduisent l'humidité et limitent la prolifération microbienne [1]. D'ailleurs, certaines femmes trouvent un soulagement avec des protège-slips respirants.
L'hygiène intime doit être repensée. Toilette externe uniquement, produits doux sans parfum, séchage minutieux : ces règles préservent l'équilibre vaginal [7]. Paradoxalement, l'excès d'hygiène aggrave souvent les symptômes. L'eau claire suffit généralement pour la toilette quotidienne.
La vie sexuelle nécessite parfois des ajustements temporaires. Communication avec le partenaire, utilisation de lubrifiants adaptés, positions confortables : autant de stratégies pour maintenir l'intimité [8]. Heureusement, la plupart des troubles se résolvent avec un traitement approprié.
Les Complications Possibles
Les complications des pertes vaginales non traitées peuvent être sérieuses. L'extension de l'infection vers les organes génitaux internes constitue le risque principal. Salpingites, endométrites et abcès pelviens représentent des urgences gynécologiques [6].
Chez la femme enceinte, certaines infections vaginales augmentent le risque d'accouchement prématuré. La vaginose bactérienne multiplie par deux ce risque . D'ailleurs, le dépistage systématique pendant la grossesse permet une prise en charge précoce. Les infections à streptocoque B nécessitent une attention particulière.
Les récidives fréquentes peuvent évoluer vers une forme chronique difficile à traiter. Cette situation affecte profondément la qualité de vie et peut conduire à des troubles psychologiques [6]. Certaines femmes développent une véritable phobie des relations sexuelles.
Les complications chirurgicales, bien que rares, existent lors de procédures gynécologiques sur terrain infecté . C'est pourquoi votre chirurgien vérifiera toujours l'absence d'infection avant toute intervention. La prévention reste la meilleure stratégie pour éviter ces complications.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des pertes vaginales est généralement excellent avec un traitement approprié. La majorité des infections aiguës guérissent en 7 à 14 jours [1,7]. Cependant, le taux de récidive varie selon le type d'infection : 5% pour les mycoses occasionnelles, 40% pour les vaginoses bactériennes.
Les facteurs pronostiques incluent l'âge, l'état immunitaire et les habitudes de vie. Les femmes jeunes et en bonne santé présentent généralement une évolution favorable [5]. En revanche, le diabète, l'immunodépression ou certains traitements peuvent compliquer la guérison.
La mycose récidivante (plus de 4 épisodes par an) concerne 5% des femmes. Cette forme nécessite une prise en charge spécialisée et un traitement prolongé [7]. Heureusement, de nouveaux protocoles thérapeutiques améliorent significativement le pronostic de ces formes résistantes.
L'évolution à long terme dépend largement de la prévention. Adoption de bonnes habitudes hygiéniques, gestion du stress, alimentation équilibrée : ces mesures réduisent considérablement le risque de récidive [4]. La plupart des femmes retrouvent un équilibre vaginal normal avec un suivi adapté.
Peut-on Prévenir les Pertes Vaginales ?
La prévention des pertes vaginales anormales repose sur des mesures simples mais efficaces. L'hygiène intime appropriée constitue la base : toilette externe uniquement, produits doux, sous-vêtements en coton [1,7]. Ces gestes préservent l'équilibre naturel du microbiote vaginal.
L'alimentation joue un rôle souvent sous-estimé. Réduire les sucres raffinés limite la prolifération des candida. À l'inverse, les aliments riches en probiotiques (yaourts, kéfir) renforcent la flore protectrice [4]. Certaines femmes constatent une amélioration notable en modifiant leur régime alimentaire.
La gestion du stress influence directement l'immunité locale. Techniques de relaxation, activité physique régulière, sommeil suffisant : ces facteurs renforcent vos défenses naturelles [6]. D'ailleurs, beaucoup de récidives surviennent lors de périodes stressantes.
Les mesures préventives spécifiques incluent : éviter les douches vaginales, changer rapidement les vêtements humides, uriner après les rapports sexuels [8]. Ces habitudes simples réduisent significativement le risque d'infection. La prévention reste plus efficace que le traitement !
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont établi des recommandations précises concernant la prise en charge des pertes vaginales. L'Assurance Maladie préconise une consultation médicale pour tout changement notable des sécrétions vaginales [1]. Cette approche précoce évite les complications et les traitements inadaptés.
La Haute Autorité de Santé (HAS) insiste sur l'importance du diagnostic différentiel. Les prélèvements bactériologiques sont recommandés avant tout traitement antibiotique . Cette démarche limite l'émergence de résistances et améliore l'efficacité thérapeutique.
Le programme I-STOP vise à optimiser l'usage des antibiotiques dans les infections génitales . Les médecins sont encouragés à privilégier les traitements locaux quand c'est possible. Cette stratégie préserve le microbiote intestinal et réduit les effets secondaires systémiques.
Les recommandations 2024-2025 intègrent les nouvelles technologies diagnostiques et les approches personnalisées [2]. L'accent est mis sur la prévention et l'éducation des patientes. Ces évolutions marquent un tournant vers une médecine plus préventive et individualisée.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations accompagnent les femmes souffrant de troubles gynécologiques récurrents. L'Association Française d'Urologie propose des ressources spécialisées sur les infections génitales . Leurs brochures d'information sont particulièrement appréciées des patientes.
Les forums en ligne constituent une source de soutien précieuse. Partage d'expériences, conseils pratiques, soutien moral : ces communautés virtuelles aident de nombreuses femmes [6]. Cependant, attention aux informations non vérifiées qui circulent parfois.
Votre pharmacien représente un interlocuteur de proximité essentiel. Formation spécialisée, conseils personnalisés, suivi thérapeutique : il joue un rôle clé dans votre prise en charge [1]. N'hésitez pas à lui poser toutes vos questions sur les traitements et la prévention.
Les centres de planification familiale offrent des consultations gratuites et confidentielles. Particulièrement utiles pour les jeunes femmes, ils proposent dépistage, traitement et éducation sanitaire [7]. Ces structures publiques attendussent l'accès aux soins pour toutes.
Nos Conseils Pratiques
Nos conseils pratiques vous aideront à mieux gérer vos pertes vaginales au quotidien. Tenez un journal de vos symptômes : date, aspect, intensité, facteurs déclenchants. Cette information précieuse orientera votre médecin vers le bon diagnostic [6].
Adaptez votre garde-robe : privilégiez les matières naturelles, évitez les pantalons trop serrés, changez de sous-vêtements quotidiennement. Ces ajustements simples créent un environnement moins favorable aux infections [1,7]. Certaines femmes préfèrent dormir sans sous-vêtements pour aérer la zone intime.
Côté alimentation, réduisez les sucres et augmentez les probiotiques naturels. Yaourts nature, choucroute, kéfir : ces aliments renforcent votre flore protectrice [4]. L'hydratation abondante aide également à éliminer les toxines et maintenir l'équilibre.
En cas de récidives fréquentes, consultez un spécialiste. Gynécologue, infectiologue ou dermatologue selon les cas : une expertise pointue peut identifier des causes méconnues [5]. N'acceptez pas de vivre avec des symptômes chroniques, des solutions existent !
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes d'alarme nécessitent une consultation médicale urgente. Fièvre associée aux pertes, douleurs pelviennes intenses, saignements anormaux : ces symptômes peuvent révéler une infection grave [6]. Ne tardez pas à consulter dans ces situations.
Les pertes malodorantes persistantes malgré un traitement bien conduit doivent vous alerter. Elles peuvent signaler une résistance thérapeutique ou une cause non infectieuse [7]. Votre médecin réévaluera alors le diagnostic et adaptera le traitement.
Consultez également si vos symptômes perturbent significativement votre qualité de vie. Troubles du sommeil, anxiété, difficultés relationnelles : ces répercussions justifient une prise en charge globale [6]. Votre bien-être psychologique compte autant que votre santé physique.
Les femmes enceintes doivent être particulièrement vigilantes. Toute modification des pertes vaginales pendant la grossesse mérite une évaluation médicale . La prévention des complications obstétricales passe par un suivi attentif de ces symptômes.
Questions Fréquentes
Les pertes blanches sont-elles toujours pathologiques ?
Non, les pertes blanches peuvent être parfaitement normales. Elles varient selon votre cycle menstruel et vos hormones. Consultez si elles s'accompagnent de démangeaisons, d'odeur ou de brûlures.
Peut-on avoir des rapports sexuels pendant un traitement ?
Il est généralement recommandé d'éviter les rapports pendant le traitement actif. Cela favorise la guérison et évite la réinfection du partenaire.
Les probiotiques sont-ils vraiment efficaces ?
Les études montrent des résultats prometteurs, particulièrement pour prévenir les récidives. Privilégiez les souches spécifiquement étudiées pour la santé vaginale.
Faut-il traiter le partenaire ?
Cela dépend du type d'infection. Pour les mycoses, le traitement du partenaire n'est pas systématique. Les infections sexuellement transmissibles nécessitent un traitement simultané.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] I-STOP. HAS. 2024-2025.Lien
- [2] Mycose vaginale et autres vaginites : consultation et traitement. Ameli.frLien
- [3] Dispositifs de traitement de l'incontinence urinaire et du prolapsus. Sante.gouv.fr. 2024-2025.Lien
- [4] Performance Study of the Cobas® BV/CV Test. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] A clinical trial of curcumin effect in comparison to standard treatment. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] Elinzanetant reduces vasomotor symptom frequency and intensity. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [8] Surbone A, Pache B. Microbiote vaginal et vaginose. 2022.Lien
- [10] Rekhil L, Amrani D. Profil microbiologique des infections urinaires et vaginales. 2022.Lien
- [11] MESGHOUNI PK. Les signes fonctionnels en gynécologie.Lien
- [12] Pymar H, Waddington A. Diagnostic et prise en charge de la perte précoce de grossesse. 2025.Lien
- [14] Phe V, Pignot G. Les complications chirurgicales en urologie adulte. 2022.Lien
- [15] Vaginites et mycoses vaginales. Vidal.frLien
- [16] Les faits en bref : Pertes vaginales. MSD ManualsLien
Publications scientifiques
- Comment je fais… une réparation des pertes de substances du périnée postérieur par lambeau de muqueuse vaginale postérieure après une vulvectomie (2022)
- Microbiote vaginal et vaginose [Vaginal microbiota and vaginosis] (2022)1 citations[PDF]
- Conduite à tenir face à des pertes vulvaires de sang frais (2024)[PDF]
- Profil microbiologique des infections urinaires et vaginales diagnostiquées au Laboratoire de Biologie Médicale ZERRAR. A à Tizi-Ouzou (2022)
- [PDF][PDF] Les signes fonctionnels en gynécologie [PDF]
Ressources web
- Vaginites et mycoses vaginales (vidal.fr)
28 mars 2025 — Elles se manifestent le plus souvent par des pertes vaginales, des démangeaisons ou des brûlures de la vulve (on parle alors de vulvovaginite).
- Les faits en bref:Pertes vaginales (msdmanuals.com)
Les symptômes typiques sont des pertes épaisses, blanches et grumeleuses, ainsi que des démangeaisons et des brûlures au niveau de la vulve. Les infections à ...
- Mycose vaginale et autres vaginites : consultation et ... (ameli.fr)
26 févr. 2025 — Les pertes vaginales, un élément de diagnostic important · blanchâtres, épaisses et ressemblant à du lait caillé dans les vaginites dues à un ...
- Présentation de la vaginite (infection ou inflammation ... (msdmanuals.com)
Diagnostic de la vaginite. Les petites filles ou les femmes qui ont des pertes vaginales accompagnées d'un prurit, d'une odeur de poisson, ou qui présentent d' ...
- Symptômes de la vaginose : les reconnaître et les traiter (qare.fr)
11 déc. 2024 — des pertes vaginales plus abondantes et malodorantes (leucorrhées) ; · un écoulement vaginal de couleur jaunâtre ou grisâtre ; · des démangeaisons ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
