Paludisme (Malaria) : Symptômes, Traitement et Prévention - Guide Complet 2025
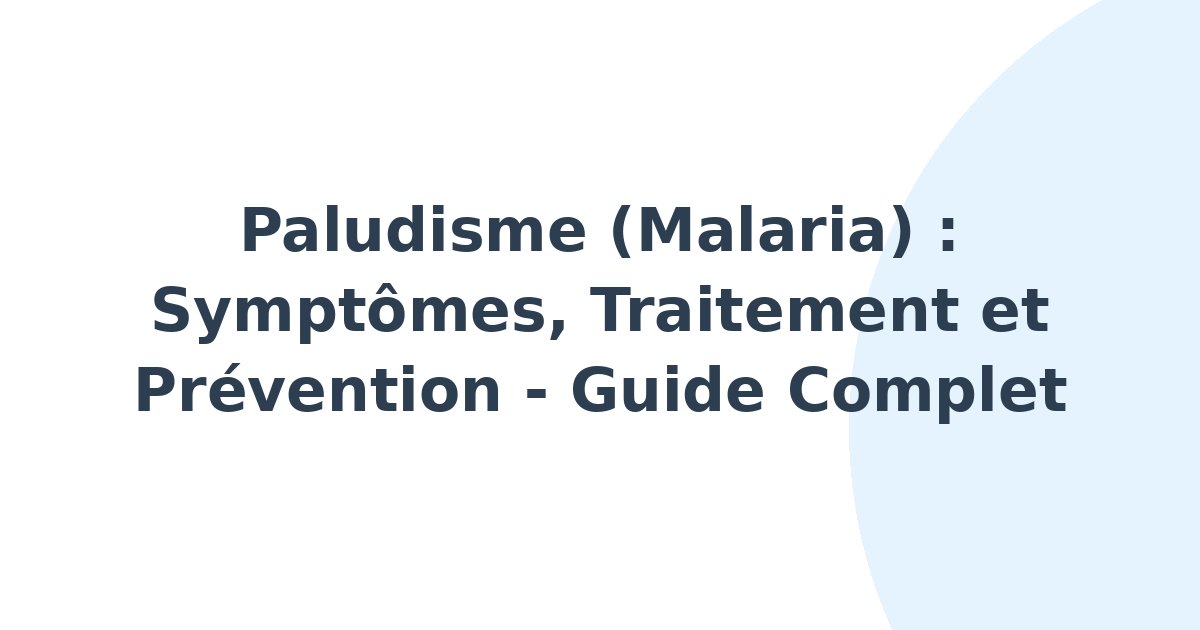
Le paludisme, aussi appelé malaria, reste l'une des maladies infectieuses les plus préoccupantes au monde. Transmise par les moustiques Anopheles, cette pathologie touche encore 247 millions de personnes chaque année selon l'OMS. En France, environ 4 000 cas sont diagnostiqués annuellement, principalement chez des voyageurs de retour de zones endémiques [1,2]. Heureusement, les avancées thérapeutiques de 2024-2025 offrent de nouveaux espoirs dans la lutte contre cette maladie tropicale.
Téléconsultation et Paludisme
Téléconsultation non recommandéeLe paludisme est une urgence médicale potentielle nécessitant un diagnostic biologique immédiat par frottis sanguin et tests de diagnostic rapide. La gravité peut évoluer rapidement, particulièrement avec Plasmodium falciparum, nécessitant une évaluation clinique complète et une prise en charge hospitalière urgente.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil de l'historique de voyage en zone d'endémie palustre, évaluation des symptômes fébriles et leur chronologie, vérification de la prise de chimioprophylaxie antipaludique, orientation diagnostique initiale en cas de fièvre au retour de voyage, suivi post-traitement à distance une fois le diagnostic confirmé.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen clinique complet pour rechercher les signes de gravité (splénomégalie, ictère, troubles neurologiques), réalisation urgente de frottis sanguin et goutte épaisse, tests de diagnostic rapide (TDR), évaluation de la parasitémie, prise en charge thérapeutique adaptée au type de Plasmodium.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Fièvre au retour de zone d'endémie palustre nécessitant un diagnostic biologique urgent, suspicion de paludisme grave avec troubles neurologiques ou digestifs sévères, échec thérapeutique ou résistance suspectée aux antipaludiques, besoin d'hospitalisation pour surveillance ou traitement intraveineux.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Paludisme grave avec convulsions, coma ou confusion, détresse respiratoire ou œdème pulmonaire, ictère intense avec insuffisance hépatique, parasitémie élevée nécessitant une prise en charge hospitalière immédiate.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Troubles de la conscience, confusion, convulsions ou coma
- Détresse respiratoire ou œdème pulmonaire aigu
- Ictère intense avec urines foncées et selles décolorées
- Vomissements incoercibles empêchant la prise de traitement oral
- Fièvre persistante malgré un traitement antipaludique bien conduit
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Infectiologue ou médecin spécialisé en médecine tropicale — consultation en présentiel indispensable
Le paludisme nécessite impérativement une consultation en présentiel pour confirmation diagnostique par examens biologiques et évaluation clinique de la gravité. L'infectiologue ou le spécialiste en médecine tropicale assure la prise en charge optimale selon l'espèce plasmodiale et les résistances.
Paludisme : Définition et Vue d'Ensemble
Le paludisme est une maladie parasitaire causée par des protozoaires du genre Plasmodium. Ces parasites microscopiques infectent les globules rouges après avoir été transmis par la piqûre d'un moustique femelle Anopheles infecté [9,10].
Il existe cinq espèces principales de Plasmodium responsables du paludisme humain. Plasmodium falciparum est le plus dangereux et cause la forme la plus sévère de la maladie. Plasmodium vivax, ovale, malariae et knowlesi complètent ce tableau parasitaire complexe [17,18].
Contrairement aux idées reçues, le paludisme n'est pas contagieux d'une personne à l'autre. La transmission nécessite obligatoirement le passage par un moustique vecteur. C'est pourquoi cette pathologie reste concentrée dans les régions tropicales et subtropicales où ces insectes prolifèrent [3,19].
En France métropolitaine, tous les cas de paludisme sont dits "d'importation". Ils surviennent chez des personnes ayant séjourné en zone endémique, principalement en Afrique subsaharienne qui concentre 95% des cas mondiaux [1,2].
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques françaises révèlent une situation préoccupante mais stable. Selon Santé Publique France, environ 4 000 à 4 500 cas de paludisme sont diagnostiqués chaque année en métropole [1]. Cette incidence place la France parmi les pays européens les plus touchés, principalement en raison des liens historiques avec l'Afrique.
L'analyse des données 2024 montre une répartition géographique inégale sur le territoire français. L'Île-de-France concentre près de 40% des cas, suivie par les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes [1]. Cette concentration s'explique par la présence d'importantes communautés originaires de zones endémiques et par l'activité des aéroports internationaux.
Mais l'évolution temporelle inquiète les épidémiologistes. Après une baisse notable entre 2010 et 2020, les cas de paludisme d'importation repartent à la hausse depuis 2022 [2]. Les voyages d'affaires et le tourisme vers l'Afrique subsaharienne expliquent en partie cette tendance.
Au niveau mondial, l'Organisation Mondiale de la Santé rapporte 247 millions de cas en 2023, avec 619 000 décès. L'Afrique subsaharienne porte 95% de ce fardeau épidémiologique [6]. Les enfants de moins de 5 ans représentent 80% des décès, soulignant la vulnérabilité particulière de cette population [11,15].
D'ailleurs, les projections pour 2025-2030 restent préoccupantes. Malgré les efforts de prévention, le réchauffement climatique pourrait étendre les zones de transmission vers de nouvelles régions [4]. Les résistances parasitaires aux traitements compliquent également la donne thérapeutique.
Les Causes et Facteurs de Risque
La cause unique du paludisme est l'infection par un parasite Plasmodium. Mais plusieurs facteurs influencent le risque de contracter cette maladie lors d'un voyage en zone endémique [9,10].
Le principal facteur de risque reste évidemment le séjour dans une région où la transmission est active. L'Afrique subsaharienne, certaines zones d'Asie du Sud-Est, d'Amérique du Sud et d'Océanie concentrent ces risques [2,17]. La saison des pluies augmente particulièrement le danger car elle favorise la reproduction des moustiques vecteurs.
Certaines populations présentent une vulnérabilité accrue. Les femmes enceintes développent des formes plus sévères, avec des risques pour le fœtus [11]. Les enfants de moins de 5 ans, les personnes âgées et les immunodéprimés constituent également des groupes à haut risque [15].
L'absence de chimioprophylaxie appropriée multiplie considérablement les risques. Pourtant, de nombreux voyageurs négligent encore cette protection médicamenteuse [14,16]. L'automédication aux antipaludiques, fréquente dans certaines régions, contribue paradoxalement à l'émergence de résistances [16].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes du paludisme apparaissent généralement 7 à 15 jours après la piqûre infectante. Mais cette période d'incubation peut s'étendre jusqu'à plusieurs mois pour certaines espèces parasitaires [9,10].
La fièvre constitue le symptôme cardinal, présente chez plus de 95% des patients. Elle s'accompagne classiquement de frissons intenses, de maux de tête et de douleurs musculaires [17,18]. Ces manifestations évoquent souvent un syndrome grippal, d'où le risque de retard diagnostique.
D'autres signes peuvent alerter : nausées, vomissements, diarrhées et douleurs abdominales. La splénomégalie (augmentation du volume de la rate) se développe progressivement [10]. Certains patients décrivent une fatigue extrême et des sueurs profuses.
Attention aux formes graves ! Le paludisme à P. falciparum peut évoluer vers des complications neurologiques : convulsions, coma, troubles de la conscience [15]. L'anémie sévère, l'insuffisance rénale et les troubles respiratoires signent également la gravité [9].
Il faut savoir que les symptômes peuvent être trompeurs. Chez les personnes ayant vécu en zone endémique, une immunité partielle peut masquer les signes cliniques. Inversely, chez les voyageurs non immuns, l'évolution peut être foudroyante [10,17].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic du paludisme repose sur la mise en évidence du parasite dans le sang. Face à une fièvre chez un voyageur de retour de zone endémique, ce diagnostic doit être évoqué en urgence [9,10].
L'examen microscopique de la goutte épaisse et du frottis sanguin reste la référence diagnostique. Cette technique permet d'identifier l'espèce parasitaire et de quantifier la parasitémie [17]. La coloration de Giemsa révèle les parasites à l'intérieur des globules rouges.
Les tests de diagnostic rapide (TDR) offrent une alternative précieuse, surtout en urgence. Ces tests immunochromatographiques détectent des antigènes parasitaires en 15-20 minutes [18]. Leur sensibilité dépasse 95% pour P. falciparum, mais reste plus faible pour les autres espèces.
La PCR (réaction en chaîne par polymérase) représente la technique la plus sensible et spécifique. Elle permet de détecter de très faibles parasitémies et d'identifier précisément l'espèce [10]. Cependant, sa complexité technique limite son utilisation aux laboratoires spécialisés.
D'autres examens complètent le bilan : numération formule sanguine (recherche d'anémie, thrombopénie), bilan hépatique et rénal. L'évaluation de la gravité guide les décisions thérapeutiques [9,15].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement du paludisme dépend de l'espèce parasitaire, de la gravité clinique et de la zone géographique de contamination. Les résistances aux antipaludiques compliquent considérablement les choix thérapeutiques [10,14].
Pour le paludisme simple à P. falciparum, les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine (CTA) constituent le traitement de référence. L'artéméther-luméfantrine et l'artésunate-méfloquine sont les plus utilisées [9,10]. Ces associations combinent efficacité et réduction du risque de résistance.
Le paludisme grave nécessite une prise en charge hospitalière urgente. L'artésunate intraveineux a remplacé la quinine comme traitement de première ligne [15]. Cette molécule agit plus rapidement et présente moins d'effets secondaires graves.
Les autres espèces parasitaires (P. vivax, ovale, malariae) répondent généralement bien à la chloroquine, sauf en cas de résistance documentée [17]. Pour P. vivax et ovale, un traitement par primaquine élimine les formes dormantes hépatiques et prévient les rechutes [10].
Concrètement, la durée de traitement varie de 3 à 7 jours selon les protocoles. Le suivi médical reste indispensable pour vérifier l'efficacité thérapeutique et dépister d'éventuelles complications [18,19].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la lutte contre le paludisme avec plusieurs avancées majeures. La stratégie France 2030 "Maladies infectieuses émergentes" investit massivement dans la recherche antipaludique [4].
Le vaccin RTS,S/AS01 (Mosquirix) a franchi une étape décisive avec son déploiement élargi en Afrique. Les données 2024 confirment une réduction de 30% des cas de paludisme sévère chez les enfants vaccinés [12]. Parallèlement, le nouveau vaccin R21/Matrix-M montre des résultats encore plus prometteurs avec une efficacité de 77% [8].
Une découverte révolutionnaire émane du Research Institute of the MUHC : l'identification de nouvelles cibles thérapeutiques dans le cycle parasitaire [5]. Ces travaux ouvrent la voie à des traitements plus spécifiques et moins toxiques.
Les essais cliniques 2025 testent des approches innovantes. Sanaria développe un vaccin à base de sporozoïtes entiers (PfSPZ-LARC2) avec des résultats de sécurité encourageants [8]. Cette approche pourrait révolutionner la prévention vaccinale.
L'intelligence artificielle transforme également le diagnostic. De nouveaux algorithmes analysent les images microscopiques avec une précision supérieure à l'œil humain [7]. Ces outils promettent d'améliorer le diagnostic dans les zones reculées.
Enfin, l'argumentaire d'investissement du Fonds mondial 2025 prévoit 4 milliards de dollars pour accélérer l'élimination du paludisme [6]. Ces financements soutiendront le déploiement des innovations thérapeutiques les plus prometteuses.
Vivre au Quotidien avec le Paludisme
Vivre avec un épisode de paludisme bouleverse temporairement le quotidien. La fatigue intense peut persister plusieurs semaines après la guérison parasitologique [9,10].
Pendant la phase aiguë, le repos complet s'impose. Les patients décrivent souvent une asthénie majeure qui rend impossible toute activité normale. L'hydratation régulière et la prise d'antipyrétiques soulagent les symptômes [17,18].
La reprise progressive des activités doit être adaptée à chaque personne. Certains patients retrouvent leur forme en quelques jours, d'autres nécessitent plusieurs semaines de convalescence [19]. L'écoute de son corps reste primordiale.
Pour les formes récurrentes (P. vivax, ovale), l'impact psychologique peut être important. L'angoisse des rechutes affecte la qualité de vie et nécessite parfois un soutien psychologique [10]. Heureusement, un traitement préventif par primaquine élimine définitivement ces formes dormantes.
Les Complications Possibles
Le paludisme peut évoluer vers des complications graves, particulièrement avec Plasmodium falciparum. Ces complications engagent le pronostic vital et nécessitent une prise en charge hospitalière urgente [9,15].
Le paludisme cérébral représente la complication la plus redoutable. Il se manifeste par des troubles de la conscience, des convulsions et peut évoluer vers le coma [15]. Cette atteinte neurologique touche particulièrement les enfants et peut laisser des séquelles définitives.
L'anémie sévère constitue une autre complication majeure, surtout chez les enfants de moins de 5 ans. La destruction massive des globules rouges peut nécessiter des transfusions sanguines d'urgence [9,15]. Cette complication explique en partie la mortalité élevée dans cette tranche d'âge.
Les complications respiratoires incluent l'œdème pulmonaire aigu, particulièrement chez l'adulte. L'insuffisance rénale aiguë peut également survenir, nécessitant parfois une dialyse temporaire [10]. Ces atteintes multi-viscérales caractérisent les formes les plus graves.
Chez la femme enceinte, le paludisme augmente les risques d'avortement, d'accouchement prématuré et de petit poids de naissance [11]. Le paludisme placentaire peut également compromettre la santé fœtale même en l'absence de symptômes maternels.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic du paludisme dépend essentiellement de l'espèce parasitaire, de la précocité du diagnostic et de la rapidité du traitement [9,10].
Pour les formes simples traitées précocement, la guérison est la règle. Le paludisme à P. vivax, ovale ou malariae présente un excellent pronostic avec un taux de mortalité quasi nul [17]. Ces espèces causent rarement des complications graves chez les patients immunocompétents.
Le paludisme à P. falciparum non compliqué guérit également très bien sous traitement approprié. Cependant, l'évolution peut être rapide vers les formes graves en l'absence de prise en charge [15]. C'est pourquoi tout retard diagnostique ou thérapeutique aggrave considérablement le pronostic.
Les formes graves conservent une mortalité significative malgré les progrès thérapeutiques. Le paludisme cérébral présente un taux de décès de 15-20% même avec un traitement optimal [9,15]. Les séquelles neurologiques touchent 10-15% des survivants.
Chez l'enfant de moins de 5 ans, le pronostic reste préoccupant dans les zones endémiques. Cette population représente 80% des décès mondiaux par paludisme [6,15]. Heureusement, les programmes de prévention et les nouveaux vaccins améliorent progressivement cette situation.
Peut-on Prévenir le Paludisme ?
La prévention du paludisme repose sur une approche globale combinant protection contre les piqûres de moustiques et chimioprophylaxie adaptée [13,14].
La protection anti-vectorielle constitue la première ligne de défense. L'utilisation de répulsifs contenant du DEET, de l'icaridine ou de l'IR3535 s'avère très efficace [3,14]. Les vêtements longs et clairs, surtout en soirée, réduisent significativement l'exposition aux moustiques.
Les moustiquaires imprégnées d'insecticide représentent un outil majeur de prévention. Leur utilisation systématique réduit de 50% l'incidence du paludisme dans les zones endémiques [13]. La climatisation et les ventilateurs découragent également l'activité des moustiques.
La chimioprophylaxie médicamenteuse s'adapte au niveau de résistance de la zone visitée. L'atovaquone-proguanil, la doxycycline ou la méfloquine constituent les options principales [2,14]. Le choix dépend de la destination, de la durée du séjour et des contre-indications individuelles.
Les nouveaux vaccins ouvrent des perspectives prometteuses. Le RTS,S/AS01 est déjà déployé dans plusieurs pays africains avec des résultats encourageants [12]. Le R21/Matrix-M pourrait bientôt compléter l'arsenal préventif [8].
Concrètement, la consultation pré-voyage chez un médecin spécialisé reste indispensable. Cette démarche permet d'adapter la prévention aux risques spécifiques de chaque destination et de chaque voyageur [2,18].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises actualisent régulièrement leurs recommandations face à l'évolution de la résistance parasitaire et des zones de transmission [1,2].
Santé Publique France publie annuellement les Recommandations sanitaires aux voyageurs. Ce document de référence détaille les mesures préventives par pays et région [2]. Les cartes de risque sont mises à jour en temps réel selon les données épidémiologiques locales.
La Haute Autorité de Santé (HAS) a validé en 2024 de nouvelles recommandations sur la chimioprophylaxie. Les schémas thérapeutiques intègrent désormais les résistances émergentes et les nouvelles molécules disponibles [1]. Ces guidelines harmonisent les pratiques sur l'ensemble du territoire.
Le ministère de la Santé renforce la surveillance des maladies à déclaration obligatoire, incluant le paludisme d'importation [1]. Cette surveillance permet de détecter rapidement les épidémies et d'adapter les mesures de prévention.
Les recommandations insistent particulièrement sur les populations vulnérables. Les femmes enceintes, les enfants et les immunodéprimés bénéficient de protocoles spécifiques renforcés [11,13]. La consultation spécialisée devient obligatoire pour ces groupes à risque.
D'ailleurs, les autorités européennes coordonnent leurs efforts dans le cadre du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Cette coopération améliore la surveillance transfrontalière et l'harmonisation des recommandations .
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs organismes accompagnent les patients et sensibilisent le public aux risques du paludisme [17,18,19].
L'Institut Pasteur propose des consultations spécialisées de médecine des voyages dans ses centres régionaux. Ces consultations incluent l'évaluation des risques, la prescription de chimioprophylaxie et les conseils de prévention personnalisés [17,18].
Les centres de vaccinations internationales, présents dans toutes les grandes villes, constituent des ressources précieuses. Ils délivrent les traitements préventifs et maintiennent une veille épidémiologique actualisée [19]. La prise de rendez-vous est recommandée 4 à 6 semaines avant le départ.
Plusieurs associations sensibilisent aux maladies tropicales. Bien qu'il n'existe pas d'association spécifiquement dédiée au paludisme en France, les organisations de coopération internationale intègrent cette problématique dans leurs actions [6].
Les plateformes numériques se développent également. Des applications mobiles proposent des alertes géolocalisées sur les risques sanitaires et des rappels de prise de chimioprophylaxie [4]. Ces outils modernes complètent l'information médicale traditionnelle.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos recommandations concrètes pour prévenir efficacement le paludisme lors de vos voyages [13,14].
Avant le départ : Consultez un médecin spécialisé 4 à 6 semaines avant votre voyage. Cette anticipation permet d'adapter la chimioprophylaxie et de vérifier les contre-indications [2,14]. N'attendez jamais la dernière minute pour cette démarche essentielle.
Pendant le séjour : Appliquez rigoureusement les mesures de protection. Utilisez des répulsifs efficaces (DEET 30-50%) toutes les 4-6 heures [3]. Portez des vêtements longs et clairs dès le coucher du soleil, période d'activité maximale des moustiques Anopheles.
Hébergement : Privilégiez les chambres climatisées ou équipées de moustiquaires en bon état. Vérifiez l'absence de trous et l'imprégnation insecticide [13]. Les ventilateurs créent un courant d'air défavorable aux moustiques.
Après le retour : Restez vigilant pendant 3 mois minimum. Toute fièvre doit motiver une consultation médicale urgente en précisant vos antécédents de voyage [9,10]. Cette vigilance peut vous sauver la vie en cas d'infection tardive.
Cas particuliers : Les femmes enceintes et les enfants nécessitent des précautions renforcées. Certaines destinations sont formellement déconseillées pour ces populations vulnérables [11,13].
Quand Consulter un Médecin ?
Certaines situations nécessitent une consultation médicale urgente, parfois vitale [9,10,15].
Avant tout voyage : La consultation pré-voyage s'impose pour tout séjour en zone d'endémie palustre. Cette démarche permet d'évaluer les risques individuels et d'adapter la prévention [2,14]. Ne partez jamais sans cet avis médical spécialisé.
Fièvre au retour : Toute élévation thermique dans les 3 mois suivant un voyage tropical constitue une urgence médicale. Consultez immédiatement en précisant vos antécédents de voyage [17,18]. Cette information oriente rapidement le diagnostic.
Signes d'alarme : Certains symptômes imposent une hospitalisation urgente : troubles de la conscience, convulsions, difficultés respiratoires, ictère intense [15]. Ces manifestations peuvent signaler un paludisme grave engageant le pronostic vital.
Échec de chimioprophylaxie : Si des symptômes apparaissent malgré un traitement préventif bien conduit, consultez rapidement. Les résistances parasitaires peuvent expliquer ces échecs thérapeutiques [10,16].
Populations à risque : Les femmes enceintes, enfants, personnes âgées et immunodéprimés doivent consulter dès les premiers symptômes. Leur vulnérabilité particulière justifie une surveillance médicale renforcée [11,15].
Médicaments associés
Les médicaments suivants peuvent être prescrits dans le cadre de Paludisme. Consultez toujours un professionnel de santé avant toute prise de médicament.
Questions Fréquentes
Le paludisme peut-il se transmettre d'une personne à l'autre ?
Non, le paludisme n'est pas contagieux entre humains dans les maladies normales. La transmission nécessite obligatoirement le passage par un moustique Anopheles infecté. Seules les transfusions sanguines ou les accidents d'exposition au sang peuvent exceptionnellement transmettre la maladie.
Combien de temps dure l'immunité après un épisode de paludisme ?
Il n'existe pas d'immunité définitive après un épisode de paludisme. Les personnes ayant vécu en zone endémique développent une immunité partielle qui atténue les symptômes mais ne protège pas complètement. Cette immunité diminue rapidement après quelques années hors de la zone d'exposition.
Peut-on prendre l'avion avec du paludisme ?
Le voyage aérien est formellement déconseillé en phase aiguë de paludisme. Les variations de pression et le stress du voyage peuvent aggraver l'état clinique. Attendez la guérison complète et l'autorisation médicale avant tout déplacement.
Les enfants peuvent-ils prendre une chimioprophylaxie ?
Oui, des schémas préventifs adaptés existent pour tous les âges. Les posologies sont ajustées au poids et certaines molécules sont spécifiquement autorisées chez l'enfant. La consultation pédiatrique spécialisée reste indispensable.
Le paludisme peut-il récidiver des années après ?
Oui, P. vivax et P. ovale peuvent provoquer des rechutes plusieurs mois ou années après l'infection initiale. Ces espèces forment des formes dormantes dans le foie qui se réactivent spontanément. Le traitement par primaquine élimine définitivement ces formes latentes.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Les maladies à déclaration obligatoire en Centre-Val de Loire. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [2] Chikungunya, dengue et zika - Données de la surveillance renforcée en France hexagonale 2024. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [3] Recommandations sanitaires aux voyageurs 2024. Ministère de la Santé. 2024-2025.Lien
- [4] Moustiques vecteurs de maladies. Ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. 2024-2025.Lien
- [5] France 2030 - Stratégie Maladies infectieuses émergentes. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] Research Institute of the MUHC - Une nouvelle découverte dans la lutte contre le paludisme. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [7] Argumentaire d'investissement - Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [8] Recent perspectives in clinical development of malaria vaccines. Nature Communications. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [9] Sanaria Reports Positive Initial Safety Results for Groundbreaking PfSPZ-LARC2 Malaria Vaccine. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [10] DANIS M. Le paludisme aujourd'hui. Médecine Tropicale et Santé Internationale. 2023.Lien
- [11] FICKO C, CONAN PL. Le paludisme en 2022: aspects cliniques et thérapeutiques. Médecine Tropicale et Santé Internationale. 2023.Lien
- [12] AKPOVO C, DIALLO Z. Paludisme et grossesse en Afrique subsaharienne: prévention, progrès actuels et perspectives. 2025.Lien
- [13] MARIE M. Vaccination contre le paludisme. Médecine Tropicale et Santé Internationale. 2023.Lien
- [14] SONDO P, VALEA I. Prévention du paludisme en Afrique subsaharienne: états des lieux, enjeux et perspectives. 2024.Lien
- [15] ZANGO WWG, FAUCHER JF. Mesures préventives et nouveaux outils de lutte contre le paludisme. 2023.Lien
- [16] MAMADOU K, SALIF C. Paludisme Grave chez l'Enfant dans le District de Bamako: Aspects Épidémiologiques, Clinico-biologiques et Thérapeutiques. 2022.Lien
- [17] MIHINDOU CJ, DITOMBI BCM. La Fréquence de l'automédication aux antipaludiques et impact sur les caractéristiques du paludisme au Gabon. Revue Marocaine de Santé Publique. 2024.Lien
- [18] Paludisme : symptômes, traitement, prévention. Institut Pasteur.Lien
- [19] Paludisme (ou Malaria) : symptômes, traitement et prévention. Institut Pasteur de Lille.Lien
- [20] Paludisme : Vaccin, symptômes, prévention et traitement. Elsan.Lien
Publications scientifiques
- Le paludisme aujourd'hui (2023)4 citations[PDF]
- Le paludisme en 2022: aspects cliniques et thérapeutiques (2023)5 citations[PDF]
- Paludisme et grossesse en Afrique subsaharienne: prévention, progrès actuels et perspectives (2025)
- Vaccination contre le paludisme (2023)3 citations[PDF]
- Prévention du paludisme en Afrique subsaharienne: états des lieux, enjeux et perspectives (2024)
Ressources web
- Paludisme : symptômes, traitement, prévention (pasteur.fr)
Le paludisme soit confirmé par un diagnostic basé sur la recherche des plasmodies (par microscopie ou test diagnostique rapide). Le diagnostic et le traitement ...
- Paludisme (ou Malaria) : symptômes, traitement et ... (pasteur-lille.fr)
Le symptôme le plus fréquent du paludisme est une fièvre irrégulière pouvant s'accompagner de troubles digestifs (douleurs abdominales, nausées, vomissements). ...
- Paludisme : Vaccin, symptômes, prévention et traitement (elsan.care)
Les symptômes initiaux du paludisme peuvent être bénins et comprennent généralement de la fièvre, des maux de tête, des frissons, des douleurs musculaires et de ...
- Paludisme - Maladies infectieuses - Édition professionnelle ... (msdmanuals.com)
Le paludisme est une infection à Plasmodium spp. La symptomatologie comprend une fièvre (qui peut être périodique), des frissons, des sueurs, une diarrhée, ...
- Paludisme : symptômes, dépistage et traitements (cerballiance.fr)
Diagnostic du paludisme Les premiers symptômes – fièvre, maux de tête et frissons – apparaissent généralement 10 à 15 jours après la piqûre de moustique et ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
