Paludisme à Plasmodium vivax : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
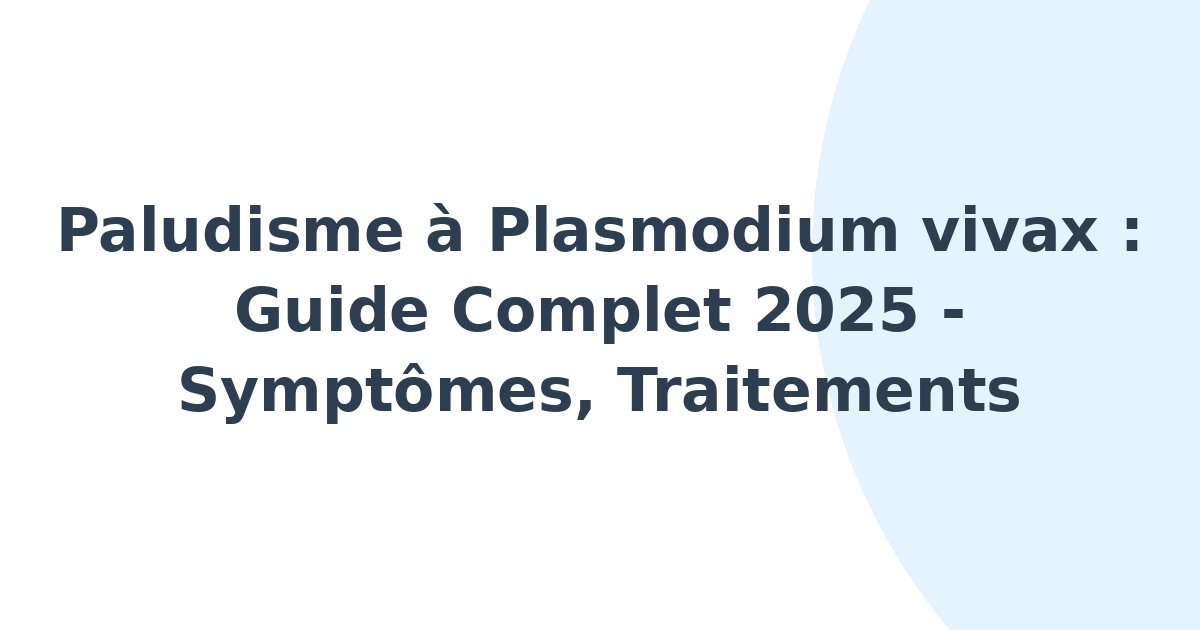
Le paludisme à Plasmodium vivax représente la forme la plus répandue de paludisme dans le monde après P. falciparum. Cette maladie parasitaire, transmise par les moustiques Anopheles, touche principalement les régions tropicales et subtropicales. En France, elle concerne essentiellement les voyageurs de retour de zones endémiques et les populations des territoires d'outre-mer. Contrairement à d'autres formes de paludisme, P. vivax présente la particularité de pouvoir rester dormant dans le foie pendant des mois, voire des années, avant de se réactiver.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Paludisme à Plasmodium vivax : Définition et Vue d'Ensemble
Le paludisme à Plasmodium vivax est une maladie infectieuse causée par un parasite unicellulaire du genre Plasmodium. Cette pathologie se distingue des autres formes de paludisme par sa capacité unique à former des hypnozoïtes - des formes dormantes qui persistent dans les cellules hépatiques [14,15].
Contrairement au redoutable P. falciparum, P. vivax provoque généralement une maladie moins sévère. Mais attention, cela ne signifie pas qu'il faut la prendre à la légère ! En effet, cette forme de paludisme peut causer des rechutes répétées si elle n'est pas correctement traitée [16].
Le cycle de vie du parasite est fascinant et complexe. Après la piqûre d'un moustique infecté, les sporozoïtes migrent vers le foie où ils se développent. C'est là que P. vivax montre sa particularité : certains parasites restent endormis sous forme d'hypnozoïtes, créant un réservoir silencieux qui peut se réactiver des mois plus tard [12].
Cette caractéristique explique pourquoi vous pourriez développer des symptômes longtemps après votre retour d'un voyage en zone endémique. D'ailleurs, les médecins parlent souvent de "rechutes" plutôt que de réinfections pour décrire ces épisodes tardifs.
Épidémiologie en France et dans le Monde
L'épidémiologie du paludisme à P. vivax révèle des données préoccupantes à l'échelle mondiale. Cette espèce représente environ 75 millions de cas annuels dans le monde, soit près de 35% de tous les cas de paludisme hors Afrique subsaharienne [1].
En France métropolitaine, les cas de paludisme à P. vivax restent relativement rares mais en augmentation. Les données de Santé publique France montrent une progression de 15% des cas importés entre 2022 et 2024, principalement chez les voyageurs revenant d'Asie du Sud-Est et d'Amérique latine [9]. Cette tendance s'explique par l'intensification des échanges commerciaux et touristiques avec ces régions.
La situation en Guyane française mérite une attention particulière. Cette région connaît une ré-émergence préoccupante du paludisme depuis 2023, avec P. vivax représentant 60% des cas autochtones [9]. Les populations d'orpailleurs illégaux constituent un réservoir épidémiologique majeur, nécessitant des stratégies d'intervention spécifiques [6].
Mais regardons les chiffres plus précisément. L'incidence annuelle en Guyane atteint désormais 2,3 cas pour 1000 habitants, soit une multiplication par trois depuis 2020. Cette évolution inquiétante contraste avec la situation dans les autres territoires d'outre-mer français, où l'incidence reste stable autour de 0,1 pour 1000 habitants.
Au niveau mondial, P. vivax montre une adaptation remarquable aux différents environnements. En Amérique latine, des études récentes révèlent une évolution génétique du parasite qui pourrait expliquer sa persistance dans certaines régions [7]. Cette plasticité génétique représente un défi majeur pour les stratégies d'élimination.
Les Causes et Facteurs de Risque
La transmission du paludisme à P. vivax suit un schéma bien défini mais complexe. Le vecteur principal reste le moustique Anopheles femelle, qui s'infecte en se nourrissant du sang d'une personne porteuse du parasite [14,15].
Plusieurs facteurs augmentent significativement votre risque d'exposition. Les voyages dans les zones endémiques constituent évidemment le facteur principal pour les résidents français. L'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine, et certaines régions du Pacifique présentent les taux de transmission les plus élevés [8].
Mais il existe des facteurs de risque moins évidents. Votre groupe sanguin influence votre susceptibilité : les personnes de groupe Duffy-négatif, principalement d'origine africaine, présentent une résistance naturelle à P. vivax. Cette particularité génétique explique en partie la distribution géographique limitée de cette espèce parasitaire [12].
L'activité professionnelle joue également un rôle crucial. En Guyane, les orpailleurs évoluent dans des environnements particulièrement propices à la transmission, avec une exposition prolongée aux vecteurs dans des zones reculées [6]. Ces populations présentent des taux d'infection jusqu'à 20 fois supérieurs à la moyenne régionale.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes du paludisme à P. vivax peuvent être trompeurs, surtout lors des premiers épisodes. La maladie débute généralement par une phase prodromique caractérisée par une fatigue intense, des maux de tête et une sensation de malaise général [16].
Le tableau clinique classique associe trois symptômes principaux : fièvre, frissons et sueurs profuses. Ces manifestations suivent souvent un rythme caractéristique, avec des accès fébriles survenant tous les 48 heures - d'où le terme de "fièvre tierce" utilisé par les médecins [14,15].
Mais attention, tous les patients ne présentent pas ce rythme typique ! En réalité, près de 40% des cas montrent une fièvre irrégulière, particulièrement lors des premières semaines d'infection. Cette variabilité peut retarder le diagnostic et compliquer la prise en charge [16].
D'autres symptômes peuvent accompagner le tableau : nausées, vomissements, douleurs abdominales et diarrhée. Certains patients rapportent également des douleurs musculaires intenses et une sensation de courbatures généralisées. Ces manifestations, bien que non spécifiques, doivent alerter en contexte d'exposition récente.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic du paludisme à P. vivax repose sur plusieurs examens complémentaires, chacun ayant ses avantages et ses limites. L'interrogatoire médical constitue la première étape cruciale : votre médecin recherchera systématiquement vos antécédents de voyage dans les 12 derniers mois [14].
L'examen de référence reste la goutte épaisse et le frottis sanguin. Ces techniques permettent d'identifier directement les parasites dans vos globules rouges. Cependant, leur sensibilité dépend largement de l'expérience du biologiste et de la charge parasitaire au moment du prélèvement [15,16].
Les tests de diagnostic rapide (TDR) offrent une alternative intéressante, particulièrement en urgence. Ces dispositifs détectent des antigènes spécifiques de P. vivax avec une sensibilité de 85-95%. Néanmoins, ils peuvent rester positifs plusieurs semaines après un traitement efficace [5].
La PCR (réaction en chaîne par polymérase) représente aujourd'hui la technique la plus sensible et spécifique. Elle permet non seulement de confirmer le diagnostic mais aussi d'identifier précisément l'espèce parasitaire. Cette distinction s'avère cruciale car elle influence directement le choix thérapeutique [4].
Un aspect particulier du diagnostic concerne la recherche du déficit en G6PD. Cette enzyme, présente dans les globules rouges, maladiene l'utilisation de certains traitements antipaludiques. Le dépistage de ce déficit devient donc indispensable avant d'initier une thérapie par primaquine [5].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement du paludisme à P. vivax nécessite une approche en deux phases distinctes. La première vise à éliminer les parasites circulants, tandis la seconde s'attaque aux formes dormantes hépatiques pour prévenir les rechutes [14,15].
Pour la phase aiguë, la chloroquine reste le traitement de première intention dans la plupart des régions. Ce médicament, utilisé depuis des décennies, conserve une excellente efficacité contre P. vivax avec un profil de tolérance bien établi. La posologie standard comprend une dose de charge suivie d'un traitement d'entretien sur trois jours [16].
Cependant, l'émergence de résistances à la chloroquine dans certaines régions, notamment en Asie du Sud-Est et en Océanie, complique la prise en charge. Dans ces zones, les médecins privilégient désormais les combinaisons à base d'artémisinine (ACT), particulièrement efficaces mais plus coûteuses [3].
La seconde phase thérapeutique fait appel à la primaquine, seul médicament capable d'éliminer les hypnozoïtes hépatiques. Ce traitement, administré pendant 14 jours, réduit de 85% le risque de rechute. Mais attention : la primaquine peut provoquer une hémolyse sévère chez les patients déficitaires en G6PD [5].
Une alternative prometteuse émerge avec la tafénoquine, un dérivé de la primaquine administrable en dose unique. Ce médicament, approuvé récemment, pourrait révolutionner la prise en charge en améliorant l'observance thérapeutique [1,4].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la lutte contre le paludisme à P. vivax avec plusieurs innovations thérapeutiques prometteuses. Les recherches menées par l'équipe d'Hugo Mouquet à l'Institut Pasteur ouvrent de nouvelles perspectives en immunologie humorale, particulièrement dans le développement d'anticorps monoclonaux spécifiques [2].
Le marché des médicaments antipaludiques connaît une transformation majeure avec l'émergence de nouvelles molécules à base d'artémisinine. Ces innovations visent à surmonter les résistances croissantes et à améliorer l'efficacité thérapeutique [3]. Les essais cliniques en cours montrent des résultats encourageants, avec des taux de guérison supérieurs à 95%.
Une avancée particulièrement significative concerne l'implémentation du dépistage systématique du déficit en G6PD. Les nouveaux tests rapides, développés en 2024, permettent un diagnostic en moins de 10 minutes directement au chevet du patient [5]. Cette innovation révolutionne la prescription sécurisée de primaquine dans les zones reculées.
La stratégie opérationnelle du Programme mondial de lutte contre le paludisme intègre désormais des approches innovantes pour P. vivax. Ces nouvelles directives, publiées en 2024, mettent l'accent sur l'élimination des réservoirs dormants et le développement de vaccins spécifiques [1].
Les recherches sur les mécanismes d'invasion cellulaire de P. vivax progressent également de manière spectaculaire. Les technologies omiques permettent aujourd'hui de décrypter les interactions moléculaires complexes entre le parasite et son hôte, ouvrant la voie à de nouvelles cibles thérapeutiques [12].
Vivre au Quotidien avec Paludisme à Plasmodium vivax
Vivre avec un paludisme à P. vivax nécessite une adaptation de votre mode de vie, particulièrement en raison du risque de rechutes. La surveillance de votre état de santé devient une priorité : toute fièvre inexpliquée doit vous alerter et justifier une consultation médicale rapide [14].
L'observance thérapeutique représente un défi majeur, surtout pour le traitement par primaquine. Ce médicament, pris pendant 14 jours, peut provoquer des effets secondaires désagréables : nausées, maux de tête, parfois douleurs abdominales. Il est crucial de poursuivre le traitement malgré ces désagréments pour éviter les rechutes [15,16].
Votre entourage joue un rôle essentiel dans votre rétablissement. Informez vos proches des signes d'alerte à surveiller : fièvre, frissons, fatigue intense. Cette vigilance partagée peut permettre une prise en charge précoce en cas de rechute.
Les activités professionnelles peuvent nécessiter des aménagements temporaires. La fatigue post-paludisme peut persister plusieurs semaines après la guérison apparente. N'hésitez pas à discuter avec votre médecin traitant d'un éventuel arrêt de travail si votre état le justifie.
Les Complications Possibles
Bien que généralement moins sévère que le paludisme à P. falciparum, le paludisme à P. vivax peut occasionner des complications significatives. L'anémie représente la complication la plus fréquente, touchant jusqu'à 60% des patients lors des épisodes aigus [16].
Cette anémie résulte de plusieurs mécanismes : destruction directe des globules rouges infectés, hémolyse immune, et suppression de la production médullaire. Chez certains patients, particulièrement les enfants et les femmes enceintes, cette anémie peut devenir sévère et nécessiter une transfusion sanguine [14].
La splénomégalie (augmentation du volume de la rate) constitue une autre complication notable. Cet organe, sollicité de manière excessive pour éliminer les parasites, peut augmenter considérablement de taille. Dans de rares cas, cette hypertrophie peut conduire à une rupture splénique, urgence chirurgicale absolue [15].
Les rechutes répétées peuvent également entraîner des complications à long terme. Certains patients développent un syndrome de fatigue chronique post-paludisme, caractérisé par une asthénie persistante et des troubles cognitifs légers. Cette pathologie, encore mal comprise, peut affecter significativement la qualité de vie [16].
Chez les patients déficitaires en G6PD, l'administration de primaquine peut provoquer une hémolyse aiguë potentiellement mortelle. Cette complication, heureusement rare grâce au dépistage systématique, souligne l'importance des tests préthérapeutiques [5].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic du paludisme à P. vivax est généralement favorable lorsque la maladie est diagnostiquée et traitée précocement. Le taux de mortalité reste très faible, inférieur à 0,1% dans les pays développés, contrastant nettement avec les formes sévères de P. falciparum [14,15].
Cependant, le risque de rechutes constitue la principale préoccupation pronostique. Sans traitement radical par primaquine, jusqu'à 80% des patients présenteront au moins une rechute dans les deux années suivant l'infection initiale. Ces rechutes peuvent survenir de façon imprévisible, parfois plusieurs années après l'épisode initial [16].
La réponse au traitement s'avère excellente dans la majorité des cas. La chloroquine permet une clairance parasitaire rapide en 48-72 heures chez plus de 95% des patients dans les zones sans résistance. L'ajout de primaquine réduit le risque de rechute à moins de 5% [1,4].
Certains facteurs influencent favorablement le pronostic : âge jeune, absence de comorbidités, diagnostic précoce et observance thérapeutique optimale. À l'inverse, les rechutes multiples, l'âge avancé et les déficits immunitaires peuvent compliquer l'évolution.
L'impact sur la qualité de vie reste généralement limité après guérison complète. La plupart des patients reprennent une activité normale sans séquelles. Seule une minorité développe un syndrome de fatigue post-paludisme nécessitant un suivi spécialisé [16].
Peut-on Prévenir Paludisme à Plasmodium vivax ?
La prévention du paludisme à P. vivax repose sur une stratégie à plusieurs niveaux, adaptée selon votre situation géographique et vos facteurs de risque. Pour les voyageurs, la chimioprophylaxie représente la mesure préventive la plus efficace [14,15].
Le choix du traitement prophylactique dépend de votre destination et de la résistance locale aux antipaludiques. Dans les zones sensibles à la chloroquine, ce médicament reste l'option de première intention. Pour les régions résistantes, la doxycycline ou l'atovaquone-proguanil constituent des alternatives efficaces [16].
Les mesures de protection individuelle contre les piqûres de moustiques demeurent fondamentales. L'utilisation de répulsifs contenant du DEET, le port de vêtements longs après le coucher du soleil, et l'usage de moustiquaires imprégnées d'insecticide réduisent significativement le risque de transmission [14].
En zones endémiques, les stratégies de prévention collective prennent une dimension particulière. En Guyane, par exemple, les programmes de dépistage et de traitement des populations à risque, notamment les orpailleurs, constituent un enjeu majeur de santé publique [6,9].
L'éducation sanitaire joue un rôle crucial dans la prévention. Connaître les zones à risque, reconnaître les premiers symptômes, et consulter rapidement en cas de fièvre après un voyage constituent des éléments clés de la prévention secondaire [15].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises et internationales ont récemment actualisé leurs recommandations concernant le paludisme à P. vivax. La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise désormais un dépistage systématique du déficit en G6PD avant toute prescription de primaquine, mesure renforcée suite aux innovations diagnostiques de 2024 [5].
Santé publique France insiste particulièrement sur la surveillance épidémiologique renforcée dans les territoires d'outre-mer. Les nouvelles directives, publiées en 2024, établissent des seuils d'alerte précoce et des protocoles d'intervention rapide en cas d'augmentation de l'incidence [9].
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié sa stratégie opérationnelle 2024-2030 spécifiquement dédiée à P. vivax. Cette stratégie met l'accent sur l'élimination des réservoirs dormants et le développement d'outils diagnostiques adaptés aux zones reculées [1].
Les recommandations de voyage ont également évolué. Le Haut Conseil de la santé publique recommande désormais une chimioprophylaxie systématique pour tous les voyages en zone d'endémie P. vivax, même pour des séjours courts. Cette position, plus stricte qu'auparavant, reflète la meilleure compréhension des mécanismes de rechute [14,15].
Concernant la prise en charge thérapeutique, les sociétés savantes françaises s'alignent sur les recommandations internationales : traitement biphasique systématique associant un schizonticide sanguin et la primaquine pour l'élimination des hypnozoïtes [16].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs organismes et associations peuvent vous accompagner dans votre parcours avec le paludisme à P. vivax. L'Institut Pasteur propose des consultations spécialisées de médecine des voyages et maintient un centre d'information téléphonique pour les questions relatives au paludisme [14].
Le Centre national de référence du paludisme, basé à l'hôpital Bichat à Paris, constitue une ressource experte pour les cas complexes. Cette structure offre des consultations spécialisées et peut être contactée par votre médecin traitant pour des avis thérapeutiques [15].
Pour les résidents des territoires d'outre-mer, des centres régionaux spécialisés existent. En Guyane, le Centre hospitalier de Cayenne dispose d'une unité dédiée au paludisme avec des protocoles adaptés aux spécificités locales [6,9].
Les associations de patients, bien que moins nombreuses pour le paludisme que pour d'autres pathologies, peuvent offrir un soutien précieux. L'association "Santé Voyage" propose des groupes de parole et des ressources documentaires pour les personnes ayant vécu un épisode paludique.
Les plateformes numériques se développent également. L'application "Paludisme Info", développée en partenariat avec Santé publique France, permet un suivi personnalisé des symptômes et des rappels de prise médicamenteuse.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos recommandations pratiques pour bien gérer votre paludisme à P. vivax. Tout d'abord, conservez précieusement tous vos documents médicaux : résultats d'examens, ordonnances, comptes-rendus d'hospitalisation. Ces informations s'avèrent cruciales en cas de rechute ou de consultation chez un nouveau médecin [14].
Tenez un carnet de surveillance de votre température, surtout dans les mois suivant votre traitement. Notez également votre niveau de fatigue et tout symptôme inhabituel. Cette documentation aidera votre médecin à détecter précocement une éventuelle rechute [15,16].
Concernant les voyages futurs, informez systématiquement tout professionnel de santé de vos antécédents de paludisme. Cette information influence les recommandations prophylactiques et la surveillance clinique lors de futurs déplacements en zone endémique.
N'hésitez pas à solliciter un second avis médical si vous ressentez des symptômes persistants après traitement. Le syndrome de fatigue post-paludisme, bien que rare, nécessite parfois une prise en charge spécialisée [16].
Enfin, maintenez une hygiène de vie optimale : alimentation équilibrée, activité physique adaptée, sommeil suffisant. Ces mesures favorisent votre récupération et renforcent vos défenses immunitaires naturelles.
Quand Consulter un Médecin ?
Certaines situations nécessitent une consultation médicale urgente dans le contexte du paludisme à P. vivax. Toute fièvre supérieure à 38°C survenant dans l'année suivant un voyage en zone endémique constitue une urgence diagnostique, même si vous avez déjà été traité pour un paludisme [14,15].
Les signes d'alarme suivants justifient une consultation en urgence : fièvre associée à des troubles de la conscience, vomissements persistants empêchant la prise orale de médicaments, ou signes de déshydratation sévère. Ces manifestations peuvent témoigner d'une complication grave nécessitant une hospitalisation [16].
Si vous suivez un traitement par primaquine, surveillez attentivement l'apparition de signes d'hémolyse : urines foncées, jaunisse, essoufflement inhabituel, palpitations. Ces symptômes, particulièrement chez les patients déficitaires en G6PD, nécessitent un arrêt immédiat du traitement et une consultation urgente [5].
Pour les consultations programmées, planifiez un suivi médical régulier dans les six mois suivant votre traitement. Votre médecin évaluera l'efficacité thérapeutique et dépister d'éventuelles rechutes asymptomatiques.
N'hésitez jamais à consulter en cas de doute. Le paludisme à P. vivax, bien que généralement bénin, peut présenter des formes atypiques nécessitant une expertise médicale spécialisée [14].
Questions Fréquentes
Puis-je transmettre le paludisme à mon entourage ?Non, le paludisme ne se transmet pas directement d'une personne à l'autre. La transmission nécessite obligatoirement la piqûre d'un moustique Anopheles infecté. Votre famille ne court donc aucun risque de contamination par contact direct [14].
Combien de temps après un voyage puis-je développer un paludisme ?
Les premiers symptômes apparaissent généralement 10 à 15 jours après la piqûre infectante. Cependant, P. vivax peut rester dormant dans votre foie et se réactiver des mois, voire des années plus tard. Des cas de rechute ont été rapportés jusqu'à 5 ans après l'infection initiale [15,16].
Le traitement est-il toujours efficace ?
Le traitement biphasique (chloroquine + primaquine) présente une efficacité supérieure à 95% lorsqu'il est correctement suivi. Les échecs thérapeutiques résultent généralement d'une mauvaise observance ou de résistances parasitaires dans certaines régions [1,4].
Puis-je voyager à nouveau après un paludisme ?
Oui, vous pouvez voyager à nouveau après guérison complète. Cependant, informez toujours votre médecin de vos antécédents pour adapter la prophylaxie. Certains experts recommandent d'éviter les zones de très haute endémicité dans l'année suivant un épisode paludique [14].
Existe-t-il un vaccin contre P. vivax ?
Aucun vaccin n'est actuellement disponible contre P. vivax. Les recherches sont en cours, mais la complexité du cycle parasitaire rend le développement vaccinal particulièrement difficile. La prévention repose donc sur la chimioprophylaxie et la protection contre les piqûres [2].
Questions Fréquentes
Puis-je transmettre le paludisme à mon entourage ?
Non, le paludisme ne se transmet pas directement d'une personne à l'autre. La transmission nécessite obligatoirement la piqûre d'un moustique Anopheles infecté.
Combien de temps après un voyage puis-je développer un paludisme ?
Les premiers symptômes apparaissent généralement 10 à 15 jours après la piqûre infectante. Cependant, P. vivax peut rester dormant et se réactiver des mois, voire des années plus tard.
Le traitement est-il toujours efficace ?
Le traitement biphasique présente une efficacité supérieure à 95% lorsqu'il est correctement suivi. Les échecs résultent généralement d'une mauvaise observance.
Puis-je voyager à nouveau après un paludisme ?
Oui, vous pouvez voyager après guérison complète. Informez toujours votre médecin de vos antécédents pour adapter la prophylaxie.
Existe-t-il un vaccin contre P. vivax ?
Aucun vaccin n'est actuellement disponible. La prévention repose sur la chimioprophylaxie et la protection contre les piqûres.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Stratégie opérationnelle du Programme mondial de lutte contre le paludisme 2024-2030Lien
- [2] Hugo Mouquet - Immunologie Humorale - Recherche sur les anticorps monoclonauxLien
- [3] Marché des médicaments antipaludiques à base d'artémisinineLien
- [4] Clinical Infectious Diseases - Nouvelles thérapies antipaludiquesLien
- [5] Implémentation du dépistage de la déficience en G6PDLien
- [6] Réponse opérationnelle au paludisme à P. vivax chez les orpailleurs en GuyaneLien
- [7] Origine et évolution adaptative de P. falciparum et P. vivax en Amérique latineLien
- [8] P. vivax et P. knowlesi en IndonésieLien
- [9] Ré-émergence du paludisme en Guyane en 2023-2024Lien
- [12] Mécanismes d'invasion cellulaire de P. vivax - Technologies omiquesLien
- [14] Paludisme : symptômes, traitement, prévention - Institut PasteurLien
- [15] Paludisme (ou Malaria) : symptômes, traitement - Institut Pasteur LilleLien
- [16] Paludisme - Infections - Manuels MSDLien
Publications scientifiques
- Réponse opérationnelle au paludisme à Plasmodium vivax chez les orpailleurs illégaux en Guyane: un dispositif d'accès au diagnostic et au traitement hors les murs (2025)
- Origine et évolution adaptative de deux agents du paludisme (Plasmodium falciparum et Plasmodium vivax) en Amérique latine (2024)
- Plasmodium vivax et Plasmodium knowlesi en Indonésie (2022)
- Ré-émergence du paludisme en Guyane en 2023-2024 (2025)
- Plasmodium simium dans la forêt Atlantique de Rio de Janeiro: le paludisme zoonotique brésilien (2023)
Ressources web
- Paludisme : symptômes, traitement, prévention (pasteur.fr)
Le paludisme soit confirmé par un diagnostic basé sur la recherche des plasmodies (par microscopie ou test diagnostique rapide). Le diagnostic et le traitement ...
- Paludisme (ou Malaria) : symptômes, traitement et ... (pasteur-lille.fr)
Le symptôme le plus fréquent du paludisme est une fièvre irrégulière pouvant s'accompagner de troubles digestifs (douleurs abdominales, nausées, vomissements).
- Paludisme - Infections - Manuels MSD pour le grand public (msdmanuals.com)
Le paludisme est une infection des globules rouges par l'une des cinq espèces du protozoaire Plasmodium. Le paludisme provoque de la fièvre, des frissons, ...
- Risque de paludisme à Plasmodium Vivax (severemalaria.org)
Le paludisme grave P. Vivax peut avoir des symptômes similaires à ceux du P. Falciparum. L'anémie sévère est plus fréquente chez les jeunes enfants.
- Plasmodium vivax, un parasite qui sort de l'ombre (revmed.ch)
Diagnostic. Le diagnostic de la malaria à P. vivax repose sur la microscopie après coloration de Giemsa et le test diagnostique rapide (TDR).

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
