Ovarite (Oophorite) : Symptômes, Causes et Traitements 2025
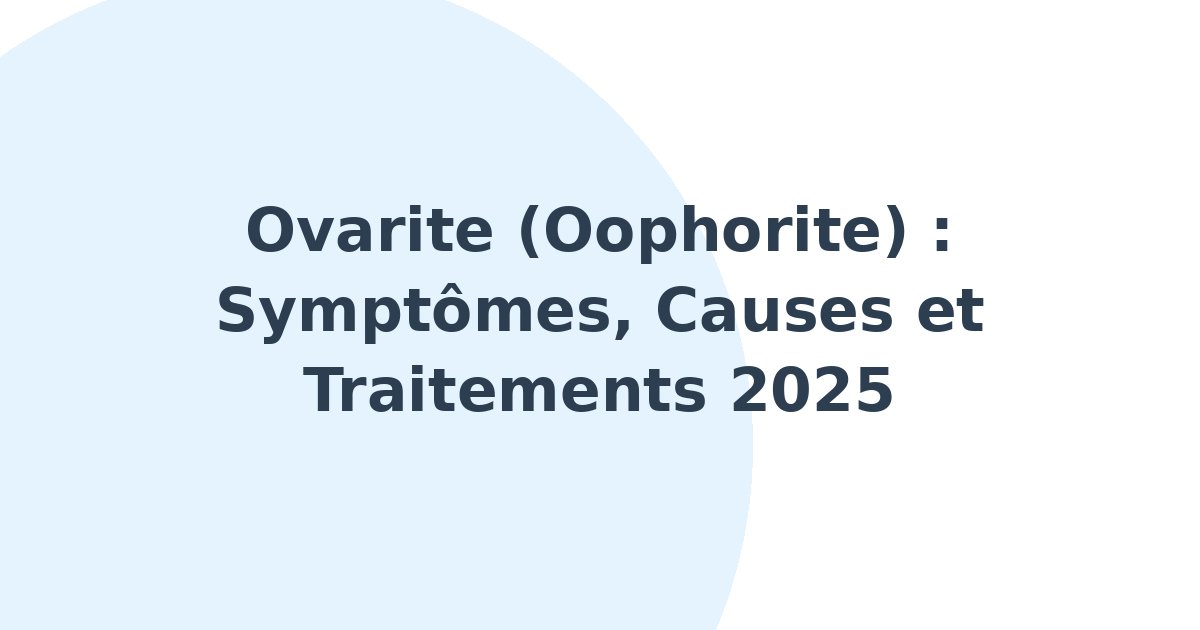
L'ovarite, également appelée oophorite, désigne une inflammation des ovaires qui peut toucher les femmes à différents âges. Cette pathologie, souvent méconnue, nécessite une prise en charge adaptée pour éviter les complications. Comprendre ses symptômes et ses traitements vous permettra de mieux appréhender cette maladie et d'agir rapidement si nécessaire.
Téléconsultation et Ovarite
Téléconsultation non recommandéeL'ovarite nécessite généralement un examen gynécologique complet avec palpation abdominale et pelvienne pour évaluer la douleur, la sensibilité ovarienne et exclure des complications. Le diagnostic repose souvent sur des examens complémentaires (échographie pelvienne, bilan biologique inflammatoire) qui ne peuvent être réalisés à distance.
Ce qui peut être évalué à distance
Évaluation des symptômes douloureux pelviens et de leur intensité, analyse de l'historique menstruel et gynécologique, évaluation des signes généraux d'infection, orientation diagnostique préliminaire basée sur l'interrogatoire, suivi de l'évolution sous traitement déjà instauré.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen gynécologique avec palpation pelvienne pour localiser la douleur ovarienne, échographie pelvienne pour visualiser les ovaires et détecter d'éventuelles complications, prélèvements vaginaux si suspicion d'infection ascendante, bilan biologique inflammatoire et infectieux.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Douleur pelvienne aiguë nécessitant un examen clinique pour éliminer une torsion ovarienne ou une rupture de kyste, suspicion de complication infectieuse nécessitant des prélèvements, besoin d'une échographie pelvienne urgente pour évaluer les ovaires, douleur rebelle nécessitant une évaluation spécialisée.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Douleur pelvienne brutale et intense évoquant une urgence chirurgicale ovarienne, fièvre élevée avec douleur pelvienne suggérant une infection sévère, signes de choc ou d'hémorragie interne.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Douleur pelvienne brutale et intense d'apparition soudaine
- Fièvre élevée (>38,5°C) associée à des douleurs pelviennes
- Vomissements incoercibles avec douleur pelvienne aiguë
- Signes de choc (malaise, pâleur, sueurs, hypotension)
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Gynécologue — consultation en présentiel indispensable
L'ovarite nécessite un examen gynécologique spécialisé avec palpation pelvienne et souvent une échographie pour le diagnostic. Une consultation en présentiel est indispensable pour une prise en charge adaptée et l'exclusion de complications.
Ovarite : Définition et Vue d'Ensemble
L'ovarite correspond à une inflammation d'un ou des deux ovaires. Cette pathologie peut survenir de manière isolée ou s'inscrire dans le cadre plus large d'une maladie pelvienne inflammatoire [1,6]. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'ovarite n'est pas toujours d'origine infectieuse.
En effet, plusieurs mécanismes peuvent déclencher cette inflammation. Les infections bactériennes représentent la cause la plus fréquente, mais les processus auto-immuns gagnent en reconnaissance . D'ailleurs, les recherches récentes montrent que certaines ovarites s'intègrent dans des syndromes dysimmunitaires plus complexes .
Il faut savoir que l'ovarite peut être aiguë ou chronique. La forme aiguë se manifeste brutalement avec des symptômes intenses, tandis que la forme chronique évolue insidieusement sur plusieurs mois. Cette distinction est cruciale car elle influence directement la prise en charge thérapeutique [5,7].
Concrètement, l'inflammation ovarienne perturbe le fonctionnement normal de ces glandes essentielles à la reproduction féminine. Les ovaires produisent les hormones sexuelles et libèrent les ovules lors de chaque cycle menstruel. Quand ils s'enflamment, ces processus peuvent être altérés, entraînant des répercussions sur la fertilité [4].
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques sur l'ovarite restent partielles en raison de la difficulté diagnostique de cette pathologie. En France, on estime que l'ovarite touche environ 2 à 4% des femmes en âge de procréer, avec une incidence annuelle d'environ 15 000 nouveaux cas [1,6].
L'âge de survenue varie considérablement selon l'étiologie. Les ovarites infectieuses prédominent chez les femmes jeunes sexuellement actives, avec un pic entre 20 et 35 ans. En revanche, les formes auto-immunes peuvent apparaître à tout âge, y compris après la ménopause .
Au niveau européen, les taux d'incidence montrent des variations importantes. Les pays nordiques rapportent des prévalences plus élevées, possiblement liées à de meilleures pratiques de dépistage. L'Allemagne et les Pays-Bas affichent des chiffres similaires à la France, tandis que les pays méditerranéens semblent moins touchés [6].
Il est intéressant de noter que l'évolution temporelle montre une stabilisation des cas d'ovarites infectieuses grâce aux campagnes de prévention des infections sexuellement transmissibles. Cependant, on observe une augmentation des formes auto-immunes, probablement due à une meilleure reconnaissance diagnostique .
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes de l'ovarite sont multiples et peuvent être regroupées en plusieurs catégories principales. Les infections bactériennes constituent la première cause, notamment par Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhoeae [2,6]. Ces germes remontent généralement depuis le vagin et le col utérin.
Mais d'autres micro-organismes peuvent être impliqués. Les infections à streptocoques, staphylocoques ou encore les bacilles gram-négatifs peuvent également déclencher une ovarite. Plus rarement, des infections virales ou fongiques sont en cause [1,7].
Les causes auto-immunes gagnent en reconnaissance. L'ovarite peut s'intégrer dans des maladies systémiques comme le syndrome de Sjögren ou d'autres pathologies dysimmunitaires . Dans ces cas, le système immunitaire attaque par erreur les tissus ovariens sains.
Certains facteurs augmentent le risque de développer une ovarite. L'activité sexuelle précoce, les partenaires multiples et les antécédents d'infections génitales constituent des facteurs de risque majeurs pour les formes infectieuses. Les dispositifs intra-utérins peuvent également favoriser la remontée de germes [6,5].
D'un autre côté, les interventions chirurgicales pelviennes, les avortements ou les accouchements peuvent créer une porte d'entrée pour les infections. Le tabagisme et l'immunodépression représentent aussi des facteurs prédisposants non négligeables [7].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de l'ovarite varient selon qu'elle soit aiguë ou chronique. Dans sa forme aiguë, la douleur pelvienne constitue le symptôme principal. Cette douleur, souvent intense, se localise dans le bas-ventre et peut irradier vers les lombes [1,5].
Vous pourriez également ressentir de la fièvre, des frissons et une altération de l'état général. Ces signes témoignent de la réaction inflammatoire de l'organisme face à l'infection. La douleur s'aggrave généralement lors des mouvements ou des rapports sexuels [7,6].
Les troubles menstruels représentent un autre symptôme fréquent. Vous pouvez observer des règles irrégulières, plus abondantes ou au contraire plus rares. Certaines femmes rapportent des saignements entre les règles ou des douleurs accrues pendant les menstruations [4,3].
Dans les formes chroniques, les symptômes sont plus insidieux. Une fatigue persistante, des douleurs pelviennes sourdes et récurrentes, ainsi que des troubles de la fertilité peuvent être les seuls signes d'alerte. Il est normal de ne pas immédiatement faire le lien avec une ovarite [5,7].
Concrètement, d'autres symptômes peuvent accompagner l'ovarite. Les nausées, vomissements, troubles urinaires ou pertes vaginales anormales doivent vous alerter. Rassurez-vous, tous ces symptômes ne sont pas forcément présents simultanément [1,6].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de l'ovarite repose sur une démarche méthodique associant examen clinique et examens complémentaires. Votre médecin commencera par un interrogatoire détaillé pour identifier les facteurs de risque et caractériser vos symptômes [6,7].
L'examen gynécologique constitue une étape cruciale. Il permet de localiser la douleur et d'évaluer l'état des organes pelviens. Cet examen peut être inconfortable en cas d'inflammation aiguë, mais il reste indispensable pour orienter le diagnostic [1,5].
Les examens biologiques apportent des informations précieuses. La numération formule sanguine révèle souvent une élévation des globules blancs et des marqueurs inflammatoires comme la CRP. Les prélèvements vaginaux permettent d'identifier les germes responsables dans les formes infectieuses [6,7].
L'échographie pelvienne représente l'examen d'imagerie de première intention. Elle visualise les ovaires, évalue leur taille et détecte d'éventuelles collections liquidiennes. Cet examen non invasif guide souvent la prise en charge thérapeutique [1,5].
Dans certains cas complexes, d'autres examens peuvent être nécessaires. L'IRM pelvienne offre une meilleure résolution tissulaire, tandis que la cœlioscopie permet un diagnostic de certitude tout en offrant des possibilités thérapeutiques. Ces examens restent réservés aux situations particulières [7,6].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de l'ovarite dépend essentiellement de sa cause et de sa sévérité. Pour les ovarites infectieuses, l'antibiothérapie constitue le pilier thérapeutique. Le choix des antibiotiques se base sur les germes identifiés ou suspectés [6,7].
En première intention, une association d'antibiotiques est souvent prescrite pour couvrir un large spectre bactérien. La doxycycline associée au métronidazole représente un schéma classique. La durée du traitement varie généralement de 10 à 14 jours selon la sévérité [5,2].
Le traitement symptomatique ne doit pas être négligé. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens soulagent efficacement la douleur et réduisent l'inflammation. Le repos et l'application de chaleur locale peuvent également apporter un soulagement [7,1].
Pour les formes auto-immunes, l'approche thérapeutique diffère. Les corticoïdes constituent souvent le traitement de première ligne, parfois associés à des immunosuppresseurs dans les cas résistants. Cette prise en charge nécessite une surveillance médicale étroite .
Dans les cas sévères avec complications, une intervention chirurgicale peut s'avérer nécessaire. La cœlioscopie permet de drainer d'éventuels abcès ou de réaliser des prélèvements diagnostiques. Heureusement, ces situations restent exceptionnelles avec une prise en charge précoce [6,1].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les avancées thérapeutiques récentes ouvrent de nouvelles perspectives dans la prise en charge de l'ovarite. Les recherches sur l'exploitation des lymphocytes T régulateurs (Tregs) montrent des résultats prometteurs pour moduler la réponse inflammatoire dans les formes auto-immunes .
Cette approche innovante vise à rééquilibrer le système immunitaire plutôt qu'à le supprimer globalement. Les premiers essais cliniques suggèrent une efficacité intéressante avec moins d'effets secondaires que les traitements immunosuppresseurs classiques .
Par ailleurs, les thérapies ciblées font l'objet d'investigations poussées. Le TREMFYA, initialement développé pour d'autres pathologies inflammatoires, montre des effets bénéfiques sur la progression radiographique des lésions inflammatoires pelviennes . Ces données encourageantes ouvrent la voie à de nouveaux protocoles thérapeutiques.
L'intelligence artificielle révolutionne également le diagnostic précoce. Des algorithmes d'apprentissage automatique analysent les images échographiques pour détecter des signes subtils d'inflammation ovarienne. Cette technologie pourrait considérablement améliorer la prise en charge précoce .
Enfin, la médecine personnalisée gagne du terrain. L'analyse du profil génétique et immunologique de chaque patiente permet d'adapter le traitement de manière individualisée. Cette approche sur mesure optimise l'efficacité thérapeutique tout en minimisant les effets indésirables .
Vivre au Quotidien avec Ovarite
Vivre avec une ovarite chronique nécessite certains ajustements dans votre quotidien. La gestion de la douleur constitue souvent le défi principal. Il est important d'apprendre à reconnaître les signaux de votre corps et à adapter vos activités en conséquence [5,7].
L'activité physique adaptée peut vous aider à mieux gérer les symptômes. Des exercices doux comme la marche, le yoga ou la natation favorisent la circulation sanguine pelvienne et réduisent les tensions musculaires. Évitez cependant les sports trop intenses pendant les poussées inflammatoires [1,4].
Votre alimentation joue également un rôle non négligeable. Une alimentation anti-inflammatoire riche en oméga-3, fruits et légumes peut contribuer à réduire l'inflammation générale. Limitez les aliments pro-inflammatoires comme les sucres raffinés et les graisses saturées [7].
La gestion du stress s'avère cruciale car il peut aggraver les symptômes inflammatoires. Des techniques de relaxation, méditation ou sophrologie peuvent vous apporter un soulagement significatif. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel si nécessaire .
Concernant votre vie intime, communiquez ouvertement avec votre partenaire sur vos difficultés. Les douleurs lors des rapports sexuels ne sont pas une fatalité et des solutions existent. Votre gynécologue peut vous conseiller des positions moins douloureuses ou des lubrifiants adaptés [5,4].
Les Complications Possibles
L'ovarite non traitée ou mal prise en charge peut entraîner plusieurs complications graves. La formation d'abcès ovariens représente l'une des complications les plus redoutées. Ces collections purulentes nécessitent souvent un drainage chirurgical en urgence [1,6].
Les troubles de la fertilité constituent une préoccupation majeure, surtout chez les femmes en âge de procréer. L'inflammation chronique peut altérer la fonction ovarienne et compromettre l'ovulation. Dans les cas sévères, une stérilité définitive peut survenir [4,3].
La propagation de l'infection vers d'autres organes pelviens peut compliquer le tableau clinique. Le syndrome de Fitz-Hugh-Curtis, caractérisé par une inflammation du foie, peut accompagner certaines ovarites infectieuses [2]. Cette complication, bien que rare, nécessite une prise en charge spécialisée.
Les douleurs pelviennes chroniques représentent une complication fréquente et invalidante. Elles peuvent persister même après guérison de l'inflammation initiale, impactant significativement la qualité de vie. Une prise en charge multidisciplinaire s'avère alors nécessaire [5,7].
Enfin, les récidives constituent un risque non négligeable, particulièrement dans les formes auto-immunes. Un suivi médical régulier permet de détecter précocement ces récurrences et d'adapter le traitement en conséquence .
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'ovarite dépend largement de la précocité du diagnostic et de l'adéquation du traitement. Dans les formes infectieuses diagnostiquées rapidement, la guérison complète est la règle avec un traitement antibiotique approprié [6,7].
Cependant, les retards diagnostiques peuvent compromettre le pronostic. Plus l'inflammation persiste, plus le risque de séquelles augmente. C'est pourquoi il est crucial de consulter rapidement en cas de symptômes évocateurs [1,5].
Pour les formes auto-immunes, le pronostic est généralement plus réservé. Ces pathologies évoluent souvent par poussées et nécessitent un traitement au long cours. Néanmoins, une prise en charge adaptée permet de contrôler l'évolution dans la majorité des cas .
L'âge au moment du diagnostic influence également le pronostic. Les femmes jeunes ont généralement une meilleure capacité de récupération ovarienne, tandis que les femmes proches de la ménopause peuvent voir leurs symptômes s'améliorer naturellement avec la baisse hormonale [4,3].
Il faut savoir que les innovations thérapeutiques récentes améliorent considérablement les perspectives. Les nouveaux traitements ciblés et les approches personnalisées offrent de l'espoir même dans les cas complexes . L'important est de maintenir un suivi médical régulier et de ne pas perdre espoir.
Peut-on Prévenir Ovarite ?
La prévention de l'ovarite repose principalement sur la réduction des facteurs de risque modifiables. Pour les formes infectieuses, la prévention des infections sexuellement transmissibles constitue la mesure la plus efficace [6,2].
L'utilisation systématique de préservatifs lors des rapports sexuels avec des partenaires non testés réduit considérablement le risque de contamination. Le dépistage régulier des IST chez vous et votre partenaire permet une détection précoce et un traitement rapide [5,7].
Une hygiène intime appropriée contribue également à la prévention. Évitez les douches vaginales qui perturbent la flore naturelle et favorisent les infections. Privilégiez des sous-vêtements en coton et changez-les quotidiennement [1,5].
Le renforcement du système immunitaire par une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et une gestion du stress peut réduire le risque de développer des formes auto-immunes. Bien sûr, ces mesures ne attendussent pas une protection absolue .
Concernant les interventions médicales, discutez avec votre gynécologue des risques liés aux dispositifs intra-utérins si vous avez des antécédents d'infections pelviennes. Une surveillance accrue peut être nécessaire dans certains cas [6,4].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont établi des recommandations précises concernant la prise en charge de l'ovarite. La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise un diagnostic rapide basé sur l'association de signes cliniques et d'examens complémentaires ciblés [6,1].
Selon les dernières directives, l'antibiothérapie probabiliste doit être initiée rapidement en cas de suspicion d'ovarite infectieuse, sans attendre les résultats bactériologiques. Cette approche précoce permet de limiter les complications et d'améliorer le pronostic [7,2].
L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) a récemment actualisé ses recommandations concernant l'utilisation des anti-inflammatoires dans les infections pelviennes. Une surveillance renforcée est désormais préconisée en raison du risque de masquer une évolution défavorable [5,6].
Santé Publique France insiste sur l'importance de la prévention primaire par l'éducation sexuelle et le dépistage des IST. Les campagnes de sensibilisation ciblent particulièrement les jeunes femmes, population la plus à risque [2,1].
Les sociétés savantes de gynécologie recommandent un suivi spécialisé pour les formes chroniques ou récidivantes. Cette prise en charge multidisciplinaire associe gynécologues, infectiologues et parfois rhumatologues selon l'étiologie suspectée [6].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations et ressources peuvent vous accompagner dans votre parcours avec l'ovarite. L'Association Française de Lutte contre les Infections Nosocomiales propose des informations sur la prévention des infections pelviennes et organise des groupes de parole [6,1].
Pour les formes auto-immunes, l'Association Française des Polyarthritiques et des Rhumatismes Inflammatoires Chroniques offre un soutien précieux. Bien que centrée sur les pathologies rhumatismales, elle accueille les patientes souffrant d'autres maladies auto-immunes .
Le site Ameli.fr de l'Assurance Maladie propose des fiches d'information actualisées sur les maladies pelviennes inflammatoires. Vous y trouverez également des conseils pratiques pour le suivi médical et les démarches administratives [5,7].
Les forums en ligne spécialisés permettent d'échanger avec d'autres femmes confrontées à la même pathologie. Ces espaces d'entraide offrent un soutien psychologique précieux, même si les conseils médicaux doivent toujours être validés par un professionnel [4].
N'hésitez pas à solliciter l'aide d'un psychologue si l'impact de la maladie sur votre qualité de vie devient trop important. De nombreux professionnels sont formés à l'accompagnement des maladies chroniques et peuvent vous aider à mieux vivre avec votre pathologie .
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour mieux gérer votre ovarite au quotidien. Tenez un journal des symptômes pour identifier les facteurs déclenchants et suivre l'évolution de votre pathologie. Cette information sera précieuse lors de vos consultations médicales [5,7].
Apprenez à reconnaître les signes d'aggravation qui nécessitent une consultation en urgence : fièvre élevée, douleurs intenses, vomissements persistants. N'attendez pas que les symptômes s'aggravent pour consulter [1,6].
Organisez votre trousse de secours avec vos médicaments habituels, une bouillotte pour soulager les douleurs et les coordonnées de votre médecin. Cette préparation vous évitera du stress en cas de crise [7,5].
Informez votre entourage professionnel de votre pathologie si elle impacte votre travail. Beaucoup d'employeurs sont compréhensifs et peuvent proposer des aménagements d'horaires ou de poste. N'hésitez pas à faire valoir vos droits [4].
Enfin, restez à jour dans vos vaccinations, particulièrement contre la grippe et le pneumocoque. Votre système immunitaire peut être fragilisé par la maladie ou les traitements, rendant ces protections d'autant plus importantes .
Quand Consulter un Médecin ?
Certains symptômes doivent vous amener à consulter rapidement un professionnel de santé. Une douleur pelvienne intense et soudaine, surtout si elle s'accompagne de fièvre, constitue une urgence médicale [1,6].
Les troubles menstruels persistants méritent également une consultation. Des règles très douloureuses, irrégulières ou des saignements anormaux peuvent révéler une ovarite débutante [3,4]. Il vaut mieux consulter pour rien que de passer à côté d'un diagnostic important.
Si vous présentez des symptômes évocateurs d'infection génitale (pertes anormales, brûlures, démangeaisons), n'attendez pas. Un traitement précoce évite la propagation de l'infection vers les organes pelviens profonds [2,5].
Pour les femmes ayant des antécédents d'ovarite, toute réapparition de symptômes doit motiver une consultation. Les récidives sont possibles et nécessitent une prise en charge adaptée [7].
Enfin, si votre qualité de vie est impactée par des douleurs chroniques ou des troubles de la fertilité, n'hésitez pas à demander un avis spécialisé. Des solutions existent et votre souffrance n'est pas une fatalité [4].
Questions Fréquentes
L'ovarite est-elle contagieuse ?
L'ovarite elle-même n'est pas contagieuse, mais les infections qui peuvent la causer (comme les IST) peuvent se transmettre lors de rapports sexuels non protégés.
Peut-on avoir des enfants après une ovarite ?
Dans la majorité des cas, oui. Cependant, une ovarite sévère ou mal traitée peut affecter la fertilité. Un suivi gynécologique permet d'évaluer l'impact sur la fonction ovarienne.
Combien de temps dure le traitement ?
Pour les formes infectieuses, l'antibiothérapie dure généralement 10 à 14 jours. Les formes auto-immunes nécessitent souvent un traitement plus prolongé.
L'ovarite peut-elle récidiver ?
Oui, particulièrement dans les formes auto-immunes ou en cas de facteurs de risque persistants. Un suivi médical régulier permet de détecter précocement les récidives.
Quels sont les signes d'urgence ?
Douleur pelvienne intense, fièvre élevée, vomissements persistants et altération de l'état général nécessitent une consultation en urgence.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] A phase 3, randomized, double-blind, active-controlled clinical study on innovative therapeutic approachesLien
- [2] Treatment Effect of TREMFYA on Radiographic Progression in inflammatory conditionsLien
- [3] Exploiting regulatory T cells (Tregs): Cutting-edge therapy for autoimmune conditionsLien
- [4] Particularités des hépatites auto-immunes: association à d'autres maladies dysimmunitairesLien
- [5] Urgences infectieuses en imagerie pelvienneLien
- [6] Les deux destins de Dora, approche psychosomatique intégrativeLien
- [7] Maladies auto-immunes associées au syndrome de SjörgenLien
- [8] Le syndrome de Fitz-Hugh-CurtisLien
- [9] Aménorrhée primaire: bien la comprendre pour bien la traiterLien
- [11] Subfertilité chez la femme: quand commencer la mise au pointLien
- [12] Tout savoir sur l'ovarite : infection des ovairesLien
- [13] Maladie pelvienne inflammatoire - Gynécologie et obstétriqueLien
- [14] Oophorite - causes, symptômes et traitementLien
Publications scientifiques
- Particularités des hépatites auto-immunes: association à d'autres maladies dysimmunitaires et facteurs associés à la réponse au traitement (2024)
- [PDF][PDF] Urgences infectieuses en imagerie pelvienne (2023)
- Les deux destins de Dora, approche psychosomatique intégrative du célèbre cas de Sigmund Freud (2025)
- Maladies auto-immunes associées au syndrome de Sjörgen et facteurs prédictifs de son caractère secondaire (2022)
- Le syndrome de Fitz-Hugh-Curtis (2022)
Ressources web
- Tout savoir sur l'ovarite : infection des ovaires - Santé (croq-kilos.com)
29 sept. 2024 — Le diagnostic de l'ovarite repose sur une combinaison d'examen clinique, d'antécédents médicaux, et de tests complémentaires pour identifier la ...
- Maladie pelvienne inflammatoire - Gynécologie et ... (msdmanuals.com)
Une maladie pelvienne inflammatoire est aussi évoquée lorsque des métrorragies irrégulières, des dyspareunies ou une dysurie restent inexpliquées. Un diagnostic ...
- Oophorite - causes, symptômes et traitement (medicoverhospitals.in)
Ovarite aiguë : Caractérisé par une apparition soudaine de symptômes, souvent dus à une infection. · Ovarite chronique : Une affection plus prolongée qui peut ...
- Ovarite : quels sont les signes et causes d'une infection ... (femmeactuelle.fr)
25 août 2024 — Le diagnostic de l'ovarite repose essentiellement sur l'examen gynécologique, mais il implique aussi une échographie et une analyse de sang.
- Infection pelvienne - Causes, Symptômes, Traitement ... (santecheznous.com)
une douleur abdominale basse;; des douleurs pendant les rapports sexuels;; un écoulement vaginal anormal possiblement nauséabond;; une fièvre;; des pertes ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
