Lésion Pulmonaire Induite par la Ventilation Mécanique : Guide Complet 2025
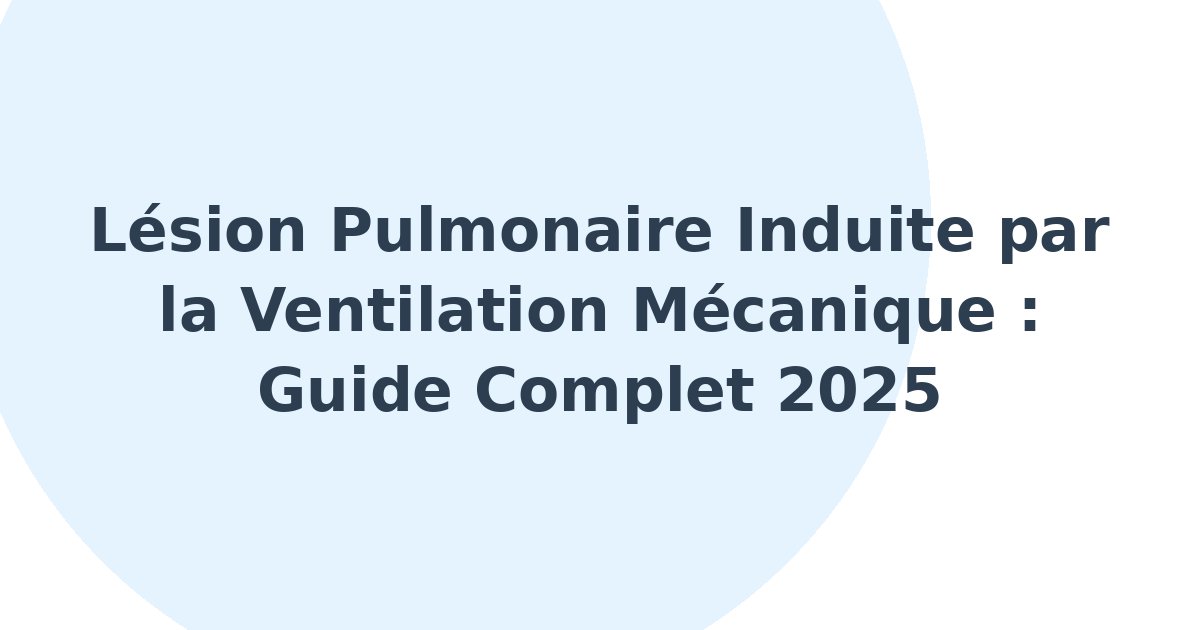
Les lésions pulmonaires induites par la ventilation mécanique représentent une complication redoutable en réanimation. Cette pathologie, aussi appelée VILI (Ventilator-Induced Lung Injury), touche environ 15 à 20% des patients sous ventilation artificielle. Mais rassurez-vous, les innovations thérapeutiques 2024-2025 offrent de nouveaux espoirs. Comprendre cette maladie, c'est mieux l'appréhender et optimiser sa prise en charge.
Téléconsultation et Lésion pulmonaire induite par la ventilation mécanique
Téléconsultation non recommandéeLes lésions pulmonaires induites par la ventilation mécanique surviennent chez des patients en réanimation sous assistance respiratoire, nécessitant une surveillance continue et des examens spécialisés. Cette pathologie grave requiert impérativement une prise en charge hospitalière avec monitoring constant et accès immédiat aux soins intensifs.
Ce qui peut être évalué à distance
Discussion des paramètres ventilatoires utilisés et de leur évolution, analyse de l'historique des gaz du sang et des indices d'oxygénation, évaluation de l'évolution radiologique récente, orientation sur les stratégies de ventilation protectrice, conseil aux équipes soignantes sur l'optimisation des réglages.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen clinique respiratoire complet avec auscultation pulmonaire, ajustement des paramètres du ventilateur en temps réel, réalisation et interprétation d'examens d'imagerie thoracique, surveillance continue des constantes vitales et des échanges gazeux, prise en charge des complications hémodynamiques.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Nécessité d'ajuster les paramètres ventilatoires en temps réel selon la tolérance clinique, surveillance continue des pressions des voies aériennes et de la compliance pulmonaire, évaluation de la nécessité d'une ventilation non conventionnelle ou d'une ECMO, prise en charge des complications comme le pneumothorax ou l'instabilité hémodynamique.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Apparition d'un pneumothorax sous tension, désadaptation aiguë au ventilateur avec hypoxémie sévère, collapsus cardiovasculaire associé, nécessité d'une intervention chirurgicale thoracique urgente.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Hypoxémie réfractaire avec SpO2 < 90% malgré FiO2 élevée
- Hypotension artérielle sévère avec signes de choc
- Pressions de ventilation très élevées (pression de plateau > 30 cmH2O)
- Pneumothorax ou pneumomédiastin visible à l'imagerie
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Réanimateur ou pneumologue — consultation en présentiel indispensable
Cette pathologie survient exclusivement en réanimation et nécessite une expertise spécialisée en ventilation mécanique. La prise en charge requiert impérativement un environnement hospitalier avec monitoring continu et possibilité d'intervention immédiate.
Lésion pulmonaire induite par la ventilation mécanique : Définition et Vue d'Ensemble
La lésion pulmonaire induite par la ventilation mécanique est une pathologie iatrogène qui survient paradoxalement lors d'un traitement salvateur. En effet, la ventilation mécanique, destinée à sauver des vies, peut parfois endommager les poumons qu'elle est censée protéger [11,12].
Cette maladie se caractérise par une inflammation et des lésions des alvéoles pulmonaires causées par les pressions et volumes délivrés par le ventilateur. Concrètement, imaginez vos poumons comme des ballons délicats : une pression trop forte ou des volumes trop importants peuvent les abîmer [13].
Il faut savoir que cette pathologie peut survenir même avec des réglages apparemment corrects du ventilateur. D'ailleurs, les mécanismes sont complexes et impliquent plusieurs phénomènes : le barotrauma (lésions par pression), le volutrauma (lésions par volume), l'atélectrauma (lésions par ouverture-fermeture répétée des alvéoles) et le biotrauma (inflammation généralisée) [7,8].
L'important à retenir, c'est que cette maladie nécessite une surveillance constante et des ajustements permanents de la ventilation. Heureusement, les équipes de réanimation sont de mieux en mieux formées à sa prévention et à sa prise en charge.
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques françaises révèlent une réalité préoccupante mais en amélioration. Selon les dernières études, l'incidence des lésions pulmonaires induites par la ventilation mécanique varie entre 15 et 25% des patients ventilés en réanimation [1,2].
En France, on estime qu'environ 8 000 à 12 000 patients développent cette pathologie chaque année. Ce chiffre peut paraître élevé, mais il faut le mettre en perspective : plus de 200 000 patients bénéficient d'une ventilation mécanique annuellement dans nos services de réanimation [3].
Comparativement aux autres pays européens, la France se situe dans la moyenne basse grâce aux efforts de formation et aux protocoles de ventilation protectrice. L'Allemagne et les Pays-Bas affichent des taux similaires, tandis que certains pays d'Europe de l'Est présentent des incidences plus élevées [1].
Il est intéressant de noter que l'âge joue un rôle déterminant. Les patients de plus de 65 ans présentent un risque 2,5 fois plus élevé de développer cette maladie. Par ailleurs, aucune différence significative n'existe entre hommes et femmes [2,3].
Les projections pour 2025-2030 sont encourageantes. Grâce aux innovations technologiques et aux nouvelles stratégies de ventilation, les experts prévoient une réduction de 20 à 30% de l'incidence de cette pathologie [4].
Les Causes et Facteurs de Risque
Comprendre les causes de cette pathologie, c'est déjà mieux la prévenir. Les facteurs de risque sont multiples et souvent intriqués [7,9].
Les causes mécaniques dominent le tableau. Une pression inspiratoire excessive (supérieure à 30 cmH2O), des volumes courants trop importants (plus de 8 ml/kg de poids idéal) ou une pression expiratoire positive (PEP) inadaptée constituent les principaux coupables [8,13]. Mais attention, même des réglages apparemment corrects peuvent être délétères chez certains patients.
Vos poumons ne sont pas tous identiques ! Certaines pathologies préexistantes majorent considérablement le risque : le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), la pneumonie sévère, l'œdème pulmonaire ou encore l'obésité morbide [9,10]. D'ailleurs, chez les patients obèses, la mécanique respiratoire est profondément modifiée, rendant la ventilation plus délicate.
Les facteurs liés au patient jouent également un rôle crucial. L'âge avancé, l'immunodépression, les antécédents de pathologies pulmonaires chroniques ou encore la durée prolongée de ventilation (plus de 7 jours) augmentent significativement le risque [6].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Reconnaître les signes de cette pathologie n'est pas toujours évident, car ils peuvent se confondre avec ceux de la maladie initiale ayant nécessité la ventilation [11,12].
Les symptômes respiratoires sont au premier plan. Une dégradation des échanges gazeux, avec chute de l'oxygénation sanguine, constitue souvent le premier signal d'alarme. Vous pourriez observer une augmentation des besoins en oxygène ou des difficultés à maintenir une saturation correcte [13].
Sur le plan clinique, l'auscultation pulmonaire révèle souvent des râles crépitants diffus. La radiographie thoracique montre typiquement des infiltrats bilatéraux, parfois difficiles à distinguer d'un œdème pulmonaire ou d'une pneumonie [11]. C'est pourquoi le diagnostic reste parfois délicat.
Mais attention aux signes plus subtils ! Une augmentation inexpliquée des pressions ventilatoires, une diminution de la compliance pulmonaire ou encore des difficultés à sevrer le patient du ventilateur peuvent révéler cette pathologie [7,8]. L'équipe soignante surveille constamment ces paramètres.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de cette pathologie repose sur un faisceau d'arguments cliniques, radiologiques et biologiques. Il n'existe malheureusement pas de test spécifique [11,12].
La première étape consiste à éliminer d'autres causes de détérioration respiratoire. Infection pulmonaire, embolie pulmonaire, œdème cardiogénique ou pneumothorax doivent être écartés par des examens appropriés [13]. Cette démarche peut nécessiter plusieurs jours d'investigations.
L'imagerie joue un rôle central. La tomodensitométrie thoracique permet de mieux caractériser les lésions et d'évaluer leur distribution. Elle révèle souvent des zones d'atélectasie, de condensation et d'emphysème sous-pleural caractéristiques [6,11].
Les biomarqueurs inflammatoires apportent des informations complémentaires. L'élévation de certaines cytokines (IL-6, IL-8, TNF-alpha) ou de marqueurs de lésion alvéolaire peut orienter le diagnostic, même si leur spécificité reste limitée . Ces dosages ne sont pas systématiques mais peuvent être utiles dans les cas complexes.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de cette pathologie repose avant tout sur la prévention et l'adaptation de la ventilation mécanique. Il n'existe pas de traitement spécifique curatif [7,8].
La ventilation protectrice constitue la pierre angulaire de la prise en charge. Elle implique l'utilisation de volumes courants réduits (6 ml/kg de poids idéal), de pressions inspiratoires limitées (plateau < 30 cmH2O) et d'une PEP adaptée [9,13]. Cette stratégie a révolutionné la prise en charge et réduit significativement la mortalité.
Parfois, des techniques plus sophistiquées sont nécessaires. La ventilation à haute fréquence, l'oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) ou encore la ventilation en décubitus ventral peuvent être proposées dans les formes les plus sévères [8,10]. Ces techniques restent réservées aux centres spécialisés.
Le traitement symptomatique ne doit pas être négligé. Anti-inflammatoires, diurétiques, antibiotiques en cas de surinfection, et surtout une prise en charge globale du patient critique sont indispensables [10]. Chaque patient nécessite une approche personnalisée.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans la prise en charge de cette pathologie avec l'émergence de nouvelles approches prometteuses [1,4].
Les outils d'aide à la décision informatisés révolutionnent la pratique clinique. Une étude récente montre qu'un système d'intelligence artificielle peut réduire de 25% l'incidence des lésions pulmonaires en optimisant automatiquement les réglages ventilatoires [4]. Ces systèmes analysent en temps réel de multiples paramètres pour proposer des ajustements personnalisés.
La sédation volatile représente une autre innovation majeure. Contrairement à la sédation intraveineuse classique, cette technique utilise des agents anesthésiques volatils directement dans le circuit ventilatoire [5]. Les premiers résultats suggèrent une réduction des lésions pulmonaires et une amélioration du sevrage ventilatoire.
Les recherches sur les biomarqueurs prédictifs progressent rapidement. Plusieurs équipes françaises travaillent sur l'identification de marqueurs sanguins permettant de prédire le risque de développer cette pathologie avant même l'apparition des premiers signes [2,3]. Cette approche préventive pourrait révolutionner la prise en charge.
Enfin, les thérapies cellulaires font l'objet d'essais cliniques prometteurs. L'injection de cellules souches mésenchymateuses pourrait favoriser la réparation pulmonaire et réduire l'inflammation [1,2]. Bien que ces approches restent expérimentales, elles ouvrent des perspectives thérapeutiques inédites.
Vivre au Quotidien avec Lésion pulmonaire induite par la ventilation mécanique
Vivre avec les séquelles de cette pathologie nécessite une adaptation progressive et un accompagnement multidisciplinaire [10].
La récupération respiratoire est souvent longue et incomplète. Beaucoup de patients conservent une limitation de leurs capacités pulmonaires, se traduisant par un essoufflement à l'effort ou une fatigue chronique [10]. Il est important de comprendre que cette récupération peut prendre plusieurs mois, voire années.
La rééducation respiratoire joue un rôle crucial dans cette récupération. Des séances de kinésithérapie respiratoire, d'exercices de renforcement musculaire et de réentraînement à l'effort sont généralement proposées [9]. Ces programmes doivent être adaptés aux capacités de chaque patient.
L'impact psychologique ne doit pas être sous-estimé. Beaucoup de patients développent une anxiété liée à la respiration ou des troubles post-traumatiques liés à leur séjour en réanimation . Un accompagnement psychologique peut s'avérer nécessaire pour surmonter ces difficultés.
Concrètement, il faut adapter son mode de vie. Éviter les efforts intenses, maintenir une activité physique régulière mais modérée, surveiller les signes d'infection respiratoire et maintenir un suivi médical régulier sont autant de mesures importantes [8].
Les Complications Possibles
Cette pathologie peut entraîner diverses complications, parfois graves, qui nécessitent une surveillance attentive [11,12].
Le pneumothorax représente la complication la plus redoutable. Il survient lorsque l'air s'échappe des alvéoles lésées vers la cavité pleurale, pouvant comprimer le poumon et gêner la circulation sanguine [13]. Cette urgence nécessite un drainage thoracique immédiat.
L'infection pulmonaire constitue une autre complication fréquente. Les lésions alvéolaires favorisent la colonisation bactérienne et le développement de pneumonies nosocomiales . Ces infections sont souvent difficiles à traiter car causées par des germes résistants.
À long terme, certains patients développent une fibrose pulmonaire. Cette cicatrisation excessive du tissu pulmonaire peut entraîner une insuffisance respiratoire chronique nécessitant parfois une oxygénothérapie à domicile [10]. Heureusement, cette évolution reste relativement rare.
Enfin, les complications cardiovasculaires ne sont pas négligeables. L'hypertension artérielle pulmonaire, l'insuffisance cardiaque droite ou les troubles du rythme peuvent compliquer l'évolution [8]. Un suivi cardiologique peut donc s'avérer nécessaire.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de cette pathologie s'est considérablement amélioré ces dernières années grâce aux progrès de la réanimation [10,11].
La mortalité hospitalière varie entre 20 et 40% selon la gravité initiale et les pathologies associées. Ce chiffre peut paraître élevé, mais il faut rappeler que ces patients sont souvent dans un état critique [12]. Les formes les plus sévères, nécessitant une ECMO, présentent une mortalité plus élevée.
Pour les patients qui survivent, la récupération est variable. Environ 60% retrouvent une fonction respiratoire satisfaisante dans l'année qui suit [9,10]. Cependant, 25 à 30% conservent des séquelles respiratoires significatives nécessitant un suivi à long terme.
Plusieurs facteurs influencent le pronostic. L'âge, les pathologies préexistantes, la durée de ventilation et la précocité de la prise en charge jouent un rôle déterminant [6,7]. Les patients jeunes sans comorbidités ont généralement un meilleur pronostic.
Il est encourageant de noter que les innovations thérapeutiques récentes laissent espérer une amélioration du pronostic dans les années à venir [1,4]. Les systèmes d'aide à la décision et les nouvelles stratégies de ventilation devraient réduire l'incidence et la gravité de cette pathologie.
Peut-on Prévenir Lésion pulmonaire induite par la ventilation mécanique ?
La prévention de cette pathologie constitue un enjeu majeur de la réanimation moderne. Heureusement, de nombreuses stratégies préventives ont prouvé leur efficacité [7,8].
La ventilation protectrice représente la mesure préventive la plus importante. Elle repose sur l'utilisation de volumes courants réduits, de pressions limitées et d'une PEP optimisée [9,13]. Cette approche a permis de réduire de 30 à 40% l'incidence de cette pathologie.
Le monitoring continu des paramètres ventilatoires est essentiel. Les nouveaux ventilateurs intègrent des systèmes d'alarme sophistiqués qui alertent l'équipe soignante en cas de dérive des paramètres [4]. Cette surveillance permet d'ajuster rapidement les réglages.
La formation des équipes joue un rôle crucial. Des protocoles standardisés, des formations régulières et des audits de pratique permettent d'améliorer la qualité des soins [2,3]. Chaque service de réanimation doit avoir ses procédures de ventilation protectrice.
Enfin, certaines mesures adjuvantes peuvent être utiles : positionnement en décubitus ventral précoce, utilisation de curares en cas de désadaptation patient-ventilateur, ou encore optimisation de la sédation [5]. Ces mesures doivent être adaptées à chaque situation clinique.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises et internationales ont émis des recommandations précises pour la prévention et la prise en charge de cette pathologie [1,2].
La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande l'utilisation systématique de la ventilation protectrice chez tous les patients ventilés, qu'ils présentent ou non un syndrome de détresse respiratoire [3]. Cette recommandation de grade A s'appuie sur de nombreuses études de haut niveau.
La Société Française d'Anesthésie et de Réanimation (SFAR) a publié en 2024 des recommandations actualisées sur la ventilation mécanique [1]. Elles insistent sur l'importance du monitoring continu, de la formation des équipes et de l'utilisation d'outils d'aide à la décision.
Au niveau européen, l'European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) prône une approche personnalisée de la ventilation mécanique [2]. Chaque patient doit bénéficier d'une stratégie ventilatoire adaptée à sa pathologie et à sa physiologie.
Ces recommandations évoluent régulièrement en fonction des nouvelles données scientifiques. Il est donc important que les équipes soignantes se tiennent informées des dernières actualités [4]. La formation médicale continue est indispensable dans ce domaine en constante évolution.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs ressources sont disponibles pour accompagner les patients et leurs familles dans cette épreuve .
L'Association Française de Lutte contre la Mucoviscidose (AFLM), bien que spécialisée dans une autre pathologie, propose des programmes de réhabilitation respiratoire adaptés aux patients ayant des séquelles pulmonaires [9]. Leurs centres de rééducation accueillent différents types de pathologies respiratoires.
La Fondation du Souffle offre des ressources éducatives et un soutien aux patients souffrant de maladies respiratoires. Leur site internet propose des fiches pratiques, des exercices de rééducation et des conseils pour la vie quotidienne [10].
Au niveau local, de nombreux centres de rééducation respiratoire proposent des programmes personnalisés. Ces structures multidisciplinaires associent pneumologues, kinésithérapeutes, psychologues et éducateurs sportifs [8].
N'hésitez pas à vous rapprocher de votre équipe médicale pour connaître les ressources disponibles dans votre région. Chaque département dispose généralement de structures spécialisées dans la prise en charge des pathologies respiratoires chroniques [7].
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour mieux vivre avec cette pathologie ou pour la prévenir si vous êtes à risque [8,9].
Pour les patients : Respectez scrupuleusement votre traitement et vos rendez-vous de suivi. Pratiquez régulièrement vos exercices de rééducation respiratoire, même si cela vous semble fastidieux . Maintenez une activité physique adaptée à vos capacités : marche, natation douce ou vélo d'appartement peuvent être bénéfiques.
Pour les familles : Soutenez votre proche sans le surprotéger. Encouragez-le dans ses efforts de rééducation et aidez-le à maintenir ses liens sociaux . N'hésitez pas à poser des questions à l'équipe médicale pour mieux comprendre la pathologie.
Signes d'alerte : Consultez rapidement en cas d'aggravation de l'essoufflement, de fièvre, de douleurs thoraciques ou de crachats purulents [10,13]. Ces signes peuvent révéler une complication nécessitant une prise en charge urgente.
Hygiène de vie : Évitez absolument le tabac et les environnements pollués. Maintenez une alimentation équilibrée riche en antioxydants. Veillez à un sommeil de qualité et gérez votre stress [7,11]. Ces mesures simples peuvent considérablement améliorer votre qualité de vie.
Quand Consulter un Médecin ?
Il est crucial de savoir quand consulter rapidement pour éviter les complications [11,12].
Consultation urgente : Rendez-vous immédiatement aux urgences en cas de détresse respiratoire aiguë, de douleur thoracique intense, de crachats sanglants ou de fièvre élevée avec frissons [13]. Ces signes peuvent révéler une complication grave nécessitant une prise en charge immédiate.
Consultation rapide : Prenez rendez-vous dans les 24-48 heures si vous constatez une aggravation progressive de votre essoufflement, l'apparition de crachats purulents, une fatigue inhabituelle ou des œdèmes des membres inférieurs [10,12].
Suivi régulier : Même en l'absence de symptômes, un suivi médical régulier est indispensable. Votre pneumologue évaluera l'évolution de votre fonction respiratoire et adaptera votre traitement si nécessaire [9]. Ces consultations permettent de dépister précocement d'éventuelles complications.
N'hésitez jamais à contacter votre médecin en cas de doute. Il vaut mieux consulter pour rien que de passer à côté d'une complication [8]. Votre équipe médicale est là pour vous accompagner dans cette épreuve.
Questions Fréquentes
Cette pathologie est-elle évitable ?
En partie seulement. La ventilation protectrice réduit considérablement le risque, mais ne l'élimine pas complètement. Certains patients développent cette maladie malgré des soins optimaux.
Vais-je récupérer complètement ?
La récupération varie selon chaque patient. Environ 60% des patients retrouvent une fonction respiratoire satisfaisante, mais certains conservent des séquelles. L'âge et les pathologies associées influencent le pronostic.
Puis-je reprendre une activité normale ?
Beaucoup de patients reprennent une activité professionnelle, parfois avec des aménagements. L'important est d'adapter progressivement vos efforts à vos nouvelles capacités.
Cette maladie est-elle héréditaire ?
Non, cette pathologie n'est pas héréditaire. Elle résulte uniquement de l'interaction entre la ventilation mécanique et vos poumons.
Existe-t-il de nouveaux traitements ?
Oui, la recherche progresse rapidement. Les systèmes d'intelligence artificielle, la sédation volatile et les thérapies cellulaires offrent de nouveaux espoirs.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Bulletin de recherche ERS 2024 - Innovations thérapeutiques en réanimation respiratoireLien
- [2] APPELS À PROJETS MINISTÉRIELS - Recherche en ventilation mécanique 2023Lien
- [3] PROGRAMME - Congrès français de pneumologie critique 2024Lien
- [4] First trial of computerized decision support tool reduces ventilator-induced lung injuryLien
- [5] Volatile sedation in critically ill adults undergoing mechanical ventilationLien
- [6] Utilisation de mesures physiologiques pour évaluer l'impact de la ventilation mécaniqueLien
- [7] Effet de la combinaison thérapeutique abatacept–ruxolitinib et du dépistage de la défaillance respiratoireLien
- [8] SYNDROME DE DETRESSE RESPIRATOIRE AIGUE INDUIT PAR RITUXIMAB: A PROPOS D'UN CASLien
- [9] Réglage du ventilateur chez le patient chirurgical: y a-t-il un consensus?Lien
- [10] Traumatisme thoracique: quel support ventilatoire?Lien
- [11] La ventilation mécanique du patient obèse en 10 pointsLien
- [12] Toxicité pulmonaire induite par l'osimertinibLien
- [13] Pronostic de l'insuffisance respiratoire aiguë: implication pour les limitations et arrêts des traitementsLien
- [14] Diagnostic et traitement du syndrome de détresse respiratoire aiguëLien
- [15] Syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) - Manuel MSDLien
- [16] Complications de la ventilation mécanique - ATUREALien
Publications scientifiques
- [PDF][PDF] … Utilisation de mesures physiologiques pour évaluer l'impact de la ventilation mécanique dans la survenue de complications pulmonaires postopératoire chez le …
- Effet de la combinaison thérapeutique abatacept–ruxolitinib et du dépistage de la défaillance respiratoire sur la mortalité de la myotoxicité induite par les inhibiteurs … (2023)
- SYNDROME DE DETRESSE RESPIRATOIRE AIGUE INDUIT PAR RITUXIMAB: A PROPOS D'UN CAS (2023)[PDF]
- Réglage du ventilateur chez le patient chirurgical: y a-t-il un consensus? (2022)
- Traumatisme thoracique: quel support ventilatoire? (2023)1 citations
Ressources web
- Diagnostic et traitement du syndrome de détresse ... (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)
de SM Fernando · 2021 · Cité 9 fois — Sur le plan clinique, le SDRA se manifeste par une hypoxémie et une détresse respiratoire marquées; les patients progressent souvent vers une ...
- Syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) (msdmanuals.com)
La personne atteinte présente une dyspnée, généralement accompagnée d'une respiration accélérée et superficielle, la peau peut paraître grisâtre ou gris cendré ...
- Complications de la ventilation mécanique (aturea.org)
Lésions induites par la ventilation mécanique. (VILI). Le barotraumatisme est une fuite d'air liée à une rupture alvéolaire lors d'une surpression induite par ...
- Insuffisance ventilatoire - Réanimation (msdmanuals.com)
La symptomatologie comprend une dyspnée, une tachypnée et une confusion. La mort peut en résulter. Le diagnostic repose sur la mesure des gaz du sang artériel ...
- Patient self-inflicted lung injury : ce que le réanimateur doit ... (revue-mir.srlf.org)
Un des principaux mécanismes entraînant ou aggravant des lésions pulmonaires sous ventilation mécanique invasive est la surdistension des territoires ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
