Myéloméningocèle : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements et Innovations
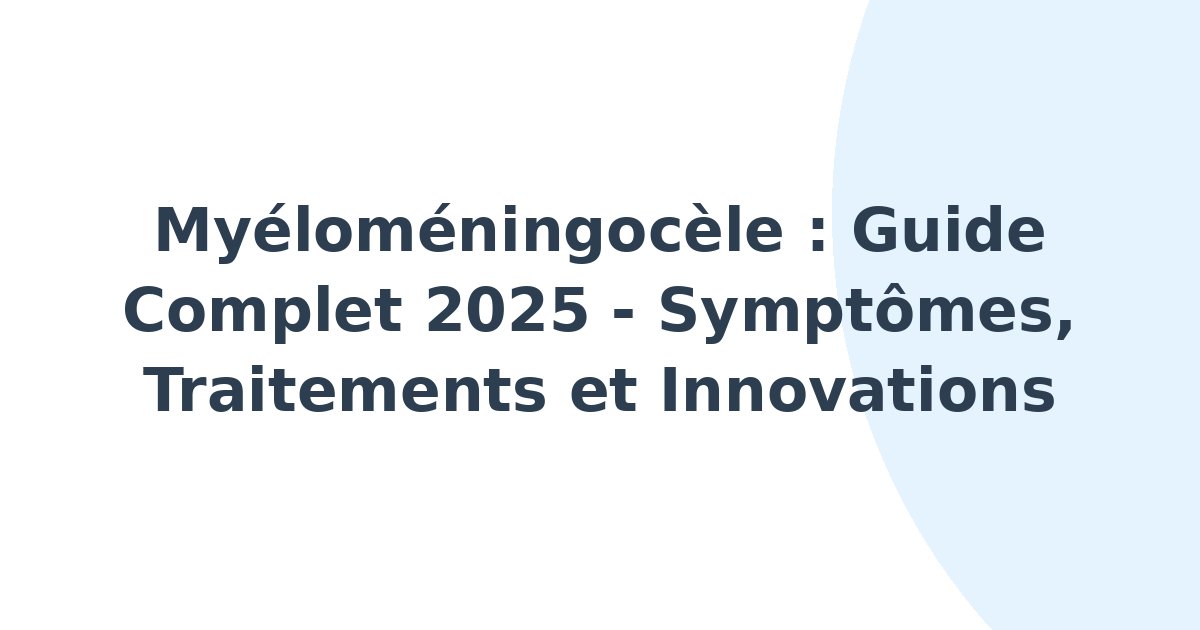
Le myéloméningocèle représente la forme la plus sévère de spina bifida, touchant environ 1 naissance sur 1000 en France [1]. Cette malformation du tube neural survient très tôt dans la grossesse et nécessite une prise en charge spécialisée dès la naissance. Heureusement, les innovations thérapeutiques 2024-2025 offrent de nouveaux espoirs aux familles concernées [2,3].

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Myéloméningocèle : Définition et Vue d'Ensemble
Le myéloméningocèle est une malformation congénitale complexe qui se développe entre la 3ème et 4ème semaine de grossesse [1]. Concrètement, il s'agit d'une ouverture de la colonne vertébrale où la moelle épinière et ses enveloppes (les méninges) font saillie à travers la peau.
Cette pathologie fait partie du groupe des anomalies du tube neural, qui comprend également le spina bifida occulta et la méningocèle [12]. Mais le myéloméningocèle se distingue par sa gravité : contrairement aux autres formes, la moelle épinière elle-même est exposée et endommagée.
L'important à retenir, c'est que cette malformation peut survenir à différents niveaux de la colonne vertébrale. Plus elle se situe haut (vers le thorax), plus les conséquences neurologiques sont importantes [5]. À l'inverse, une localisation basse (région lombaire ou sacrée) entraîne généralement moins de complications.
D'ailleurs, il faut savoir que le myéloméningocèle s'accompagne presque toujours d'une hydrocéphalie - une accumulation de liquide dans le cerveau - qui nécessite elle aussi un traitement spécifique [1,12].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, le myéloméningocèle touche environ 0,8 à 1,2 naissances pour 1000, soit près de 600 à 900 nouveaux cas chaque année [13]. Ces chiffres placent notre pays dans la moyenne européenne, légèrement en dessous des taux observés au Royaume-Uni (1,5/1000) mais au-dessus de ceux des pays nordiques (0,6/1000).
Bon à savoir : l'incidence a considérablement diminué depuis les années 1990 grâce à la supplémentation en acide folique chez les femmes enceintes. En effet, nous sommes passés de 1,8/1000 naissances en 1990 à moins de 1/1000 aujourd'hui [13]. Cette baisse représente une véritable victoire de la prévention.
Les données épidémiologiques révèlent également des disparités géographiques intéressantes. Les régions du Nord et de l'Est de la France présentent des taux légèrement supérieurs, probablement liés à des facteurs génétiques et environnementaux [13]. Par ailleurs, cette pathologie touche légèrement plus les filles que les garçons, avec un ratio de 1,2:1.
Au niveau mondial, l'Organisation Mondiale de la Santé estime que 300 000 enfants naissent chaque année avec des anomalies du tube neural, dont 60% de myéloméningocèles [1]. Les pays en développement restent les plus touchés, principalement en raison d'un accès limité à la supplémentation folique.
Les Causes et Facteurs de Risque
La formation du tube neural est un processus complexe qui peut être perturbé par plusieurs facteurs [4]. Le principal coupable ? Une carence en acide folique (vitamine B9) chez la mère pendant les premières semaines de grossesse. Cette vitamine joue un rôle crucial dans la division cellulaire et la formation du système nerveux.
Mais ce n'est pas tout. Les recherches récentes de 2024 ont mis en évidence le rôle de la toxicité du liquide amniotique dans la pathophysiologie du myéloméningocèle [4]. Cette découverte explique pourquoi certains dommages neurologiques s'aggravent pendant la grossesse, même après la formation initiale de la malformation.
D'autres facteurs de risque sont bien identifiés : l'obésité maternelle, le diabète mal contrôlé, la prise de certains médicaments (comme les antiépileptiques), et l'exposition à des températures élevées en début de grossesse [1,12]. Les antécédents familiaux jouent également un rôle, avec un risque multiplié par 10 à 20 si un parent ou un frère/sœur est atteint.
Il est important de noter que dans 95% des cas, aucun facteur de risque particulier n'est identifié [12]. Cela peut être frustrant pour les parents, mais il faut comprendre que cette malformation résulte souvent d'une combinaison complexe de facteurs génétiques et environnementaux encore mal compris.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Le myéloméningocèle se manifeste dès la naissance par une masse kystique visible sur le dos du bébé, généralement dans la région lombaire [1]. Cette masse, de taille variable, contient la moelle épinière et les méninges qui font saillie à travers l'ouverture vertébrale.
Les symptômes neurologiques dépendent directement du niveau de la lésion. Plus celle-ci est haute, plus les conséquences sont importantes [5]. Concrètement, un enfant avec une lésion lombaire haute (L1-L2) présentera une paralysie complète des membres inférieurs, tandis qu'une lésion basse (L4-L5) peut permettre une marche avec des aides techniques.
D'autres signes sont fréquemment associés : des troubles de la sensibilité (l'enfant ne sent pas certaines parties de ses jambes), des déformations des pieds (pieds bots), et surtout des troubles vésico-sphinctériens [12]. Ces derniers touchent pratiquement tous les enfants et nécessitent une prise en charge spécialisée dès les premiers mois.
L'hydrocéphalie accompagne le myéloméningocèle dans 80 à 90% des cas [1]. Elle se manifeste par une augmentation du périmètre crânien, des vomissements, une somnolence excessive ou des troubles du regard. Heureusement, elle est aujourd'hui bien prise en charge grâce aux techniques neurochirurgicales modernes.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic du myéloméningocèle peut être posé à différents moments : pendant la grossesse, à la naissance, ou parfois même avant la conception lors d'un conseil génétique [1].
Pendant la grossesse, l'échographie morphologique du 2ème trimestre (vers 20-22 semaines) permet de détecter la malformation dans 80 à 95% des cas [12]. Les signes échographiques incluent l'absence de fermeture de la colonne vertébrale, la présence d'une masse kystique, et souvent des signes d'hydrocéphalie. L'IRM fœtale complète alors le bilan pour préciser l'étendue des lésions.
Le dosage de l'alpha-fœtoprotéine dans le sang maternel ou le liquide amniotique peut également orienter le diagnostic. Cette protéine est en effet élevée en cas d'ouverture du tube neural [12]. Cependant, ce test n'est plus systématiquement proposé depuis l'amélioration des techniques d'imagerie.
À la naissance, le diagnostic est évident devant l'aspect clinique caractéristique. L'équipe médicale réalise alors rapidement une IRM cérébrale et médullaire pour évaluer précisément les lésions et planifier la prise en charge chirurgicale [1]. Des examens complémentaires (échographie cardiaque, radiographies) recherchent d'éventuelles malformations associées.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge du myéloméningocèle nécessite une approche multidisciplinaire coordonnée dès la naissance [5]. L'objectif principal est de fermer la malformation, traiter l'hydrocéphalie et prévenir les complications.
La chirurgie de fermeture doit être réalisée dans les 24 à 48 heures suivant la naissance pour réduire le risque d'infection [7]. Cette intervention, menée par un neurochirurgien pédiatrique, consiste à replacer la moelle épinière dans le canal rachidien et à refermer les différentes couches (méninges, muscles, peau). Bien que cette chirurgie ne restaure pas la fonction neurologique, elle prévient la détérioration supplémentaire.
L'hydrocéphalie nécessite souvent la pose d'une dérivation ventriculo-péritonéale (valve) qui évacue l'excès de liquide cérébral vers l'abdomen [1]. Cette intervention peut être réalisée simultanément ou quelques jours après la fermeture du myéloméningocèle.
Par la suite, la prise en charge comprend de la kinésithérapie précoce pour maintenir la mobilité articulaire, de l'orthophonie si nécessaire, et un suivi urologique spécialisé [12]. L'objectif est de maximiser l'autonomie de l'enfant et sa qualité de vie. Des aides techniques (fauteuil roulant, orthèses) peuvent être proposées selon les besoins.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la prise en charge du myéloméningocèle avec l'essor de la chirurgie fœtale [2,3]. Cette technique révolutionnaire permet de fermer la malformation directement dans l'utérus, entre 19 et 26 semaines de grossesse.
Les résultats de la chirurgie fœtale sont particulièrement encourageants [2]. Comparée à la chirurgie postnatale, elle réduit significativement le besoin de dérivation pour l'hydrocéphalie (40% vs 82%) et améliore la fonction motrice des membres inférieurs. D'ailleurs, certains enfants opérés in utero peuvent même marcher de façon autonome, ce qui était impensable il y a encore quelques années.
Deux approches chirurgicales fœtales sont actuellement développées : la chirurgie fœtoscopique (minimalement invasive) et la chirurgie à utérus ouvert [2,6]. La première technique, plus récente, présente l'avantage de réduire les risques maternels et le risque d'accouchement prématuré. Le protocole du Texas Children's Fetal Center, publié en 2024, fait référence en matière d'anesthésie materno-fœtale [6].
En parallèle, la recherche explore de nouvelles pistes thérapeutiques : la thérapie cellulaire avec des cellules souches, les biomatériaux pour améliorer la réparation tissulaire, et même la thérapie génique pour prévenir la malformation [1,3]. Ces approches, encore expérimentales, pourraient révolutionner la prise en charge dans les années à venir.
Vivre au Quotidien avec Myéloméningocèle
Vivre avec un myéloméningocèle demande des adaptations, mais n'empêche pas une vie épanouie [9]. L'important est de mettre en place un suivi médical régulier et d'adapter l'environnement aux besoins spécifiques de chaque personne.
La mobilité constitue souvent le défi principal. Selon le niveau de la lésion, certaines personnes utilisent un fauteuil roulant, d'autres des orthèses ou des cannes. Heureusement, les progrès technologiques offrent aujourd'hui des solutions de plus en plus performantes et esthétiques. Les fauteuils électriques modernes permettent une autonomie remarquable, tandis que les orthèses robotisées commencent à faire leur apparition.
Les troubles urinaires nécessitent une attention particulière [12]. La plupart des personnes apprennent à réaliser des sondages intermittents, une technique simple qui préserve la fonction rénale et l'autonomie. Certains utilisent également des collecteurs externes ou, plus rarement, bénéficient d'une dérivation urinaire chirurgicale.
Sur le plan cognitif, les études récentes montrent que les adultes avec myéloméningocèle peuvent présenter des difficultés spécifiques, notamment en mathématiques et dans l'organisation spatiale [9]. Cependant, avec un accompagnement adapté, la plupart poursuivent des études normales et exercent une profession. L'essentiel est de ne pas sous-estimer leurs capacités et de favoriser leur intégration sociale dès l'enfance.
Les Complications Possibles
Le myéloméningocèle peut s'accompagner de diverses complications qu'il est important de connaître pour mieux les prévenir [1,10]. L'hydrocéphalie reste la plus fréquente, touchant 80 à 90% des patients et nécessitant souvent plusieurs interventions au cours de la vie.
Les complications urologiques représentent un enjeu majeur à long terme [12]. Sans prise en charge adaptée, elles peuvent conduire à des infections urinaires récurrentes, une détérioration de la fonction rénale, voire une insuffisance rénale terminale. C'est pourquoi un suivi urologique régulier est indispensable dès les premiers mois de vie.
Sur le plan orthopédique, des déformations peuvent apparaître : scoliose, déformations des hanches, pieds bots [12]. Ces complications nécessitent parfois des interventions chirurgicales correctrices, mais les techniques modernes permettent d'obtenir d'excellents résultats fonctionnels et esthétiques.
Les études de suivi à long terme révèlent également des risques de complications cognitives et émotionnelles [9,10]. Certains adultes présentent des difficultés d'attention, d'organisation ou des troubles anxio-dépressifs. Heureusement, un accompagnement psychologique adapté permet de prévenir ou de traiter efficacement ces difficultés.
Enfin, il faut mentionner le risque d'allergie au latex, particulièrement élevé chez ces patients en raison des multiples interventions chirurgicales [1]. Cette allergie peut être grave et nécessite des précautions spéciales lors des soins médicaux.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic du myéloméningocèle s'est considérablement amélioré au cours des 50 dernières années [5]. Alors que la survie était limitée dans les années 1970, plus de 90% des enfants atteignent aujourd'hui l'âge adulte grâce aux progrès de la prise en charge.
La qualité de vie dépend largement du niveau de la lésion et de la précocité de la prise en charge [9]. Les enfants avec une lésion basse (L4-S1) ont généralement un pronostic fonctionnel excellent : ils peuvent marcher avec des aides, contrôler partiellement leur vessie, et mener une vie quasi-normale. À l'inverse, une lésion haute (T12-L2) entraîne une paralysie complète des membres inférieurs.
Sur le plan cognitif, la majorité des personnes avec myéloméningocèle ont une intelligence normale [9]. Cependant, certaines peuvent présenter des difficultés spécifiques d'apprentissage, notamment en mathématiques et dans les tâches visuo-spatiales. Avec un accompagnement adapté, beaucoup poursuivent des études supérieures et exercent une profession.
L'espérance de vie se rapproche de celle de la population générale, même si elle reste légèrement diminuée en raison des complications possibles [5]. Les principales causes de mortalité sont les complications de l'hydrocéphalie, les infections urinaires sévères et, plus rarement, les complications respiratoires.
Il est important de souligner que chaque situation est unique. Certains enfants dépassent largement les pronostics initiaux, tandis que d'autres rencontrent plus de difficultés. L'essentiel est de maintenir un suivi médical régulier et de croire en les capacités de chaque personne.
Peut-on Prévenir Myéloméningocèle ?
La prévention du myéloméningocèle repose principalement sur la supplémentation en acide folique [1,12]. Cette vitamine B9 joue un rôle crucial dans la formation du tube neural pendant les premières semaines de grossesse, souvent avant même que la femme sache qu'elle est enceinte.
Les recommandations officielles sont claires : toute femme en âge de procréer devrait prendre 400 microgrammes d'acide folique par jour, idéalement dès l'arrêt de la contraception [13]. Cette supplémentation doit être poursuivie au moins jusqu'à la 12ème semaine de grossesse. Pour les femmes à risque élevé (antécédents personnels ou familiaux), la dose est portée à 5 mg par jour.
D'autres mesures préventives sont importantes : maintenir un poids normal avant la grossesse, équilibrer un éventuel diabète, éviter l'exposition à des températures élevées (sauna, bain très chaud) en début de grossesse [12]. Certains médicaments, notamment les antiépileptiques, peuvent augmenter le risque et nécessitent une adaptation du traitement.
L'enrichissement des aliments en acide folique, pratiqué dans de nombreux pays, a montré son efficacité. Aux États-Unis et au Canada, cette mesure a réduit l'incidence des anomalies du tube neural de 20 à 30% [1]. En France, cette politique n'est pas encore mise en œuvre, mais elle fait l'objet de discussions au niveau des autorités sanitaires.
Enfin, le conseil génétique peut être proposé aux couples ayant des antécédents familiaux. Il permet d'évaluer le risque de récurrence et d'adapter la surveillance de la grossesse.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont émis des recommandations précises concernant la prise en charge du myéloméningocèle [13]. La Haute Autorité de Santé (HAS) insiste sur la nécessité d'une prise en charge multidisciplinaire dans des centres spécialisés dès la naissance.
Concernant la chirurgie fœtale, les recommandations évoluent rapidement [2,3]. Bien que cette technique ne soit pas encore généralisée en France, plusieurs centres d'excellence développent cette expertise. Les critères de sélection sont stricts : lésion située entre T1 et S1, absence de malformations associées sévères, et accord parental éclairé.
La Société Française de Pédiatrie recommande un suivi standardisé incluant : évaluation neurologique tous les 6 mois, surveillance urologique annuelle, bilan orthopédique régulier, et suivi psychologique si nécessaire [12]. Cette approche coordonnée permet de détecter précocement les complications et d'adapter la prise en charge.
Au niveau européen, les guidelines de l'European Association for Neurosurgical Societies préconisent la fermeture chirurgicale dans les 24 à 48 heures suivant la naissance [7]. Cette recommandation, basée sur des études récentes, vise à réduire le risque infectieux et à préserver au maximum la fonction neurologique résiduelle.
Enfin, l'Organisation Mondiale de la Santé a inclus la prévention des anomalies du tube neural dans ses priorités de santé publique, recommandant l'enrichissement systématique des aliments en acide folique [1].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations accompagnent les familles concernées par le myéloméningocèle en France [13]. L'Association Spina Bifida France (ASBF) constitue la référence nationale, proposant information, soutien et défense des droits des personnes atteintes.
Cette association organise régulièrement des journées d'information où familles et professionnels se rencontrent. Ces événements permettent de découvrir les dernières innovations, d'échanger des conseils pratiques, et surtout de rompre l'isolement que peuvent ressentir certaines familles.
Au niveau local, de nombreuses antennes régionales proposent un accompagnement de proximité. Elles peuvent aider dans les démarches administratives (reconnaissance de handicap, aménagements scolaires), orienter vers les professionnels compétents, ou simplement offrir une écoute bienveillante.
D'autres ressources sont précieuses : les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) pour les aides financières et techniques, les centres de référence pour les maladies rares qui coordonnent les soins spécialisés, et les réseaux de santé périnatale qui assurent le suivi des grossesses à risque.
Sur internet, plusieurs forums et groupes de soutien permettent aux familles d'échanger leurs expériences. Attention cependant à vérifier la fiabilité des informations médicales et à toujours confirmer avec son équipe soignante.
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec un myéloméningocèle nécessite quelques adaptations pratiques que nous souhaitons partager avec vous. D'abord, l'organisation du domicile : pensez à l'accessibilité dès que possible. Rampes d'accès, élargissement des portes, adaptation de la salle de bain... Ces aménagements facilitent grandement le quotidien.
Pour les déplacements, renseignez-vous sur les aides disponibles : carte de stationnement, réductions dans les transports, aménagements des véhicules. Beaucoup de ces dispositifs sont méconnus mais peuvent considérablement améliorer la mobilité et l'autonomie.
Concernant la scolarité, n'hésitez pas à rencontrer l'équipe éducative avant la rentrée. Un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) peut être mis en place, incluant l'intervention d'une Auxiliaire de Vie Scolaire si nécessaire. L'objectif est de permettre une scolarité la plus normale possible.
Sur le plan médical, tenez un carnet de suivi détaillé : interventions chirurgicales, complications, traitements en cours. Ce document sera précieux lors des consultations et en cas d'urgence. Pensez également à signaler systématiquement l'allergie au latex potentielle lors de tout soin médical.
Enfin, n'oubliez pas de prendre soin de vous en tant que parent ou proche aidant. Le soutien psychologique n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Certaines associations proposent des groupes de parole spécifiquement dédiés aux familles.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous amener à consulter rapidement, même en dehors des rendez-vous programmés [1,12]. En cas de fièvre inexpliquée, surtout si elle s'accompagne de maux de tête ou de vomissements, il faut penser à une possible infection de la valve de dérivation ou une méningite.
Les troubles urinaires nouveaux ou qui s'aggravent nécessitent également une consultation rapide : brûlures, urines troubles ou malodorantes, difficultés à uriner. Ces symptômes peuvent révéler une infection urinaire qui, non traitée, peut avoir des conséquences graves sur la fonction rénale.
Surveillez également l'apparition de nouveaux déficits neurologiques : faiblesse musculaire qui s'aggrave, troubles de la sensibilité, difficultés de coordination. Ces signes peuvent indiquer une complication au niveau de la moelle épinière et nécessitent un bilan urgent.
Chez l'enfant, des changements de comportement inhabituels (irritabilité, somnolence excessive, refus de s'alimenter) peuvent révéler une complication de l'hydrocéphalie [1]. N'hésitez pas à consulter même si vous n'êtes pas certain : il vaut mieux une consultation de trop qu'une complication grave non détectée.
En cas d'urgence vraie (convulsions, perte de connaissance, détresse respiratoire), appelez immédiatement le 15 (SAMU) en précisant bien que la personne a un myéloméningocèle et une valve de dérivation si c'est le cas.
Questions Fréquentes
Le myéloméningocèle est-il héréditaire ?
Le myéloméningocèle a une composante génétique mais n'est pas strictement héréditaire. Le risque de récurrence est de 3-5% après un premier enfant atteint, et peut atteindre 10-15% après deux enfants atteints. La plupart des cas (95%) surviennent sans antécédent familial.
Peut-on détecter le myéloméningocèle pendant la grossesse ?
Oui, l'échographie morphologique du 2ème trimestre détecte 80-95% des cas de myéloméningocèle. L'IRM fœtale peut compléter le diagnostic pour préciser l'étendue des lésions. Le dosage de l'alpha-fœtoprotéine peut également orienter le diagnostic.
Quelle est la différence entre spina bifida et myéloméningocèle ?
Le myéloméningocèle est la forme la plus sévère de spina bifida. Contrairement au spina bifida occulta (forme légère) ou à la méningocèle, le myéloméningocèle implique une exposition de la moelle épinière elle-même, entraînant des déficits neurologiques importants.
La chirurgie fœtale est-elle recommandée pour tous les cas ?
Non, la chirurgie fœtale n'est proposée que dans des cas sélectionnés selon des critères stricts : lésion entre T1 et S1, absence de malformations associées sévères, et après évaluation multidisciplinaire. Cette technique reste encore en développement en France.
Les enfants avec myéloméningocèle peuvent-ils aller à l'école normale ?
Oui, la plupart des enfants avec myéloméningocèle peuvent être scolarisés en milieu ordinaire avec des aménagements appropriés. Un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) peut être mis en place, incluant si nécessaire l'intervention d'une Auxiliaire de Vie Scolaire.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Myelomeningocele - StatPearls. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] Fetoscopic Myelomeningocele (MMC) Repair: Evolution of .... Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] Myelomeningocele in the Pediatric Neurosurgery .... Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] Y Athiel, JM Jouannic. Role of amniotic fluid toxicity in the pathophysiology of myelomeningocele: a narrative literature review. 2024Lien
- [5] RM Bowman, JY Lee. Myelomeningocele: the evolution of care over the last 50 years. 2023Lien
- [6] CA Naus, DG Mann. This is how we do it maternal and fetal anesthetic management for fetoscopic myelomeningocele repairs: The Texas Children's fetal center protocol. 2024Lien
- [7] B Shao, JS Chen. Postnatal myelomeningocele repair in the United States: rates and disparities before and after the management of myelomeningocele study trial. 2023Lien
- [9] E Fagereng, IB Lidal. Cognition and emotional distress in middle-aged and older adults with spina bifida myelomeningocele. 2024Lien
- [10] E George, C MacPherson. Long-term imaging follow-up from the management of myelomeningocele study. 2023Lien
- [12] Spina bifida - Pédiatrie - Édition professionnelle du Manuel MSDLien
- [13] Spina-bifida : définition, causes et traitements - ELSANLien
Publications scientifiques
- Role of amniotic fluid toxicity in the pathophysiology of myelomeningocele: a narrative literature review (2024)3 citations
- Myelomeningocele: the evolution of care over the last 50 years (2023)9 citations
- “This is how we do it” maternal and fetal anesthetic management for fetoscopic myelomeningocele repairs: The Texas Children's fetal center protocol (2024)3 citations
- Postnatal myelomeningocele repair in the United States: rates and disparities before and after the management of myelomeningocele study trial (2023)9 citations[PDF]
- Surgical experimental protocol of fetal myelomeningocele creation and repair in the ovine model (with video) (2022)2 citations
Ressources web
- Spina bifida - Pédiatrie - Édition professionnelle du Manuel ... (msdmanuals.com)
Le spina bifida ouvert peut être diagnostiqué en prénatal au moyen d'une échographie ou suspecté devant une élévation des taux d'alpha-fœtoprotéine dans le sé ...
- Spina-bifida : définition, causes et traitements (elsan.care)
Méningocèle : ce type de spina-bifida peut entraîner des troubles au niveau de la vésicule et des intestins, notamment une incapacité à maîtriser la défécation, ...
- Spina-bifida (cnfs.ca)
Myéloméningocèle : Comme le méningocèle, le myéloméningocèle est caractérisé par la formation de sacs dans le bas du dos. En revanche, dans cette forme, ils ...
- Myéloméningocèle : causes, symptômes et options de ... (medicoverhospitals.in)
Diagnostic postnatal · Examen physique : Un examen approfondi du nouveau-né peut révéler la présence d'un myéloméningocèle. · Imagerie par résonance magnétique ( ...
- Spina bifida - Causes, Symptômes, Traitement, Diagnostic (santecheznous.com)
Le spina bifida peut être facilement diagnostiqué à la naissance. La myéloméningocèle et la méningocèle sont clairement visibles et le spina bifida occulta est ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
