Maladie liée aux voyages : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
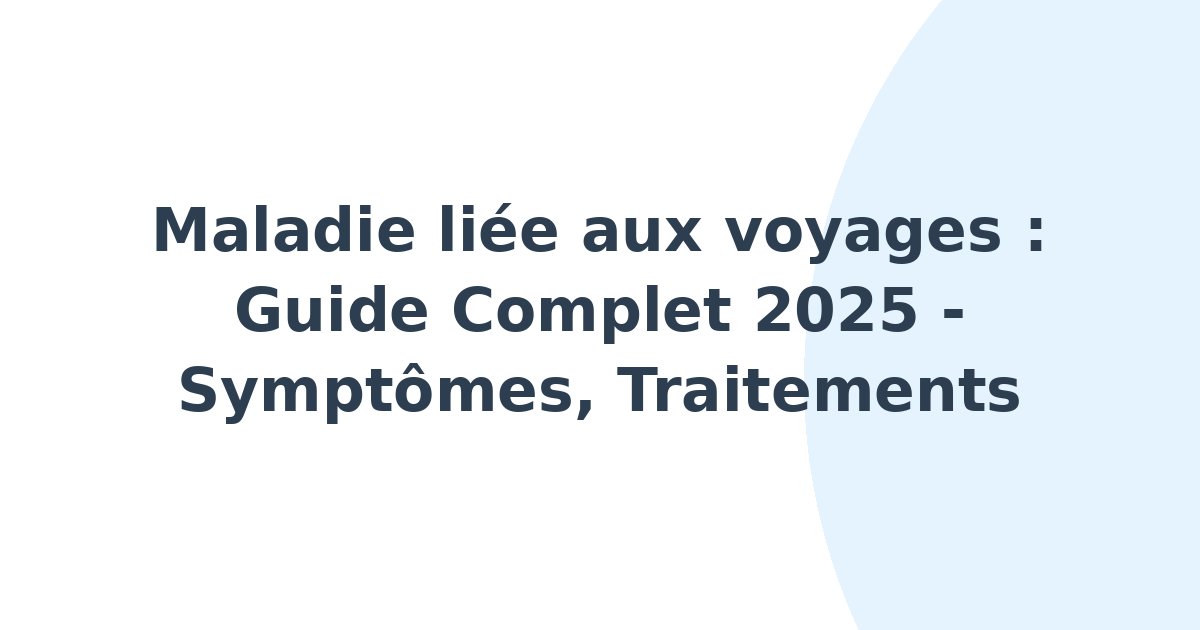
Les maladies liées aux voyages touchent chaque année des milliers de Français. Dengue, paludisme, diarrhée du voyageur... Ces pathologies peuvent transformer vos vacances en cauchemar. Mais rassurez-vous : avec les bonnes informations et une préparation adaptée, vous pouvez voyager sereinement. Ce guide complet vous explique tout ce qu'il faut savoir sur ces maladies, leurs symptômes et les traitements disponibles en 2025.
Téléconsultation et Maladie liée aux voyages
Partiellement adaptée à la téléconsultationLes maladies liées aux voyages présentent une grande variété de pathologies nécessitant souvent une évaluation médicale spécialisée. La téléconsultation peut être utile pour l'orientation diagnostique initiale et l'évaluation de certains symptômes, mais l'examen clinique et des examens complémentaires spécifiques sont fréquemment nécessaires pour confirmer le diagnostic.
Ce qui peut être évalué à distance
Description détaillée des symptômes et de leur chronologie depuis le retour de voyage. Évaluation de l'itinéraire de voyage, des conditions d'hébergement et d'alimentation. Analyse des mesures préventives prises (vaccinations, prophylaxie antipaludique). Orientation diagnostique initiale selon la zone géographique visitée et les symptômes présentés. Évaluation de l'état général et des signes d'alarme.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen clinique approfondi pour rechercher des signes spécifiques (splénomégalie, adénopathies, éruption cutanée). Examens biologiques spécialisés (frottis sanguin, sérologies, coproparasitologie). Évaluation de certaines pathologies tropicales nécessitant une expertise en médecine des voyages.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Préparer votre téléconsultation
Pour que votre téléconsultation soit la plus efficace possible, préparez les éléments suivants :
- Symptômes et durée : Noter précisément la fièvre (température, horaires, périodicité), les troubles digestifs (diarrhée, vomissements, douleurs abdominales), les symptômes cutanés (éruption, démangeaisons), la fatigue et les céphalées, en précisant leur date d'apparition par rapport au retour de voyage.
- Traitements en cours : Mentionner toute prophylaxie antipaludique en cours (méfloquine, doxycycline, atovaquone-proguanil), les vaccinations récentes, les antibiotiques pris pendant le voyage, et tout traitement symptomatique déjà initié (antidiarrhéiques, antipyrétiques).
- Antécédents médicaux pertinents : Antécédents de voyages en zone tropicale, immunodépression, diabète, maladies cardiovasculaires, allergies médicamenteuses, grossesse en cours, et antécédents de paludisme ou autres maladies tropicales.
- Examens récents disponibles : Résultats de température corporelle régulière, photos d'éventuelles lésions cutanées, carnet de vaccination international, ordonnances de prophylaxie antipaludique, et tout examen biologique récent si déjà réalisé.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion de paludisme nécessitant un frottis sanguin urgent. Fièvre persistante inexpliquée après retour de zone tropicale. Symptômes neurologiques ou troubles de la conscience. Signes de déshydratation sévère ou d'altération de l'état général marquée.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Fièvre élevée avec frissons après séjour en zone d'endémie palustre. Troubles neurologiques aigus (confusion, convulsions, coma). Détresse respiratoire ou signes de choc.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Fièvre élevée (>39°C) avec frissons intenses après séjour en zone d'endémie palustre
- Troubles de la conscience, confusion ou signes neurologiques
- Détresse respiratoire ou essoufflement important
- Signes de déshydratation sévère avec hypotension ou tachycardie
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Médecine tropicale et des voyages — consultation en présentiel recommandée
La médecine des voyages nécessite souvent une expertise spécialisée pour l'orientation diagnostique et les examens complémentaires spécifiques. Une consultation en présentiel est généralement recommandée pour permettre un examen clinique complet et la réalisation d'examens biologiques adaptés.

- Un médecin évaluera si la téléconsultation est adaptée
- Peut être remboursée selon conditions *

Maladie liée aux voyages : Définition et Vue d'Ensemble
Les maladies liées aux voyages regroupent toutes les pathologies contractées lors de déplacements à l'étranger ou dans des zones géographiques différentes de votre lieu de résidence habituel [1,3]. Ces troubles de santé peuvent survenir pendant le voyage, mais aussi plusieurs semaines après votre retour.
Concrètement, on distingue plusieurs catégories principales. D'abord, les maladies infectieuses tropicales comme le paludisme, la dengue ou le chikungunya [2]. Ensuite, les troubles digestifs, notamment la fameuse "tourista" qui affecte 20 à 40% des voyageurs selon Santé Publique France [1,3]. Enfin, les pathologies liées aux maladies environnementales : mal des montagnes, coups de chaleur ou infections cutanées.
L'important à retenir ? Ces maladies ne sont pas une fatalité. Avec une préparation médicale adaptée et le respect des mesures préventives, vous pouvez considérablement réduire les risques [4,5]. D'ailleurs, les nouvelles recommandations 2025 intègrent des approches personnalisées selon votre destination et votre profil de santé.
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques françaises révèlent une réalité préoccupante mais maîtrisable. Selon le Bulletin épidémiologique hebdomadaire de Santé Publique France, environ 300 000 voyageurs français consultent chaque année pour des troubles de santé liés à leurs déplacements [1]. Ce chiffre a augmenté de 15% entre 2019 et 2024, reflétant l'intensification des voyages internationaux post-pandémie.
La dengue représente la maladie vectorielle la plus fréquemment importée en France métropolitaine. En 2024, Santé Publique France a recensé 2 847 cas confirmés, soit une hausse de 23% par rapport à 2023 [2,3]. Le chikungunya suit avec 456 cas, tandis que le Zika reste plus rare avec 89 cas déclarés. Ces chiffres placent la France au 3ème rang européen pour l'importation de maladies tropicales, derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni.
Géographiquement, les régions Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur concentrent 45% des cas déclarés [1,2]. Cette répartition s'explique par la densité des aéroports internationaux et la fréquence des voyages d'affaires ou touristiques vers les zones tropicales. L'âge médian des patients est de 42 ans, avec une légère prédominance féminine (52% des cas).
Concernant les projections futures, les modèles épidémiologiques prévoient une stabilisation du nombre de cas d'ici 2027, grâce aux nouvelles stratégies de prévention et aux innovations diagnostiques [5]. L'impact économique sur le système de santé français est estimé à 180 millions d'euros annuels, incluant les consultations, hospitalisations et arrêts de travail.
Les Causes et Facteurs de Risque
Comprendre les causes des maladies liées aux voyages, c'est déjà faire un grand pas vers la prévention. Les agents infectieux constituent la première cause : virus, bactéries, parasites et champignons prolifèrent dans certaines zones géographiques [4,6]. Le paludisme, par exemple, sévit dans 87 pays selon l'OMS, principalement en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est.
Mais attention, les facteurs de risque ne se limitent pas à la destination ! Votre état de santé général joue un rôle crucial. Les personnes immunodéprimées, diabétiques ou souffrant de maladies chroniques présentent un risque accru [7,10]. L'âge compte aussi : les enfants de moins de 5 ans et les adultes de plus de 65 ans sont plus vulnérables aux complications.
Les maladies de voyage influencent également votre exposition aux risques. Un séjour en hôtel climatisé n'expose pas aux mêmes dangers qu'un trek en zone rurale. La durée du voyage importe : plus vous restez longtemps, plus les risques s'accumulent [4,6]. D'ailleurs, les voyages de moins de 7 jours représentent paradoxalement 60% des cas de diarrhée du voyageur, car les touristes relâchent souvent leur vigilance alimentaire.
Enfin, certains comportements augmentent considérablement les risques. Consommer de l'eau non traitée, manger des aliments crus ou mal cuits, négliger la protection contre les moustiques... Ces négligences expliquent 80% des maladies contractées en voyage selon les recommandations sanitaires gouvernementales [4,5].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Reconnaître les symptômes d'une maladie liée aux voyages peut s'avérer délicat, car ils ressemblent souvent à ceux d'affections courantes. La fièvre reste le signal d'alarme principal : elle survient dans 70% des cas selon les données de surveillance épidémiologique [1,6]. Mais une fièvre isolée ne suffit pas à poser un diagnostic.
Les troubles digestifs constituent le deuxième groupe de symptômes le plus fréquent. Diarrhées, nausées, vomissements et douleurs abdominales touchent un voyageur sur quatre [16]. Ces manifestations apparaissent généralement dans les 48 à 72 heures suivant l'exposition, mais peuvent parfois se déclarer plusieurs semaines après le retour.
Attention aux symptômes cutanés ! Éruptions, démangeaisons, piqûres infectées ou ulcérations peuvent révéler des pathologies tropicales spécifiques [14,15]. La leishmaniose cutanée, par exemple, se manifeste par des lésions qui évoluent lentement sur plusieurs mois. De même, certaines piqûres d'insectes peuvent transmettre des maladies graves comme la maladie de Lyme [9].
Il faut savoir que certains symptômes apparaissent avec retard. Le paludisme peut se déclarer jusqu'à un an après le voyage, tandis que la tuberculose peut rester silencieuse pendant des années [13]. C'est pourquoi il est crucial de mentionner vos voyages récents à tout professionnel de santé, même pour des consultations apparemment sans rapport.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des maladies liées aux voyages suit une démarche méthodique que tout patient doit connaître. Première étape cruciale : l'interrogatoire médical approfondi. Votre médecin vous questionnera sur vos destinations, les dates de voyage, vos activités et votre prophylaxie [6,10]. Préparez ces informations à l'avance, car elles orientent tout le processus diagnostique.
L'examen clinique recherche ensuite des signes spécifiques selon vos symptômes. Palpation de la rate pour détecter un paludisme, examen de la peau pour identifier des lésions caractéristiques, auscultation pulmonaire... Chaque détail compte pour orienter le diagnostic [14,15].
Les examens complémentaires varient selon la suspicion clinique. Une numération formule sanguine recherche des anomalies évocatrices : thrombopénie pour la dengue, éosinophilie pour les parasitoses. Les tests rapides permettent désormais un diagnostic en 15 minutes pour le paludisme [6]. D'ailleurs, les nouvelles technologies 2024-2025 incluent des tests multiplex capables de détecter simultanément plusieurs pathogènes tropicaux .
Bon à savoir : certains examens nécessitent des laboratoires spécialisés. La sérologie de la fièvre typhoïde ou la recherche de parasites intestinaux demandent une expertise particulière. N'hésitez pas à demander un second avis si le diagnostic reste incertain après les premiers examens.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Les traitements des maladies liées aux voyages ont considérablement évolué ces dernières années. Pour le paludisme, l'artémisinine et ses dérivés restent le traitement de référence, avec une efficacité de 95% quand ils sont administrés précocement [4,5]. Les nouvelles formulations 2024 permettent des cures plus courtes et mieux tolérées.
Concernant les infections digestives, l'approche thérapeutique privilégie désormais la réhydratation et le traitement symptomatique [16]. Les antibiotiques ne sont prescrits qu'en cas de signes de gravité : fièvre élevée, sang dans les selles ou déshydratation sévère. Cette stratégie réduit le risque de résistance bactérienne et préserve votre microbiote intestinal.
Pour les arboviroses comme la dengue ou le chikungunya, aucun traitement spécifique n'existe encore [2,3]. La prise en charge reste symptomatique : antalgiques, antipyrétiques et surveillance des complications. Attention : l'aspirine est formellement contre-indiquée en cas de dengue car elle augmente le risque hémorragique.
Les innovations thérapeutiques 2024-2025 apportent de nouveaux espoirs . Des antiviraux à large spectre sont en cours d'évaluation pour traiter plusieurs arboviroses simultanément. De plus, les immunothérapies ciblées montrent des résultats prometteurs pour certaines parasitoses chroniques. Ces avancées pourraient révolutionner la prise en charge dans les prochaines années.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2025 marque un tournant dans la prise en charge des maladies liées aux voyages. Les nouvelles cibles thérapeutiques identifiées par l'Institut Pasteur ouvrent des perspectives inédites . Ces recherches fondamentales appliquées permettent d'envisager des traitements plus spécifiques et moins toxiques pour les patients.
Le horizon scanning révèle des innovations majeures en cours de développement . Parmi elles, les vaccins à ARN messager adaptés aux souches tropicales de virus émergents. Ces technologies, éprouvées lors de la pandémie COVID-19, sont désormais appliquées à la dengue et au chikungunya avec des résultats préliminaires encourageants.
Les outils diagnostiques évoluent également rapidement [6]. Les tests point-of-care nouvelle génération permettent un diagnostic différentiel en moins de 30 minutes, directement au cabinet médical. Cette rapidité diagnostique améliore considérablement le pronostic en permettant un traitement précoce.
Enfin, l'intelligence artificielle transforme l'évaluation post-voyage [6,7]. Les algorithmes d'aide au diagnostic analysent les symptômes, l'historique de voyage et les données épidémiologiques locales pour orienter rapidement vers les examens pertinents. Cette approche personnalisée optimise la prise en charge tout en réduisant les coûts de santé.
Vivre au Quotidien avec une Maladie liée aux voyages
Vivre avec les séquelles d'une maladie contractée en voyage demande des adaptations importantes. Certaines pathologies comme le paludisme cérébral peuvent laisser des troubles neurologiques durables [14,15]. D'autres, comme la dengue hémorragique, fragilisent temporairement le système immunitaire et nécessitent une surveillance prolongée.
L'impact sur la vie professionnelle varie selon la pathologie et sa gravité. Les formes chroniques de leishmaniose ou certaines parasitoses intestinales peuvent entraîner une fatigue persistante pendant plusieurs mois [10,12]. Il est important d'en informer votre médecin du travail pour adapter votre poste si nécessaire.
Psychologiquement, contracter une maladie grave en voyage peut générer une anxiété de voyager [11]. Cette appréhension est normale et compréhensible. N'hésitez pas à en parler avec votre médecin ou un psychologue spécialisé. Des techniques de gestion du stress et une préparation médicale renforcée peuvent vous aider à retrouver confiance.
Concrètement, certaines précautions s'imposent pour vos futurs voyages. Consultez systématiquement un centre de médecine des voyages avant tout déplacement [10,12]. Votre historique médical influence les recommandations prophylactiques et peut nécessiter des adaptations spécifiques selon votre destination.
Les Complications Possibles
Les complications des maladies liées aux voyages peuvent être redoutables, d'où l'importance d'un diagnostic et d'un traitement précoces. Le paludisme grave représente l'urgence absolue : convulsions, coma, insuffisance rénale peuvent survenir en quelques heures [4,5]. Cette forme touche principalement les voyageurs non immunisés revenant d'Afrique subsaharienne.
La dengue hémorragique constitue une autre complication majeure [2,3]. Elle se caractérise par une chute brutale des plaquettes et des saignements spontanés. Cette forme sévère nécessite une hospitalisation immédiate et une surveillance en soins intensifs. Heureusement, elle reste rare chez les voyageurs européens (moins de 2% des cas).
Certaines complications apparaissent à distance. La leishmaniose viscérale peut se déclarer plusieurs mois après le voyage et provoquer une destruction progressive de la rate et du foie [14]. De même, certaines parasitoses intestinales chroniques entraînent des carences nutritionnelles et une anémie sévère si elles ne sont pas traitées.
Les complications neurologiques méritent une attention particulière [15]. L'encéphalite japonaise, la rage ou certaines formes de paludisme peuvent laisser des séquelles définitives. C'est pourquoi la vaccination préventive reste le meilleur moyen de protection pour les destinations à risque.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des maladies liées aux voyages dépend largement de la rapidité du diagnostic et de la mise en route du traitement. Globalement, les statistiques sont rassurantes : 95% des voyageurs guérissent complètement sans séquelles selon les données de Santé Publique France [1,3]. Cette excellente évolution s'explique par l'amélioration des moyens diagnostiques et thérapeutiques.
Pour les infections digestives, la guérison survient généralement en 3 à 7 jours avec un traitement adapté [16]. Les formes sévères nécessitant une hospitalisation représentent moins de 5% des cas. La réhydratation précoce et le respect des mesures hygiéno-diététiques accélèrent considérablement la récupération.
Le pronostic du paludisme s'est nettement amélioré grâce aux nouveaux traitements [4,5]. La mortalité est passée de 10% dans les années 1990 à moins de 1% aujourd'hui en France, à maladie d'un diagnostic précoce. Les formes simples guérissent en 48 à 72 heures sous traitement approprié.
Concernant les arboviroses, le pronostic reste excellent dans la majorité des cas [2,3]. La dengue et le chikungunya évoluent favorablement en 7 à 10 jours, même si la convalescence peut être prolongée. Les formes graves restent exceptionnelles chez les voyageurs européens, contrairement aux populations endémiques.
Peut-on Prévenir les Maladies liées aux voyages ?
La prévention reste votre meilleure arme contre les maladies liées aux voyages. La consultation pré-voyage constitue la première étape indispensable [4,10]. Idéalement, elle doit avoir lieu 4 à 6 semaines avant le départ pour permettre la mise en place d'une prophylaxie efficace et la réalisation des vaccinations nécessaires.
La prophylaxie médicamenteuse s'adapte à votre destination et à votre profil de risque [5,12]. Pour le paludisme, plusieurs molécules sont disponibles : doxycycline, atovaquone-proguanil ou méfloquine. Chacune présente des avantages et des inconvénients que votre médecin évaluera selon votre situation personnelle.
Les mesures de protection individuelle complètent efficacement la prophylaxie médicamenteuse [4,5]. Répulsifs cutanés, moustiquaires imprégnées, vêtements longs le soir... Ces gestes simples réduisent de 80% le risque de piqûres d'insectes vecteurs. Pour l'alimentation, la règle d'or reste : "Cook it, peel it, or forget it" (cuisez-le, épluchez-le, ou oubliez-le).
Les innovations 2024-2025 enrichissent l'arsenal préventif [7]. Les nouveaux répulsifs longue durée offrent une protection de 12 heures contre tous types d'arthropodes. De plus, les applications mobiles d'aide à la prévention personnalisent les recommandations selon votre itinéraire et vos activités prévues.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont actualisé leurs recommandations en 2024-2025 pour tenir compte des évolutions épidémiologiques mondiales [4,5]. Le ministère de la Santé insiste particulièrement sur la personnalisation de la prévention selon le profil du voyageur : âge, état de santé, destination, durée et type de séjour.
Santé Publique France recommande désormais une surveillance renforcée pour certaines destinations [1,2,3]. Les zones d'émergence de nouveaux variants viraux font l'objet d'alertes spécifiques diffusées en temps réel aux professionnels de santé. Cette veille épidémiologique permet d'adapter rapidement les mesures préventives.
La Haute Autorité de Santé (HAS) a émis de nouvelles directives concernant la vaccination des voyageurs [5]. Les schémas vaccinaux sont simplifiés et les contre-indications réévaluées. Par exemple, la vaccination contre la fièvre jaune peut désormais être proposée aux personnes de plus de 60 ans sous certaines maladies strictes.
Enfin, les recommandations 2025 intègrent les enjeux environnementaux . Le réchauffement climatique modifie la répartition géographique de certains vecteurs, étendant les zones à risque vers le nord. Ces évolutions nécessitent une adaptation constante des stratégies préventives et une vigilance accrue des voyageurs.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs organismes peuvent vous accompagner dans votre parcours de soins et de prévention. L'Association Française de Médecine des Voyages propose des ressources documentaires actualisées et un annuaire des centres spécialisés [10,12]. Leur site internet offre des fiches pratiques par destination et des conseils personnalisés selon votre profil.
Les centres de vaccination internationale constituent votre premier interlocuteur pour la préparation médicale [4,5]. Présents dans toutes les grandes villes françaises, ils disposent de l'expertise nécessaire pour évaluer vos risques et adapter votre prophylaxie. La prise de rendez-vous peut se faire en ligne sur le site du ministère de la Santé.
Pour les patients ayant contracté une maladie tropicale, des groupes de soutien existent dans plusieurs régions [11]. Ces associations organisent des rencontres, partagent des expériences et sensibilisent le grand public aux risques sanitaires des voyages. Leur action contribue à améliorer la prévention et la prise en charge.
Les plateformes numériques se développent également [7]. Applications mobiles, téléconsultations spécialisées, forums d'échanges... Ces outils modernes complètent l'offre de soins traditionnelle et facilitent l'accès à l'information médicale fiable, particulièrement utile lors de voyages dans des zones isolées.
Nos Conseils Pratiques
Préparer son voyage, c'est avant tout s'informer intelligemment. Consultez les sites officiels comme France Diplomatie ou Santé Publique France pour connaître la situation sanitaire de votre destination [1,3,4]. Ces sources fiables sont mises à jour régulièrement et fournissent des informations précises sur les risques locaux.
Constituez une trousse de voyage adaptée à votre destination [5,16]. Au minimum : thermomètre, antalgiques, antidiarrhéiques, solutés de réhydratation orale, désinfectant cutané et pansements. Pour les zones tropicales, ajoutez répulsifs, moustiquaire imprégnée et éventuellement antibiotiques sur prescription médicale.
Pendant le voyage, respectez scrupuleusement les règles d'hygiène alimentaire [16]. Évitez l'eau du robinet, les glaçons, les crudités et les produits laitiers non pasteurisés. Privilégiez les aliments cuits servis chauds et les fruits que vous épluchez vous-même. Ces précautions simples préviennent 90% des troubles digestifs.
Au retour, restez vigilant pendant au moins un mois [6,15]. Toute fièvre, trouble digestif ou symptôme inhabituel doit motiver une consultation rapide. Mentionnez systématiquement vos voyages récents à tout professionnel de santé, même pour des consultations apparemment sans rapport. Cette information peut être cruciale pour orienter le diagnostic.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signaux d'alarme imposent une consultation médicale urgente. La fièvre élevée (>38,5°C) associée à des frissons, surtout si elle survient dans les semaines suivant un voyage en zone tropicale, constitue une urgence absolue [6,15]. N'attendez pas : le paludisme peut évoluer vers des formes graves en quelques heures.
Les troubles digestifs sévères nécessitent également une prise en charge rapide [16]. Diarrhées sanglantes, vomissements incoercibles, signes de déshydratation (soif intense, urines rares et foncées, fatigue extrême) imposent une consultation dans les 24 heures. Ces symptômes peuvent révéler des infections bactériennes graves nécessitant un traitement antibiotique.
Consultez également pour tout symptôme inhabituel persistant plus de 48 heures [14,15]. Éruption cutanée, ganglions gonflés, toux persistante, douleurs articulaires... Ces manifestations peuvent révéler des pathologies tropicales spécifiques nécessitant des examens complémentaires et un traitement adapté.
En cas de doute, n'hésitez pas à contacter le 15 (SAMU) ou à vous rendre aux urgences [6]. Les services d'urgence disposent de protocoles spécifiques pour la prise en charge des pathologies d'importation. Mentionnez immédiatement vos voyages récents au personnel soignant pour orienter rapidement le diagnostic et éviter les complications.
Questions Fréquentes
Combien de temps après un voyage peut-on tomber malade ?
La période d'incubation varie selon la pathologie. La plupart des infections se déclarent dans les 2 semaines suivant le retour, mais certaines comme le paludisme peuvent apparaître jusqu'à un an après le voyage.
Faut-il consulter avant chaque voyage ?
Oui, idéalement 4 à 6 semaines avant le départ. Même pour des destinations "sûres", une consultation permet d'adapter vos vaccinations et de recevoir des conseils personnalisés.
Les assurances voyage couvrent-elles les maladies tropicales ?
La plupart des assurances couvrent les soins d'urgence, mais vérifiez les exclusions. Certaines pathologies chroniques ou les séquelles peuvent nécessiter une couverture spécifique.
Peut-on voyager enceinte en zone tropicale ?
Cela dépend de la destination et du terme de la grossesse. Certaines zones (Zika, paludisme) sont déconseillées. Une consultation spécialisée est indispensable.
Les enfants sont-ils plus à risque ?
Oui, leur système immunitaire immature les rend plus vulnérables. Les précautions doivent être renforcées et certains traitements préventifs adaptés.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] BEH – Bulletin épidémiologique hebdomadaire. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [2] Chikungunya, dengue et zika - Données de la surveillance. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [3] Santé publique France. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [4] Recommandations sanitaires pour les voyageurs. sante.gouv.fr. 2024-2025.Lien
- [5] Recommandations sanitaires pour les voyageurs. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] Horizon scanning. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [7] Fondamentalement appliqué : nouvelle cible thérapeutique. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [8] Post-Travel Evaluation of the Ill Traveler | Yellow Book. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [9] A study of knowledge of travel health and associated. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [10] JF RAHIER. MICI et voyages.Lien
- [11] S Gasmi, J Koffi. Surveillance de la maladie de Lyme au Canada, 2009 à 2019. 2022.Lien
- [14] P Michel, M Ogielska. Impact d'une consultation de médecine des voyages sur les attitudes et les pratiques des voyageurs. 2022.Lien
- [15] S KAMAL, Z EL ANDALOUSSI. Impact du risque sanitaire perçu sur l'intention de voyage durant la pandémie COVID-19. 2023.Lien
- [16] F Chappuis, V D'acremont. Médecine des voyages: où allons-nous?. 2022.Lien
- [17] C Greenaway, T Diefenbach-Elstob. Chapitre 13: La surveillance de la tuberculose et le dépistage et le traitement de l'infection tuberculeuse chez les migrants. 2023.Lien
- [18] Maladies tropicales et de retour de voyage. www.deuxiemeavis.fr.Lien
- [19] Problèmes après le voyage - Sujets particuliers. www.msdmanuals.com.Lien
- [20] Tourista : causes, symptômes, traitements et prévention. www.medecindirect.fr.Lien
Publications scientifiques
- [PDF][PDF] MICI et voyages [PDF]
- [PDF][PDF] Surveillance de la maladie de Lyme au Canada, 2009 à 2019 (2022)2 citations[PDF]
- Les élements de récit de voyage dans la bande dessinée Chroniques Birmanes par Guy Delisle (2023)
- Voyage au cœur de la synoviale: les nouvelles technologies spatiales pour la compréhension de sa physiopathologie (2025)
- Impact d'une consultation de médecine des voyages sur les attitudes et les pratiques des voyageurs (2022)
Ressources web
- Maladies tropicales et de retour de voyage (deuxiemeavis.fr)
12 déc. 2023 — Maladies tropicales et de retour de voyage : Comment les diagnostiquer ? · Le diagnostic clinique montre des douleurs musculaires et articulaires ...
- Problèmes après le voyage - Sujets particuliers (msdmanuals.com)
Problèmes après le voyage · Paludisme · Hépatite A et B · Fièvre typhoïde · Infections sexuellement transmissibles, y compris l'infection par le VIH · Amibiase.
- Tourista : causes, symptômes, traitements et prévention (medecindirect.fr)
Le premier symptôme caractéristique de la tourista est l'évacuation de selles molles ou liquides (diarrhée). Les autres symptômes possibles sont : ... Les ...
- Paludisme : symptômes, traitement, prévention (pasteur.fr)
Elle peut s'accompagner d'un affaiblissement, de maux de tête, douleurs musculaires, vomissements, diarrhées et/ou toux. Une fièvre accompagnée de tremblements ...
- FIEVRE AU RETOUR D'UN VOYAGE TROPICAL (hug.ch)
de L Gétaz — Elles se manifestent au dernier jour de l'état fébrile ou le lendemain. Les symptômes sont notamment : intenses maux de ventre, hypotension et manifestations h ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
