Lymphogranulomatose vénérienne : Guide Complet 2025 | Symptômes, Traitements
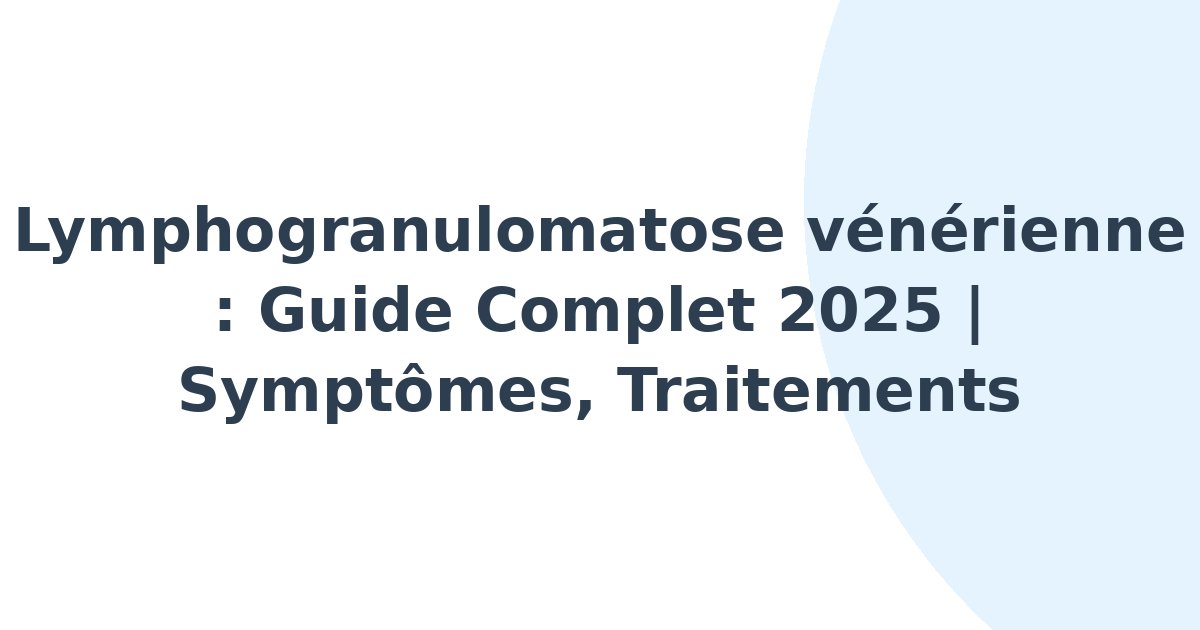
La lymphogranulomatose vénérienne (LGV) est une infection sexuellement transmissible causée par des souches spécifiques de Chlamydia trachomatis. Cette pathologie, longtemps considérée comme rare en Europe, connaît une recrudescence préoccupante depuis les années 2000. En France, les cas de LGV ont été multipliés par 15 entre 2003 et 2023 selon les données de Santé publique France [1,2]. Bien que moins connue que d'autres infections sexuellement transmissibles, la lymphogranulomatose vénérienne nécessite une prise en charge spécialisée pour éviter des complications graves.
Téléconsultation et Lymphogranulomatose vénérienne
Partiellement adaptée à la téléconsultationLa lymphogranulomatose vénérienne peut bénéficier d'une évaluation initiale à distance pour l'orientation diagnostique et l'analyse des symptômes. Cependant, le diagnostic définitif nécessite généralement des examens complémentaires spécifiques (sérologie, PCR) et un examen clinique approfondi des lésions et adénopathies.
Ce qui peut être évalué à distance
Description détaillée des lésions génitales et de leur évolution, évaluation de l'adénopathie inguinale par palpation guidée, analyse de l'historique des rapports sexuels à risque, orientation vers les examens de dépistage appropriés, discussion sur les mesures préventives et le dépistage du partenaire.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen clinique des organes génitaux et des aires ganglionnaires, prélèvements pour PCR Chlamydia trachomatis, sérologie spécifique, dépistage complet des autres IST, évaluation de complications éventuelles comme la rectite ou l'atteinte systémique.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Préparer votre téléconsultation
Pour que votre téléconsultation soit la plus efficace possible, préparez les éléments suivants :
- Symptômes et durée : Noter précisément l'apparition et l'évolution des ulcères génitaux, la présence d'adénopathies inguinales douloureuses, les éventuels écoulements, la fièvre, et la chronologie depuis les derniers rapports sexuels non protégés.
- Traitements en cours : Mentionner tout traitement antibiotique récent (doxycycline, azithromycine, érythromycine), les traitements antirétroviraux si VIH positif, et tout traitement immunosuppresseur qui pourrait modifier la présentation clinique.
- Antécédents médicaux pertinents : Antécédents d'infections sexuellement transmissibles, statut VIH, voyages récents en zone d'endémie, multiplicité des partenaires sexuels, pratiques sexuelles à risque, antécédents d'immunodépression.
- Examens récents disponibles : Résultats de dépistage IST récents, sérologies VIH et syphilis, éventuels prélèvements génitaux ou rectaux, numération formule sanguine si disponible, photos des lésions si possible.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Présence d'ulcères génitaux nécessitant un diagnostic différentiel avec d'autres IST, adénopathies volumineuses ou fluctuantes pouvant nécessiter une ponction, suspicion de complications comme une rectite ou une atteinte systémique, échec d'un premier traitement antibiotique.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Adénopathies inguinales avec signes de surinfection ou d'abcédation, fièvre élevée avec altération de l'état général, suspicion de syndrome de Fitz-Hugh-Curtis avec douleurs abdominales intenses.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Fièvre élevée supérieure à 39°C avec frissons et altération de l'état général
- Adénopathies inguinales très volumineuses, fluctuantes ou avec signes inflammatoires majeurs
- Douleurs abdominales intenses évoquant une périhépatite (syndrome de Fitz-Hugh-Curtis)
- Ulcères génitaux étendus avec signes de surinfection bactérienne secondaire
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Infectiologue ou dermato-vénérologue — consultation en présentiel recommandée
La lymphogranulomatose vénérienne nécessite une expertise spécialisée en infectiologie ou dermato-vénérologie pour le diagnostic différentiel et la prescription d'examens spécifiques. Une consultation en présentiel est généralement recommandée pour l'examen clinique et les prélèvements diagnostiques.

- Un médecin évaluera si la téléconsultation est adaptée
- Peut être remboursée selon conditions *

Lymphogranulomatose vénérienne : Définition et Vue d'Ensemble
La lymphogranulomatose vénérienne est une maladie infectieuse causée par trois sérotypes particuliers de Chlamydia trachomatis : L1, L2 et L3 [5]. Ces souches se distinguent des autres chlamydias par leur capacité à envahir les ganglions lymphatiques et à provoquer une inflammation systémique.
Contrairement aux infections génitales classiques à chlamydia, la LGV présente un tropisme particulier pour le système lymphatique. Elle évolue classiquement en trois stades distincts, chacun avec ses propres manifestations cliniques [11,12].
Cette pathologie était historiquement endémique dans les régions tropicales et subtropicales. Mais depuis le début des années 2000, l'Europe occidentale fait face à une résurgence importante de cette infection [2]. Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) représentent aujourd'hui la population la plus touchée dans nos régions [1,13].
Il est important de comprendre que la lymphogranulomatose vénérienne n'est pas une simple infection génitale. Elle peut affecter différents organes et systèmes, nécessitant une approche diagnostique et thérapeutique spécialisée [4].
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques françaises révèlent une augmentation spectaculaire des cas de lymphogranulomatose vénérienne. Selon Santé publique France, l'incidence est passée de moins de 10 cas annuels en 2003 à plus de 150 cas déclarés en 2023 [1,2].
Cette progression concerne principalement les hommes de 25 à 45 ans, avec une prédominance marquée chez les HSH (95% des cas). Les régions Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes concentrent 70% des cas français [2,7].
Au niveau européen, les Pays-Bas et le Royaume-Uni rapportent des tendances similaires. Les Pays-Bas enregistrent environ 300 cas annuels pour 17 millions d'habitants, soit une incidence trois fois supérieure à la France [10]. Cette différence s'explique en partie par des systèmes de surveillance plus développés.
D'ailleurs, les données québécoises montrent que la pandémie de COVID-19 a temporairement ralenti la progression de la LGV en 2020-2021, avec une diminution de 25% des diagnostics [7,10]. Cependant, les chiffres de 2023 suggèrent un rattrapage rapide.
Les projections épidémiologiques pour 2025-2030 anticipent une stabilisation du nombre de cas, à maladie que les programmes de prévention et de dépistage soient renforcés [3]. L'impact économique sur le système de santé français est estimé à 2,5 millions d'euros annuels, incluant les coûts de diagnostic, traitement et suivi des complications [2].
Les Causes et Facteurs de Risque
La lymphogranulomatose vénérienne résulte exclusivement d'une infection par Chlamydia trachomatis des sérotypes L1, L2 et L3 [5,8]. Ces souches possèdent des propriétés invasives particulières qui les distinguent des autres chlamydias responsables d'infections génitales classiques.
La transmission s'effectue principalement par voie sexuelle, lors de rapports non protégés avec une personne infectée. Les pratiques sexuelles anales réceptives constituent le principal facteur de risque, expliquant la prédominance de la maladie chez les HSH [1,13].
Plusieurs facteurs augmentent significativement le risque de contamination. Le multipartenariat sexuel, l'absence de protection lors des rapports, et la co-infection par le VIH multiplient les probabilités d'infection [2,12]. En effet, les personnes séropositives présentent un risque 5 fois supérieur de contracter la LGV [1].
Les voyages en zones d'endémie (Afrique subsaharienne, Asie du Sud-Est, Amérique du Sud) représentent également un facteur de risque non négligeable . Les migrants originaires de ces régions peuvent présenter des formes chroniques méconnues .
Comment Reconnaître les Symptômes ?
La lymphogranulomatose vénérienne évolue classiquement en trois stades, chacun présentant des manifestations cliniques spécifiques [11,12]. Mais attention, tous les patients ne développent pas nécessairement les trois phases.
Le stade primaire survient 3 à 30 jours après la contamination. Il se caractérise par l'apparition d'une petite ulcération indolore au niveau des organes génitaux ou de l'anus. Cette lésion, souvent discrète, passe fréquemment inaperçue et guérit spontanément en quelques jours [5,11].
Le stade secondaire apparaît 2 à 6 semaines plus tard et constitue la phase la plus caractéristique. Les ganglions lymphatiques de l'aine se gonflent de manière importante et deviennent douloureux. Ces adénopathies peuvent évoluer vers la suppuration et la fistulisation [12,13]. Des signes généraux accompagnent souvent cette phase : fièvre, fatigue, douleurs articulaires.
Chez les personnes pratiquant des rapports anaux réceptifs, la LGV peut se manifester par une proctite sévère. Les symptômes incluent des douleurs rectales intenses, des saignements, des écoulements purulents et une sensation de ténesme [4,9]. Cette forme peut évoluer vers des complications graves sans traitement approprié.
Le stade tertiaire, heureusement rare, survient après plusieurs années d'évolution non traitée. Il se caractérise par des séquelles cicatricielles importantes : sténoses rectales, éléphantiasis génital, fistules complexes [9,11].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de lymphogranulomatose vénérienne repose sur une approche combinée associant clinique, biologie et imagerie [6,11]. La suspicion diagnostique naît souvent de l'association entre des symptômes évocateurs et des facteurs de risque identifiés.
L'examen clinique constitue la première étape. Le médecin recherche les signes caractéristiques selon le stade : ulcération génitale, adénopathies inguinales, ou symptômes de proctite [12]. Un interrogatoire approfondi sur les pratiques sexuelles et les antécédents de voyage s'avère indispensable.
Les examens biologiques confirment le diagnostic. La technique de référence est la PCR (amplification génique) réalisée sur un prélèvement local : écouvillon génital, rectal ou ganglionnaire [6]. Cette méthode permet non seulement de détecter Chlamydia trachomatis, mais aussi d'identifier spécifiquement les sérotypes L1, L2 et L3 responsables de la LGV.
Depuis 2024, les plateformes cobas 5800/6800/8800 CT/NG de Roche permettent une détection automatisée et plus rapide de la LGV sur les prélèvements rectaux [6]. Cette innovation améliore significativement les délais diagnostiques.
Des examens complémentaires peuvent s'avérer nécessaires. L'imagerie (échographie, scanner) évalue l'extension ganglionnaire. Un bilan d'autres infections sexuellement transmissibles, incluant VIH, syphilis et hépatites, est systématiquement réalisé [1,2].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de la lymphogranulomatose vénérienne repose principalement sur l'antibiothérapie prolongée [11,12]. La doxycycline constitue le traitement de première intention, administrée à la dose de 100 mg deux fois par jour pendant 21 jours [5,13].
Cette durée de traitement, plus longue que pour les infections génitales classiques à chlamydia, s'explique par la nature invasive des sérotypes L. En effet, ces souches pénètrent profondément dans les tissus lymphatiques, nécessitant une exposition antibiotique prolongée [8].
Pour les patients présentant une contre-indication à la doxycycline, plusieurs alternatives existent. L'érythromycine (500 mg quatre fois par jour pendant 21 jours) ou l'azithromycine (1 g par semaine pendant 3 semaines) peuvent être utilisées [12,13]. Cependant, leur efficacité semble légèrement inférieure à la doxycycline.
Les formes compliquées nécessitent parfois une prise en charge chirurgicale. Les adénopathies suppurées peuvent requérir un drainage percutané ou chirurgical [11]. Les sténoses rectales sévères nécessitent des interventions de dilatation ou de résection [9].
Le suivi thérapeutique est crucial. Un contrôle clinique à 3 semaines évalue l'efficacité du traitement. La guérison se traduit par la disparition des symptômes et la négativation des prélèvements de contrôle [12].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans la prise en charge de la lymphogranulomatose vénérienne avec plusieurs innovations majeures [3]. Les nouvelles recommandations de prophylaxie post-exposition intègrent désormais la LGV dans les protocoles de prévention [3].
Le programme Breizh CoCoA 2024-2025 développe une approche innovante de dépistage communautaire . Cette initiative bretonne propose des tests rapides de détection de la LGV directement dans les lieux de convivialité fréquentés par les populations à risque. Les premiers résultats montrent une augmentation de 40% du taux de dépistage.
En matière de diagnostic, l'intelligence artificielle fait son entrée. Des algorithmes d'aide au diagnostic, basés sur l'analyse des symptômes et facteurs de risque, sont en cours de validation [4]. Ces outils pourraient améliorer la détection précoce, particulièrement en médecine générale.
La recherche thérapeutique explore de nouvelles pistes. Des études évaluent l'efficacité de traitements raccourcis avec des antibiotiques de nouvelle génération . L'association doravirine/islatravir, initialement développée pour le VIH, montre des propriétés anti-chlamydia prometteuses .
Les recommandations 2024 pour les populations migrantes intègrent un dépistage systématique de la LGV chez les personnes originaires de zones d'endémie . Cette approche préventive vise à identifier les formes chroniques méconnues.
Vivre au Quotidien avec Lymphogranulomatose vénérienne
Recevoir un diagnostic de lymphogranulomatose vénérienne peut générer de l'anxiété et des questionnements légitimes. Rassurez-vous, avec un traitement approprié, la guérison est obtenue dans plus de 95% des cas [12,13].
Pendant la phase de traitement, certaines précautions s'imposent. L'abstinence sexuelle est recommandée jusqu'à la fin du traitement antibiotique et la négativation des contrôles [1]. Cette mesure prévient la transmission à vos partenaires et évite les réinfections.
La gestion des symptômes peut nécessiter des adaptations temporaires. Les douleurs rectales liées à la proctite peuvent être soulagées par des antalgiques et des bains de siège tièdes [9]. Une alimentation riche en fibres et une hydratation suffisante facilitent le transit intestinal.
L'impact psychologique ne doit pas être négligé. Beaucoup de patients expriment des sentiments de culpabilité ou de honte. Il est important de comprendre que la LGV est une maladie comme une autre, sans jugement moral [13]. Le soutien d'un psychologue spécialisé peut s'avérer bénéfique.
La prévention des récidives passe par l'adoption de pratiques sexuelles protégées. L'utilisation systématique de préservatifs lors des rapports sexuels réduit considérablement le risque de réinfection [2]. Le dépistage régulier des autres IST reste également recommandé.
Les Complications Possibles
Sans traitement approprié, la lymphogranulomatose vénérienne peut évoluer vers des complications graves et parfois irréversibles [9,11]. Ces séquelles justifient l'importance d'un diagnostic et d'un traitement précoces.
Les complications rectales représentent les séquelles les plus fréquentes et les plus invalidantes. La proctite chronique peut évoluer vers des sténoses rectales nécessitant des interventions chirurgicales répétées [9]. Ces rétrécissements provoquent des troubles du transit, des douleurs et une altération significative de la qualité de vie.
Au niveau génital, l'évolution chronique peut conduire à un éléphantiasis des organes génitaux externes. Cette complication, heureusement rare dans nos régions, résulte de l'obstruction lymphatique chronique [11]. Elle nécessite une prise en charge chirurgicale complexe.
Les fistules représentent une autre complication redoutable. Elles peuvent se développer entre le rectum et les organes voisins (vessie, vagin, peau périnéale) [9]. Leur traitement chirurgical est souvent difficile et nécessite une expertise spécialisée.
D'ailleurs, certaines complications peuvent survenir même après un traitement bien conduit. Les séquelles cicatricielles peuvent persister et nécessiter un suivi à long terme [11]. C'est pourquoi un diagnostic précoce reste la meilleure prévention de ces complications.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la lymphogranulomatose vénérienne dépend essentiellement de la précocité du diagnostic et de la mise en route du traitement [12,13]. Diagnostiquée et traitée rapidement, cette pathologie guérit sans séquelles dans la grande majorité des cas.
Aux stades précoces (primaire et secondaire récent), le taux de guérison atteint 98% avec un traitement antibiotique approprié [5,12]. La disparition des symptômes survient généralement dans les 2 à 3 semaines suivant le début du traitement. Les contrôles biologiques se négativent dans un délai similaire.
Cependant, le pronostic se dégrade lorsque le diagnostic est retardé. Les formes évoluant depuis plusieurs mois présentent un risque accru de complications [11]. Même après traitement, certaines séquelles peuvent persister, notamment au niveau rectal.
Les patients co-infectés par le VIH présentent un pronostic légèrement moins favorable. L'immunodépression peut retarder la guérison et favoriser les récidives [1,2]. Un suivi renforcé est donc nécessaire dans cette population.
Il est rassurant de savoir que la LGV ne récidive généralement pas après guérison complète. Néanmoins, une réinfection reste possible en cas de nouvelle exposition [13]. D'où l'importance de maintenir des pratiques sexuelles protégées.
Peut-on Prévenir Lymphogranulomatose vénérienne ?
La prévention de la lymphogranulomatose vénérienne repose sur les mêmes principes que pour les autres infections sexuellement transmissibles [1,2]. L'utilisation systématique de préservatifs lors des rapports sexuels constitue la mesure de protection la plus efficace.
Pour les personnes à risque élevé, notamment les HSH multipartenaires, un dépistage régulier s'avère indispensable [13]. Les recommandations actuelles préconisent un dépistage annuel, voire semestriel en cas de facteurs de risque multiples [2].
Les nouvelles stratégies de prophylaxie post-exposition (PPE) intègrent désormais la LGV [3]. En cas d'exposition à risque élevé, un traitement antibiotique préventif peut être proposé dans les 72 heures suivant l'exposition. Cette approche, encore en cours d'évaluation, montre des résultats prometteurs.
L'éducation et l'information des populations à risque constituent un pilier essentiel de la prévention. Les campagnes de sensibilisation menées par les associations de lutte contre le sida intègrent progressivement la LGV dans leurs messages [13].
Pour les voyageurs se rendant en zones d'endémie, une consultation de médecine des voyages permet d'adapter les conseils de prévention. L'information sur les risques locaux et les moyens de protection s'avère particulièrement importante .
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont actualisé leurs recommandations concernant la lymphogranulomatose vénérienne en 2024 [1,2]. Ces nouvelles directives intègrent les évolutions épidémiologiques et les innovations diagnostiques récentes.
Santé publique France recommande un dépistage ciblé de la LGV chez toute personne présentant des symptômes évocateurs : proctite, adénopathies inguinales, ulcérations génitales [2]. Cette approche vise à réduire les retards diagnostiques observés en pratique clinique.
La Haute Autorité de Santé (HAS) a émis des recommandations spécifiques pour la prise en charge des populations migrantes . Un dépistage systématique de la LGV est désormais préconisé chez les personnes originaires de zones d'endémie, même en l'absence de symptômes.
Les nouvelles recommandations de prophylaxie post-exposition incluent la LGV dans les protocoles de prévention [3]. Cette évolution majeure permet une prise en charge préventive des expositions à risque élevé, particulièrement dans les 72 heures suivant l'exposition.
L'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament) a validé l'utilisation des nouvelles plateformes de diagnostic moléculaire pour la détection de la LGV [6]. Cette validation facilite l'accès au diagnostic dans l'ensemble du territoire français.
Enfin, les recommandations européennes, auxquelles la France adhère, préconisent une surveillance épidémiologique renforcée [10]. L'objectif est de mieux comprendre l'évolution de cette pathologie et d'adapter les stratégies de prévention.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs organismes proposent information et soutien aux personnes concernées par la lymphogranulomatose vénérienne [13]. Ces ressources constituent un complément précieux à la prise en charge médicale.
Sida Info Service offre une ligne d'écoute gratuite et anonyme (0 800 840 800) accessible 24h/24. Leurs conseillers, formés aux questions relatives aux IST, peuvent répondre à vos interrogations sur la LGV [13]. Le site internet propose également des fiches d'information actualisées.
L'association AIDES dispose d'antennes dans toute la France et propose des actions de prévention, de dépistage et d'accompagnement. Leurs équipes interviennent particulièrement auprès des populations les plus exposées aux IST .
Les Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) constituent un réseau de proximité pour le dépistage et la prise en charge des IST. Ces centres proposent des consultations gratuites et anonymes, particulièrement adaptées aux situations délicates [2].
Pour les professionnels de santé, la Société française de dermatologie et la Société de pathologie infectieuse de langue française proposent des formations et des recommandations actualisées. Ces ressources facilitent l'amélioration des pratiques diagnostiques et thérapeutiques.
Nos Conseils Pratiques
Face à une suspicion de lymphogranulomatose vénérienne, certaines attitudes pratiques peuvent faciliter votre prise en charge. Tout d'abord, n'hésitez pas à consulter rapidement en cas de symptômes évocateurs, même s'ils vous semblent bénins [12].
Préparez votre consultation médicale en notant vos symptômes, leur date d'apparition et leur évolution. N'omettez aucun détail, même si certains aspects vous semblent gênants à aborder. Votre médecin a besoin d'informations complètes pour poser le bon diagnostic [11].
Soyez transparent sur vos pratiques sexuelles et vos antécédents de voyage. Ces informations, couvertes par le secret médical, sont essentielles pour orienter le diagnostic. Il n'y a aucun jugement à craindre de la part des professionnels de santé [13].
Pendant le traitement, respectez scrupuleusement la prescription antibiotique. Ne stoppez pas le traitement même si les symptômes s'améliorent rapidement. La durée de 21 jours est nécessaire pour éviter les récidives [5,12].
Informez vos partenaires sexuels récents de votre diagnostic. Cette démarche, bien que délicate, permet leur dépistage et leur traitement si nécessaire. Certains centres proposent un accompagnement pour cette étape difficile [2].
Enfin, maintenez un suivi médical régulier même après guérison. Un contrôle annuel permet de vérifier l'absence de récidive et de réaliser un dépistage global des IST [1].
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous alerter et motiver une consultation médicale rapide pour éliminer une lymphogranulomatose vénérienne [11,12]. La précocité du diagnostic maladiene l'efficacité du traitement et prévient les complications.
Consultez sans délai si vous présentez des ganglions inguinaux douloureux et gonflés, particulièrement s'ils apparaissent après un rapport sexuel non protégé. Cette manifestation constitue le signe le plus évocateur de la LGV au stade secondaire [5,12].
Les symptômes de proctite nécessitent également une consultation urgente : douleurs rectales intenses, saignements, écoulements purulents, sensation de ténesme. Ces manifestations peuvent évoluer rapidement vers des complications graves [4,9].
Toute ulcération génitale, même indolore et de petite taille, justifie un avis médical. Bien que souvent discrète, cette lésion peut être le premier signe de la maladie [11,13].
En cas de fièvre associée à des symptômes génitaux ou rectaux, ne tardez pas à consulter. Cette association peut témoigner d'une forme systémique nécessitant un traitement urgent [12].
Si vous appartenez à une population à risque (HSH, multipartenariat, voyage en zone d'endémie), un dépistage régulier est recommandé même en l'absence de symptômes [1,2]. Cette surveillance permet un diagnostic précoce des formes asymptomatiques.
Questions Fréquentes
La lymphogranulomatose vénérienne est-elle grave ?
Diagnostiquée et traitée précocement, la LGV guérit sans séquelles dans 98% des cas. Cependant, sans traitement, elle peut évoluer vers des complications graves et irréversibles.
Combien de temps dure le traitement ?
Le traitement antibiotique standard dure 21 jours, soit trois semaines. Cette durée, plus longue que pour les autres infections à chlamydia, est nécessaire pour éliminer complètement la bactérie.
Peut-on avoir des rapports sexuels pendant le traitement ?
L'abstinence sexuelle est recommandée pendant toute la durée du traitement et jusqu'à la négativation des contrôles biologiques. Cette précaution évite la transmission et les réinfections.
La LGV peut-elle récidiver ?
Après guérison complète, la LGV ne récidive généralement pas. Cependant, une réinfection reste possible en cas de nouvelle exposition au germe.
Faut-il traiter les partenaires ?
Oui, tous les partenaires sexuels des 60 jours précédant le diagnostic doivent être dépistés et traités si nécessaire, même en l'absence de symptômes.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Comprendre les infections à Chlamydia | ameli.fr | Assuré. Assurance Maladie. 2024-2025.Lien
- [2] Informer sur le VIH/Sida et les autres infections sexuellement transmissibles. sante.gouv.fr. 2024-2025.Lien
- [3] Mise à jour du Guide pour la prophylaxie et le suivi après exposition. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [4] Breizh CoCoA 2024. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] Bilan de santé à réaliser chez toute personne migrante. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] Lymphogranuloma venereum proctosigmoiditis. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [7] Doravirine/Islatravir (100/0.75 mg) Once-Daily Compared With. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [8] EJ Eckbo, M Hedgcock. Lymphogranulomatose vénérienne. 2022.Lien
- [9] B Lefebvre. Modification des critères pour l'envoi au LSPQ des spécimens rectaux testés via les plateformes cobas 5800/6800/8800 CT/NG (Roche) visant la détection de la lymphogranulomatose vénérienne (LGV) chez Chlamydia trachomatis. 2023.Lien
- [10] KBGLG Perrault. Portrait des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) au Québec: année 2020 et données préliminaires de 2021. 2023.Lien
- [13] É Fougere. Infection à Chlamydiae trachomatis, accompagner et prévenir. Actualités Pharmaceutiques, 2022.Lien
- [14] D SOUDAN. Prise en charge des sténoses ano-rectales.Lien
- [15] K Blouin, G Lambert. Les infections transmissibles sexuellement et par le sang au Québec: impacts de la pandémie de COVID-19. 2022.Lien
- [16] Lymphogranulomatose vénérienne (maladie de Nicolas-Favre). MSD Manuals.Lien
- [17] Lymphogranulomatose vénérienne (LGV). Gouvernement du Québec.Lien
- [18] La LGV, c'est quoi. Sida Info Service.Lien
Publications scientifiques
- Lymphogranulomatose vénérienne (2022)1 citations[PDF]
- … rectaux testés via les plateformes cobas 5800/6800/8800 CT/NG (Roche) visant la détection de la lymphogranulomatose vénérienne (LGV) chez Chlamydia … (2023)
- Portrait des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) au Québec: année 2020 et données préliminaires de 2021 (2023)
- Émergence de cas d'infections génitales masculines à Pasteurella bettyae (2022)
- F. Causes des infections génitales hautes (IGH) chez les femmes (2024)
Ressources web
- Lymphogranulomatose vénérienne (maladie de Nicolas- ... (msdmanuals.com)
Le diagnostic repose sur les signes cliniques, mais une confirmation est généralement possible par des techniques sérologiques ou par immunofluorescence. Le ...
- Lymphogranulomatose vénérienne (LGV) (quebec.ca)
9 mars 2017 — Les symptômes du stade primaire apparaissent de 3 à 30 jours après la transmission de la bactérie. Une ou plusieurs lésions non douloureuses ...
- La LGV, c'est quoi (sida-info-service.org)
22 mars 2017 — La LGV n'a pas de symptomatologie spécifique. Pour le diagnostic de la LGV la recherche de Chlamydia trachomatis par PCR est primordiale. Les ...
- LYMPHOGRANULOME VÉNÉRIEN (Maladie de Nicolas ... (sfdermato.org)
Le diagnostic de certitude nécessite le génotypage de. Chlamydia trachomatis : sérovar L. La sérologie peut être considérée comme un argument supplémentaire du ...
- Lymphogranulome vénérien (LGV) - Infections - Manuels ... (msdmanuals.com)
Le lymphogranulome vénérien est une infection sexuellement transmissible due à Chlamydia trachomatis. Il entraîne une hypertrophie douloureuse des ganglions ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
