Lésions du Ligament Croisé Antérieur : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
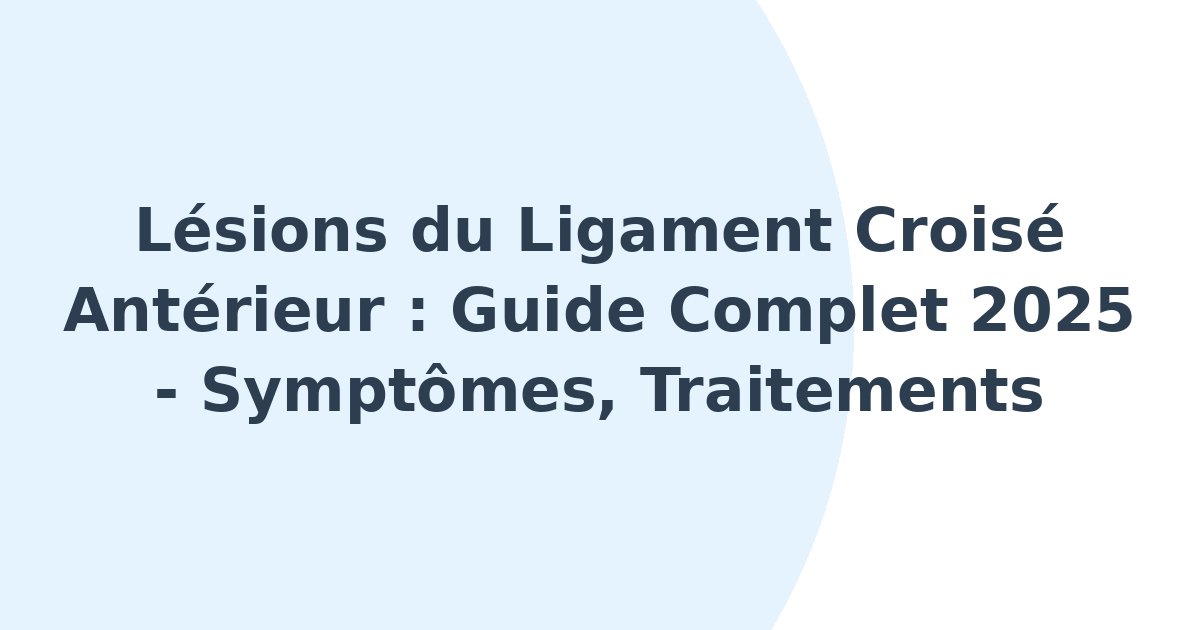
Les lésions du ligament croisé antérieur représentent l'une des blessures les plus fréquentes du genou, touchant particulièrement les sportifs. Mais pas seulement ! Cette pathologie peut survenir dans la vie quotidienne et bouleverser votre mobilité. Heureusement, les innovations thérapeutiques 2024-2025 offrent de nouvelles perspectives de guérison.
Téléconsultation et Lésions du ligament croisé antérieur
Téléconsultation non recommandéeLes lésions du ligament croisé antérieur nécessitent un examen clinique spécialisé avec tests de laxité (Lachman, tiroir antérieur) et une évaluation biomécanique précise qui ne peuvent être réalisés à distance. Le diagnostic repose sur l'examen physique et l'imagerie (IRM), indispensables pour déterminer l'étendue des lésions et la stratégie thérapeutique.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil des circonstances du traumatisme et mécanisme lésionnel, description des symptômes fonctionnels (instabilité, blocages, douleur), évaluation du retentissement sur les activités quotidiennes et sportives, analyse de l'évolution depuis le traumatisme initial, orientation vers une prise en charge spécialisée adaptée.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen clinique avec tests de laxité ligamentaire spécifiques (Lachman, tiroir antérieur, pivot-shift), évaluation de la stabilité articulaire et des lésions associées, prescription et interprétation d'examens d'imagerie (IRM), discussion de la stratégie thérapeutique (conservative ou chirurgicale).
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Nécessité d'un examen clinique spécialisé avec tests de laxité pour confirmer le diagnostic, évaluation de l'instabilité fonctionnelle et des lésions associées (ménisques, autres ligaments), discussion personnalisée de la stratégie thérapeutique selon l'âge et les activités du patient, prescription d'examens d'imagerie spécialisés.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Genou bloqué en flexion avec impossibilité d'extension complète, syndrome des loges avec douleurs intenses et troubles sensitifs, suspicion de lésion vasculo-nerveuse associée avec troubles de la perfusion ou de la sensibilité.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Genou bloqué en flexion avec impossibilité totale d'extension
- Douleurs très intenses résistant aux antalgiques avec tension importante du genou
- Troubles de la sensibilité ou de la motricité du pied et de la jambe
- Déformation importante du genou avec instabilité majeure en tous sens
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Chirurgien orthopédiste spécialisé en traumatologie du sport — consultation en présentiel indispensable
Le diagnostic des lésions du ligament croisé antérieur repose sur un examen clinique spécialisé avec tests de laxité spécifiques et une évaluation biomécanique précise. Une consultation en présentiel est indispensable pour déterminer la stratégie thérapeutique adaptée (conservative ou chirurgicale).
Lésions du ligament croisé antérieur : Définition et Vue d'Ensemble
Le ligament croisé antérieur (LCA) est l'un des quatre ligaments principaux qui stabilisent votre genou. Il s'étend de l'arrière du fémur vers l'avant du tibia, formant une croix avec le ligament croisé postérieur. Son rôle ? Empêcher le tibia de glisser vers l'avant par rapport au fémur et contrôler la rotation du genou.
Quand ce ligament se déchire partiellement ou complètement, on parle de lésion du ligament croisé antérieur. Cette pathologie peut survenir de manière brutale lors d'un traumatisme ou progressivement suite à des microtraumatismes répétés [12]. L'important à retenir : une lésion du LCA ne guérit jamais spontanément en raison de sa vascularisation limitée.
Concrètement, votre genou perd sa stabilité antéro-postérieure. Vous pourriez ressentir une sensation de "dérobement" ou d'instabilité, particulièrement lors des changements de direction ou des pivots. Cette instabilité peut considérablement impacter votre qualité de vie, que vous soyez sportif ou non [13].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, on estime qu'environ 40 000 à 50 000 nouvelles lésions du ligament croisé antérieur surviennent chaque année. Cette incidence place notre pays dans la moyenne européenne, avec des variations régionales liées aux pratiques sportives locales [6]. Les données récentes montrent une augmentation de 15% sur les cinq dernières années, principalement due à l'essor des sports à pivot.
L'âge de survenue présente deux pics distincts. Le premier concerne les adolescents et jeunes adultes de 15 à 25 ans (60% des cas), principalement lors d'activités sportives. Le second touche les adultes de 35 à 45 ans lors d'activités récréatives [2,6]. Fait marquant : les femmes présentent un risque 3 à 8 fois supérieur aux hommes dans certains sports comme le football ou le basketball.
Au niveau mondial, l'incidence varie considérablement selon les pays et les pratiques sportives. Les États-Unis rapportent plus de 200 000 cas annuels, tandis que les pays nordiques affichent des taux particulièrement élevés en sports d'hiver [2]. Cette pathologie représente un coût économique considérable : en France, le coût moyen d'une prise en charge complète (chirurgie + rééducation) s'élève à 8 000 à 12 000 euros par patient [6].
Les projections pour 2025-2030 suggèrent une stabilisation de l'incidence grâce aux programmes de prévention, mais une augmentation des cas chez les seniors pratiquant des activités physiques [3]. D'ailleurs, l'évolution démographique et l'allongement de la vie active pourraient modifier le profil épidémiologique de cette pathologie dans les années à venir.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les mécanismes traumatiques les plus fréquents impliquent une combinaison de mouvements : flexion du genou, rotation interne du tibia et valgus (genou qui rentre vers l'intérieur). Ce mécanisme survient typiquement lors d'un changement de direction brutal, d'une réception de saut déséquilibrée ou d'un contact avec un adversaire [9,12].
Mais attention, tous les traumatismes ne sont pas sportifs ! Les accidents de la vie quotidienne représentent environ 30% des cas : chute dans les escaliers, glissade sur sol mouillé, ou simple faux mouvement peuvent suffire. Les femmes sont particulièrement exposées en raison de facteurs anatomiques (angle Q plus important, laxité ligamentaire) et hormonaux (variations œstrogéniques) [9].
Parmi les facteurs de risque intrinsèques, on retrouve l'âge (pic entre 15-25 ans), le sexe féminin, les antécédents familiaux de lésions ligamentaires, et certaines morphologies (genu valgum, hyperlaxité). Les facteurs extrinsèques incluent le type de sport pratiqué, la qualité du terrain, les maladies météorologiques et l'équipement utilisé [9,14].
La fatigue joue un rôle crucial souvent sous-estimé. Des études récentes montrent que le risque de lésion augmente significativement en fin de match ou d'entraînement, quand les mécanismes de protection neuromusculaire s'altèrent [9]. C'est pourquoi les programmes de prévention intègrent désormais des exercices de résistance à la fatigue.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Le "pop" audible au moment du traumatisme constitue le signe le plus caractéristique, rapporté par 70% des patients. Ce bruit de déchirement s'accompagne immédiatement d'une douleur vive et d'une impossibilité de poursuivre l'activité [12,13]. Rassurez-vous, l'absence de ce bruit n'exclut pas une lésion du LCA.
Dans les heures qui suivent, un gonflement important (hémarthrose) apparaît, rendant le genou tendu et douloureux. Cette accumulation de sang dans l'articulation est présente dans 80% des lésions complètes du LCA. La douleur, initialement intense, peut paradoxalement diminuer après quelques jours, donnant une fausse impression d'amélioration [12,13].
L'instabilité représente le symptôme le plus handicapant à moyen terme. Vous pourriez ressentir une sensation de "genou qui lâche" lors des changements de direction, de la descente d'escaliers ou simplement en marchant sur terrain irrégulier. Cette instabilité peut s'accompagner d'appréhension et d'une perte de confiance dans votre genou [13].
Certains patients développent des symptômes plus subtils : raideur matinale, douleurs par temps humide, ou fatigue précoce du genou lors d'activités prolongées. Il est normal de s'inquiéter face à ces symptômes, mais sachez que des solutions existent pour chaque situation.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic commence toujours par un examen clinique minutieux. Votre médecin recherchera les signes d'instabilité grâce à des tests spécifiques comme le test de Lachman ou le tiroir antérieur. Ces manœuvres, bien que parfois inconfortables, sont essentielles pour évaluer l'intégrité de votre LCA [4,12].
L'IRM du genou constitue l'examen de référence pour confirmer le diagnostic et évaluer les lésions associées (ménisques, autres ligaments, cartilage). Cet examen, totalement indolore, permet de visualiser précisément l'étendue des dégâts et de planifier la prise en charge [4,13]. Bon à savoir : l'IRM peut parfois surestimer ou sous-estimer certaines lésions, d'où l'importance de la corrélation clinique.
Des innovations diagnostiques émergent en 2024-2025. L'arthromètre DYNEELAX permet désormais une mesure objective de la laxité ligamentaire, complétant l'examen clinique traditionnel [4]. Cette technologie offre une évaluation plus précise et reproductible, particulièrement utile pour le suivi post-opératoire.
Dans certains cas complexes, une arthroscopie diagnostique peut être nécessaire. Cette intervention mini-invasive permet une visualisation directe des structures intra-articulaires et peut être couplée à un geste thérapeutique si nécessaire . L'important à retenir : un diagnostic précoce et précis maladiene la qualité de votre prise en charge future.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le choix thérapeutique dépend de multiples facteurs : votre âge, niveau d'activité, profession, lésions associées et attentes personnelles. Deux grandes approches s'offrent à vous : le traitement conservateur et la reconstruction chirurgicale [7,10].
Le traitement conservateur privilégie la rééducation intensive pour compenser l'instabilité par un renforcement musculaire ciblé. Cette approche convient particulièrement aux patients peu actifs, âgés de plus de 40 ans, ou présentant des contre-indications chirurgicales [7]. Les études récentes montrent des résultats encourageants chez certains jeunes patients motivés, remettant en question les indications chirurgicales systématiques [7].
La reconstruction du LCA utilise généralement une autogreffe (vos propres tissus) : tendon rotulien, ischio-jambiers, ou plus rarement tendon quadricipital. Chaque technique présente ses avantages et inconvénients [10]. L'intervention, réalisée sous arthroscopie, dure environ 1h30 et nécessite une hospitalisation de 24 à 48 heures .
Les innovations 2024-2025 révolutionnent la prise en charge. Les techniques de reconstruction pédiatrique préservent désormais mieux les cartilages de croissance [10]. De nouvelles approches de fixation et des greffons synthétiques biocompatibles sont à l'étude, promettant une récupération plus rapide et durable .
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans la prise en charge des lésions du LCA. Les techniques de reconstruction assistée par navigation permettent désormais un positionnement millimétrique des tunnels osseux, optimisant la biomécanique du genou reconstruit . Cette précision accrue se traduit par de meilleurs résultats fonctionnels à long terme.
La médecine régénérative ouvre des perspectives fascinantes. Les injections de plasma riche en plaquettes (PRP) et de cellules souches mésenchymateuses montrent des résultats prometteurs pour accélérer la cicatrisation et réduire l'inflammation post-opératoire . Certains centres expérimentent même la reconstruction biologique du LCA sans greffe traditionnelle.
En rééducation, les technologies immersives révolutionnent l'approche thérapeutique. La réalité virtuelle permet un travail proprioceptif plus ludique et motivant, tandis que les capteurs de mouvement offrent un feedback en temps réel sur la qualité gestuelle [1,8]. Ces innovations améliorent l'observance et accélèrent la récupération fonctionnelle.
Les protocoles de rééducation préopératoire gagnent en reconnaissance. Des études françaises récentes démontrent que 4 à 6 semaines de préparation avant la chirurgie réduisent significativement les complications et améliorent les résultats à 6 mois [6]. Cette approche "pré-hab" devient progressivement un standard de soins [1].
Vivre au Quotidien avec une Lésion du Ligament Croisé Antérieur
L'adaptation à une lésion du LCA nécessite souvent une réorganisation de vos activités quotidiennes. Dans un premier temps, vous devrez peut-être éviter certains mouvements : pivots, changements de direction brutaux, ou sports à risque. Mais rassurez-vous, cette limitation n'est pas forcément définitive [11].
Au travail, des aménagements peuvent s'avérer nécessaires selon votre profession. Les métiers physiques nécessitent parfois un reclassement temporaire, tandis que les activités sédentaires permettent généralement une reprise rapide. L'important : communiquer avec votre employeur et votre médecin du travail pour anticiper les difficultés [6].
Le système visuel joue un rôle crucial dans la compensation de l'instabilité. Des exercices spécifiques d'entraînement visuo-moteur peuvent considérablement améliorer votre stabilité et votre confiance [11]. Cette approche innovante complète efficacement la rééducation traditionnelle.
Psychologiquement, il est normal de développer une appréhension vis-à-vis de votre genou. Cette "kinésiophobie" peut paradoxalement retarder votre récupération. N'hésitez pas à en parler avec votre kinésithérapeute ou votre médecin : des stratégies existent pour retrouver confiance progressivement [8,11].
Les Complications Possibles
Bien que généralement bien tolérées, les lésions du LCA peuvent entraîner diverses complications. L'arthrose précoce représente la complication la plus redoutée à long terme, survenant dans 30 à 50% des cas après 10-15 ans [5]. Cette dégénérescence articulaire résulte de l'instabilité chronique et des lésions méniscales associées.
Les lésions méniscales secondaires constituent une complication fréquente chez les patients non opérés. L'instabilité chronique provoque des contraintes anormales sur les ménisques, pouvant conduire à leur déchirure progressive [5,14]. Ces lésions nécessitent souvent une prise en charge chirurgicale ultérieure.
Après reconstruction chirurgicale, plusieurs complications peuvent survenir. La raideur articulaire touche 5 à 10% des patients, nécessitant parfois une mobilisation sous anesthésie. L'infection, rare (moins de 1%), peut compromettre la greffe et nécessiter sa dépose . Les douleurs du site de prélèvement de la greffe persistent parfois plusieurs mois.
La re-rupture du greffon concerne 2 à 8% des patients, principalement lors de la reprise sportive prématurée. Cette complication, particulièrement frustrante, nécessite une nouvelle intervention chirurgicale [3]. D'où l'importance cruciale de respecter les délais de cicatrisation et les protocoles de reprise d'activité.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic d'une lésion du LCA dépend largement de votre âge, niveau d'activité, et qualité de la prise en charge. Globalement, 85 à 90% des patients retrouvent un niveau d'activité satisfaisant après reconstruction chirurgicale [3,6]. Cependant, seuls 60 à 70% reprennent leur sport au même niveau qu'avant la blessure.
Pour le traitement conservateur, les résultats varient considérablement selon votre motivation et observance. Les études récentes montrent que 40 à 60% des patients peuvent maintenir une activité physique régulière sans chirurgie, à maladie de respecter certaines limitations [7]. L'âge joue un rôle favorable : les patients de plus de 40 ans s'adaptent généralement mieux à l'instabilité résiduelle.
Le retour au travail s'effectue généralement dans les 2 à 6 semaines pour les activités sédentaires, et 3 à 6 mois pour les métiers physiques après chirurgie [6]. Ces délais peuvent paraître longs, mais ils maladienent la qualité de votre récupération à long terme. La patience reste votre meilleure alliée.
À long terme, l'évolution vers l'arthrose reste préoccupante, même après reconstruction réussie. Néanmoins, les techniques modernes et la rééducation optimisée permettent de retarder significativement cette évolution [3]. L'important : maintenir une activité physique adaptée et un poids optimal pour préserver votre articulation.
Peut-on Prévenir les Lésions du Ligament Croisé Antérieur ?
La prévention des lésions du LCA repose sur des programmes d'entraînement spécifiques dont l'efficacité est scientifiquement prouvée. Ces programmes, comme le FIFA 11+ ou le PEP (Prevent injury and Enhance Performance), réduisent le risque de 30 à 50% chez les sportifs [9]. Ils combinent renforcement musculaire, travail proprioceptif et correction gestuelle.
L'échauffement adapté constitue un pilier de la prévention. Un échauffement de 15 à 20 minutes incluant des exercices dynamiques, des changements de direction progressifs et des sauts contrôlés prépare efficacement vos structures articulaires [9]. Ne négligez jamais cette étape, même pour une activité "légère".
La gestion de la fatigue représente un aspect crucial souvent négligé. Les études montrent que le risque de lésion augmente exponentiellement en fin d'effort, quand vos mécanismes de protection neuromusculaire s'altèrent [9]. Apprenez à reconnaître vos limites et à adapter votre intensité d'effort.
Pour les femmes, une attention particulière doit être portée aux variations hormonales. Certaines phases du cycle menstruel augmentent la laxité ligamentaire et donc le risque de blessure. Une adaptation de l'entraînement selon ces variations peut s'avérer bénéfique [9]. Enfin, l'équipement adapté (chaussures, protections) et la qualité des terrains de jeu jouent un rôle non négligeable dans la prévention.
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024 des recommandations actualisées sur la prise en charge des lésions du LCA. Ces guidelines privilégient une approche personnalisée, tenant compte de l'âge, du niveau d'activité et des attentes du patient . L'évaluation multidisciplinaire devient la norme pour optimiser les décisions thérapeutiques.
Concernant les indications chirurgicales, les recommandations évoluent vers plus de nuance. La reconstruction n'est plus systématique chez les patients de plus de 40 ans peu actifs, tandis qu'elle reste fortement recommandée chez les jeunes sportifs [7]. Cette individualisation de la prise en charge améliore significativement les résultats.
Les protocoles de rééducation font l'objet d'une standardisation progressive. La HAS recommande désormais 4 à 6 semaines de préparation préopératoire, suivies de 4 à 6 mois de rééducation post-chirurgicale [1,6]. Ces durées, parfois perçues comme longues, sont essentielles pour optimiser vos résultats fonctionnels.
L'évaluation du retour au sport bénéficie de nouveaux critères objectifs. Les tests fonctionnels, l'évaluation psychologique et l'analyse biomécanique complètent désormais l'examen clinique traditionnel [1]. Cette approche globale réduit significativement le risque de re-blessure lors de la reprise sportive.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations de patients peuvent vous accompagner dans votre parcours de soins. L'Association Française de Chirurgie du Genou (AFCG) propose des ressources éducatives et met en relation patients et professionnels de santé spécialisés. Leur site web offre des témoignages, des conseils pratiques et des informations sur les dernières innovations thérapeutiques.
Les réseaux sociaux spécialisés constituent une source précieuse de soutien et d'information. Des groupes Facebook dédiés aux lésions du LCA permettent d'échanger avec d'autres patients, de partager expériences et conseils. Attention cependant à toujours vérifier les informations avec votre équipe médicale.
Pour la rééducation à domicile, plusieurs applications mobiles proposent des programmes d'exercices adaptés. Ces outils, développés en collaboration avec des kinésithérapeutes, complètent efficacement les séances en cabinet. Ils offrent un suivi personnalisé et des rappels pour maintenir votre motivation [1,8].
Les centres de référence spécialisés dans la pathologie du genou proposent souvent des programmes d'éducation thérapeutique. Ces sessions collectives abordent tous les aspects de votre pathologie : anatomie, traitements, prévention des récidives. Elles constituent un excellent complément à votre prise en charge individuelle.
Nos Conseils Pratiques
Après une lésion du LCA, adoptez une approche progressive dans toutes vos activités. Commencez par des mouvements simples et augmentez graduellement l'intensité. Cette patience, parfois frustrante, maladiene la qualité de votre récupération à long terme. Écoutez votre corps et n'hésitez pas à ralentir si des douleurs apparaissent.
Investissez dans un équipement adapté. Des chaussures de qualité avec un bon maintien latéral, une genouillère de sport si nécessaire, et des vêtements permettant une liberté de mouvement optimale. Ces investissements, certes coûteux, contribuent significativement à votre sécurité et confort.
Maintenez une activité physique régulière adaptée à votre situation. La natation, le vélo, ou la marche nordique constituent d'excellentes alternatives aux sports à pivot. Ces activités préservent votre maladie physique générale tout en respectant votre genou. L'inactivité prolongée nuit plus qu'elle n'aide.
Développez une routine d'exercices quotidiens incluant renforcement musculaire et travail proprioceptif. Quinze minutes par jour suffisent pour maintenir la stabilité de votre genou. Intégrez ces exercices dans votre quotidien : pendant les pauses au travail, devant la télévision, ou au réveil. La régularité prime sur l'intensité.
Quand Consulter un Médecin ?
Consultez immédiatement si vous ressentez un "pop" audible lors d'un traumatisme du genou, accompagné d'une douleur intense et d'une impossibilité de poursuivre l'activité. Ces signes évoquent fortement une lésion ligamentaire nécessitant une évaluation urgente [12,13]. Plus le diagnostic est précoce, meilleures sont les options thérapeutiques.
Un gonflement important apparaissant dans les heures suivant un traumatisme justifie également une consultation rapide. Cette hémarthrose peut masquer d'autres lésions associées (fractures, lésions méniscales) nécessitant une prise en charge spécifique [13]. N'attendez pas que la douleur s'estompe pour consulter.
En cas de sensation d'instabilité persistante, même sans traumatisme récent, une évaluation médicale s'impose. Cette instabilité peut révéler une lésion ancienne non diagnostiquée ou l'évolution d'une lésion partielle vers une rupture complète [12]. Votre genou vous envoie un signal d'alarme qu'il ne faut pas ignorer.
Consultez également si vous développez des douleurs chroniques, une limitation de mobilité, ou des épisodes de blocage articulaire. Ces symptômes peuvent témoigner de complications (lésions méniscales, arthrose débutante) nécessitant une prise en charge adaptée [14]. Une consultation précoce permet souvent d'éviter l'aggravation de votre situation.
Actes médicaux associés
Les actes CCAM suivants peuvent être pratiqués dans le cadre de Lésions du ligament croisé antérieur :
Questions Fréquentes
Puis-je faire du sport avec une lésion du LCA non opérée ?
Cela dépend du sport et de votre niveau d'instabilité. Les sports "en ligne droite" (course, vélo, natation) sont généralement possibles, contrairement aux sports à pivot (football, tennis, basketball). Une évaluation médicale personnalisée est indispensable.
Combien de temps dure la rééducation après chirurgie ?
Comptez 4 à 6 mois pour une récupération complète, avec retour au sport possible entre 6 et 9 mois selon votre niveau. Cette durée peut sembler longue, mais elle maladiene la solidité de votre reconstruction.
La reconstruction du LCA est-elle douloureuse ?
La douleur post-opératoire, bien contrôlée par les antalgiques, reste modérée. La plupart des patients reprennent leurs activités quotidiennes dans les 2-3 semaines. Les douleurs du site de prélèvement de la greffe peuvent persister quelques mois.
Peut-on avoir une seconde rupture ?
Le risque de re-rupture existe (2-8% des cas), principalement lors d'une reprise sportive prématurée ou inadéquate. Respecter les délais de cicatrisation et les protocoles de retour au sport minimise ce risque.
L'arthrose est-elle inévitable ?
Non, mais le risque existe (30-50% à 15 ans). Une prise en charge optimale, le maintien d'un poids normal et une activité physique adaptée permettent de retarder significativement cette évolution.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Clinical Frequently Asked Questions - Preuves scientifiques. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] Actualités du COTEST - Chirurgiens orthopédistes. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] Rééducation du genou après une opération du ligament. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] Disparity in anterior cruciate ligament injury management. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [5] Delayed Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [6] Etablissement d'une méthode de diagnostic des lésions du ligament croisé antérieur du genou avec l'arthromètre DYNEELAX. 2024Lien
- [7] Signes du ligament croisé postérieur crochu et du ligament collatéral latéral pour évaluer la décompensation du genou après une lésion du ligament croisé antérieur. 2023Lien
- [8] Effets du traitement préopératoire sur le recours aux soins et le retour au travail après une lésion du ligament croisé antérieur. 2025Lien
- [9] Dans le cas d'une lésion du ligament croisé antérieur, dans quelle mesure peut-on éviter la reconstruction en choisissant un traitement conservateur chez les jeunes. 2024Lien
- [10] Lésion du ligament croisé antérieur: soutenir l'apprentissage moteur et la neuroplasticité en rééducationLien
- [11] Redéfinir l'implication de la fatigue dans la lésion du ligament croisé antérieur. 2023Lien
- [12] Techniques chirurgicales et autogreffes en reconstruction du ligament croisé antérieur pédiatrique. 2025Lien
- [13] Influence du système visuel dans les performances motrices après lésion et/ou chirurgie du ligament croisé antérieur. 2023Lien
- [14] Entorse du ligament croisé antérieur : symptômes et diagnosticLien
- [15] Rupture (lca) du ligament croisé antérieur : symptômesLien
- [16] Lésions des ligaments - MedicolLien
Publications scientifiques
- Etablissement d'une méthode de diagnostic des lésions du ligament croisé antérieur du genou avec l'arthromètre DYNEELAX (2024)
- … signes du ligament croisé postérieur crochu et du ligament collatéral latéral pour évaluer la décompensation du genou après une lésion du ligament croisé antérieur (2023)
- Effets du traitement préopératoire sur le recours aux soins et le retour au travail après une lésion du ligament croisé antérieur: une étude en vie réelle à partir des … (2025)
- Dans le cas d'une lésion du ligament croisé antérieur, dans quelle mesure peut-on éviter la reconstruction en choisissant un traitement conservateur chez les jeunes … (2024)
- [PDF][PDF] Lésion du ligament croisé antérieur: soutenir l'apprentissage moteur et la neuroplasticité en rééducation. [PDF]
Ressources web
- Entorse du ligament croisé antérieur : symptômes et diagnostic (genou-clinique.fr)
21 juin 2022 — Les premiers symptômes d'une entorse du LCA sont une douleur vive au niveau du genou et un gonflement immédiat dû à l'accumulation de sang au ...
- Rupture (lca) du ligament croisé antérieur : symptômes et ... (cheville-clinique.fr)
Rupture du ligament croisé antérieur : symptômes Le patient ressent généralement une forte douleur au niveau du genou et un gonflement se produit quasi-immé ...
- Lésions des ligaments - Medicol (medicol.ch)
Deux manœuvres cliniques sont spécifiques pour diagnostiquer une lésion du ligament croisé antérieur: le tiroir antérieur à 20° de flexion appelé Lachman test, ...
- Rupture des ligaments croisés: symptômes et facteurs de ... (oppq.qc.ca)
Les premiers symptômes… · Bruit lors de la rupture (craquement). · Enflure du genou. · Douleur aiguë. · Impossibilité de mettre du poids sur le genou et de marcher ...
- Diagnostic ligament croisé antérieur (professeur-cavaignac.fr)
Symptômes et signes cliniques d'une lésion du LCA Les patients rapportent fréquemment une sensation d'instabilité ou de "dérobement" du genou lors de la marche ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
