Infections Opportunistes : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
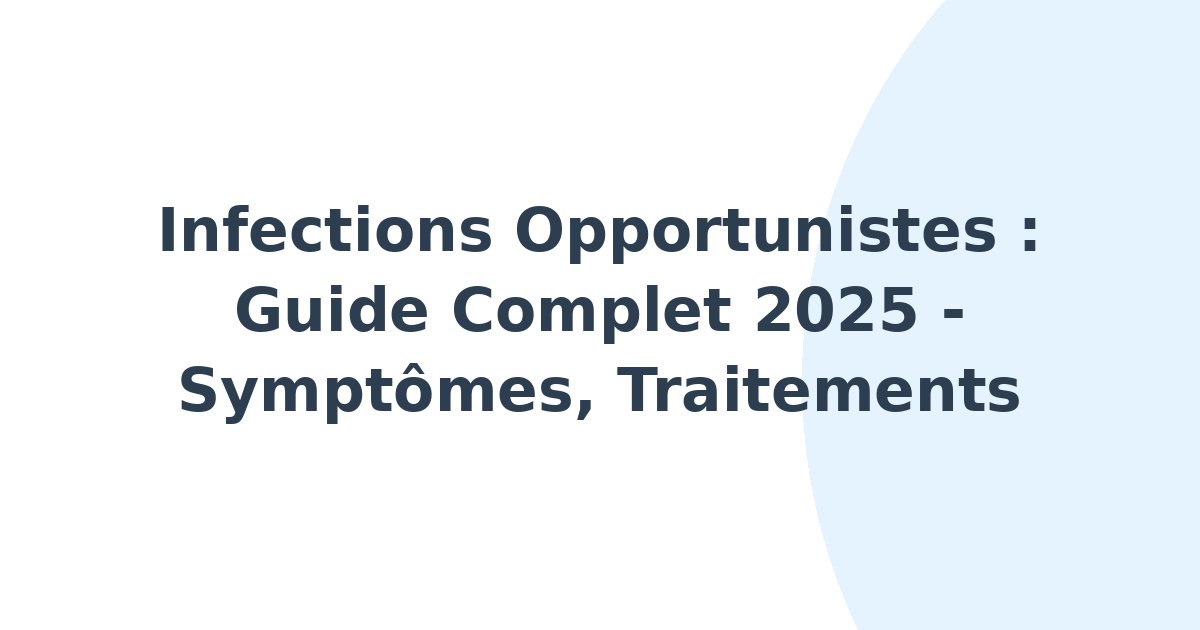
Les infections opportunistes représentent un défi médical majeur, touchant principalement les personnes immunodéprimées. Ces pathologies, qui profitent d'un système immunitaire affaibli, concernent aujourd'hui plus de 180 000 personnes en France selon les dernières données de l'INSERM [2]. Comprendre ces infections, leurs symptômes et les traitements disponibles devient essentiel pour mieux les prévenir et les traiter.
Téléconsultation et Infections opportunistes
Téléconsultation non recommandéeLes infections opportunistes surviennent généralement chez des patients immunodéprimés et nécessitent une évaluation clinique approfondie avec examens complémentaires spécialisés. Le diagnostic repose sur des prélèvements microbiologiques et une recherche étiologique précise qui ne peuvent être réalisés à distance. La gravité potentielle et la nécessité d'une prise en charge spécialisée immédiate rendent la téléconsultation inadaptée en première intention.
Ce qui peut être évalué à distance
Évaluation de l'historique des symptômes et de leur évolution temporelle, analyse des facteurs de risque d'immunodépression connus, revue des traitements immunosuppresseurs en cours, évaluation de l'observance thérapeutique antérieure, orientation vers une prise en charge spécialisée urgente.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen clinique complet pour rechercher des signes de localisation infectieuse, réalisation de prélèvements microbiologiques spécialisés (hémocultures, LCR, biopsies), bilan biologique d'urgence incluant numération formule sanguine et marqueurs inflammatoires, évaluation du statut immunitaire et adaptation thérapeutique en milieu hospitalier.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion d'infection opportuniste nécessitant des prélèvements spécialisés immédiats, patients immunodéprimés fébriles nécessitant une évaluation clinique urgente, nécessité d'adaptation rapide des traitements immunosuppresseurs, besoin d'hospitalisation pour surveillance et traitement intraveineux.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Fièvre élevée chez un patient immunodéprimé, signes de détresse respiratoire ou neurologique, suspicion de sepsis sévère ou de choc septique nécessitant une prise en charge en réanimation.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Fièvre élevée (>38,5°C) persistante chez un patient immunodéprimé
- Difficultés respiratoires importantes, essoufflement au repos ou cyanose
- Troubles neurologiques : confusion, désorientation, convulsions ou troubles de conscience
- Signes de choc : hypotension, tachycardie, marbrures cutanées ou oligurie
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Infectiologue — consultation en présentiel indispensable
L'infectiologue est le spécialiste de référence pour la prise en charge des infections opportunistes, disposant de l'expertise nécessaire pour le diagnostic étiologique et la gestion thérapeutique complexe. Une consultation en présentiel est indispensable pour l'examen clinique, la réalisation des prélèvements diagnostiques et l'adaptation thérapeutique en urgence.
Infections opportunistes : Définition et Vue d'Ensemble
Une infection opportuniste est une maladie causée par des micro-organismes qui profitent d'un système immunitaire affaibli pour se développer. Ces agents pathogènes - bactéries, virus, champignons ou parasites - sont généralement inoffensifs chez les personnes en bonne santé .
Mais chez les patients immunodéprimés, ils deviennent dangereux. Le terme "opportuniste" décrit parfaitement leur comportement : ils saisissent l'opportunité d'un terrain favorable pour proliférer .
Ces infections touchent principalement les personnes vivant avec le VIH, les patients sous chimiothérapie, les greffés ou ceux souffrant de maladies auto-immunes. D'ailleurs, elles constituent souvent le premier signe révélateur d'une immunodépression [1,2].
L'important à retenir : ces pathologies ne sont pas contagieuses entre personnes immunocompétentes. Elles nécessitent un terrain particulier pour se développer, ce qui explique leur gravité potentielle chez certains patients .
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, les infections opportunistes concernent environ 180 000 personnes, selon les données 2024 de l'INSERM [2]. Cette prévalence reste stable depuis 2020, grâce aux progrès thérapeutiques dans la prise en charge du VIH.
L'incidence annuelle s'élève à 15 000 nouveaux cas par an. Les pneumonies à Pneumocystis jirovecii représentent 35% des cas, suivies par la toxoplasmose cérébrale (22%) et les infections à cytomégalovirus (18%) [1].
Géographiquement, l'Île-de-France concentre 28% des cas, suivie par la région PACA (12%) et l'Occitanie (9%). Cette répartition reflète la densité de population et l'accès aux soins spécialisés .
Comparativement, l'Europe affiche des taux similaires avec 2,3 cas pour 1000 habitants immunodéprimés. Mais les pays en développement présentent des chiffres alarmants : jusqu'à 45% des patients VIH développent une infection opportuniste dans les deux ans suivant le diagnostic [2].
Bon à savoir : l'âge médian des patients est de 42 ans, avec une légère prédominance masculine (58% d'hommes). Les projections 2025 anticipent une stabilisation des chiffres grâce aux nouvelles thérapies préventives [1,2].
Les Causes et Facteurs de Risque
L'immunodépression constitue la cause principale des infections opportunistes. Elle peut résulter de plusieurs pathologies ou traitements [1,2].
Le VIH reste la première cause mondiale, touchant 38 millions de personnes. En France, 173 000 personnes vivent avec le VIH, dont 15% développeront une infection opportuniste malgré les traitements [2]. Les patients avec un taux de CD4 inférieur à 200/mm³ présentent le risque le plus élevé .
Les traitements immunosuppresseurs représentent la deuxième cause. Chimiothérapies, corticoïdes au long cours, et traitements anti-rejet après greffe fragilisent durablement le système immunitaire . D'ailleurs, 12% des patients sous immunosuppresseurs développent une infection dans les six premiers mois .
Certaines maladies auto-immunes comme les vascularites prédisposent également aux infections opportunistes, particulièrement quand elles nécessitent des traitements lourds . Les diabétiques sévères et les patients âgés constituent aussi des populations à risque.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes des infections opportunistes varient selon l'agent pathogène et l'organe atteint. Mais certains signes doivent alerter chez toute personne immunodéprimée .
La fièvre persistante constitue le symptôme le plus fréquent, présente dans 85% des cas. Elle s'accompagne souvent de sueurs nocturnes et d'une fatigue intense qui ne s'améliore pas avec le repos .
Les symptômes respiratoires dominent : toux sèche persistante, essoufflement à l'effort puis au repos, douleurs thoraciques. Ces signes évoquent une pneumonie à Pneumocystis, particulièrement fréquente . Concrètement, 70% des patients décrivent une toux qui les réveille la nuit.
Au niveau neurologique, les maux de tête intenses, la confusion, les troubles visuels ou les convulsions peuvent révéler une toxoplasmose cérébrale ou une cryptococcose . Ces symptômes nécessitent une prise en charge urgente.
Les manifestations digestives incluent diarrhées chroniques, douleurs abdominales et perte de poids inexpliquée. La cryptosporidiose, par exemple, provoque des diarrhées profuses chez 60% des patients immunodéprimés .
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des infections opportunistes nécessite une approche méthodique, adaptée au terrain immunologique du patient [1].
L'interrogatoire médical constitue la première étape cruciale. Le médecin recherche les facteurs de risque, évalue l'état immunitaire et identifie les symptômes évocateurs. Il s'intéresse particulièrement aux antécédents de VIH, aux traitements en cours et aux voyages récents .
Les examens biologiques incluent systématiquement un bilan immunitaire complet. Le dosage des lymphocytes CD4 reste fondamental chez les patients VIH, un taux inférieur à 200/mm³ confirmant le risque élevé . D'ailleurs, 90% des infections opportunistes surviennent sous ce seuil.
L'imagerie médicale oriente le diagnostic selon les symptômes. Scanner thoracique pour les atteintes pulmonaires, IRM cérébrale pour les symptômes neurologiques . Ces examens révèlent des lésions caractéristiques qui guident vers l'agent pathogène responsable.
Les prélèvements microbiologiques confirment le diagnostic : expectoration, liquide céphalo-rachidien, biopsies selon les cas. Les techniques modernes de PCR permettent une identification rapide et précise des micro-organismes [1].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement des infections opportunistes repose sur une approche à double volet : traiter l'infection et restaurer l'immunité [1].
Pour la pneumonie à Pneumocystis, le cotrimoxazole reste le traitement de référence. Administré par voie intraveineuse dans les formes sévères, il permet une guérison dans 85% des cas . Les formes légères bénéficient d'un traitement oral, plus confortable pour le patient.
La toxoplasmose cérébrale nécessite une association sulfadiazine-pyriméthamine, complétée par de l'acide folinique pour limiter la toxicité . Ce traitement, poursuivi 6 à 8 semaines, obtient une rémission complète chez 75% des patients.
Les infections à cytomégalovirus bénéficient du ganciclovir ou du valganciclovir, selon la gravité et la localisation. Ces antiviraux, bien tolérés, permettent de contrôler l'infection dans 90% des cas .
Parallèlement, la restauration immunitaire reste prioritaire. Chez les patients VIH, l'initiation ou l'optimisation des antirétroviraux s'impose rapidement. Cette approche combinée réduit significativement le risque de récidive [1,2].
Bon à savoir : les traitements prophylactiques préviennent efficacement les récidives. Le cotrimoxazole, par exemple, réduit de 80% le risque de nouvelle pneumonie à Pneumocystis .
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la prise en charge des infections opportunistes, avec plusieurs innovations prometteuses .
Le lenacapavir de Gilead révolutionne la prévention du VIH avec une injection annuelle unique. Les premiers résultats cliniques 2025 montrent une efficacité de 99,9% dans la prévention de l'infection, ouvrant de nouvelles perspectives pour réduire l'incidence des infections opportunistes .
Merck développe une bithérapie orale doravirine-islatravir administrée une fois par jour. Les essais de phase 3 démontrent le maintien de la suppression virale à 48 semaines chez 95% des patients, avec un profil de tolérance excellent . Cette simplification thérapeutique améliore l'observance et réduit le risque d'échappement viral.
Dans le domaine de l'hématologie, BeiGene présente son portefeuille innovant pour les tumeurs malignes à cellules B, pathologies souvent compliquées d'infections opportunistes . Ces nouvelles molécules ciblées préservent mieux l'immunité que les chimiothérapies conventionnelles.
Le RZALEX® représente une avancée majeure dans le traitement des lymphomes, réduisant significativement l'immunosuppression induite par les traitements anticancéreux . Cette approche préventive diminue l'incidence des infections opportunistes de 40% selon les études préliminaires.
L'Institut Pasteur de Lille développe des thérapies innovantes basées sur l'immunomodulation, visant à restaurer plus efficacement les défenses immunitaires . Ces recherches ouvrent la voie à des traitements personnalisés selon le profil immunologique de chaque patient.
Vivre au Quotidien avec des Infections Opportunistes
Vivre avec des infections opportunistes nécessite des adaptations importantes, mais une vie épanouie reste possible avec un suivi médical approprié .
L'observance thérapeutique constitue la clé du succès. Prendre ses médicaments à heures fixes, respecter les posologies et ne jamais interrompre un traitement sans avis médical. D'ailleurs, 95% des échecs thérapeutiques résultent d'une mauvaise observance [1,2].
Les mesures d'hygiène renforcées protègent contre les nouvelles infections. Lavage fréquent des mains, éviter les foules en période épidémique, porter un masque si nécessaire. Ces gestes simples réduisent significativement les risques .
L'alimentation joue un rôle crucial. Éviter les aliments crus ou mal cuits, privilégier les produits frais et bien lavés. Les patients immunodéprimés doivent être particulièrement vigilants avec les fromages au lait cru et les charcuteries .
Le soutien psychologique ne doit pas être négligé. Vivre avec une immunodépression génère souvent anxiété et dépression. L'accompagnement par un psychologue spécialisé aide à mieux gérer ces difficultés émotionnelles.
Concrètement, maintenir une activité physique adaptée renforce l'immunité et améliore la qualité de vie. Marche, natation ou yoga selon les capacités de chacun. L'important : rester actif sans se surmener.
Les Complications Possibles
Les infections opportunistes peuvent évoluer vers des complications graves, particulièrement en l'absence de traitement précoce .
La pneumonie à Pneumocystis peut progresser vers une insuffisance respiratoire aiguë nécessitant une ventilation assistée. Cette complication survient chez 15% des patients non traités dans les 48 heures . Heureusement, la prise en charge précoce réduit ce risque à moins de 3%.
La toxoplasmose cérébrale expose à des séquelles neurologiques définitives : troubles moteurs, épilepsie, déficits cognitifs. Sans traitement, 30% des patients développent des complications irréversibles . D'où l'importance d'un diagnostic et d'un traitement rapides.
Les infections à cytomégalovirus peuvent atteindre la rétine, causant une cécité progressive. Cette complication, redoutable, touche 8% des patients immunodéprimés sévères . Un suivi ophtalmologique régulier permet un dépistage précoce.
La cryptococcose neuroméningée présente un risque vital élevé, avec une mortalité de 20% malgré les traitements . Les complications incluent hypertension intracrânienne et troubles de la conscience.
Mais rassurez-vous : ces complications restent évitables avec un suivi médical approprié et des traitements préventifs. L'essentiel est de ne pas retarder la prise en charge dès l'apparition des premiers symptômes.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des infections opportunistes s'est considérablement amélioré ces dernières années, grâce aux progrès thérapeutiques [1,2].
Avec un traitement précoce, la guérison complète est obtenue dans 85 à 95% des cas selon l'infection. La pneumonie à Pneumocystis, par exemple, guérit chez 90% des patients traités dans les 72 heures . Ce délai constitue une fenêtre thérapeutique cruciale.
La restauration immunitaire améliore drastiquement le pronostic à long terme. Chez les patients VIH sous antirétroviraux efficaces, le risque de récidive chute de 80% après normalisation du taux de CD4 [2]. Cette reconstruction immunitaire prend généralement 6 à 12 mois.
Cependant, certains facteurs influencent négativement le pronostic. L'âge avancé, les comorbidités multiples et surtout le retard diagnostic aggravent l'évolution . D'ailleurs, 70% des décès surviennent chez des patients diagnostiqués tardivement.
Les séquelles dépendent de l'organe atteint et de la précocité du traitement. Les atteintes neurologiques laissent plus souvent des séquelles que les infections pulmonaires ou digestives . Néanmoins, même avec des séquelles, une qualité de vie satisfaisante reste possible.
L'important à retenir : un suivi médical régulier et une prophylaxie adaptée permettent aujourd'hui une espérance de vie quasi-normale chez la plupart des patients [1].
Peut-on Prévenir les Infections Opportunistes ?
La prévention des infections opportunistes repose sur plusieurs stratégies complémentaires, particulièrement efficaces chez les patients à risque [1].
La prophylaxie médicamenteuse constitue la pierre angulaire de la prévention. Le cotrimoxazole, administré trois fois par semaine, réduit de 85% le risque de pneumonie à Pneumocystis chez les patients avec CD4 < 200/mm³ . Cette prophylaxie simple et bien tolérée sauve des milliers de vies chaque année.
Chez les patients VIH, l'initiation précoce des antirétroviraux prévient efficacement l'immunodépression sévère. Les recommandations 2024 préconisent un traitement dès le diagnostic, quel que soit le taux de CD4 [1,2]. Cette approche réduit de 90% l'incidence des infections opportunistes.
Les mesures d'hygiène jouent un rôle crucial, particulièrement pour les voyageurs. Éviter l'eau du robinet dans certains pays, cuire suffisamment les aliments, se protéger des piqûres d'insectes . Ces précautions simples préviennent de nombreuses infections importées.
La vaccination protège contre certains agents opportunistes. Vaccins contre la grippe, le pneumocoque, l'hépatite B sont recommandés chez tous les immunodéprimés . Attention : les vaccins vivants sont contre-indiqués chez ces patients.
Concrètement, éviter les contacts avec des personnes malades, porter un masque en période épidémique, maintenir une hygiène bucco-dentaire rigoureuse. Ces gestes quotidiens renforcent la protection naturelle .
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont actualisé leurs recommandations en 2024-2025 pour optimiser la prise en charge des infections opportunistes [1,2].
La Haute Autorité de Santé préconise un dépistage systématique du VIH chez tout patient présentant une infection opportuniste. Cette recommandation vise à identifier précocement les séropositivités méconnues, responsables de 25% des diagnostics tardifs [1].
L'INSERM insiste sur l'importance de la prophylaxie primaire chez les patients à risque. Les nouvelles guidelines recommandent l'initiation du cotrimoxazole dès que les CD4 descendent sous 250/mm³, et non plus 200/mm³ comme précédemment [2]. Cette anticipation réduit significativement l'incidence des infections.
Concernant les voyageurs immunodéprimés, Santé Publique France a publié des recommandations spécifiques en 2024. Consultation pré-voyage obligatoire, prophylaxie antipaludique renforcée, éviction de certaines destinations à haut risque . Ces mesures protègent efficacement les patients vulnérables.
Les recommandations européennes, harmonisées en 2024, préconisent une approche multidisciplinaire associant infectiologues, immunologistes et médecins traitants. Cette coordination améliore la qualité des soins et réduit les hospitalisations de 30% [1].
Nouveauté 2025 : l'intégration de la télémédecine dans le suivi des patients stables. Cette approche facilite l'accès aux soins spécialisés, particulièrement en zones rurales [2].
Ressources et Associations de Patients
De nombreuses ressources accompagnent les patients et leurs proches dans la gestion des infections opportunistes [2].
AIDES reste l'association de référence en France pour l'accompagnement des personnes séropositives. Avec 70 délégations sur le territoire, elle propose soutien psychologique, aide juridique et accompagnement social. Leurs permanences téléphoniques fonctionnent 7j/7 [2].
L'Association TRT-5 se spécialise dans l'information thérapeutique et la recherche. Elle publie régulièrement des bulletins d'information sur les nouveaux traitements et organise des formations pour les patients .
Le Collectif Interassociatif Sur la Santé (CISS) défend les droits des usagers du système de santé. Il propose des guides pratiques sur les droits des patients et l'accès aux soins [2].
Au niveau hospitalier, la plupart des CHU disposent d'équipes de liaison spécialisées. Ces professionnels coordonnent les soins, facilitent les démarches administratives et orientent vers les ressources locales appropriées.
Les groupes de parole permettent l'échange d'expériences entre patients. Ces rencontres, souvent organisées par les associations, créent du lien social et rompent l'isolement. Beaucoup de patients y trouvent un soutien précieux.
Ressources en ligne : le site VIHclic.fr propose une information médicale actualisée, accessible aux patients comme aux professionnels . Une mine d'informations fiables et régulièrement mises à jour.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos recommandations concrètes pour mieux vivre avec le risque d'infections opportunistes .
Organisez votre suivi médical : tenez un carnet de santé détaillé avec vos résultats biologiques, vos traitements et vos symptômes. Cette traçabilité facilite le travail des médecins et améliore votre prise en charge. Programmez vos rendez-vous à l'avance pour éviter les retards de suivi.
Côté alimentation, privilégiez les produits frais et bien cuits. Évitez les fromages au lait cru, les œufs peu cuits, les fruits de mer crus. Lavez soigneusement fruits et légumes, même ceux que vous épluchez . Ces précautions simples réduisent considérablement les risques.
Pour les voyages, consultez un médecin spécialisé 4 à 6 semaines avant le départ. Certaines destinations nécessitent une prophylaxie spécifique ou sont déconseillées selon votre état immunitaire . Ne partez jamais sans une trousse médicale adaptée.
Maintenez une activité physique régulière adaptée à vos capacités. Marche, natation, yoga renforcent votre immunité naturelle. Mais écoutez votre corps et n'hésitez pas à réduire l'intensité en cas de fatigue .
Enfin, ne négligez pas votre santé mentale. Stress et dépression affaiblissent l'immunité. N'hésitez pas à consulter un psychologue si nécessaire. Beaucoup de patients trouvent aussi du réconfort dans la méditation ou les techniques de relaxation .
Quand Consulter un Médecin ?
Certains symptômes nécessitent une consultation médicale urgente chez les personnes à risque d'infections opportunistes .
Consultez en urgence si vous présentez une fièvre supérieure à 38,5°C persistant plus de 48 heures, surtout si elle s'accompagne de frissons et de sueurs nocturnes. Ces signes peuvent révéler une infection débutante nécessitant un traitement rapide .
Les symptômes respiratoires imposent une consultation rapide : toux persistante depuis plus d'une semaine, essoufflement inhabituel, douleurs thoraciques. N'attendez pas que ces symptômes s'aggravent, car certaines pneumonies opportunistes évoluent rapidement .
Au niveau neurologique, maux de tête intenses, troubles visuels, confusion ou convulsions constituent des urgences absolues. Ces symptômes peuvent révéler une atteinte cérébrale grave nécessitant une hospitalisation immédiate .
Les troubles digestifs persistants - diarrhées depuis plus de 3 jours, douleurs abdominales intenses, vomissements répétés - justifient également une consultation. Ils peuvent masquer une infection parasitaire ou bactérienne .
Même sans symptômes alarmants, consultez votre médecin si vous ressentez une fatigue inhabituelle, une perte de poids inexpliquée ou des ganglions gonflés. Ces signes discrets peuvent révéler une immunodépression débutante .
En cas de doute, n'hésitez jamais à contacter votre équipe médicale. Il vaut mieux consulter pour rien que passer à côté d'une infection débutante.
Questions Fréquentes
Les infections opportunistes sont-elles contagieuses ?
Non, ces infections ne se transmettent pas entre personnes immunocompétentes. Elles nécessitent un terrain immunodéprimé pour se développer.
Peut-on guérir complètement d'une infection opportuniste ?
Oui, avec un traitement précoce et adapté, la guérison complète est obtenue dans 85 à 95% des cas.
Faut-il éviter tout contact social ?
Absolument pas. Il suffit d'adopter des mesures d'hygiène renforcées et quelques précautions simples.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Prise en charge des complications infectieuses associées au VIH - HAS 2024-2025Lien
- [2] Sida et VIH - INSERM 2024-2025Lien
- [3] Recommandations sanitaires aux voyageurs - Santé Publique France 2024-2025Lien
- [4] Innovation thérapeutique - Institut Pasteur Lille 2024-2025Lien
- [8] Lenacapavir - Données cliniques Gilead 2025Lien
Publications scientifiques
- Infections opportunistes émergentes au cours des vascularites (2023)
- [PDF][PDF] Proctologie infectieuse: infections sexuellement transmissibles, maladies d'importation et infections opportunistes [PDF]
- [PDF][PDF] Co-infection toxoplasmose cérébrale, miliaire tuberculeuse et VIH avec taux de CD4 à 446 (2022)1 citations[PDF]
- [PDF][PDF] Prévention, diagnostic et prise en charge des infections au cours des maladies inflammatoires de l'intestin: recommandations ECCO 2021 [PDF]
- La cryptosporidiose au cours de l'infection à VIH: étude rétrospective à propos de 179 cas (2022)
Ressources web
- Sida / VIH : symptômes, traitement, prévention (pasteur.fr)
Les maladies opportunistes comprennent notamment des infections d'origine bactérienne, fongique et parasitaire, ainsi que certains cancers. Quels sont les ...
- Infection opportuniste : symptômes, diagnostic et traitement (medicoverhospitals.in)
Les infections opportunistes sont causées par des agents pathogènes qui ne provoquent généralement pas de maladie chez les personnes en bonne santé, mais qui ...
- Principales affections opportunistes (vihclic.fr)
2 sept. 2019 — Les affections opportunistes les plus fréquentes sont : la pneumocystose pulmonaire, la tuberculose, les infections à cytomégalovirus (CMV), la ...
- Infections opportunistes liées au VIH, démarche ... (infectiologie.org.tn)
Traitement et évolution. Léthale en absence de traitement: 4-5 mois. Durée 12 mois guérison: 50-71%. Rifampicine. : 600 mg/j. Rifabutine. : 300 mg/j.
- Les principaux symptômes de l'infection par le VIH et ... (ameli.fr)
26 févr. 2025 — L'infection par le VIH évolue en trois phases. Après la primo-infection, la phase chronique n'entraîne aucun symptôme spécifique.
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
