Infections Cardiovasculaires : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
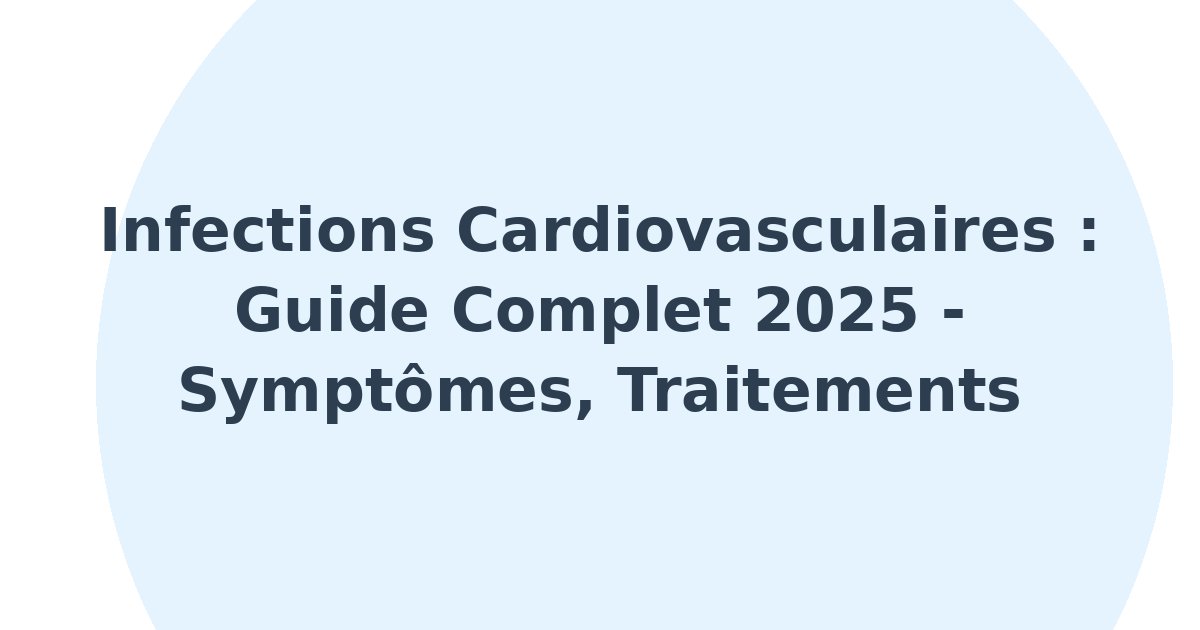
Les infections cardiovasculaires représentent un défi médical majeur qui touche directement le cœur et les vaisseaux sanguins. Ces pathologies infectieuses, bien que moins fréquentes que d'autres maladies cardiaques, peuvent avoir des conséquences graves si elles ne sont pas rapidement diagnostiquées et traitées. En France, elles concernent plusieurs milliers de personnes chaque année et nécessitent une prise en charge spécialisée.
Téléconsultation et Infections cardiovasculaires
Téléconsultation non recommandéeLes infections cardiovasculaires sont des pathologies graves nécessitant un diagnostic précis par examens complémentaires spécialisés (échocardiographie, hémocultures) et une prise en charge hospitalière urgente. L'examen clinique cardiaque et l'évaluation hémodynamique sont indispensables et ne peuvent être réalisés à distance.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil de l'historique des symptômes cardiaques (fièvre, essoufflement, palpitations). Évaluation des facteurs de risque cardiovasculaires et infectieux. Analyse des antécédents de cardiopathie ou d'intervention cardiaque. Orientation vers une prise en charge spécialisée urgente. Suivi post-hospitalisation après traitement initial.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Auscultation cardiaque pour détecter les souffles pathologiques. Échocardiographie transthoracique ou transœsophagienne obligatoire. Hémocultures et examens biologiques spécialisés. Évaluation hémodynamique et recherche de complications emboliques.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion d'endocardite infectieuse nécessitant une échocardiographie urgente. Présence de fièvre avec souffle cardiaque nouveau ou modifié. Patients porteurs de prothèses valvulaires ou de matériel cardiaque implanté. Signes d'insuffisance cardiaque aiguë ou de complications emboliques.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Fièvre élevée avec instabilité hémodynamique ou choc septique. Signes neurologiques évocateurs d'embolie cérébrale. Douleur thoracique intense avec dyspnée majeure suggérant une complication aiguë.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Fièvre élevée (>38,5°C) persistante avec frissons et altération de l'état général
- Essoufflement intense au repos ou œdème pulmonaire aigu
- Douleur thoracique brutale avec malaise ou perte de connaissance
- Signes neurologiques nouveaux (troubles de la parole, paralysie, confusion)
- Palpitations avec pouls irrégulier et signes d'instabilité hémodynamique
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Cardiologue — consultation en présentiel indispensable
Les infections cardiovasculaires nécessitent impérativement l'expertise d'un cardiologue et une prise en charge hospitalière spécialisée. L'échocardiographie et les examens complémentaires spécialisés sont indispensables au diagnostic et ne peuvent être différés.
Infections cardiovasculaires : Définition et Vue d'Ensemble
Les infections cardiovasculaires regroupent l'ensemble des pathologies infectieuses qui affectent le système cardiovasculaire. Elles touchent principalement le cœur, ses valves, et les vaisseaux sanguins [1,8]. Ces infections peuvent être causées par différents micro-organismes : bactéries, virus, champignons ou parasites.
L'endocardite infectieuse constitue la forme la plus connue et la plus grave de ces infections. Elle se caractérise par une inflammation de l'endocarde, la membrane qui tapisse l'intérieur du cœur et ses valves [8]. Mais d'autres formes existent également : péricardite infectieuse, myocardite infectieuse, ou encore infections des prothèses cardiovasculaires.
Ces pathologies peuvent survenir de manière aiguë ou chronique. Dans le premier cas, les symptômes apparaissent rapidement et l'état du patient se dégrade en quelques jours. Dans le second, l'évolution est plus insidieuse, s'étalant sur plusieurs semaines ou mois. Cette différence d'évolution influence directement le pronostic et la stratégie thérapeutique [8].
Il est important de comprendre que ces infections ne touchent pas uniquement les personnes ayant des antécédents cardiaques. En effet, même un cœur sain peut être infecté, notamment lors de certaines procédures médicales ou dentaires, ou suite à une infection à distance qui se propage par voie sanguine.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, l'incidence des infections cardiovasculaires varie selon le type d'infection considéré. L'endocardite infectieuse, forme la plus documentée, touche environ 3 à 4 personnes pour 100 000 habitants par an [1]. Cette incidence tend à augmenter légèrement depuis une décennie, notamment en raison du vieillissement de la population et de l'augmentation des procédures invasives.
Les données épidémiologiques récentes montrent des disparités importantes selon l'âge et le sexe. Les hommes sont plus fréquemment touchés que les femmes, avec un ratio de 2:1 . L'âge moyen au diagnostic a également évolué : il était de 45 ans dans les années 1990, contre 65 ans aujourd'hui [1].
Au niveau mondial, l'Organisation Mondiale de la Santé estime que les maladies cardiovasculaires, incluant les infections, représentent la première cause de mortalité [1]. Cependant, les infections cardiovasculaires spécifiquement restent relativement rares comparées aux autres pathologies cardiaques.
En Europe, la France se situe dans la moyenne des pays développés concernant l'incidence de ces infections. Les pays nordiques présentent des taux légèrement inférieurs, probablement liés à des différences dans les pratiques de prévention et de dépistage [1].
Les Causes et Facteurs de Risque
Les infections cardiovasculaires résultent de la colonisation du système cardiovasculaire par des micro-organismes pathogènes. Les bactéries représentent les agents causaux les plus fréquents, notamment les streptocoques et les staphylocoques [8]. Ces derniers peuvent atteindre le cœur par différentes voies : directement lors d'une intervention chirurgicale, ou indirectement par voie sanguine à partir d'un foyer infectieux distant.
Plusieurs facteurs augmentent significativement le risque de développer ces infections. Les cardiopathies préexistantes constituent le principal facteur de risque : valvulopathies, cardiopathies congénitales, prothèses valvulaires [8]. Les personnes porteuses de matériel cardiovasculaire implanté (pacemaker, défibrillateur, prothèses vasculaires) présentent également un risque accru.
D'autres facteurs de risque sont liés au mode de vie ou à l'état de santé général. L'usage de drogues intraveineuses multiplie par 10 le risque d'endocardite [8]. L'immunodépression, qu'elle soit liée à une maladie (VIH, cancer) ou à un traitement (chimiothérapie, corticoïdes), favorise également ces infections [6,7].
Les soins dentaires et certaines procédures médicales peuvent aussi être à l'origine d'infections cardiovasculaires. C'est pourquoi une antibioprophylaxie est recommandée chez les patients à haut risque avant certains actes [8]. Il faut noter que même des gestes apparemment anodins comme le brossage des dents peuvent, chez des personnes prédisposées, permettre le passage de bactéries dans la circulation sanguine.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes des infections cardiovasculaires peuvent être très variables selon le type d'infection et sa localisation. Dans l'endocardite aiguë, les signes apparaissent brutalement : fièvre élevée (souvent supérieure à 39°C), frissons intenses, fatigue extrême [8,9]. Ces symptômes généraux s'accompagnent souvent de signes cardiaques : palpitations, essoufflement, douleurs thoraciques.
L'endocardite subaiguë présente un tableau plus insidieux. La fièvre peut être modérée ou intermittente, la fatigue s'installe progressivement, et l'amaigrissement devient notable [8]. Des signes cutanés caractéristiques peuvent apparaître : taches de Roth au fond d'œil, nodules d'Osler aux extrémités des doigts, ou encore taches de Janeway sur les paumes et plantes.
Certains symptômes doivent particulièrement alerter. L'apparition d'un souffle cardiaque nouveau ou la modification d'un souffle préexistant constitue un signe d'alarme majeur [9]. De même, l'association fièvre et signes neurologiques (confusion, maux de tête, troubles visuels) peut témoigner d'une complication embolique cérébrale.
Il est important de savoir que ces infections peuvent parfois se manifester de façon atypique, notamment chez les personnes âgées ou immunodéprimées. Dans ces cas, la fièvre peut être absente et les symptômes se limiter à une fatigue inexpliquée ou une altération de l'état général [8,9].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des infections cardiovasculaires repose sur un faisceau d'arguments cliniques, biologiques et d'imagerie. La première étape consiste en un examen clinique approfondi, recherchant les signes évocateurs décrits précédemment [8]. L'interrogatoire explore les facteurs de risque, les antécédents médicaux et les circonstances de survenue des symptômes.
Les hémocultures constituent l'examen de référence pour identifier l'agent pathogène responsable. Elles doivent être réalisées avant toute antibiothérapie, idéalement au moment des pics fébriles [8]. Trois à six prélèvements sont généralement nécessaires, espacés de quelques heures. La positivité des hémocultures confirme la présence d'une bactériémie et permet d'adapter le traitement antibiotique.
L'échocardiographie joue un rôle central dans le diagnostic. L'échocardiographie transthoracique (ETT) est réalisée en première intention, mais l'échocardiographie transœsophagienne (ETO) est souvent nécessaire pour une meilleure visualisation des structures cardiaques [8]. Ces examens permettent de détecter les végétations, d'évaluer le retentissement sur la fonction cardiaque et de rechercher des complications.
D'autres examens complémentaires peuvent être utiles selon le contexte. Le scanner thoracique ou l'IRM cardiaque apportent des informations supplémentaires dans certains cas complexes. Les marqueurs biologiques de l'inflammation (CRP, procalcitonine) sont systématiquement dosés et permettent de suivre l'évolution sous traitement [8].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement des infections cardiovasculaires repose principalement sur l'antibiothérapie, qui doit être débutée en urgence dès que le diagnostic est suspecté [8]. Le choix de l'antibiotique dépend de l'agent pathogène identifié et de sa sensibilité aux différentes molécules. En attendant les résultats des hémocultures, un traitement probabiliste est instauré, couvrant les germes les plus fréquents.
La durée du traitement antibiotique est généralement longue, de 4 à 6 semaines selon le type d'infection et l'agent causal [8]. Cette durée prolongée s'explique par la difficulté de pénétration des antibiotiques dans les végétations et par la nécessité d'éradiquer complètement l'infection. Le traitement est initialement administré par voie intraveineuse, puis peut être relayé par voie orale dans certains cas.
Dans certaines situations, un traitement chirurgical devient nécessaire. Les indications chirurgicales incluent l'insuffisance cardiaque réfractaire au traitement médical, les infections sur prothèse, les végétations de grande taille avec risque embolique élevé, ou encore l'échec du traitement antibiotique [8]. L'intervention peut consister en un remplacement valvulaire, une réparation valvulaire, ou l'ablation de matériel infecté.
Le traitement symptomatique ne doit pas être négligé. Il comprend la prise en charge de l'insuffisance cardiaque si elle est présente, le contrôle de la douleur, et la prévention des complications thrombo-emboliques. Un suivi rapproché est indispensable pendant toute la durée du traitement [8].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les avancées récentes dans le domaine des infections cardiovasculaires ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques prometteuses. Les innovations 2024-2025 se concentrent particulièrement sur l'amélioration du diagnostic précoce et l'optimisation des traitements [2,3,4].
Une étude prospective randomisée récemment publiée compare trois approches thérapeutiques innovantes pour le traitement des infections cardiovasculaires [4]. Cette recherche met en évidence l'efficacité de nouvelles combinaisons antibiotiques qui permettent de réduire la durée de traitement tout en maintenant une efficacité optimale. Ces protocoles innovants pourraient révolutionner la prise en charge dans les années à venir.
Les développements en matière de diagnostic moléculaire représentent également une avancée majeure [2,3]. Les nouvelles techniques de PCR multiplex permettent une identification plus rapide et plus précise des agents pathogènes, réduisant le délai entre le diagnostic et l'instauration d'un traitement adapté. Cette rapidité diagnostique est cruciale pour améliorer le pronostic des patients.
La recherche s'intéresse aussi aux biomarqueurs prédictifs qui pourraient permettre d'identifier précocement les patients à risque de complications [2]. Ces marqueurs biologiques innovants ouvrent la voie à une médecine personnalisée dans le domaine des infections cardiovasculaires, permettant d'adapter le traitement au profil de risque individuel de chaque patient.
Vivre au Quotidien avec Infections cardiovasculaires
Vivre avec des infections cardiovasculaires nécessite des adaptations importantes dans la vie quotidienne, particulièrement pendant la phase aiguë de traitement. La fatigue constitue souvent le symptôme le plus handicapant, obligeant à réduire considérablement les activités habituelles. Il est essentiel d'accepter cette limitation temporaire et de ne pas forcer son organisme pendant la période de récupération.
L'observance du traitement antibiotique représente un défi majeur. La durée prolongée du traitement, souvent associée à des effets secondaires, peut décourager certains patients. Pourtant, l'arrêt prématuré du traitement expose à un risque de rechute ou de résistance bactérienne [8]. Il est donc crucial de maintenir le traitement jusqu'à son terme, même en cas d'amélioration des symptômes.
Les répercussions psychologiques ne doivent pas être sous-estimées. L'annonce du diagnostic peut générer une anxiété importante, d'autant que ces infections touchent un organe vital. Le soutien de l'entourage et parfois l'aide d'un psychologue peuvent s'avérer précieux pour traverser cette épreuve.
Certaines précautions doivent être prises à long terme, notamment chez les patients ayant des séquelles valvulaires. L'antibioprophylaxie avant certains soins dentaires ou procédures médicales devient alors indispensable [8]. Ces patients doivent également être vigilants face aux signes d'infection et consulter rapidement en cas de fièvre inexpliquée.
Les Complications Possibles
Les infections cardiovasculaires peuvent entraîner diverses complications, parfois graves, qui maladienent le pronostic. Les complications emboliques figurent parmi les plus redoutées : des fragments de végétations peuvent se détacher et migrer dans la circulation, provoquant des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus spléniques ou rénaux [8,9].
L'insuffisance cardiaque constitue une autre complication majeure, résultant de la destruction des valves cardiaques par l'infection. Cette insuffisance peut être aiguë et mettre en jeu le pronostic vital, nécessitant parfois une intervention chirurgicale en urgence [8]. Les troubles du rythme cardiaque peuvent également survenir, particulièrement lorsque l'infection s'étend au système de conduction du cœur.
Les complications infectieuses incluent la formation d'abcès intracardiaque, la rupture de cordages tendineux, ou encore la propagation de l'infection à d'autres organes [8]. Ces complications peuvent nécessiter des traitements spécifiques et prolonger considérablement la durée d'hospitalisation.
Certaines complications sont spécifiques aux infections sur matériel prothétique. Le décollement de prothèse, la formation de fistules, ou la persistance de l'infection malgré le traitement antibiotique peuvent imposer une réintervention chirurgicale [8]. Ces situations sont particulièrement complexes et nécessitent une prise en charge multidisciplinaire.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des infections cardiovasculaires s'est considérablement amélioré au cours des dernières décennies grâce aux progrès diagnostiques et thérapeutiques. Cependant, il reste variable selon plusieurs facteurs : l'âge du patient, l'agent pathogène en cause, la précocité du diagnostic et la présence de complications [1,8].
Dans l'endocardite infectieuse, la mortalité hospitalière varie de 15 à 25% selon les séries [8]. Cette mortalité est plus élevée chez les patients âgés, en cas d'infection à staphylocoque doré, ou lorsque des complications surviennent. À l'inverse, les endocardites à streptocoque chez des patients jeunes sans comorbidités ont un pronostic généralement favorable.
Le pronostic à long terme dépend largement des séquelles laissées par l'infection. Les patients sans séquelle valvulaire significative retrouvent une espérance de vie normale [8]. En revanche, ceux présentant une insuffisance valvulaire résiduelle nécessitent un suivi cardiologique régulier et peuvent développer une insuffisance cardiaque à distance.
Il est important de souligner que le pronostic s'améliore constamment. Les nouvelles approches thérapeutiques, l'amélioration des techniques chirurgicales et une meilleure prise en charge des complications contribuent à réduire la mortalité et à améliorer la qualité de vie des patients [2,3]. L'essentiel reste un diagnostic précoce et une prise en charge adaptée dans un centre spécialisé.
Peut-on Prévenir Infections cardiovasculaires ?
La prévention des infections cardiovasculaires repose sur plusieurs stratégies complémentaires. Chez les patients à haut risque, l'antibioprophylaxie avant certains actes médicaux ou dentaires constitue la mesure préventive principale [8]. Cette prophylaxie est recommandée chez les porteurs de prothèses valvulaires, les patients ayant des antécédents d'endocardite, ou ceux présentant certaines cardiopathies congénitales.
L'hygiène bucco-dentaire joue un rôle fondamental dans la prévention. Un brossage régulier des dents, l'utilisation de fil dentaire et des consultations dentaires régulières permettent de réduire la charge bactérienne orale [8]. Cette mesure simple mais efficace concerne tous les patients, qu'ils soient à risque ou non.
La vaccination représente un pilier sous-estimé de la prévention des maladies cardiovasculaires, y compris infectieuses [5]. Les vaccins contre la grippe, le pneumocoque, ou encore le COVID-19 peuvent prévenir des infections qui pourraient secondairement affecter le système cardiovasculaire. Cette approche préventive prend une importance croissante, particulièrement chez les patients fragiles.
Chez les utilisateurs de drogues intraveineuses, la réduction des risques passe par l'utilisation de matériel stérile et, idéalement, par un accompagnement vers le sevrage [8]. Les programmes d'échange de seringues et les traitements de substitution contribuent significativement à réduire l'incidence des infections cardiovasculaires dans cette population à risque.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités de santé françaises et internationales ont établi des recommandations précises concernant la prise en charge des infections cardiovasculaires. La Haute Autorité de Santé (HAS) insiste sur l'importance d'un diagnostic précoce et d'une prise en charge multidisciplinaire associant cardiologues, infectiologues et chirurgiens cardiaques [1].
Concernant l'antibioprophylaxie, les recommandations ont évolué vers une approche plus ciblée. Seuls les patients à très haut risque bénéficient désormais d'une prophylaxie systématique avant les soins dentaires [8]. Cette évolution vise à limiter l'émergence de résistances bactériennes tout en maintenant une protection efficace chez les patients les plus vulnérables.
Les recommandations européennes et américaines convergent sur la nécessité d'une prise en charge dans des centres de référence disposant d'une expertise spécifique [1,8]. Ces centres doivent pouvoir assurer une prise en charge 24h/24 et disposer d'un plateau technique complet incluant échocardiographie, microbiologie spécialisée et chirurgie cardiaque.
L'Organisation Mondiale de la Santé souligne l'importance de la prévention primaire dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires, incluant leur composante infectieuse [1]. Cette approche globale intègre la promotion de l'hygiène, la vaccination, et l'amélioration de l'accès aux soins dans les pays en développement où l'incidence de ces infections reste élevée.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations et ressources sont disponibles pour accompagner les patients atteints d'infections cardiovasculaires et leur entourage. La Fédération Française de Cardiologie propose des informations détaillées sur les différentes pathologies cardiaques, incluant les infections, ainsi que des conseils pratiques pour la vie quotidienne.
L'Association des Patients Porteurs de Valves Cardiaques et d'Assistance Circulatoire (APVAC) offre un soutien spécifique aux patients ayant des prothèses valvulaires, population particulièrement à risque d'infections cardiovasculaires. Cette association organise des rencontres, propose des forums d'échange et diffuse des informations actualisées sur les traitements.
Au niveau européen, la European Society of Cardiology met à disposition des patients des guides d'information traduits en français. Ces documents, validés scientifiquement, permettent aux patients de mieux comprendre leur pathologie et les traitements proposés.
Les centres hospitaliers universitaires disposent souvent de services d'éducation thérapeutique dédiés aux patients cardiaques. Ces programmes permettent d'acquérir les connaissances nécessaires pour mieux vivre avec sa maladie et prévenir les récidives. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre équipe soignante sur l'existence de tels programmes dans votre région.
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec des infections cardiovasculaires ou s'en prémunir nécessite l'adoption de bonnes habitudes au quotidien. Premier conseil essentiel : ne négligez jamais votre hygiène bucco-dentaire. Un brossage minutieux deux fois par jour, l'utilisation de fil dentaire et des visites régulières chez le dentiste constituent votre première ligne de défense.
Si vous êtes à risque, ayez toujours sur vous votre carte de patient cardiaque mentionnant la nécessité d'une antibioprophylaxie. Informez systématiquement tout professionnel de santé (médecin, dentiste, infirmier) de votre situation avant tout soin. Cette précaution simple peut vous éviter des complications graves.
Apprenez à reconnaître les signes d'alarme : fièvre persistante, fatigue inhabituelle, essoufflement nouveau ou aggravé. En cas de doute, n'hésitez pas à consulter rapidement. Il vaut mieux une consultation de trop qu'une infection non diagnostiquée. Gardez en mémoire que ces infections peuvent parfois se manifester de façon atypique.
Maintenez un mode de vie sain : alimentation équilibrée, activité physique adaptée à vos capacités, arrêt du tabac. Ces mesures générales renforcent vos défenses immunitaires et réduisent le risque de complications. Enfin, respectez scrupuleusement vos traitements et vos rendez-vous de suivi, même si vous vous sentez bien.
Quand Consulter un Médecin ?
Certaines situations nécessitent une consultation médicale urgente dans le contexte des infections cardiovasculaires. Toute fièvre supérieure à 38,5°C persistant plus de 48 heures, surtout si elle s'accompagne de frissons, doit vous amener à consulter rapidement [8,9]. Cette règle est particulièrement importante si vous présentez des facteurs de risque cardiovasculaire.
L'apparition de symptômes cardiaques nouveaux constitue également un motif de consultation urgente. Essoufflement inhabituel, douleurs thoraciques, palpitations ou sensation de malaise doivent vous alerter [9]. Ces symptômes peuvent témoigner d'une atteinte cardiaque débutante nécessitant une prise en charge immédiate.
Si vous êtes porteur d'une prothèse valvulaire ou d'un dispositif cardiaque implanté, la vigilance doit être maximale. Tout changement dans votre état habituel, même apparemment mineur, justifie un avis médical [8]. Les infections sur matériel prothétique peuvent évoluer rapidement et nécessitent un traitement précoce.
N'attendez pas non plus en cas de signes neurologiques : maux de tête intenses, troubles visuels, confusion, ou faiblesse d'un membre. Ces symptômes peuvent témoigner d'une complication embolique cérébrale nécessitant une prise en charge en urgence [8,9]. Dans tous ces cas, dirigez-vous vers les urgences ou contactez le SAMU (15).
Questions Fréquentes
Les infections cardiovasculaires sont-elles contagieuses ?
Non, ces infections ne se transmettent pas d'une personne à l'autre. Elles résultent de la colonisation du cœur par des bactéries présentes naturellement dans l'organisme ou introduites lors de certaines procédures.
Peut-on guérir complètement d'une infection cardiovasculaire ?
Oui, avec un traitement approprié et précoce, la guérison complète est possible dans la majorité des cas. Cependant, certains patients peuvent conserver des séquelles valvulaires nécessitant un suivi à long terme.
Faut-il prendre des antibiotiques avant tous les soins dentaires ?
Non, l'antibioprophylaxie n'est recommandée que chez les patients à très haut risque : porteurs de prothèses valvulaires, antécédents d'endocardite, ou certaines cardiopathies congénitales.
Peut-on faire du sport après une infection cardiovasculaire ?
La reprise d'activité physique est généralement possible après guérison complète, mais elle doit être progressive et encadrée médicalement. Un test d'effort peut être nécessaire pour évaluer vos capacités.
Les infections cardiovasculaires peuvent-elles récidiver ?
Les récidives sont possibles mais rares si le traitement initial a été complet et adapté. Le respect des mesures préventives réduit considérablement ce risque.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Maladies cardiovasculaires - Organisation Mondiale de la SantéLien
- [2] FDA Alert: Infectious Diseases Drug News Roundup - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] Volume 80 Issue 3 | Clinical Infectious Diseases - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] A prospective randomized study that compares three approaches - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [5] Mortalité maternelle de causes indirectes en France 2016–2018Lien
- [7] Les vaccins de l'adulte: un pilier sous-estimé de la prévention des maladies cardiovasculairesLien
- [10] Manifestations cardiovasculaires au cours de l'infection à VIH à LibrevilleLien
- [12] Dérégulation des lymphocytes B et développement prématuré des maladies cardiovasculaires chez les individus infectés au VIH-1Lien
- [13] Endocardite infectieuse - Troubles cardiaques et vasculaires - MSD ManualsLien
- [14] Présentation des symptômes des maladies cardiovasculaires - MSD ManualsLien
Publications scientifiques
- Mortalité maternelle de causes indirectes (hors AVC, maladies cardiovasculaires et infections) en France 2016–2018 (2024)3 citations
- Existe-t-il un risque cardiovasculaire à l'usage des fluoroquinolones pour le traitement des infections ostéoarticulaires? Analyse d'une cohorte rétrospective de 817 … (2025)
- Les vaccins de l'adulte: un pilier sous-estimé de la prévention des maladies cardiovasculaires. (2024)[PDF]
- Évaluation du risque d'événements thrombo-emboliques, d'événements cardiovasculaires graves et d'infection graves chez les patients atteints de polyarthrite … (2023)
- Morts maternelles de causes indirectes (hors AVC, maladies cardiovasculaires et infections) en France 2016–2018 (2024)
Ressources web
- Endocardite infectieuse - Troubles cardiaques et vasculaires (msdmanuals.com)
L'endocardite infectieuse aiguë se manifeste en général soudainement par une forte fièvre, une fréquence cardiaque rapide, une fatigue et des lésions rapides et ...
- Présentation des symptômes des maladies cardiovasculaires (msdmanuals.com)
Présentation des symptômes des maladies cardiovasculaires · Certains types de douleur (par exemple, douleur thoracique) · Essoufflement · Fatigue · Palpitations ( ...
- Maladies cardiovasculaires (who.int)
11 juin 2021 — La cardiopathie rhumatismale peut se manifester par différents symptômes : essoufflement, fatigue, arythmie cardiaque, douleur thoracique et ...
- Les pathologies cardiovasculaires - Je m'informe – FFC (fedecardio.org)
L'angor (l'angine de poitrine) est l'un des symptômes de la maladie coronarienne. En savoir · Insuffisance veineuse : les situations à risque. L'insuffisance ...
- Symptômes, diagnostic et évolution de l'insuffisance ... (ameli.fr)
En présence de symptômes évocateurs (fatigue, essoufflement, œdèmes...), un bilan est nécessaire. Il permet de poser le diagnostic d'insuffisance cardiaque, ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
