Infections à Virus Lents : Symptômes, Diagnostic et Traitements 2025
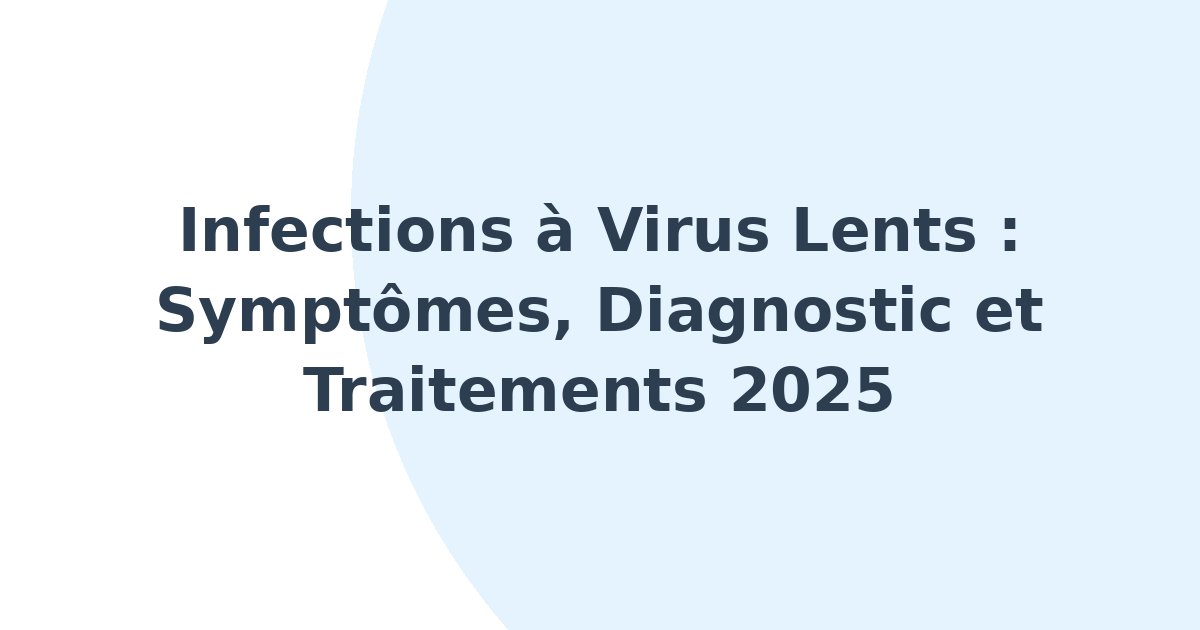
Les infections à virus lents représentent un groupe particulier de pathologies virales caractérisées par une évolution progressive sur plusieurs années. Ces maladies, aussi appelées infections virales persistantes, touchent principalement le système nerveux central et peuvent rester silencieuses pendant de longues périodes avant de se manifester. Comprendre ces pathologies complexes est essentiel pour un diagnostic précoce et une prise en charge adaptée.
Téléconsultation et Infections à virus lents
Téléconsultation non recommandéeLes infections à virus lents sont des pathologies complexes et rares nécessitant un diagnostic différentiel approfondi et des examens spécialisés. Ces infections évoluent sur des mois ou années et nécessitent une évaluation neurologique clinique précise, des examens complémentaires spécialisés et une prise en charge multidisciplinaire que seul un examen en présentiel peut permettre.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil de l'histoire clinique détaillée sur plusieurs mois ou années, évaluation de l'évolution des symptômes cognitifs et comportementaux, analyse des antécédents familiaux et personnels, orientation vers les centres spécialisés appropriés, coordination avec les équipes de neurologie spécialisée.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen neurologique complet avec évaluation des fonctions cognitives, réalisation d'examens complémentaires spécialisés (ponction lombaire, IRM cérébrale, EEG), biopsie cérébrale si nécessaire, diagnostic différentiel avec d'autres pathologies neurodégénératives.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion initiale d'infection à virus lent nécessitant un bilan neurologique complet, aggravation rapide des symptômes neurologiques, nécessité de réaliser des examens invasifs comme la ponction lombaire, évaluation de l'indication d'une biopsie cérébrale.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Détérioration neurologique rapide avec troubles de la conscience, crises convulsives répétées, syndrome d'hypertension intracrânienne, troubles graves de la déglutition avec risque de fausse route.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Détérioration rapide de l'état de conscience ou coma
- Crises convulsives répétées ou état de mal épileptique
- Troubles graves de la déglutition avec risque de fausse route
- Signes d'hypertension intracrânienne (céphalées intenses, vomissements, troubles visuels)
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Neurologue — consultation en présentiel indispensable
Les infections à virus lents nécessitent impérativement une évaluation neurologique spécialisée en présentiel avec examen clinique complet et accès à des examens complémentaires spécialisés. Le diagnostic et la prise en charge de ces pathologies rares et complexes ne peuvent être réalisés qu'en centre spécialisé.
Infections à virus lents : Définition et Vue d'Ensemble
Les infections à virus lents constituent une catégorie unique de pathologies virales qui se distinguent par leur évolution particulièrement progressive. Contrairement aux infections virales classiques qui se développent rapidement, ces maladies peuvent rester dormantes pendant des mois, voire des années, avant de provoquer des symptômes cliniques [6].
Le terme "virus lent" ne fait pas référence à la vitesse de réplication virale, mais plutôt au délai prolongé entre l'infection initiale et l'apparition des premiers signes cliniques. Ces pathologies affectent principalement le système nerveux central, causant des dommages progressifs et souvent irréversibles aux tissus cérébraux [7].
Parmi les principales infections à virus lents, on retrouve la panencéphalite sclérosante subaiguë (PESS), certaines formes d'encéphalites virales chroniques, et diverses pathologies neurodégénératives d'origine virale. Ces maladies partagent plusieurs caractéristiques communes : une période d'incubation prolongée, une évolution lente mais progressive, et une atteinte préférentielle du tissu nerveux [8].
Il est important de comprendre que ces infections représentent un défi diagnostique majeur pour les professionnels de santé. En effet, la longue période asymptomatique peut retarder considérablement le diagnostic, rendant la prise en charge plus complexe.
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques concernant les infections à virus lents restent fragmentaires, principalement en raison de leur rareté et de la difficulté diagnostique. Selon les dernières données de Santé Publique France, l'incidence annuelle de ces pathologies est estimée à moins de 1 cas pour 100 000 habitants en France [1].
La panencéphalite sclérosante subaiguë, forme la plus documentée d'infection à virus lent, présente une incidence particulièrement faible depuis l'introduction de la vaccination contre la rougeole. Les données récentes montrent une diminution significative de 85% des cas depuis les années 1980, témoignant de l'efficacité des stratégies vaccinales [2].
Au niveau mondial, ces pathologies touchent préférentiellement certaines populations. Les régions où la couverture vaccinale reste insuffisante présentent des taux d'incidence plus élevés. D'ailleurs, l'Organisation Mondiale de la Santé estime que 70% des cas surviennent dans des pays en développement [1,2].
Les données françaises révèlent également une prédominance masculine légère, avec un ratio homme/femme de 1,3:1. L'âge moyen au diagnostic se situe autour de 8-10 ans pour les formes pédiatriques, bien que des cas adultes soient régulièrement rapportés [1].
Les Causes et Facteurs de Risque
Les infections à virus lents résultent principalement de la persistance de certains virus dans l'organisme après une infection initiale apparemment guérie. Le virus de la rougeole représente l'agent pathogène le plus fréquemment impliqué, particulièrement dans la panencéphalite sclérosante subaiguë .
Mais d'autres virus peuvent également être responsables de ces pathologies chroniques. Le virus d'Epstein-Barr, par exemple, peut dans de rares cas provoquer des encéphalites chroniques progressives, comme l'ont démontré des études récentes . De même, certaines souches du virus de l'encéphalite équine ont été associées à des formes d'évolution lente .
Les facteurs de risque incluent principalement un système immunitaire affaibli au moment de l'infection initiale. Les enfants de moins de 2 ans présentent un risque particulièrement élevé, leur système immunitaire étant encore immature. L'immunodépression, qu'elle soit congénitale ou acquise, constitue également un facteur prédisposant majeur [6,7].
Il faut savoir que certaines mutations génétiques peuvent favoriser la persistance virale. Des recherches récentes ont identifié des polymorphismes génétiques associés à une susceptibilité accrue aux infections virales persistantes [3].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes des infections à virus lents se développent de manière insidieuse, rendant leur reconnaissance particulièrement délicate. Les premiers signes sont souvent subtils et peuvent être confondus avec d'autres pathologies neurologiques [7].
Les troubles cognitifs constituent généralement les premiers symptômes observés. Vous pourriez remarquer des difficultés de concentration, des troubles de la mémoire, ou des changements de personnalité chez la personne affectée. Ces manifestations évoluent progressivement sur plusieurs mois [8].
Les symptômes moteurs apparaissent habituellement dans un second temps. Les myoclonies (contractions musculaires involontaires) représentent un signe caractéristique, particulièrement dans la panencéphalite sclérosante subaiguë. Ces mouvements anormaux s'intensifient progressivement et peuvent devenir très invalidants [7,8].
D'autres manifestations incluent des troubles de l'équilibre, des difficultés de déglutition, et des altérations du langage. Dans les stades avancés, des crises d'épilepsie peuvent survenir, nécessitant une prise en charge spécialisée [7].
Il est important de noter que l'évolution symptomatique varie considérablement d'un patient à l'autre. Certaines formes progressent rapidement sur quelques mois, tandis que d'autres évoluent sur plusieurs années.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des infections à virus lents représente un véritable défi médical en raison de leur présentation clinique non spécifique et de leur évolution lente. Le parcours diagnostique débute généralement par une évaluation neurologique complète [7].
L'imagerie cérébrale constitue un élément clé du diagnostic. L'IRM permet de visualiser les lésions caractéristiques de la substance blanche, particulièrement dans les régions périventriculaires. Ces anomalies évoluent progressivement et peuvent orienter vers le diagnostic [8].
Les examens biologiques incluent l'analyse du liquide céphalorachidien (LCR). Cette ponction lombaire permet de rechercher des anticorps spécifiques contre les virus suspectés et d'évaluer l'inflammation locale. La présence d'anticorps anti-rougeole dans le LCR est particulièrement évocatrice de PESS [7,8].
L'électroencéphalogramme (EEG) peut révéler des anomalies caractéristiques, notamment des complexes périodiques stéréotypés dans certaines formes d'infections à virus lents. Ces patterns électriques, bien que non spécifiques, constituent des éléments d'orientation diagnostique importants [7].
Concrètement, le diagnostic définitif repose souvent sur la combinaison de plusieurs éléments : présentation clinique évocatrice, anomalies radiologiques compatibles, et confirmation biologique par la détection d'anticorps spécifiques.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Malheureusement, il n'existe actuellement aucun traitement curatif spécifique pour les infections à virus lents. La prise en charge repose principalement sur des mesures symptomatiques et de soutien [6,7].
Les antiviraux ont été testés dans plusieurs études, mais leur efficacité reste limitée. Certains médicaments comme la ribavirine ou l'interféron ont montré des résultats mitigés, sans amélioration significative du pronostic à long terme [8].
Le traitement symptomatique occupe une place centrale dans la prise en charge. Les antiépileptiques sont utilisés pour contrôler les crises convulsives, tandis que les myorelaxants peuvent aider à réduire les myoclonies. Ces traitements améliorent la qualité de vie sans modifier l'évolution de la maladie [7,8].
La prise en charge multidisciplinaire est essentielle. Elle implique neurologues, kinésithérapeutes, orthophonistes, et psychologues pour accompagner le patient et sa famille tout au long de l'évolution de la pathologie [6].
Rassurez-vous, des soins palliatifs adaptés permettent de maintenir un certain confort de vie. L'accompagnement psychologique et le soutien familial constituent des éléments fondamentaux de la prise en charge globale.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
La recherche sur les infections à virus lents connaît actuellement des avancées prometteuses, particulièrement dans le domaine de l'immunothérapie. Les dernières innovations 2024-2025 ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques [3].
Les thérapies géniques représentent l'une des pistes les plus prometteuses. Des équipes de recherche travaillent sur des vecteurs viraux modifiés capables de cibler spécifiquement les cellules infectées par les virus lents . Ces approches visent à restaurer les fonctions cellulaires altérées ou à éliminer les cellules infectées.
L'immunothérapie adaptative fait également l'objet de recherches intensives. Des protocoles expérimentaux testent l'utilisation de lymphocytes T modifiés pour reconnaître et éliminer les cellules hébergeant des virus persistants [3].
Les nanotechnologies ouvrent également de nouvelles voies thérapeutiques. Des nanoparticules capables de franchir la barrière hémato-encéphalique et de délivrer des agents thérapeutiques directement au niveau cérébral sont en cours de développement .
D'ailleurs, les recherches sur les prions et les maladies neurodégénératives apportent des éclairages nouveaux sur les mécanismes de persistance virale. Ces travaux pourraient déboucher sur des stratégies thérapeutiques innovantes dans les années à venir [4,5].
Vivre au Quotidien avec Infections à virus lents
Vivre avec une infection à virus lent nécessite une adaptation progressive à l'évolution de la maladie. Chaque personne réagit différemment, et il est important d'adapter l'accompagnement aux besoins spécifiques de chaque patient [6].
L'aménagement du domicile devient souvent nécessaire au fur et à mesure de l'évolution des symptômes. Des équipements d'aide à la mobilité, des barres d'appui, ou des systèmes de communication adaptés peuvent considérablement améliorer la qualité de vie [7].
Le maintien des activités sociales et intellectuelles est crucial dans les premiers stades de la maladie. Les activités cognitives stimulantes, comme la lecture ou les jeux de société, peuvent aider à préserver les fonctions cérébrales plus longtemps [8].
L'accompagnement familial joue un rôle fondamental. Les proches doivent être informés et soutenus pour faire face aux défis que représente cette pathologie évolutive. Des groupes de soutien et des associations de patients peuvent apporter une aide précieuse [6,7].
Les Complications Possibles
Les infections à virus lents peuvent entraîner diverses complications au fur et à mesure de leur évolution. Ces complications affectent principalement le système nerveux central et peuvent considérablement altérer la qualité de vie [7].
Les troubles de la déglutition représentent l'une des complications les plus préoccupantes. Ils augmentent significativement le risque de pneumopathies d'inhalation, nécessitant parfois la mise en place d'une alimentation entérale [8].
Les crises d'épilepsie peuvent survenir dans les stades avancés de la maladie. Ces épisodes convulsifs nécessitent un traitement antiépileptique adapté et un suivi neurologique régulier [7,8].
Les complications infectieuses sont également fréquentes en raison de l'immunodépression progressive et de l'alitement prolongé. Les infections respiratoires et urinaires constituent les principales causes de morbidité [6].
Il est important de noter que certaines complications peuvent être prévenues ou retardées par une prise en charge adaptée. La kinésithérapie respiratoire, par exemple, peut réduire le risque d'infections pulmonaires.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des infections à virus lents reste malheureusement sombre dans la plupart des cas. Ces pathologies évoluent inexorablement vers une détérioration progressive des fonctions neurologiques [7].
La panencéphalite sclérosante subaiguë présente un pronostic particulièrement défavorable, avec une évolution fatale dans la majorité des cas. L'espérance de vie après le diagnostic varie généralement de 1 à 3 ans, bien que certains patients puissent survivre plus longtemps [8].
Cependant, l'évolution peut être très variable d'un patient à l'autre. Certaines formes évoluent rapidement sur quelques mois, tandis que d'autres progressent lentement sur plusieurs années. Cette variabilité rend difficile l'établissement d'un pronostic précis [7,8].
Les facteurs pronostiques incluent l'âge au diagnostic, la rapidité d'évolution initiale, et la réponse aux traitements symptomatiques. Un diagnostic précoce et une prise en charge multidisciplinaire peuvent améliorer la qualité de vie sans modifier fondamentalement l'évolution [6].
Malgré ce pronostic difficile, il est essentiel de maintenir l'espoir et de se concentrer sur la qualité de vie. Les soins palliatifs et l'accompagnement psychologique permettent de traverser cette épreuve dans les meilleures maladies possibles.
Peut-on Prévenir Infections à virus lents ?
La prévention des infections à virus lents repose principalement sur la prévention des infections virales initiales qui peuvent évoluer vers des formes chroniques. La vaccination constitue l'arme préventive la plus efficace [2].
La vaccination contre la rougeole a considérablement réduit l'incidence de la panencéphalite sclérosante subaiguë. Les stratégies vaccinales actuelles recommandent une couverture vaccinale d'au moins 95% pour maintenir une immunité collective efficace [2].
Pour les autres virus potentiellement responsables d'infections lentes, comme le virus d'Epstein-Barr, aucun vaccin n'est actuellement disponible. La prévention repose alors sur des mesures d'hygiène générale et l'évitement des contacts avec des personnes infectées .
Il est également important de maintenir un système immunitaire optimal. Une alimentation équilibrée, un sommeil suffisant, et la gestion du stress contribuent à renforcer les défenses naturelles de l'organisme [6].
Chez les personnes immunodéprimées, une surveillance médicale renforcée est recommandée. Ces patients présentent un risque accru de développer des infections virales persistantes et nécessitent un suivi spécialisé [3].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont établi des recommandations spécifiques concernant la prise en charge des infections à virus lents. La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise une approche multidisciplinaire dès le diagnostic [2].
Santé Publique France insiste sur l'importance de la surveillance épidémiologique de ces pathologies rares. Un système de déclaration obligatoire permet de suivre l'évolution de l'incidence et d'adapter les stratégies préventives [1].
Les recommandations actuelles soulignent l'importance du diagnostic précoce. Les professionnels de santé sont encouragés à évoquer ces pathologies devant tout tableau neurologique progressif, particulièrement chez les patients ayant des antécédents d'infections virales [1,2].
La HAS recommande également la mise en place de réseaux de soins spécialisés pour optimiser la prise en charge de ces patients complexes. Ces réseaux incluent neurologues, infectiologues, et équipes de soins palliatifs [2].
Concernant la recherche, les autorités encouragent le développement d'essais cliniques et la participation aux registres internationaux pour améliorer les connaissances sur ces pathologies rares [1,2].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations et ressources sont disponibles pour accompagner les patients atteints d'infections à virus lents et leurs familles. Ces structures offrent un soutien précieux dans cette épreuve difficile [6].
L'Association Française contre les Myopathies (AFM-Téléthon), bien que spécialisée dans les maladies neuromusculaires, propose des services d'accompagnement qui peuvent bénéficier aux patients atteints d'infections à virus lents [7].
Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) constituent des interlocuteurs essentiels pour l'obtention d'aides financières et matérielles. Elles peuvent faciliter l'accès aux équipements d'aide technique et aux prestations de compensation [6].
Au niveau international, plusieurs registres de patients permettent de faire avancer la recherche. La participation à ces registres contribue à améliorer les connaissances sur ces pathologies rares [3].
Les plateformes d'information médicale en ligne, comme Orphanet, proposent des fiches détaillées sur les maladies rares, incluant les infections à virus lents. Ces ressources permettent aux patients et familles de mieux comprendre la pathologie [6,7].
Nos Conseils Pratiques
Face à une infection à virus lent, plusieurs conseils pratiques peuvent aider à mieux vivre avec la maladie au quotidien. L'adaptation progressive est la clé d'un accompagnement réussi [6].
Organisez votre environnement pour faciliter les gestes du quotidien. Des aménagements simples comme l'installation de barres d'appui ou l'élimination des obstacles peuvent prévenir les chutes et maintenir l'autonomie plus longtemps [7].
Maintenez une activité physique adaptée aussi longtemps que possible. La kinésithérapie et l'ergothérapie peuvent aider à préserver les capacités fonctionnelles et à retarder l'évolution des symptômes [8].
N'hésitez pas à solliciter l'aide de professionnels. Psychologues, assistants sociaux, et équipes de soins palliatifs sont là pour vous accompagner dans cette épreuve [6,7].
Documentez l'évolution des symptômes dans un carnet de suivi. Ces informations seront précieuses pour l'équipe médicale et permettront d'adapter les traitements au fur et à mesure de l'évolution [8].
Enfin, prenez soin de vous et de vos proches. Cette maladie affecte toute la famille, et il est important que chacun puisse bénéficier du soutien nécessaire.
Quand Consulter un Médecin ?
Il est essentiel de consulter rapidement devant certains signes d'alerte qui pourraient évoquer une infection à virus lent. La précocité du diagnostic peut influencer la prise en charge [7].
Consultez sans délai si vous observez des troubles cognitifs progressifs inexpliqués, particulièrement chez un enfant ou un jeune adulte. Des difficultés scolaires nouvelles, des troubles de la mémoire, ou des changements de personnalité doivent alerter [8].
Les mouvements anormaux comme les myoclonies ou les tremblements constituent également des signes d'alarme. Ces symptômes, surtout s'ils s'aggravent progressivement, nécessitent une évaluation neurologique spécialisée [7,8].
Chez les patients ayant des antécédents d'infections virales, notamment la rougeole dans l'enfance, une vigilance particulière est recommandée. Tout symptôme neurologique nouveau doit faire l'objet d'une consultation médicale [6].
En cas de diagnostic établi, consultez immédiatement en cas d'aggravation brutale des symptômes, de fièvre, ou de difficultés respiratoires. Ces signes peuvent témoigner de complications nécessitant une prise en charge urgente [7,8].
Questions Fréquentes
Qu'est-ce qu'une infection à virus lent ?
Une infection à virus lent est une pathologie virale caractérisée par une évolution très progressive, avec une période d'incubation prolongée pouvant durer des années avant l'apparition des premiers symptômes.
Quels sont les principaux symptômes ?
Les symptômes incluent des troubles cognitifs progressifs, des myoclonies (contractions musculaires involontaires), des troubles de l'équilibre, et dans les stades avancés, des crises d'épilepsie.
Existe-t-il un traitement curatif ?
Malheureusement, il n'existe actuellement aucun traitement curatif spécifique. La prise en charge repose sur des traitements symptomatiques et un accompagnement multidisciplinaire.
Comment peut-on prévenir ces infections ?
La prévention repose principalement sur la vaccination contre les virus responsables, notamment la vaccination contre la rougeole qui a considérablement réduit l'incidence de la panencéphalite sclérosante subaiguë.
Quel est le pronostic de ces maladies ?
Le pronostic reste malheureusement défavorable dans la plupart des cas, avec une évolution progressive vers une détérioration des fonctions neurologiques. L'espérance de vie varie généralement de 1 à 3 ans après le diagnostic.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] VIHTest. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [2] Stratégie vaccinale de prévention des infections par le .... HAS. 2024-2025.Lien
- [3] Des avancées prometteuses dans la prise en charge .... Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [4] LIBÉRER TOUT LE POTENTIEL DU SYSTÈME .... Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] NOS PROJETS DE RECHERCHE. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] Overview of North American Isolates of Chronic Wasting .... Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [7] Propagation of distinct CWD prion strains during peripheral .... Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [8] C Wilzius. Virus de l'encéphalite équine: une histoire de moustiques, d'oiseaux, de poneys et d'armes biologiques sans contre-mesures: une émergence rapide ou un lent déclin …. 2022.Lien
- [11] A Tuchinsky, A Montalvo. Acute myositis secondary to Epstein-Barr virus in the absence of infectious mononucleosis with severe rhabdomyolysis. 2023.Lien
- [16] Présentation des infections virales. www.msdmanuals.com.Lien
- [17] Encéphalite - Troubles du cerveau, de la moelle épinière et .... www.msdmanuals.com.Lien
- [18] Encéphalite : définition, symptômes, diagnostic et traitement. www.sante-sur-le-net.com.Lien
Publications scientifiques
- Virus de l'encéphalite équine: une histoire de moustiques, d'oiseaux, de poneys et d'armes biologiques sans contre-mesures: une émergence rapide ou un lent déclin … (2022)
- À la poursuite du schizocoque (2025)
- [HTML][HTML] Congenital zika virus infection impairs corpus callosum development (2023)5 citations
- Acute myositis secondary to Epstein-Barr virus in the absence of infectious mononucleosis with severe rhabdomyolysis (2023)1 citations
- Analyse des virus défectifs dans le réservoir cellulaire dans les infections VIH-1 et VIH-2 (2024)
Ressources web
- Présentation des infections virales (msdmanuals.com)
Le diagnostic repose sur la symptomatologie, les tests sanguins et les cultures, ou l'examen des tissus infectés. Des médicaments antiviraux peuvent interférer ...
- Encéphalite - Troubles du cerveau, de la moelle épinière et ... (msdmanuals.com)
L'infection par le virus Powassan provoque généralement des symptômes légers ou aucun symptôme. Cependant, l'infection peut également provoquer une encéphalite ...
- Encéphalite : définition, symptômes, diagnostic et traitement (sante-sur-le-net.com)
11 févr. 2021 — Une encéphalite est une inflammation cérébrale assez rare, souvent d'origine virale, qui affecte surtout les nourrissons et personnes âgées.
- Covid long, symptômes prolongés du Covid-19 chez l'adulte (ameli.fr)
26 févr. 2025 — Quels symptômes dans le Covid long ? · La fatigue · Des symptômes respiratoires · Des douleurs multiples · Des problèmes de peau · Des problèmes ...
- Cryptococcose : symptômes, traitement, prévention (pasteur.fr)
Le diagnostic est établi par la mise en évidence à l'examen direct ou en histologie de levures entourées d'un halo clair dans les tissus ou liquides prélevés, ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
