Infections à Mycobacterium : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
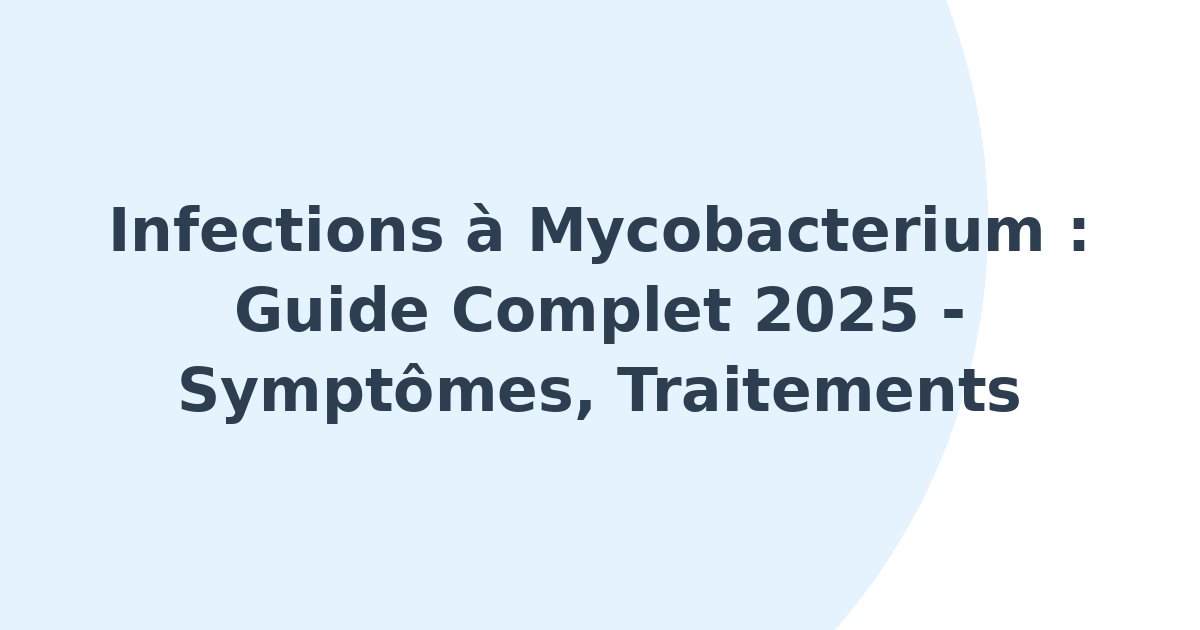
Les infections à Mycobacterium regroupent plusieurs pathologies causées par des bactéries particulières, dont la plus connue est la tuberculose. En France, ces infections touchent environ 5 000 nouvelles personnes chaque année selon Santé Publique France [1,2]. Mais il existe aussi d'autres mycobactéries, appelées atypiques, qui peuvent provoquer des infections pulmonaires ou cutanées. Comprendre ces maladies, c'est mieux les reconnaître et les traiter efficacement.
Téléconsultation et Infections à Mycobacterium
Téléconsultation non recommandéeLes infections à Mycobacterium nécessitent généralement des examens microbiologiques spécialisés et une expertise infectiologique pour le diagnostic et la prise en charge. La complexité de ces infections, leur potentiel de gravité et la nécessité de prélèvements spécifiques rendent la téléconsultation insuffisante pour une évaluation initiale complète.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil de l'historique des symptômes respiratoires ou cutanés et de leur évolution. Évaluation des facteurs de risque d'exposition (voyage, immunosuppression, contact avec cas). Analyse des antécédents de tuberculose ou d'infections mycobactériennes. Orientation vers les examens nécessaires et les spécialistes appropriés. Suivi de l'observance thérapeutique une fois le traitement initié.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen clinique complet incluant auscultation pulmonaire et palpation ganglionnaire. Réalisation ou prescription d'examens microbiologiques spécialisés (crachats, biopsies, hémocultures). Interprétation des résultats d'imagerie thoracique ou autres. Prescription et surveillance des traitements antituberculeux complexes.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion initiale d'infection mycobacterienne nécessitant un examen clinique complet et des prélèvements. Prescription de traitements antituberculeux nécessitant une évaluation hépatique préalable. Évaluation de complications pulmonaires ou extrapulmonaires. Recherche de contacts et enquête épidémiologique.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Détresse respiratoire aiguë ou hémoptysie massive chez un patient suspect d'infection mycobacterienne. Signes de méningite tuberculeuse avec troubles neurologiques. Altération majeure de l'état général avec suspicion de tuberculose miliaire.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Détresse respiratoire avec essoufflement au repos ou cyanose
- Hémoptysie importante ou crachats de sang répétés
- Fièvre élevée persistante avec altération majeure de l'état général
- Troubles neurologiques évoquant une méningite tuberculeuse (maux de tête intenses, confusion, raideur de nuque)
- Douleurs thoraciques intenses évoquant un pneumothorax
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Infectiologue ou pneumologue — consultation en présentiel indispensable
Les infections à Mycobacterium nécessitent une expertise spécialisée en infectiologie ou pneumologie pour le diagnostic, la prescription d'examens spécifiques et la mise en place de traitements complexes. Une consultation en présentiel est indispensable pour l'examen clinique et la réalisation des prélèvements diagnostiques.
Infections à Mycobacterium : Définition et Vue d'Ensemble
Les mycobactéries sont des bactéries très particulières. Elles possèdent une paroi cellulaire épaisse qui les rend résistantes à de nombreux antibiotiques classiques [3]. Cette caractéristique explique pourquoi les traitements sont souvent longs et complexes.
On distingue principalement deux groupes. D'abord, le Mycobacterium tuberculosis, responsable de la tuberculose classique. Ensuite, les mycobactéries atypiques ou non tuberculeuses, comme Mycobacterium avium ou Mycobacterium marinum [7,8]. Ces dernières sont de plus en plus fréquentes, notamment chez les personnes immunodéprimées.
Contrairement aux idées reçues, ces infections ne touchent pas que les poumons. Elles peuvent affecter la peau, les ganglions, les os, ou même plusieurs organes à la fois [8]. L'important à retenir : chaque type de mycobactérie a ses spécificités en termes de transmission, de symptômes et de traitement.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, la situation épidémiologique des infections à mycobactérium évolue constamment. Selon les dernières données de Santé Publique France, l'incidence de la tuberculose s'établit à 7,1 cas pour 100 000 habitants en 2023 [1,2]. Cette tendance marque une stabilisation après plusieurs années de baisse progressive.
L'Île-de-France concentre près de 30% des cas nationaux, avec une incidence de 12,8 pour 100 000 habitants [2]. Cette concentration s'explique par la densité urbaine et la présence de populations à risque. D'ailleurs, 65% des nouveaux cas concernent des personnes nées à l'étranger, principalement en Afrique subsaharienne et en Asie [1,4].
Mais les mycobactéries atypiques gagnent du terrain. Les infections à Mycobacterium avium complex représentent désormais 60% des infections mycobactériennes non tuberculeuses [8]. Cette évolution préoccupe les spécialistes car ces bactéries sont naturellement plus résistantes aux traitements.
Au niveau mondial, l'Organisation mondiale de la santé estime que 10,6 millions de personnes développent une tuberculose chaque année . La France reste un pays à faible incidence, mais la vigilance reste de mise face aux souches résistantes qui émergent [6].
Les Causes et Facteurs de Risque
La transmission des mycobactéries tuberculeuses se fait principalement par voie aérienne. Quand une personne infectée tousse ou éternue, elle projette des gouttelettes contenant les bactéries [3,9]. Mais attention : toute exposition ne mène pas forcément à une infection active.
Plusieurs facteurs augmentent le risque d'infection. L'immunodépression arrive en tête : VIH, traitements immunosuppresseurs, diabète mal contrôlé [4,9]. L'âge joue aussi un rôle, avec un risque accru chez les personnes de plus de 65 ans et les jeunes enfants.
Pour les mycobactéries atypiques, c'est différent. Mycobacterium marinum se transmet par contact avec l'eau contaminée, d'où son surnom de "tuberculose des piscines" [7]. Mycobacterium avium se trouve dans l'environnement : sol, eau, poussière [8].
Certaines professions exposent davantage : personnel de santé, travailleurs en contact avec des animaux, plongeurs [7]. Les voyages en zone d'endémie constituent également un facteur de risque non négligeable [4].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes varient énormément selon le type de mycobactérie et l'organe touché. Pour la tuberculose pulmonaire, la triade classique associe toux persistante, fièvre et amaigrissement [3,9]. Cette toux, souvent productive, peut s'accompagner de crachats sanglants dans les formes évoluées.
Mais d'autres signes doivent alerter. Les sueurs nocturnes profuses, la fatigue intense qui ne passe pas avec le repos, l'essoufflement à l'effort [3]. Certains patients décrivent aussi des douleurs thoraciques, surtout lors de la respiration profonde.
Les infections cutanées à mycobactéries atypiques se manifestent différemment. Mycobacterium marinum provoque des nodules violacés sur les mains et avant-bras [7]. Ces lésions évoluent lentement, parfois sur plusieurs mois, et peuvent s'ulcérer.
L'important : ces symptômes sont souvent insidieux. Ils s'installent progressivement, sur plusieurs semaines ou mois. C'est pourquoi beaucoup de patients consultent tardivement, pensant à une simple bronchite qui traîne [3,9].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des infections à mycobactérium nécessite plusieurs examens complémentaires. Tout commence par un interrogatoire minutieux et un examen clinique [3]. Votre médecin recherchera les facteurs de risque et évaluera vos symptômes.
La radiographie pulmonaire constitue souvent le premier examen. Elle peut révéler des opacités, des cavités ou des ganglions élargis [3,9]. Mais attention : 15% des tuberculoses pulmonaires ont une radiographie normale au début !
L'examen des crachats reste l'étape clé. Trois échantillons sont généralement nécessaires, prélevés à jeun trois matins consécutifs [3]. La recherche se fait par microscopie directe, puis par culture sur milieux spéciaux. Cette culture prend 2 à 8 semaines, d'où l'importance de la patience.
Les tests moléculaires modernes, comme la PCR, accélèrent le diagnostic [9]. Ils détectent l'ADN des mycobactéries en quelques heures. Concrètement, ces techniques permettent aussi d'identifier les résistances aux antibiotiques, information cruciale pour adapter le traitement [6].
Pour les formes extra-pulmonaires, d'autres prélèvements sont nécessaires : biopsie ganglionnaire, ponction pleurale, prélèvement cutané [7,8]. Chaque situation nécessite une approche adaptée.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement des infections à mycobactérium repose sur une antibiothérapie prolongée. Pour la tuberculose, le schéma standard associe quatre antibiotiques pendant deux mois, puis deux antibiotiques pendant quatre mois [4,9]. Cette durée peut paraître longue, mais elle est indispensable pour éviter les rechutes.
Les médicaments de première ligne incluent l'isoniazide, la rifampicine, l'éthambutol et le pyrazinamide [9]. Chacun agit différemment sur la bactérie, d'où l'intérêt de les associer. Cette combinaison permet aussi de prévenir l'émergence de résistances.
Mais que faire en cas de résistance ? Les tuberculoses multirésistantes nécessitent des traitements de deuxième ligne, plus longs et plus toxiques [6]. Heureusement, de nouveaux médicaments comme la bédaquiline et le délamanide offrent de nouvelles perspectives [5].
Pour les mycobactéries atypiques, c'est plus complexe. Mycobacterium avium nécessite souvent une trithérapie associant clarithromycine, éthambutol et rifabutine [8]. Le traitement dure généralement 12 à 18 mois après négativation des cultures.
L'observance reste cruciale. Interrompre prématurément le traitement expose au risque de rechute et de résistance [4,9]. C'est pourquoi un suivi médical régulier est indispensable.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
La recherche sur les mycobactéries connaît une accélération remarquable en 2024-2025. Les mycobactériophages, ces virus qui s'attaquent spécifiquement aux mycobactéries, font l'objet d'essais prometteurs . Une étude récente montre leur efficacité en inhalation chez la souris, ouvrant la voie à de nouveaux traitements adjuvants.
L'immunothérapie représente une autre piste d'avenir. Les chercheurs développent des vaccins multi-épitopes ciblant à la fois Mycobacterium tuberculosis et le SARS-CoV-2 . Cette approche innovante pourrait révolutionner la prévention, surtout dans le contexte post-COVID.
Côté diagnostic, les biomarqueurs inflammatoires gagnent en précision. L'analyse des profils de cytokines permet désormais de distinguer une infection récente d'une infection ancienne . Concrètement, cela aide les médecins à adapter leur prise en charge.
Malheureusement, les résistances évoluent aussi. Une étude suisse de 2025 révèle que les souches résistantes aux nouveaux médicaments se transmettent déjà de patient à patient [6]. Cette découverte souligne l'urgence de développer de nouvelles molécules.
Les essais cliniques se multiplient. L'université de Californie teste actuellement un traitement raccourci pour Mycobacterium avium complex . Si les résultats sont concluants, cela pourrait réduire la durée de traitement de 18 à 9 mois.
Vivre au Quotidien avec Infections à Mycobacterium
Recevoir un diagnostic d'infection à mycobactérium bouleverse souvent le quotidien. La première préoccupation concerne la contagiosité. Rassurez-vous : après 2-3 semaines de traitement bien conduit, vous n'êtes plus contagieux [4,9]. Vous pouvez reprendre une vie sociale normale.
L'organisation du traitement demande de la rigueur. Prendre ses médicaments à heure fixe, de préférence le matin à jeun, facilite l'observance [9]. Certains patients utilisent des piluliers ou des applications mobiles pour ne pas oublier.
Les effets secondaires peuvent perturber le quotidien. Nausées, fatigue, troubles visuels avec l'éthambutol [9]. N'hésitez pas à en parler à votre médecin : des solutions existent souvent. Par exemple, prendre les médicaments avec un peu de nourriture peut réduire les nausées.
L'activité physique reste bénéfique, adaptée à vos capacités. Commencez doucement : marche, natation, yoga. L'exercice améliore la fonction pulmonaire et le moral [9]. Évitez simplement les efforts intenses au début du traitement.
Côté alimentation, privilégiez une nourriture riche et équilibrée. Les infections à mycobactérium provoquent souvent un amaigrissement [3]. Protéines, fruits, légumes : votre corps a besoin d'énergie pour lutter contre l'infection.
Les Complications Possibles
Les complications des infections à mycobactérium peuvent être graves si le traitement est retardé ou inadéquat. La tuberculose pulmonaire peut évoluer vers la formation de cavités dans les poumons [3,9]. Ces cavités fragilisent le tissu pulmonaire et peuvent saigner, provoquant des hémoptysies parfois massives.
L'extension de l'infection représente un autre risque majeur. La tuberculose peut se disséminer vers d'autres organes : méninges, os, reins, foie [4,9]. Cette forme disséminée, appelée tuberculose miliaire, engage le pronostic vital et nécessite une prise en charge en urgence.
Les mycobactéries atypiques ont leurs propres complications. Mycobacterium avium peut provoquer une destruction progressive du tissu pulmonaire chez les patients immunodéprimés [8]. Les infections cutanées à Mycobacterium marinum peuvent s'étendre le long des vaisseaux lymphatiques [7].
Mais les traitements eux-mêmes peuvent causer des complications. L'hépatotoxicité de l'isoniazide et de la rifampicine nécessite une surveillance biologique régulière [9]. L'éthambutol peut provoquer des troubles visuels, d'où l'importance d'un suivi ophtalmologique.
Heureusement, avec un diagnostic précoce et un traitement adapté, la plupart de ces complications peuvent être évitées [4,9]. C'est pourquoi il ne faut jamais retarder la consultation devant des symptômes évocateurs.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des infections à mycobactérium s'est considérablement amélioré avec les traitements modernes. Pour la tuberculose sensible, le taux de guérison dépasse 95% avec un traitement bien conduit [4,9]. Cette excellente efficacité s'explique par la puissance des associations d'antibiotiques actuelles.
Plusieurs facteurs influencent le pronostic. L'âge du patient joue un rôle : les personnes âgées et les jeunes enfants ont un risque plus élevé de complications [4]. L'état immunitaire est également crucial : les patients VIH-positifs nécessitent une surveillance renforcée.
La précocité du diagnostic reste déterminante. Une tuberculose diagnostiquée tôt, avant l'apparition de cavités pulmonaires, guérit plus facilement et plus rapidement [3,9]. À l'inverse, un retard diagnostic peut compromettre les chances de guérison complète.
Pour les mycobactéries atypiques, le pronostic varie selon l'espèce. Mycobacterium avium répond généralement bien au traitement, mais nécessite une durée prolongée [8]. Mycobacterium abscessus reste plus difficile à traiter, avec des taux de guérison plus modestes .
L'important à retenir : même les formes résistantes peuvent aujourd'hui être traitées efficacement grâce aux nouveaux médicaments [5]. Le pronostic dépend surtout de l'observance du traitement et du suivi médical régulier.
Peut-on Prévenir Infections à Mycobacterium ?
La prévention des infections à mycobactérium repose sur plusieurs stratégies complémentaires. La vaccination BCG reste recommandée chez les enfants à risque élevé : nés dans des pays d'endémie ou ayant des antécédents familiaux [4,9]. Bien qu'imparfaite, cette vaccination protège contre les formes graves de tuberculose infantile.
Le dépistage des contacts constitue une mesure préventive essentielle. Quand un cas de tuberculose est diagnostiqué, l'entourage proche fait l'objet d'une enquête systématique [1,4]. Cette démarche permet d'identifier et de traiter précocement les infections latentes.
Pour les mycobactéries atypiques, la prévention passe par l'hygiène environnementale. Éviter les eaux stagnantes, porter des gants lors de travaux de jardinage, désinfecter les équipements de piscine [7,8]. Ces mesures simples réduisent significativement le risque d'exposition.
Chez les personnes immunodéprimées, une prophylaxie médicamenteuse peut être proposée. Les patients VIH avec un taux de CD4 bas reçoivent parfois un traitement préventif contre Mycobacterium avium [8]. Cette approche a considérablement réduit l'incidence de ces infections opportunistes.
L'amélioration des maladies de vie reste fondamentale. Logements surpeuplés, malnutrition, précarité : tous ces facteurs favorisent la transmission [4]. Les politiques de santé publique doivent intégrer cette dimension sociale de la prévention.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont actualisé leurs recommandations en 2024-2025 face à l'évolution épidémiologique des infections à mycobactérium. La Haute Autorité de Santé préconise un dépistage renforcé dans certaines populations : migrants récents, personnes sans domicile fixe, détenus [4].
Le Ministère de la Santé insiste sur l'importance de la déclaration obligatoire de tous les cas de tuberculose [4]. Cette surveillance épidémiologique permet d'adapter les stratégies de prévention et de détecter précocement les épidémies locales. Concrètement, chaque médecin doit signaler tout cas confirmé aux autorités sanitaires.
Santé Publique France recommande une approche graduée du traitement selon le niveau de résistance [1,2]. Les centres de lutte antituberculeuse (CLAT) coordonnent la prise en charge et assurent le suivi des patients. Ces structures spécialisées attendussent une expertise optimale.
Pour les mycobactéries atypiques, les recommandations évoluent. L'identification précise de l'espèce devient obligatoire avant tout traitement [8]. Cette démarche évite les traitements inadaptés et limite l'émergence de résistances.
L'Institut Pasteur souligne l'importance de la formation continue des professionnels de santé [9]. Les symptômes atypiques et l'évolution des résistances nécessitent une mise à jour régulière des connaissances. Des programmes de formation sont déployés dans toutes les régions.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations accompagnent les patients atteints d'infections à mycobactérium en France. L'Association Française de Lutte Antituberculeuse propose des informations actualisées et un soutien psychologique. Leurs bénévoles, souvent d'anciens patients, comprennent les difficultés du parcours de soins.
Les centres de lutte antituberculeuse (CLAT) constituent la ressource principale. Présents dans chaque département, ils offrent consultations gratuites, suivi médical et accompagnement social [4]. Ces centres disposent d'équipes pluridisciplinaires : médecins, infirmiers, assistants sociaux.
Pour les mycobactéries atypiques, les ressources sont plus limitées. Certains centres hospitaliers universitaires développent des consultations spécialisées. Le CHU de Bordeaux, par exemple, a créé une unité dédiée aux infections mycobactériennes complexes.
Les plateformes numériques se développent également. Des applications mobiles aident à la gestion du traitement : rappels de prise, suivi des effets secondaires, contact direct avec l'équipe soignante. Ces outils modernes améliorent l'observance, surtout chez les jeunes patients.
N'oubliez pas les ressources institutionnelles. Le site ameli.fr propose des fiches pratiques détaillées [3]. Santé Publique France met à disposition des brochures d'information actualisées [1,2]. Ces documents officiels attendussent la fiabilité de l'information.
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec une infection à mycobactérium nécessite quelques adaptations pratiques. Organisez votre prise médicamenteuse de façon ritualisée : même heure, même endroit, même verre d'eau. Cette routine facilite l'observance sur la durée longue du traitement.
Tenez un carnet de suivi détaillé. Notez vos symptômes, les effets secondaires, vos questions pour le médecin. Cette démarche active vous aide à mieux comprendre votre maladie et améliore la communication avec l'équipe soignante.
Adaptez votre environnement familial. Aérez régulièrement votre logement, évitez les espaces confinés les premières semaines. Vos proches peuvent porter un masque par précaution, mais sans excès : la peur ne doit pas isoler le patient.
Maintenez une activité sociale adaptée. Après 2-3 semaines de traitement, vous pouvez reprendre progressivement vos activités [4,9]. Commencez par les sorties courtes, puis augmentez graduellement selon votre forme.
Surveillez votre alimentation. L'infection provoque souvent une perte d'appétit et un amaigrissement [3]. Fractionnez vos repas, privilégiez les aliments riches en protéines, n'hésitez pas à consulter un nutritionniste si nécessaire. Votre corps a besoin d'énergie pour guérir.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains symptômes doivent vous amener à consulter rapidement. Une toux persistante depuis plus de trois semaines, surtout si elle s'accompagne de fièvre ou d'amaigrissement [3,9]. N'attendez pas que les symptômes s'aggravent : plus le diagnostic est précoce, meilleur est le pronostic.
Les signes d'alarme nécessitent une consultation en urgence. Crachats sanglants, essoufflement important au repos, fièvre élevée persistante [3]. Ces symptômes peuvent témoigner d'une complication grave nécessitant une prise en charge immédiate.
Si vous êtes sous traitement, surveillez les effets secondaires. Jaunisse, troubles visuels, nausées importantes qui vous empêchent de manger [9]. Votre médecin peut adapter le traitement ou prescrire des médicaments pour soulager ces effets indésirables.
Les personnes à risque doivent être particulièrement vigilantes. Immunodéprimés, diabétiques, personnes âgées : consultez dès l'apparition de symptômes respiratoires [4,8]. Votre médecin pourra prescrire des examens complémentaires même devant des signes minimes.
En cas de contact avec un malade, ne paniquez pas mais restez attentif. Le risque de transmission existe surtout avec les contacts prolongés et répétés [4]. Votre médecin évaluera la nécessité d'un dépistage selon les circonstances de l'exposition.
Médicaments associés
Les médicaments suivants peuvent être prescrits dans le cadre de Infections à Mycobacterium. Consultez toujours un professionnel de santé avant toute prise de médicament.
Questions Fréquentes
Combien de temps dure le traitement des infections à mycobactérium ?
Pour la tuberculose, le traitement dure 6 mois minimum. Les mycobactéries atypiques nécessitent souvent 12 à 18 mois de traitement.
Suis-je contagieux pendant le traitement ?
Après 2-3 semaines de traitement bien conduit, vous n'êtes plus contagieux. Les mycobactéries atypiques sont généralement peu contagieuses.
Puis-je travailler pendant le traitement ?
Oui, dans la plupart des cas. Un arrêt initial peut être nécessaire, puis reprise progressive selon votre forme.
Quels sont les effets secondaires du traitement ?
Nausées, fatigue, troubles digestifs sont fréquents mais généralement gérables. Votre médecin peut adapter le traitement si nécessaire.
Peut-on guérir complètement d'une infection à mycobactérium ?
Oui, avec un traitement adapté et bien suivi, la guérison est obtenue dans plus de 95% des cas.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Surveillance régionale de la tuberculose. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [2] Tuberculose en Île-de-France. Bilan 2023. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [3] Symptômes, diagnostic et évolution de la tuberculose. www.ameli.fr.Lien
- [4] La tuberculose - Ministère du Travail, de la Santé, des ... sante.gouv.fr. 2024-2025.Lien
- [5] Tuberculose : un cruel paradoxe. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [7] Les souches de tuberculose résistantes aux nouveaux ... Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [12] Skin infection by Mycobacterium marinum - diagnostic and therapeutic challenge. 2022.Lien
- [18] Infections mycobactériennes non tuberculeuses - Maladies ... www.msdmanuals.com.Lien
- [19] Tuberculose : symptômes, traitement, prévention. www.pasteur.fr.Lien
Publications scientifiques
- Are we underestimating the annual risk of infection with Mycobacterium tuberculosis in high-burden settings? (2022)56 citations[PDF]
- Preclinical murine models to study lung infection with Mycobacterium abscessus complex (2023)22 citations
- Skin infection by Mycobacterium marinum - diagnostic and therapeutic challenge (2022)15 citations
- Immunoinformatic-Based Multi-Epitope Vaccine Design for Co-Infection of Mycobacterium tuberculosis and SARS-CoV-2 (2023)20 citations
- Effect of Mixed Infections with Mycobacterium tuberculosis and Nontuberculous Mycobacteria on Diagnosis of Multidrug-Resistant Tuberculosis: A Retrospective … (2022)19 citations
Ressources web
- Infections mycobactériennes non tuberculeuses - Maladies ... (msdmanuals.com)
La maladie disséminée à Mycobacterium avium complex entraîne de la fièvre, une anémie, une thrombopénie, de la diarrhée et des douleurs abdominales (similaires ...
- Tuberculose : symptômes, traitement, prévention (pasteur.fr)
Le diagnostic de la tuberculose est dans un premier temps un test moléculaire permettant une détection précoce. Un test cutané ou un test sanguin pour détecter ...
- Symptômes, diagnostic et évolution de la tuberculose (ameli.fr)
26 mars 2025 — La primo-infection tuberculeuse et la tuberculose latente sont asymptomatiques. Si la tuberculose évolue, divers symptômes, ...
- Mycobactérium non-tuberculeux (poumonquebec.ca)
Le diagnostic d'une infection à MNT est basé principalement sur la mise en commun des signes et symptômes, d'images radiologiques obtenues généralement à l'aide ...
- Infections à Mycobactéries non tuberculeuses Diagnostic ... (infectiologie.com)
Traitement : Aspirine, traitement bronchodilatateurs et corticoïdes inhalés. ▫ Bon état général. ▫ Toux sèche apparue il y a un peu plus de 3 mois.
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
