Infections à Haemophilus : Symptômes, Traitements et Prévention 2025
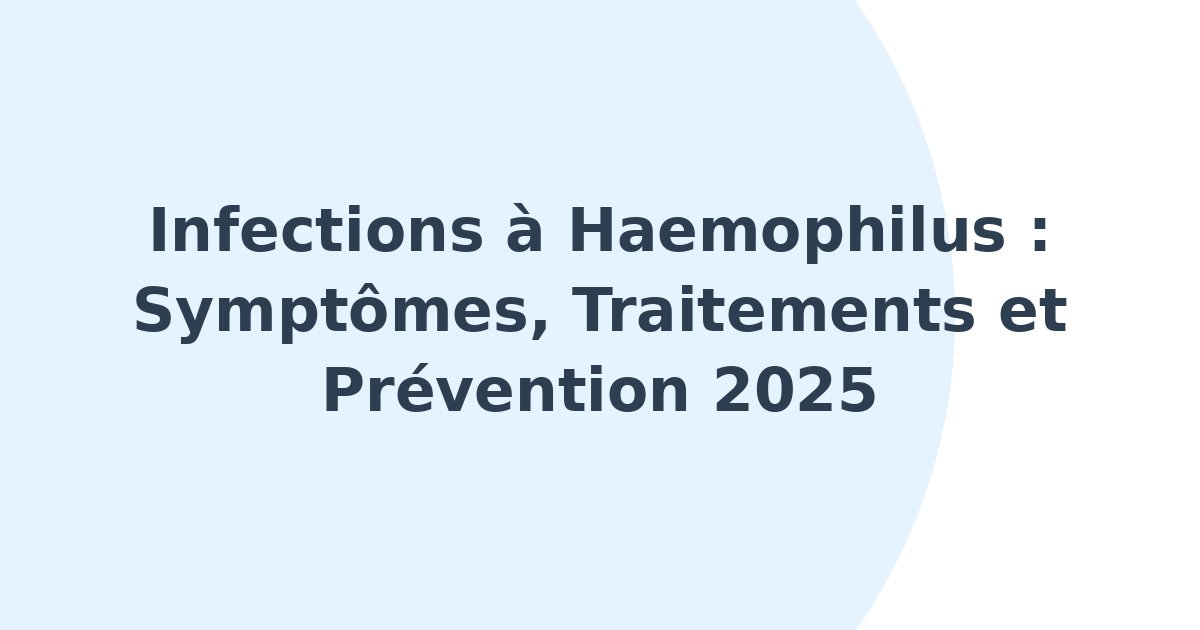
Les infections à Haemophilus représentent un enjeu majeur de santé publique, touchant particulièrement les enfants et les personnes immunodéprimées. Ces bactéries gram-négatives peuvent provoquer des pathologies graves, allant de simples infections respiratoires à des méningites potentiellement mortelles. Heureusement, les avancées thérapeutiques récentes et les stratégies vaccinales modernes offrent de nouveaux espoirs. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette pathologie complexe mais de mieux en mieux maîtrisée.
Téléconsultation et Infections à Haemophilus
Partiellement adaptée à la téléconsultationLes infections à Haemophilus peuvent généralement bénéficier d'une évaluation initiale en téléconsultation pour l'orientation diagnostique et l'analyse des symptômes. Cependant, la confirmation diagnostique nécessite souvent des examens complémentaires (prélèvements bactériologiques, imagerie) et certaines localisations (méningite, pneumonie sévère) requièrent impérativement une prise en charge en présentiel.
Ce qui peut être évalué à distance
Analyse des symptômes respiratoires (toux, expectoration, dyspnée) et leur évolution temporelle. Évaluation de l'état général et des signes fonctionnels (fièvre, fatigue, perte d'appétit). Description des symptômes ORL spécifiques (otite, sinusite, pharyngite). Analyse de l'historique vaccinal contre Haemophilus influenzae type b. Orientation diagnostique initiale selon la localisation suspectée de l'infection.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen clinique approfondi pour localiser précisément l'infection (auscultation pulmonaire, otoscopie, examen pharyngé). Réalisation de prélèvements bactériologiques pour confirmation diagnostique et antibiogramme. Examens d'imagerie si suspicion de pneumonie ou de complications. Évaluation de l'état hémodynamique en cas de signes de sepsis.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Préparer votre téléconsultation
Pour que votre téléconsultation soit la plus efficace possible, préparez les éléments suivants :
- Symptômes et durée : Noter précisément la fièvre et sa durée, les symptômes respiratoires (toux, expectoration purulente, essoufflement), les douleurs thoraciques, les symptômes ORL (douleurs d'oreille, écoulement, maux de gorge), les signes généraux (fatigue, frissons, perte d'appétit) et leur évolution depuis le début.
- Traitements en cours : Mentionner tout traitement antibiotique en cours ou récent (amoxicilline, clavulanique, céphalosporines, macrolides), les traitements symptomatiques (antalgiques, antipyrétiques), les corticoïdes, et tout traitement immunosuppresseur qui pourrait favoriser l'infection.
- Antécédents médicaux pertinents : Antécédents d'infections respiratoires récurrentes, immunodéficience connue, maladie pulmonaire chronique (BPCO, asthme), diabète, splénectomie, statut vaccinal contre Haemophilus influenzae type b, antécédents d'infections à Haemophilus.
- Examens récents disponibles : Résultats de prélèvements bactériologiques récents (ECBC, hémocultures, prélèvements ORL), radiographie thoracique récente, bilan biologique avec numération formule sanguine et marqueurs inflammatoires (CRP, procalcitonine), antibiogrammes antérieurs.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion de pneumonie nécessitant une auscultation et une radiographie thoracique immédiate. Otite moyenne aiguë compliquée nécessitant une otoscopie spécialisée. Infection grave avec signes de sepsis nécessitant une évaluation hémodynamique. Échec d'un traitement antibiotique initial nécessitant une réévaluation clinique et de nouveaux prélèvements.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Détresse respiratoire aiguë avec suspicion de pneumonie sévère à Haemophilus. Signes de méningite (céphalées intenses, raideur de nuque, photophobie) nécessitant une ponction lombaire urgente. État de choc septique avec défaillance hémodynamique.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Détresse respiratoire avec dyspnée de repos, cyanose ou saturation en oxygène diminuée
- Signes de méningite : céphalées intenses, raideur de nuque, photophobie, vomissements
- État de choc avec hypotension, tachycardie, marbrures cutanées ou confusion
- Fièvre élevée persistante avec altération importante de l'état général chez un patient immunodéprimé
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Généraliste — consultation en présentiel recommandée
Le médecin généraliste est généralement compétent pour diagnostiquer et traiter les infections à Haemophilus courantes. Une consultation en présentiel est recommandée pour permettre l'examen clinique nécessaire et la réalisation d'éventuels prélèvements bactériologiques.

- Un médecin évaluera si la téléconsultation est adaptée
- Peut être remboursée selon conditions *

Infections à Haemophilus : Définition et Vue d'Ensemble
Les infections à Haemophilus sont causées par des bactéries du genre Haemophilus, principalement Haemophilus influenzae. Contrairement à ce que son nom suggère, cette bactérie ne cause pas la grippe ! Elle tire son nom d'une confusion historique datant de la pandémie de 1918.
Ces micro-organismes sont des bactéries gram-négatives qui colonisent naturellement les voies respiratoires supérieures chez de nombreuses personnes. Mais attention : chez certains individus, elles peuvent devenir pathogènes et provoquer des infections parfois sévères [10,11].
Il existe plusieurs types d'Haemophilus influenzae. Le type b (Hib) était autrefois le plus redoutable, causant des méningites chez les jeunes enfants. Heureusement, la vaccination systématique a considérablement réduit son impact . Aujourd'hui, ce sont plutôt les souches non typables qui posent problème, notamment dans les infections respiratoires chroniques [2].
L'important à retenir ? Ces infections peuvent toucher différents organes : poumons, méninges, articulations, ou encore provoquer une septicémie. La gravité varie énormément selon votre âge, votre état de santé général et le type de bactérie impliquée.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, l'épidémiologie des infections à Haemophilus a radicalement changé depuis l'introduction de la vaccination Hib en 1992. Avant cette date, on comptait environ 600 à 700 cas de méningites à Hib par an chez les enfants de moins de 5 ans. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à moins de 10 cas annuels .
Mais voici un paradoxe intéressant : si les infections invasives à Hib ont quasiment disparu, les infections à souches non typables ont, elles, augmenté. Les données récentes montrent une incidence de 2 à 3 cas pour 100 000 habitants par an pour l'ensemble des infections à Haemophilus [7]. Cette évolution s'explique en partie par l'amélioration des techniques diagnostiques et le vieillissement de la population.
La pandémie de COVID-19 a créé un phénomène surprenant. En 2020-2021, on a observé une diminution significative des infections à Haemophilus chez les enfants, probablement liée aux mesures barrières et à la fermeture des écoles [4,8]. Cette "expérience naturelle" a confirmé l'importance de la transmission interhumaine dans la propagation de ces bactéries.
Au niveau mondial, l'Organisation mondiale de la santé estime que les infections à Haemophilus touchent encore 3 millions de personnes chaque année, principalement dans les pays où la vaccination Hib n'est pas systématique . En Europe, la France fait partie des bons élèves avec une couverture vaccinale supérieure à 95% .
Les Causes et Facteurs de Risque
Comprendre pourquoi certaines personnes développent des infections à Haemophilus alors que d'autres restent asymptomatiques, c'est un peu comme résoudre une équation à plusieurs inconnues. La bactérie est présente chez 20 à 80% des individus sains dans leur gorge ou leur nez, sans causer de problème [10].
Plusieurs facteurs peuvent faire basculer cette cohabitation pacifique vers l'infection. L'âge joue un rôle crucial : les enfants de moins de 5 ans et les adultes de plus de 65 ans sont particulièrement vulnérables. Pourquoi ? Leur système immunitaire est soit immature, soit affaibli par le temps.
Les facteurs de risque incluent également les maladies chroniques comme l'asthme, la BPCO, ou le diabète [2,9]. D'ailleurs, des recherches récentes suggèrent que les infections à Haemophilus non typables pourraient être "le prochain trait traitable" dans l'asthme, tant leur rôle dans l'aggravation de cette maladie devient évident [2].
L'immunodépression, qu'elle soit liée à une maladie (VIH, cancer) ou à des traitements (chimiothérapie, corticoïdes), multiplie considérablement les risques. Et puis il y a des facteurs environnementaux : tabagisme, pollution, vie en collectivité, qui favorisent la transmission et l'infection [6].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes des infections à Haemophilus varient énormément selon la localisation de l'infection. C'est un peu comme si cette bactérie était un caméléon médical, capable de se manifester de multiples façons.
Pour les infections respiratoires, les plus fréquentes, vous pourriez ressentir une toux persistante, des expectorations purulentes, de la fièvre et un essoufflement. Chez les patients asthmatiques, ces infections peuvent déclencher des exacerbations sévères [2]. Les enfants présentent souvent des otites récidivantes ou des sinusites traînantes.
Mais attention aux formes invasives ! La méningite à Haemophilus se manifeste par des maux de tête intenses, une raideur de nuque, de la fièvre élevée et parfois des troubles de la conscience. Ces symptômes nécessitent une prise en charge d'urgence [10,11].
Les infections articulaires provoquent des douleurs, un gonflement et une limitation des mouvements. Quant à la septicémie, elle peut se manifester par une fièvre élevée, des frissons, une chute de tension et un état général altéré. Concrètement, si vous ressentez plusieurs de ces symptômes simultanément, il ne faut pas attendre pour consulter.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des infections à Haemophilus repose sur plusieurs étapes complémentaires. Votre médecin commencera toujours par un interrogatoire détaillé et un examen clinique approfondi. Il cherchera notamment à identifier les facteurs de risque et à localiser précisément l'infection.
Les examens biologiques constituent l'étape clé du diagnostic. Une prise de sang permettra de rechercher des signes d'inflammation (CRP élevée, hyperleucocytose) et, dans les formes sévères, d'identifier la bactérie par hémoculture [10,11]. Pour les infections respiratoires, l'analyse des expectorations ou un prélèvement bronchique peut être nécessaire.
L'imagerie médicale apporte des informations précieuses. Une radiographie pulmonaire révélera une pneumonie, tandis qu'un scanner cérébral sera indispensable en cas de suspicion de méningite. La ponction lombaire reste l'examen de référence pour confirmer une méningite bactérienne.
Bon à savoir : les techniques de diagnostic moléculaire se développent rapidement. La PCR permet désormais une identification plus rapide et plus précise des souches d'Haemophilus, ce qui améliore la prise en charge thérapeutique [6]. Ces avancées sont particulièrement importantes pour adapter au mieux le traitement antibiotique.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement des infections à Haemophilus repose principalement sur l'antibiothérapie, mais le choix du médicament n'est pas toujours simple. En effet, ces bactéries ont développé des résistances à certains antibiotiques au fil des années [5,6].
Pour les infections légères à modérées, l'amoxicilline-acide clavulanique reste souvent le traitement de première intention. Cette association permet de contourner la résistance liée à la production de bêta-lactamases par certaines souches. La durée du traitement varie généralement de 7 à 10 jours selon la localisation de l'infection [10,11].
Dans les formes sévères ou en cas de résistance, d'autres antibiotiques peuvent être utilisés : céphalosporines de 3ème génération, fluoroquinolones, ou macrolides. Le choix dépend des résultats de l'antibiogramme et de votre profil médical. Les infections invasives nécessitent souvent une hospitalisation et un traitement intraveineux.
Parallèlement au traitement antibiotique, une prise en charge symptomatique est importante. Cela inclut la gestion de la fièvre, l'hydratation, et parfois des traitements spécifiques selon la localisation (bronchodilatateurs pour les infections respiratoires, par exemple). L'important est d'adapter le traitement à votre situation particulière.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la lutte contre les infections à Haemophilus. L'Organisation mondiale de la santé vient de publier des recommandations révolutionnaires : une meilleure utilisation des vaccins pourrait réduire l'usage d'antibiotiques de 2,5 milliards de doses annuellement . Cette approche préventive représente un espoir majeur face à l'antibiorésistance croissante.
Du côté de la recherche vaccinale, des progrès significatifs émergent. Les travaux récents sur les vaccins contre Haemophilus parasuis ouvrent de nouvelles perspectives, même si cette souche concerne principalement la médecine vétérinaire [3]. Ces recherches pourraient néanmoins bénéficier aux vaccins humains par transfert de technologies.
En France, les autorités de santé renforcent leur surveillance épidémiologique. L'Agence régionale de santé d'Île-de-France a notamment mis en place de nouveaux protocoles de détection précoce des infections invasives, s'inspirant des stratégies développées pour le méningocoque [1]. Cette approche intégrée améliore significativement la prise en charge des patients.
Les plateformes comme MesVaccins.net se modernisent également, offrant aux professionnels de santé des outils de suivi vaccinal plus performants . Ces innovations numériques facilitent l'identification des patients à risque et l'optimisation des stratégies préventives. Concrètement, votre médecin dispose désormais d'outils plus précis pour évaluer vos besoins vaccinaux.
Vivre au Quotidien avec Infections à Haemophilus
Vivre avec des infections récurrentes à Haemophilus peut sembler décourageant, mais de nombreuses stratégies permettent d'améliorer votre qualité de vie. La clé réside dans une approche globale combinant traitement médical et adaptations du mode de vie.
L'hygiène respiratoire devient votre meilleure alliée. Lavez-vous les mains régulièrement, évitez les foules pendant les pics épidémiques, et n'hésitez pas à porter un masque dans les transports en commun. Ces gestes simples réduisent significativement les risques de réinfection [6,9].
Pour les patients souffrant d'infections respiratoires chroniques, la kinésithérapie respiratoire peut faire des merveilles. Elle aide à évacuer les sécrétions et améliore la fonction pulmonaire. Certains patients bénéficient également d'exercices de respiration ou de techniques de relaxation pour mieux gérer l'anxiété liée à leur pathologie.
N'oubliez pas l'importance du soutien psychologique. Vivre avec une maladie chronique peut être épuisant moralement. Parler à un psychologue, rejoindre un groupe de soutien, ou simplement échanger avec d'autres patients peut vous aider à mieux accepter votre situation et à développer des stratégies d'adaptation efficaces.
Les Complications Possibles
Les complications des infections à Haemophilus peuvent être redoutables, d'où l'importance d'un diagnostic et d'un traitement précoces. Heureusement, avec une prise en charge adaptée, la plupart de ces complications peuvent être évitées ou traitées efficacement.
Les complications respiratoires incluent la pneumonie nécrosante, l'abcès pulmonaire, ou l'empyème pleural. Ces situations nécessitent souvent une hospitalisation prolongée et parfois des gestes chirurgicaux. Chez les patients asthmatiques, les infections à Haemophilus peuvent déclencher des exacerbations sévères nécessitant une prise en charge en urgence [2,9].
Les complications neurologiques sont les plus graves. La méningite peut laisser des séquelles définitives : surdité, troubles cognitifs, épilepsie, ou paralysies. C'est pourquoi toute suspicion de méningite constitue une urgence médicale absolue [10,11]. Les abcès cérébraux, plus rares, peuvent également survenir.
D'autres complications peuvent toucher différents organes : arthrites septiques, endocardites, ou septicémies. La formation de biofilms bactériens complique parfois le traitement, rendant les bactéries plus résistantes aux antibiotiques [6]. Cette capacité d'adaptation explique pourquoi certaines infections deviennent chroniques ou récidivantes.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des infections à Haemophilus s'est considérablement amélioré au cours des dernières décennies. Cette évolution positive résulte de plusieurs facteurs : meilleur diagnostic, antibiotiques plus efficaces, et surtout prévention vaccinale .
Pour les infections respiratoires simples, le pronostic est généralement excellent avec un traitement approprié. La guérison survient habituellement en 7 à 10 jours sans séquelles. Cependant, chez les patients avec des maladies respiratoires chroniques, les récidives sont possibles et nécessitent un suivi régulier [2,9].
Les infections invasives ont un pronostic plus réservé. Le taux de mortalité de la méningite à Haemophilus reste autour de 5 à 10%, malgré les progrès thérapeutiques. Environ 15 à 20% des survivants gardent des séquelles neurologiques [10,11]. Ces chiffres soulignent l'importance cruciale d'un diagnostic et d'un traitement précoces.
L'âge influence significativement le pronostic. Les très jeunes enfants et les personnes âgées ont des risques de complications plus élevés. Mais rassurez-vous : avec les stratégies préventives actuelles et les nouveaux traitements en développement, l'avenir s'annonce plus prometteur . Les innovations thérapeutiques 2024-2025 laissent espérer une amélioration continue du pronostic.
Peut-on Prévenir Infections à Haemophilus ?
La prévention des infections à Haemophilus repose sur plusieurs piliers, dont le plus important reste la vaccination. Le vaccin contre Haemophilus influenzae type b (Hib) constitue l'une des plus grandes réussites de la médecine préventive moderne .
En France, la vaccination Hib est obligatoire depuis 2018 pour tous les nourrissons. Elle fait partie du vaccin hexavalent administré à 2, 4 et 11 mois. Cette stratégie a permis de réduire de 99% l'incidence des méningites à Hib chez les enfants . Les données récentes confirment l'excellente efficacité de cette approche préventive.
Mais la prévention ne s'arrête pas là. Les mesures d'hygiène jouent un rôle crucial : lavage fréquent des mains, évitement des contacts rapprochés avec des personnes malades, aération régulière des locaux. Ces gestes simples réduisent significativement la transmission [6,9].
Pour les personnes à risque élevé (immunodéprimés, maladies chroniques), des mesures spécifiques peuvent être recommandées : vaccination antigrippale annuelle, évitement des foules pendant les épidémies, suivi médical régulier. Certains patients bénéficient d'une antibioprophylaxie dans des situations particulières, mais cette approche doit être discutée au cas par cas avec votre médecin.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont établi des recommandations précises concernant la prise en charge des infections à Haemophilus. Le ministère de la Santé, à travers ses questions-réponses officielles, rappelle l'importance de la vaccination systématique et du respect du calendrier vaccinal .
La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise une approche graduée du traitement antibiotique. Elle recommande de privilégier les antibiotiques à spectre étroit quand c'est possible, afin de limiter l'émergence de résistances. Cette stratégie s'inscrit dans le plan national de lutte contre l'antibiorésistance .
Concernant la surveillance épidémiologique, Santé publique France a renforcé ses dispositifs de détection précoce des infections invasives. Les médecins sont encouragés à déclarer rapidement tout cas suspect, permettant ainsi une réponse sanitaire adaptée [1,7]. Cette vigilance collective contribue à maintenir un niveau de protection élevé de la population.
Les recommandations 2024-2025 insistent particulièrement sur l'importance de la prévention. L'accent est mis sur l'amélioration de la couverture vaccinale, notamment dans les populations vulnérables, et sur le développement d'outils numériques d'aide à la décision pour les professionnels de santé . Ces évolutions témoignent d'une approche de plus en plus personnalisée de la prévention.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs ressources spécialisées peuvent vous accompagner dans votre parcours avec les infections à Haemophilus. L'Association Européenne contre les Méningites et Infections à Haemophilus (AEMiP) propose des informations actualisées et un soutien aux patients et familles [12].
Au niveau national, la Fondation pour la Recherche Médicale finance régulièrement des projets de recherche sur les infections bactériennes invasives. Leurs publications grand public permettent de mieux comprendre les enjeux scientifiques actuels et les perspectives d'avenir.
Les plateformes numériques se développent également. MesVaccins.net offre des outils personnalisés de suivi vaccinal, particulièrement utiles pour les personnes à risque . Ces ressources digitales facilitent le dialogue avec votre médecin et l'optimisation de votre prise en charge préventive.
N'oubliez pas les ressources locales : centres de référence des maladies infectieuses, services de pneumologie, consultations spécialisées en infectiologie. Ces structures disposent souvent de programmes d'éducation thérapeutique qui peuvent vous aider à mieux gérer votre pathologie au quotidien. L'important est de ne pas rester isolé face à la maladie.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour mieux vivre avec le risque d'infections à Haemophilus. Premièrement, tenez un carnet de santé détaillé : notez vos symptômes, les traitements reçus, et leur efficacité. Cette information sera précieuse pour votre médecin lors des consultations de suivi.
Apprenez à reconnaître les signes d'alerte qui nécessitent une consultation rapide : fièvre élevée persistante, difficultés respiratoires, maux de tête intenses avec raideur de nuque. Plus vous consulterez tôt, meilleur sera le pronostic. N'hésitez jamais à contacter votre médecin en cas de doute.
Optimisez votre environnement de vie : aérez régulièrement votre domicile, maintenez une humidité appropriée (40-60%), évitez les irritants respiratoires comme la fumée de tabac. Ces mesures simples réduisent les risques de complications respiratoires [6,9].
Enfin, prenez soin de votre état général : alimentation équilibrée, activité physique adaptée, sommeil suffisant, gestion du stress. Un organisme en bonne santé résiste mieux aux infections. Et surtout, respectez scrupuleusement vos rendez-vous de suivi médical et vos rappels vaccinaux. La prévention reste votre meilleure protection.
Quand Consulter un Médecin ?
Savoir quand consulter peut faire la différence entre une infection bénigne et des complications graves. Consultez immédiatement si vous présentez des signes de méningite : maux de tête violents, raideur de nuque, fièvre élevée, troubles de la conscience, ou éruption cutanée qui ne disparaît pas à la pression [10,11].
Pour les infections respiratoires, plusieurs signaux doivent vous alerter : fièvre supérieure à 38,5°C persistant plus de 48 heures, essoufflement au repos, douleurs thoraciques, expectorations purulentes ou sanglantes. Chez les enfants, une altération de l'état général, des difficultés alimentaires, ou une somnolence inhabituelle justifient une consultation urgente.
Les personnes à risque élevé (immunodéprimés, maladies chroniques, âges extrêmes) doivent consulter plus précocement. Pour elles, même des symptômes apparemment bénins peuvent évoluer rapidement vers des formes graves [2,9]. N'attendez pas que les symptômes s'aggravent.
En cas de doute, n'hésitez pas à contacter le 15 (SAMU) ou à vous rendre aux urgences. Les professionnels de santé préfèrent une consultation "pour rien" plutôt qu'un retard de prise en charge. Votre santé n'a pas de prix, et les infections à Haemophilus peuvent parfois évoluer très rapidement vers des formes sévères.
Questions Fréquentes
Les infections à Haemophilus sont-elles contagieuses ?
Oui, ces bactéries se transmettent par voie respiratoire (gouttelettes, toux, éternuements). Cependant, la plupart des personnes exposées ne développent pas d'infection grâce à leur immunité naturelle.
Peut-on avoir plusieurs fois une infection à Haemophilus ?
Absolument. Contrairement à certaines maladies virales, les infections à Haemophilus ne confèrent pas d'immunité durable. Les récidives sont possibles, surtout chez les personnes fragilisées.
Le vaccin Hib protège-t-il contre toutes les souches ?
Non, il protège spécifiquement contre Haemophilus influenzae type b. Les souches non typables, responsables de nombreuses infections respiratoires, ne sont pas couvertes par ce vaccin.
Combien de temps dure un traitement antibiotique ?
Généralement 7 à 10 jours pour les infections simples, mais cela peut être prolongé selon la gravité et la localisation. Il est crucial de terminer le traitement même si vous vous sentez mieux.
Les infections à Haemophilus peuvent-elles devenir résistantes aux antibiotiques ?
Oui, c'est un problème croissant. Certaines souches produisent des enzymes (bêta-lactamases) qui inactivent certains antibiotiques. C'est pourquoi l'antibiogramme est important.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Une meilleure utilisation des vaccins pourrait réduire l'usage d'antibiotiques de 2,5 milliards de doses annuellement selon l'OMSLien
- [2] Questions/réponses officielles du Ministère de la Santé sur la vaccination obligatoireLien
- [3] Plateforme MesVaccins pour le suivi vaccinal personnaliséLien
- [4] Surveillance renforcée des infections invasives par l'ARS Île-de-FranceLien
- [7] Haemophilus influenzae non typable : le prochain trait traitable dans l'asthmeLien
- [8] Progrès de la recherche sur les vaccins contre Haemophilus parasuisLien
- [9] Évolution des infections à Haemophilus chez l'enfant avant et après la pandémie COVID-19Lien
- [10] Système d'efflux du cuivre requis pour l'infection pulmonaire murine par Haemophilus influenzaeLien
- [11] Tendances épidémiques et mécanismes de formation de biofilms d'Haemophilus influenzaeLien
- [12] Évolution des infections invasives à Neisseria meningitidis et Haemophilus influenzae en France pendant la pandémie COVID-19Lien
- [13] Impact de la pandémie COVID-19 sur les infections à Haemophilus influenzae chez les patients pédiatriquesLien
- [14] Anticorps polyréactifs salivaires et Haemophilus influenzae associés à la sévérité des infections respiratoiresLien
- [15] Manuel MSD : Infections à Haemophilus influenzaeLien
- [16] Manuel MSD Professionnel : Infections par HaemophilusLien
- [17] Association Européenne contre les Méningites et Infections à HaemophilusLien
Publications scientifiques
- Non-typeable Haemophilus influenzae airways infection: the next treatable trait in asthma? (2022)22 citations[PDF]
- Research progress on Haemophilus parasuis vaccines (2025)3 citations
- Changes of Haemophilus influenzae infection in children before and after the COVID-19 pandemic, Henan, China (2022)72 citations[PDF]
- Copper efflux system required in murine lung infection by Haemophilus influenzae composed of a canonical ATPase gene and tandem chaperone gene copies (2023)4 citations
- Epidemic trends and biofilm formation mechanisms of Haemophilus influenzae: Insights into clinical implications and prevention strategies (2023)12 citations
Ressources web
- Infections à Haemophilus influenzae (msdmanuals.com)
Pour faire le diagnostic, le médecin prélève un échantillon de sang, de pus, ou de tout autre liquide de l'organisme et l'envoie au laboratoire pour qu'il soit ...
- Infections par Haemophilus - Maladies infectieuses (msdmanuals.com)
Le diagnostic repose sur la culture, les tests d'amplification des acides nucléiques et le sérotypage. Le traitement repose sur les antibiotiques. Diagnostic| ...
- Haemophilus influenzae - AEMiP (aemip.fr)
Le diagnostic d'une infection à H. influenzae repose sur la culture qui exige la présence de facteurs de croissance : facteur X (hémine) et facteur V (NAD) dans ...
- Les infections à Haemophilus influenzae de type b (vaccination-info.be)
19 juil. 2024 — L'Haemophilus influenzae de type b, couramment appelée « HIB », cause habituellement une infection bénigne comme une otite ou une sinusite, mais ...
- Infection à Haemophilus influenzae - ... (canada.ca)
15 mai 2023 — Infection des oreilles (otite, p. ex. otite moyenne) · Infection des sinus (sinusite). Les symptômes incluent nez bouché et maux de tête.
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
