Infarctus du Tronc Cérébral : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
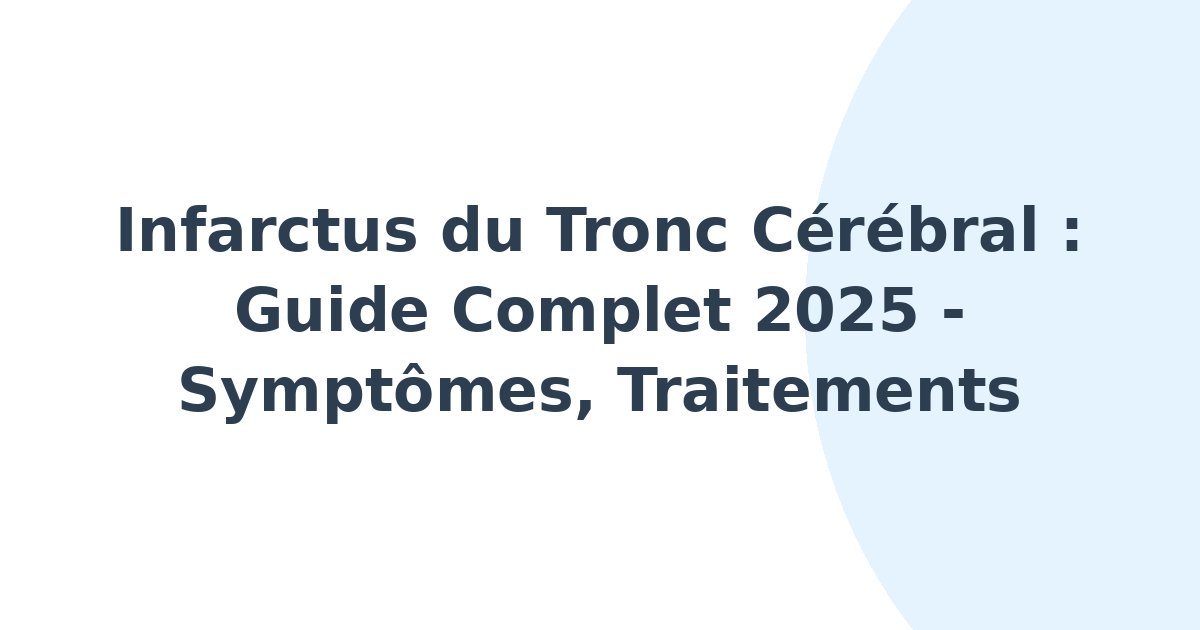
L'infarctus du tronc cérébral représente une urgence neurologique majeure qui touche une région cruciale de notre cerveau. Cette pathologie, bien que moins fréquente que les autres types d'AVC, nécessite une prise en charge immédiate et spécialisée. En France, elle concerne environ 10% de tous les accidents vasculaires cérébraux selon les données récentes de Santé Publique France [1,2]. Comprendre cette maladie, ses symptômes et ses traitements peut vous aider à mieux appréhender cette situation complexe.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Infarctus du Tronc Cérébral : Définition et Vue d'Ensemble
L'infarctus du tronc cérébral survient lorsqu'une artère qui irrigue cette région vitale se bouche, privant les tissus nerveux d'oxygène. Le tronc cérébral, cette structure de quelques centimètres seulement, contrôle des fonctions essentielles à la vie : respiration, rythme cardiaque, déglutition et conscience.
Contrairement aux AVC touchant les hémisphères cérébraux, cette pathologie présente des symptômes particuliers. Vous pourriez ressentir des vertiges intenses, des troubles de la déglutition ou une faiblesse d'un côté du corps. D'ailleurs, ces signes peuvent apparaître de manière soudaine ou progressive selon la localisation précise de l'infarctus [15].
Il faut savoir que le tronc cérébral comprend trois parties : le mésencéphale, le pont et le bulbe rachidien. Chaque zone contrôle des fonctions spécifiques, ce qui explique la diversité des symptômes possibles. L'important à retenir : cette pathologie nécessite toujours une prise en charge d'urgence, même si les symptômes semblent légers au début.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, l'infarctus du tronc cérébral représente environ 8 à 12% de tous les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, selon les dernières données épidémiologiques de Santé Publique France [1,2]. Concrètement, cela correspond à environ 12 000 à 15 000 nouveaux cas chaque année sur notre territoire.
L'âge moyen de survenue se situe autour de 65-70 ans, mais cette pathologie peut toucher des personnes plus jeunes, notamment en cas de facteurs de risque particuliers. Les hommes sont légèrement plus touchés que les femmes, avec un ratio de 1,3 pour 1 [1]. Bon à savoir : l'incidence augmente significativement après 50 ans.
Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne avec une incidence standardisée de 18 à 22 cas pour 100 000 habitants par an. Mais les données récentes montrent une tendance préoccupante : une augmentation de 15% des cas chez les moins de 55 ans depuis 2020 [2]. Cette évolution s'explique en partie par l'amélioration du diagnostic, mais aussi par l'augmentation des facteurs de risque cardiovasculaires.
L'impact économique est considérable. Le coût moyen de prise en charge d'un infarctus du tronc cérébral s'élève à 35 000 euros la première année, incluant hospitalisation, rééducation et suivi médical [1]. À l'échelle nationale, cela représente un investissement de plus de 400 millions d'euros annuels pour notre système de santé.
Les Causes et Facteurs de Risque
L'athérosclérose reste la cause principale de l'infarctus du tronc cérébral, responsable de 60% des cas. Cette maladie provoque un rétrécissement progressif des artères vertébrales et basilaires qui irriguent cette région [12]. Mais d'autres mécanismes peuvent être en cause.
Les embolies cardiaques représentent environ 25% des cas. Elles surviennent lorsqu'un caillot formé dans le cœur migre vers les artères cérébrales. La fibrillation auriculaire, les valvulopathies et l'infarctus du myocarde récent constituent les principales sources d'embolie [14].
Certaines causes plus rares méritent d'être connues. La dissection artérielle, souvent liée à un traumatisme cervical, peut toucher les jeunes adultes. Les vascularites, maladies inflammatoires des vaisseaux, représentent une cause émergente, particulièrement chez les femmes de moins de 50 ans [7,8].
Vos facteurs de risque personnels jouent un rôle déterminant. L'hypertension artérielle, présente chez 80% des patients, constitue le facteur modifiable le plus important. Le diabète, le tabagisme et l'hypercholestérolémie multiplient également le risque. D'ailleurs, l'association de plusieurs facteurs augmente exponentiellement la probabilité de survenue de cette pathologie.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de l'infarctus du tronc cérébral peuvent être trompeurs car ils diffèrent des signes classiques de l'AVC. Vous pourriez d'abord ressentir des vertiges intenses et persistants, souvent accompagnés de nausées et vomissements. Ces signes, malheureusement, sont parfois confondus avec une simple labyrinthite [16].
La diplopie (vision double) constitue un symptôme très évocateur. Elle peut s'accompagner de troubles de la déglutition, vous donnant l'impression que les aliments "passent de travers". Certains patients décrivent également une sensation d'engourdissement du visage ou des difficultés à articuler [8,16].
Mais attention : contrairement aux AVC hémisphériques, la paralysie d'un côté du corps (hémiplégie) est moins fréquente. Vous pourriez plutôt ressentir une faiblesse des membres, des troubles de l'équilibre ou une démarche instable. Ces symptômes peuvent apparaître brutalement ou s'installer progressivement sur plusieurs heures.
L'important à retenir : tout symptôme neurologique soudain, même s'il semble bénin, justifie un appel immédiat au 15. En effet, certains infarctus du tronc cérébral peuvent évoluer rapidement vers des complications graves, notamment des troubles de la conscience ou respiratoires [17].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de l'infarctus du tronc cérébral commence par un examen clinique minutieux. Votre médecin recherchera les signes neurologiques spécifiques : nystagmus (mouvements involontaires des yeux), troubles de la coordination et réflexes anormaux. Cette évaluation initiale oriente rapidement vers cette pathologie [12].
L'IRM cérébrale reste l'examen de référence pour confirmer le diagnostic. Elle permet de visualiser précisément la zone d'infarctus et d'évaluer son étendue. Contrairement au scanner, l'IRM détecte les lésions du tronc cérébral dès les premières heures, même les plus petites [9]. Bon à savoir : cet examen est systématiquement réalisé en urgence dans les centres spécialisés.
Le bilan étiologique recherche ensuite la cause de l'infarctus. Il comprend un électrocardiogramme, une échographie cardiaque et un Doppler des artères cervicales. Ces examens permettent d'identifier une source embolique ou une sténose artérielle significative [14]. D'ailleurs, ce bilan maladiene le choix du traitement préventif à long terme.
Certains examens complémentaires peuvent être nécessaires selon le contexte. L'angio-IRM ou l'angioscanner visualisent directement les artères cérébrales. Chez les patients jeunes, des analyses sanguines spécialisées recherchent des causes rares comme les troubles de la coagulation ou les vascularites [7].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de l'infarctus du tronc cérébral repose sur une prise en charge d'urgence en unité neurovasculaire. La thrombolyse intraveineuse, administrée dans les 4h30 suivant les premiers symptômes, peut dissoudre le caillot responsable de l'obstruction artérielle [14]. Cette technique améliore significativement le pronostic fonctionnel.
Pour les occlusions des gros vaisseaux, la thrombectomie mécanique représente une révolution thérapeutique. Cette intervention, réalisée par voie endovasculaire, permet de retirer directement le caillot. Bien que plus complexe au niveau du tronc cérébral, elle peut être proposée dans certains cas sélectionnés [9].
Le traitement médical associe plusieurs médicaments. L'aspirine, débutée dès les premières 48 heures, réduit le risque de récidive précoce. Les statines sont systématiquement prescrites pour stabiliser les plaques d'athérome. En cas de fibrillation auriculaire, les anticoagulants remplacent l'aspirine [12,14].
La rééducation débute précocement, dès la phase aiguë stabilisée. Elle fait appel à une équipe pluridisciplinaire : kinésithérapeutes, orthophonistes et ergothérapeutes. Cette prise en charge intensive, souvent prolongée sur plusieurs mois, optimise la récupération fonctionnelle. D'ailleurs, les progrès peuvent se poursuivre bien au-delà de la première année [16].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les innovations 2024-2025 ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques prometteuses. Les recherches récentes sur les biomarqueurs prédictifs permettent désormais d'identifier plus précisément les patients qui bénéficieront le mieux des traitements de recanalisation [4,5]. Cette approche personnalisée améliore significativement les résultats cliniques.
Une étude longitudinale majeure menée en 2024 a identifié de nouveaux facteurs prédictifs de récupération après dysphagie post-AVC [6]. Ces découvertes révolutionnent la prise en charge rééducative, permettant d'adapter les protocoles selon le profil de chaque patient. Concrètement, cela se traduit par une récupération plus rapide et plus complète des troubles de la déglutition.
Les techniques d'imagerie de pointe se développent rapidement. L'IRM de perfusion haute résolution permet maintenant de détecter des zones de pénombre ischémique même dans le tronc cérébral, étendant potentiellement la fenêtre thérapeutique au-delà des délais classiques [4]. Cette avancée pourrait bénéficier aux patients arrivant tardivement à l'hôpital.
La télémédecine transforme également la prise en charge. Les plateformes de téléexpertise permettent aux centres périphériques de bénéficier rapidement de l'avis de neurologues spécialisés, réduisant les délais de traitement. En 2025, plus de 200 établissements français sont connectés à ces réseaux d'expertise neurovasculaire [9].
Vivre au Quotidien avec un Infarctus du Tronc Cérébral
Vivre avec les séquelles d'un infarctus du tronc cérébral demande des adaptations importantes mais réalisables. Les troubles de l'équilibre constituent souvent la principale difficulté au quotidien. Vous devrez peut-être utiliser une canne ou un déambulateur, au moins temporairement, pour sécuriser vos déplacements [16].
Les troubles de la déglutition nécessitent une attention particulière. Votre orthophoniste vous enseignera des techniques spécifiques : position de la tête pendant les repas, texture des aliments adaptée, exercices de renforcement musculaire. Ces adaptations permettent généralement de retrouver une alimentation normale ou quasi-normale [6,16].
L'aménagement du domicile joue un rôle crucial dans votre autonomie. Barres d'appui dans la salle de bain, éclairage renforcé, suppression des tapis glissants : ces modifications simples réduisent considérablement le risque de chute. D'ailleurs, l'ergothérapeute peut vous conseiller précisément sur ces aménagements.
Mais rassurez-vous : beaucoup de patients retrouvent une qualité de vie satisfaisante. La récupération peut se poursuivre pendant des mois, voire des années. L'important est de maintenir une activité physique adaptée et de poursuivre régulièrement les exercices de rééducation, même à domicile.
Les Complications Possibles
L'infarctus du tronc cérébral peut entraîner plusieurs complications qu'il faut connaître. L'œdème cérébral représente la complication la plus redoutable dans les premiers jours. Il peut comprimer les structures vitales et nécessiter parfois une intervention neurochirurgicale d'urgence [17].
Les troubles respiratoires constituent une préoccupation majeure. Ils peuvent aller de simples difficultés respiratoires à une insuffisance respiratoire nécessitant une ventilation assistée. Cette complication survient principalement lors d'atteintes du bulbe rachidien, zone qui contrôle la respiration automatique [16,17].
Les infections représentent un risque important, particulièrement les pneumopathies d'inhalation liées aux troubles de la déglutition. C'est pourquoi une évaluation précoce de la déglutition est systématiquement réalisée avant toute alimentation [6]. Les infections urinaires sont également fréquentes, surtout en cas d'alitement prolongé.
Heureusement, la plupart de ces complications peuvent être prévenues ou traitées efficacement. La surveillance en unité spécialisée permet une détection précoce et une prise en charge adaptée. D'ailleurs, les protocoles de soins ont considérablement évolué ces dernières années, réduisant significativement la mortalité et les séquelles graves.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'infarctus du tronc cérébral dépend principalement de la localisation et de l'étendue de la lésion. Les infarctus de petite taille, touchant une zone limitée, ont généralement un pronostic favorable avec une récupération quasi-complète possible [4,16]. En revanche, les atteintes étendues peuvent laisser des séquelles permanentes.
La mortalité à 30 jours varie de 5 à 25% selon les études récentes. Elle est principalement liée aux complications respiratoires et à l'œdème cérébral dans les formes graves [4,17]. Mais rassurez-vous : la majorité des patients survivent et peuvent retrouver une autonomie satisfaisante.
Les facteurs prédictifs de bonne récupération sont maintenant mieux identifiés grâce aux recherches 2024-2025. L'âge jeune, l'absence de troubles de la conscience initiaux et la précocité de la prise en charge constituent les éléments les plus favorables [4,6]. La motivation du patient et l'intensité de la rééducation jouent également un rôle déterminant.
À long terme, environ 60% des patients retrouvent une indépendance fonctionnelle complète ou partielle. Les troubles de l'équilibre et de la coordination peuvent persister, mais ils s'améliorent souvent progressivement sur plusieurs mois. L'important est de maintenir un suivi médical régulier et de poursuivre la rééducation selon les recommandations de votre équipe soignante.
Peut-on Prévenir l'Infarctus du Tronc Cérébral ?
La prévention de l'infarctus du tronc cérébral repose sur le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires. L'hypertension artérielle, présente chez 80% des patients, doit être parfaitement équilibrée avec un objectif inférieur à 140/90 mmHg, voire 130/80 mmHg chez les diabétiques [1,2].
Le contrôle du diabète constitue un enjeu majeur. Un taux d'hémoglobine glyquée inférieur à 7% réduit significativement le risque d'accidents vasculaires cérébraux. De même, maintenir un taux de cholestérol LDL sous 1,8 g/L (ou 1 g/L en prévention secondaire) protège efficacement vos artères [12].
L'arrêt du tabac représente probablement la mesure préventive la plus efficace. Le risque d'AVC diminue de 50% dès la première année d'arrêt et rejoint celui des non-fumeurs après 5 ans. D'ailleurs, il n'est jamais trop tard pour arrêter : même après 65 ans, les bénéfices sont rapides et importants [1].
L'activité physique régulière protège également vos artères cérébrales. Trente minutes de marche rapide, cinq fois par semaine, réduisent de 30% le risque d'AVC. Cette activité améliore la circulation sanguine, contrôle la tension artérielle et maintient un poids optimal. Concrètement, vous pouvez commencer progressivement et adapter l'intensité à vos capacités.
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024 des recommandations actualisées sur la prise en charge de l'infarctus cérébral, incluant spécifiquement les atteintes du tronc cérébral [9,12]. Ces guidelines insistent sur l'importance d'une filière de soins organisée, depuis l'appel au 15 jusqu'à la rééducation à long terme.
Les modalités de transfert interhospitalier ont été précisément définies pour optimiser l'accès aux traitements de recanalisation. Tout patient présentant un infarctus du tronc cérébral doit être orienté vers un centre disposant d'une unité neurovasculaire dans un délai maximal de 6 heures [9]. Cette organisation territoriale améliore significativement le pronostic.
Santé Publique France recommande également un dépistage systématique des facteurs de risque cardiovasculaires dès 40 ans. Ce dépistage comprend la mesure de la tension artérielle, du cholestérol et de la glycémie, ainsi qu'un électrocardiogramme de repos [1,2]. Ces examens simples permettent d'identifier précocement les personnes à risque.
Les recommandations 2025 insistent particulièrement sur l'éducation thérapeutique du patient. Vous devez être informé sur votre pathologie, vos traitements et les signes d'alerte à surveiller. Cette approche éducative améliore l'observance thérapeutique et réduit le risque de récidive de 25% selon les études récentes [3].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations peuvent vous accompagner dans votre parcours de soins et de récupération. France AVC constitue la référence nationale avec des antennes dans toute la France. Cette association propose des groupes de parole, des ateliers de rééducation et un soutien psychologique adapté aux patients et à leurs familles.
L'Association pour la Recherche sur les AVC (ARVC) finance des projets de recherche innovants et informe les patients sur les dernières avancées thérapeutiques. Elle organise également des conférences grand public pour mieux comprendre ces pathologies complexes.
Au niveau local, de nombreuses associations proposent des activités adaptées : ateliers mémoire, groupes de marche, cours de gymnastique douce. Ces activités favorisent le lien social et maintiennent une activité physique régulière, éléments essentiels à votre récupération.
N'hésitez pas à contacter votre MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) pour connaître vos droits et les aides disponibles. Allocation d'autonomie, aménagement du logement, transport adapté : de nombreuses solutions existent pour faciliter votre quotidien. D'ailleurs, un ergothérapeute peut vous accompagner dans ces démarches administratives souvent complexes.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour mieux vivre avec un infarctus du tronc cérébral. Organisez votre domicile de manière sécurisée : éclairage suffisant dans tous les passages, barres d'appui dans la salle de bain, téléphone à portée de main. Ces aménagements simples préviennent efficacement les chutes.
Concernant l'alimentation, respectez scrupuleusement les conseils de votre orthophoniste. Mangez lentement, en position assise bien droite, et évitez de parler pendant les repas. Privilégiez les textures adaptées à vos capacités de déglutition : mixé, haché ou normal selon votre évolution.
Maintenez une activité physique régulière, même modérée. La marche reste l'exercice le plus bénéfique : elle améliore l'équilibre, renforce les muscles et stimule la circulation cérébrale. Commencez par de courtes distances et augmentez progressivement selon vos capacités.
Surveillez attentivement les signes d'alerte de récidive : maux de tête inhabituels, troubles visuels soudains, difficultés d'élocution nouvelles. En cas de doute, n'hésitez jamais à appeler le 15. Il vaut mieux une fausse alerte qu'un retard de prise en charge. D'ailleurs, votre entourage doit également connaître ces signes pour pouvoir réagir rapidement.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes nécessitent une consultation médicale immédiate. Appelez le 15 sans délai si vous ressentez des maux de tête intenses et inhabituels, des troubles visuels soudains (vision double, perte de vision) ou des difficultés d'élocution nouvelles. Ces symptômes peuvent signaler une récidive ou une complication [17].
Les troubles de la déglutition qui s'aggravent constituent également un motif de consultation urgente. Si vous commencez à tousser systématiquement en buvant ou si vous avez l'impression que les aliments "passent de travers", contactez rapidement votre médecin. Ces signes peuvent annoncer un risque de pneumopathie d'inhalation [6].
Pour le suivi régulier, consultez votre neurologue tous les 3 à 6 mois la première année, puis annuellement. Ces consultations permettent d'adapter vos traitements, d'évaluer votre récupération et de dépister d'éventuelles complications tardives. N'hésitez pas à préparer vos questions à l'avance.
Votre médecin traitant reste votre interlocuteur privilégié pour le suivi au long cours. Il coordonne vos soins, surveille vos facteurs de risque cardiovasculaires et adapte vos traitements préventifs. Une consultation tous les 3 mois est généralement recommandée, avec un bilan biologique semestriel comprenant glycémie, cholestérol et fonction rénale.
Questions Fréquentes
Puis-je conduire après un infarctus du tronc cérébral ?La conduite automobile dépend de vos séquelles. En cas de troubles visuels (diplopie) ou d'instabilité importante, la conduite est contre-indiquée. Une évaluation médicale spécialisée est nécessaire, généralement 3 mois après l'accident. Votre médecin peut vous orienter vers un centre d'évaluation de l'aptitude à la conduite.
Vais-je récupérer complètement ?
La récupération varie selon l'étendue et la localisation de l'infarctus. Environ 60% des patients retrouvent une autonomie satisfaisante [4]. La récupération peut se poursuivre pendant des mois, voire des années. L'important est de maintenir une rééducation régulière et de rester motivé.
Dois-je modifier mon alimentation ?
Oui, une alimentation équilibrée est essentielle. Réduisez le sel (moins de 6g/jour), limitez les graisses saturées et privilégiez les fruits et légumes. Si vous avez des troubles de la déglutition, respectez les textures recommandées par votre orthophoniste. Un suivi diététique peut être utile.
Puis-je reprendre une activité professionnelle ?
Cela dépend de vos séquelles et de votre métier. Beaucoup de patients reprennent une activité, parfois à temps partiel ou avec des aménagements. Votre médecin du travail évaluera vos capacités et proposera les adaptations nécessaires. N'hésitez pas à en discuter avec votre équipe soignante.
Questions Fréquentes
Puis-je conduire après un infarctus du tronc cérébral ?
La conduite automobile dépend de vos séquelles. En cas de troubles visuels (diplopie) ou d'instabilité importante, la conduite est contre-indiquée. Une évaluation médicale spécialisée est nécessaire, généralement 3 mois après l'accident.
Vais-je récupérer complètement ?
La récupération varie selon l'étendue et la localisation de l'infarctus. Environ 60% des patients retrouvent une autonomie satisfaisante. La récupération peut se poursuivre pendant des mois, voire des années.
Dois-je modifier mon alimentation ?
Oui, une alimentation équilibrée est essentielle. Réduisez le sel (moins de 6g/jour), limitez les graisses saturées et privilégiez les fruits et légumes. Si vous avez des troubles de la déglutition, respectez les textures recommandées.
Puis-je reprendre une activité professionnelle ?
Cela dépend de vos séquelles et de votre métier. Beaucoup de patients reprennent une activité, parfois à temps partiel ou avec des aménagements. Votre médecin du travail évaluera vos capacités.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Épidémiologie des maladies cardiovasculaires en France. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [2] Épidémiologie des maladies cardiovasculaires en France. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [3] RECOMMANDATIONS SANITAIRES AUX VOYAGEURS. sante.gouv.fr. 2024-2025.Lien
- [4] Outcome Predictor Differences in Infratentorial and .... Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] Longitudinal Studies to Identify Biomarkers for Sturge .... Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] Predictors of recovery from dysphagia after stroke. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [7] H Paré. Infarctus cérébral ischémique récidivant chez une patiente de 8 ans. 2025.Lien
- [8] M Hamid, A Kadira. Syndrome abducens isolé secondaire à un infarctus du tegmentum pontique. 2022.Lien
- [9] RDEP PROFESSIONNELLES. Modalités des transferts interhospitaliers des patients ayant un infarctus cérébral aigu nécessitant un transfert pour un traitement endovasculaire.Lien
- [12] G Duloquin, M Graber. Prise en charge de l'infarctus cérébral à la phase initiale. 2022.Lien
- [14] V Dryhynycz, K Lavandier. La thrombolyse intraveineuse de l'infarctus cérébral: des recommandations à la pratique clinique. 2022.Lien
- [15] Accident vasculaire cérébral ischémique. www.msdmanuals.com.Lien
- [16] Les AVC du tronc cérébral : les séquelles et la rééducation. www.flintrehab.com.Lien
- [17] Infarctus du tronc cérébral : causes, symptômes et traitement. www.medicoverhospitals.in.Lien
Publications scientifiques
- Infarctus cérébral ischémique récidivant chez une patiente de 8 ans (2025)[PDF]
- Syndrome abducens isolé secondaire à un infarctus du tegmentum pontique (2022)
- [PDF][PDF] Modalités des transferts interhospitaliers des patients ayant un infarctus cérébral aigu nécessitant un transfert pour un traitement endovasculaire ou vers une … [PDF]
- Le Bloomy Rind Sign: une signature IRM méconnue dans le diagnostic des méningites carcinomateuses (2025)
- Une double discordance cardiaque décompensée suite à une aspergillose pulmonaire, à propos d'un cas et revue de la littérature: A riboflavin-responsive … (2022)
Ressources web
- Accident vasculaire cérébral ischémique (msdmanuals.com)
Les symptômes apparaissent soudainement et peuvent inclure une faiblesse musculaire, une paralysie, une sensation anormale ou un manque de sensation d'un côté ...
- Les AVC du tronc cérébral : les séquelles et la rééducation (flintrehab.com)
Les séquelles potentielles d'un AVC du tronc cérébral · Coma. · Syndrome d'enfermement. · Troubles de la respiration. · Dysphagie · Troubles de la vue · Ataxie.
- Infarctus du tronc cérébral : causes, symptômes et traitement (medicoverhospitals.in)
Les symptômes courants comprennent des difficultés de coordination, une faiblesse d'un côté du corps, des changements de vision et des problèmes d'élocution ou ...
- Accidents vasculaires cérébraux (cen-neurologie.fr)
Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) sont caractérisés par la survenue brutale d'un déficit neurologique focal.Ils affectent environ 150000 patients ...
- Accident vasculaire cérébral du tronc cérébral (medicoverhospitals.in)
Les symptômes courants comprennent des étourdissements soudains, vertige, déséquilibre et difficulté à marcher.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
