Infarctus du territoire de l'artère cérébrale antérieure : Guide Complet 2025
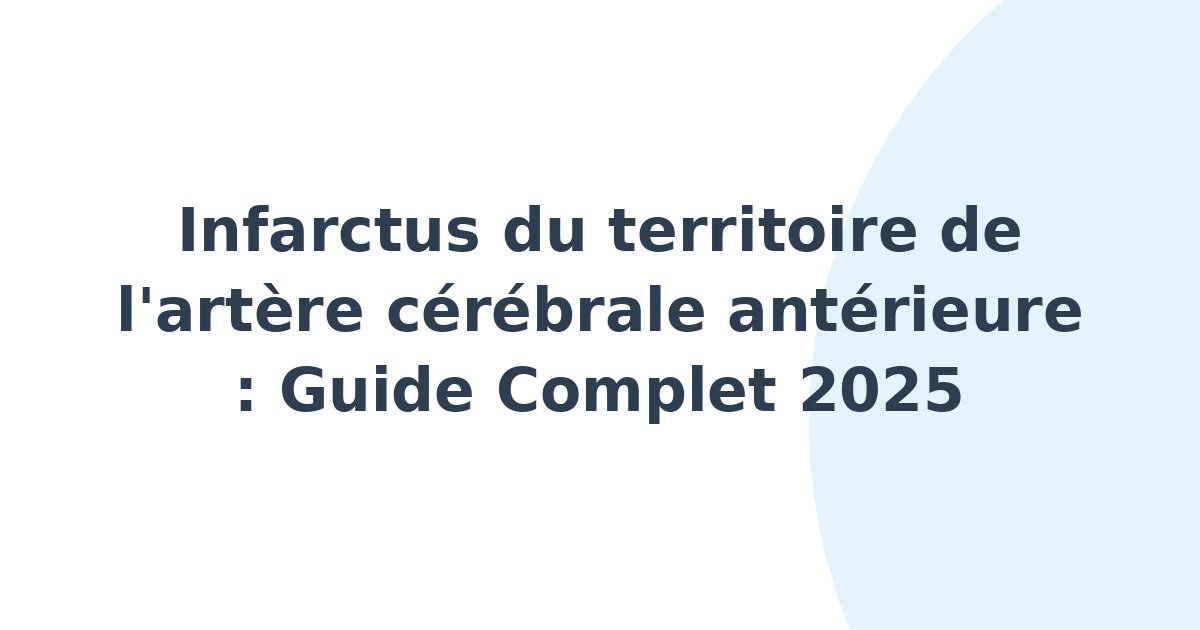
L'infarctus du territoire de l'artère cérébrale antérieure représente une forme particulière d'accident vasculaire cérébral (AVC) qui touche une zone spécifique du cerveau. Cette pathologie, bien que moins fréquente que d'autres types d'AVC, peut avoir des conséquences importantes sur la motricité et les fonctions cognitives. Comprendre cette maladie, ses symptômes et ses traitements est essentiel pour une prise en charge optimale.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Infarctus du territoire de l'artère cérébrale antérieure : Définition et Vue d'Ensemble
L'infarctus du territoire de l'artère cérébrale antérieure survient lorsque cette artère majeure du cerveau se bouche, privant une partie du cortex frontal et pariétal d'oxygène. Cette artère irrigue des zones cruciales pour le contrôle moteur des membres inférieurs et certaines fonctions cognitives [13,14].
Concrètement, imaginez votre cerveau comme une ville avec plusieurs quartiers. L'artère cérébrale antérieure alimente un quartier spécifique, principalement la partie interne des lobes frontaux. Quand cette "autoroute" se bloque, les neurones de cette zone souffrent et peuvent mourir [15].
Cette pathologie se distingue des autres AVC par sa localisation particulière. Elle affecte souvent la motricité des jambes plus que celle des bras, contrairement aux infarctus de l'artère cérébrale moyenne. D'ailleurs, les patients présentent fréquemment des troubles de la marche caractéristiques [5,8].
Il faut savoir que cette forme d'AVC représente environ 2 à 3% de tous les accidents vasculaires cérébraux ischémiques. Bien que relativement rare, elle nécessite une prise en charge spécialisée pour optimiser la récupération [11,12].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, les accidents vasculaires cérébraux touchent environ 140 000 personnes chaque année, selon les données du Ministère de la Santé [1]. Parmi ces cas, l'infarctus du territoire de l'artère cérébrale antérieure représente une proportion relativement faible mais significative.
Les données épidémiologiques récentes montrent que cette pathologie affecte principalement les personnes âgées de 60 à 80 ans, avec une légère prédominance masculine. L'incidence annuelle est estimée à environ 2 à 4 cas pour 100 000 habitants en France [11,12].
Comparativement aux autres pays européens, la France présente des taux similaires à ceux observés en Allemagne et en Italie. Cependant, les pays nordiques rapportent des incidences légèrement plus élevées, probablement liées aux facteurs de risque cardiovasculaire [1].
L'évolution temporelle sur les dix dernières années révèle une stabilisation de l'incidence, mais une amélioration notable du pronostic grâce aux progrès thérapeutiques. Les projections pour 2025-2030 suggèrent une possible augmentation liée au vieillissement de la population [1].
Il est intéressant de noter que les variations régionales en France restent modestes, contrairement à d'autres pathologies cardiovasculaires. L'impact économique sur le système de santé français est estimé à plusieurs millions d'euros annuellement, incluant les coûts de prise en charge aiguë et de rééducation [1].
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes de l'infarctus du territoire de l'artère cérébrale antérieure sont multiples et souvent intriquées. La principale origine reste l'athérosclérose, cette accumulation de plaques graisseuses dans les artères qui finissent par les obstruer [13,14].
Mais d'autres mécanismes entrent en jeu. L'embolie cardiaque représente une cause fréquente : un caillot formé dans le cœur migre et vient boucher l'artère cérébrale antérieure. Cette situation survient notamment en cas de fibrillation auriculaire ou de valvulopathie [11,12].
Les facteurs de risque classiques incluent l'hypertension artérielle, le diabète, le tabagisme et l'hypercholestérolémie. Ces quatre "cavaliers de l'apocalypse" cardiovasculaire multiplient considérablement le risque d'AVC [1]. D'ailleurs, leur contrôle représente la pierre angulaire de la prévention.
Certaines causes plus rares méritent d'être mentionnées. Les dissections artérielles, les vascularites ou encore les troubles de la coagulation peuvent également provoquer cette pathologie [5,8]. Chez les sujets jeunes, il faut particulièrement rechercher ces causes atypiques.
L'âge reste le facteur de risque non modifiable le plus important. Après 55 ans, le risque double tous les dix ans. Heureusement, la plupart des autres facteurs peuvent être contrôlés par des mesures hygiéno-diététiques et des traitements appropriés [1].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de l'infarctus du territoire de l'artère cérébrale antérieure présentent des caractéristiques particulières qui permettent souvent de suspecter cette localisation. Le signe le plus typique est la faiblesse prédominante des membres inférieurs, souvent plus marquée que celle des bras [5,8].
Concrètement, vous pourriez observer une difficulté soudaine à marcher, avec une jambe qui "traîne" ou qui ne répond plus normalement. Cette faiblesse touche généralement le côté opposé à l'artère bouchée. Si l'artère droite est atteinte, c'est la jambe gauche qui sera affectée, et vice versa [13,14].
Les troubles cognitifs constituent un autre aspect important. L'apathie, cette perte de motivation et d'initiative, peut être très marquée. Les patients semblent indifférents à leur environnement, ce qui peut être déroutant pour l'entourage [8]. D'autres troubles comme des difficultés de concentration ou des problèmes de mémoire peuvent également survenir.
Certains patients développent ce qu'on appelle une apraxie de la marche. Ils "oublient" comment marcher, même si leurs jambes ne sont pas paralysées. C'est comme si le programme moteur de la marche était effacé [5]. Cette situation peut être particulièrement frustrante car la force musculaire est préservée.
Il faut savoir que les symptômes peuvent parfois être subtils au début. Une simple maladresse inhabituelle, une fatigue inexpliquée ou des changements de personnalité doivent alerter, surtout chez une personne à risque cardiovasculaire [15].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de l'infarctus du territoire de l'artère cérébrale antérieure repose sur une démarche méthodique qui commence dès l'arrivée aux urgences. L'examen clinique initial permet souvent de suspecter cette localisation particulière grâce aux signes caractéristiques [13,14].
L'imagerie cérébrale constitue l'étape cruciale du diagnostic. Le scanner cérébral, réalisé en urgence, peut montrer les signes précoces de l'infarctus. Mais c'est l'IRM qui reste l'examen de référence, capable de détecter les lésions très tôt et de préciser leur étendue [15].
L'IRM de diffusion révèle les zones d'infarctus dès les premières heures, bien avant que les lésions ne soient visibles au scanner. Cette technique permet également de différencier un infarctus récent d'une lésion ancienne, information cruciale pour la prise en charge [13,14].
Parallèlement, les médecins recherchent la cause de l'AVC. Un bilan cardiologique complet est systématiquement réalisé : électrocardiogramme, échocardiographie, parfois Holter ECG pour détecter une fibrillation auriculaire intermittente [11,12]. Cette enquête étiologique maladiene le traitement préventif à long terme.
Les examens biologiques complètent le bilan : numération formule sanguine, bilan de coagulation, glycémie, bilan lipidique. Chez les sujets jeunes, des examens plus spécialisés peuvent être nécessaires pour rechercher des causes rares [5,8].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de l'infarctus du territoire de l'artère cérébrale antérieure s'articule autour de deux phases : la prise en charge aiguë et le traitement au long cours. En phase aiguë, la thrombolyse intraveineuse peut être proposée si le patient arrive dans les 4h30 suivant le début des symptômes [13,14].
Cette technique consiste à injecter un médicament qui dissout le caillot obstruant l'artère. Bien que moins souvent réalisable que pour d'autres localisations d'AVC, la thrombolyse peut considérablement améliorer le pronostic quand elle est possible [15].
La thrombectomie mécanique, cette technique qui consiste à retirer physiquement le caillot, est parfois envisageable selon la localisation précise de l'obstruction. Cette intervention, réalisée par voie endovasculaire, nécessite une équipe spécialisée en neuroradiologie interventionnelle [13,14].
Au-delà de la phase aiguë, le traitement repose sur la prévention des récidives. Les antiagrégants plaquettaires comme l'aspirine ou le clopidogrel constituent la base du traitement. En cas de fibrillation auriculaire, les anticoagulants sont préférés [1,11].
La rééducation occupe une place centrale dans la prise en charge. Kinésithérapie, ergothérapie et orthophonie peuvent être nécessaires selon les déficits présentés. Cette rééducation doit débuter précocement, idéalement dès les premiers jours d'hospitalisation [12].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les innovations thérapeutiques dans le domaine des AVC évoluent rapidement, offrant de nouveaux espoirs pour les patients atteints d'infarctus du territoire de l'artère cérébrale antérieure. Les cellules souches mésenchymateuses représentent une voie de recherche particulièrement prometteuse en 2024-2025 [2].
Ces cellules, capables de se différencier en différents types cellulaires, pourraient aider à réparer les tissus cérébraux lésés. Les premiers essais cliniques montrent des résultats encourageants, notamment pour améliorer la récupération motrice et cognitive [2]. Cette approche révolutionnaire pourrait transformer la prise en charge dans les années à venir.
Du côté des traitements médicamenteux, la rosuvastatine fait l'objet d'études approfondies pour ses effets neuroprotecteurs au-delà de son action sur le cholestérol [4]. Cette statine pourrait avoir des propriétés anti-inflammatoires et neuroprotectrices spécifiques dans le contexte de l'AVC.
Les techniques d'imagerie évoluent également. Les nouvelles séquences IRM permettent une meilleure caractérisation des tissus cérébraux et une évaluation plus précise du potentiel de récupération [3]. Ces avancées technologiques améliorent la sélection des patients pour les traitements innovants.
La télémédecine et l'intelligence artificielle transforment aussi la prise en charge. Des algorithmes d'aide au diagnostic permettent une reconnaissance plus rapide des AVC, particulièrement importante pour cette localisation parfois difficile à identifier [3].
Vivre au Quotidien avec un Infarctus du territoire de l'artère cérébrale antérieure
Vivre avec les séquelles d'un infarctus du territoire de l'artère cérébrale antérieure nécessite des adaptations importantes mais surmontables. Les troubles de la marche, souvent au premier plan, peuvent considérablement impacter l'autonomie quotidienne [5,8].
L'adaptation du domicile devient souvent nécessaire. Barres d'appui dans la salle de bain, suppression des tapis glissants, éclairage renforcé : ces aménagements simples peuvent faire une grande différence. L'ergothérapeute joue un rôle clé dans ces adaptations [12].
La conduite automobile pose souvent question. Une évaluation spécialisée est généralement nécessaire avant de reprendre le volant. Certains patients peuvent conduire avec des adaptations, d'autres devront renoncer temporairement ou définitivement [15].
L'aspect psychologique ne doit pas être négligé. L'apathie, fréquente dans cette localisation d'AVC, peut être particulièrement difficile à vivre pour l'entourage. Il est important de comprendre que ce n'est pas de la paresse mais bien une conséquence neurologique de la lésion [8].
Heureusement, la récupération peut se poursuivre pendant des mois, voire des années. La plasticité cérébrale permet souvent une amélioration progressive des fonctions. L'important est de maintenir une rééducation régulière et de rester motivé [11,12].
Les Complications Possibles
L'infarctus du territoire de l'artère cérébrale antérieure peut entraîner diverses complications, certaines immédiates, d'autres plus tardives. L'œdème cérébral représente la complication aiguë la plus redoutable, pouvant comprimer les structures cérébrales adjacentes [13,14].
Cette complication survient généralement dans les 24 à 72 heures suivant l'AVC. Elle nécessite une surveillance neurologique rapprochée et peut imposer des traitements spécifiques pour réduire la pression intracrânienne [15]. Heureusement, elle reste relativement rare dans cette localisation d'infarctus.
Les complications infectieuses constituent un autre écueil. Les pneumopathies d'inhalation peuvent survenir, particulièrement chez les patients présentant des troubles de la déglutition associés. Une évaluation orthophonique précoce permet de prévenir ces complications [11,12].
À plus long terme, les troubles thrombo-emboliques représentent un risque majeur. L'immobilisation prolongée favorise la formation de caillots dans les veines des jambes, pouvant migrer vers les poumons. La prévention par anticoagulants et mobilisation précoce est essentielle [1].
Les complications psychiatriques ne doivent pas être sous-estimées. Dépression, anxiété, mais aussi troubles du comportement peuvent compliquer l'évolution. L'apathie, particulièrement fréquente dans cette localisation, nécessite souvent une prise en charge spécialisée [8].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'infarctus du territoire de l'artère cérébrale antérieure dépend de nombreux facteurs, mais il est généralement plus favorable que celui d'autres localisations d'AVC. La taille de l'infarctus constitue le facteur pronostique principal : plus la lésion est étendue, plus les séquelles risquent d'être importantes [11,12].
L'âge du patient joue également un rôle crucial. Les sujets jeunes ont généralement une meilleure capacité de récupération grâce à la plasticité cérébrale plus importante. Après 75 ans, la récupération peut être plus lente et parfois incomplète [1].
La rapidité de la prise en charge influence considérablement le pronostic. Les patients bénéficiant d'une thrombolyse précoce ont généralement de meilleurs résultats fonctionnels à long terme [13,14]. Chaque minute compte dans la phase aiguë de l'AVC.
Il faut savoir que la récupération peut se poursuivre pendant des mois, voire des années. La majorité des patients récupèrent une marche autonome, même si elle peut rester imparfaite. Les troubles cognitifs, notamment l'apathie, peuvent être plus persistants [5,8].
Les données récentes montrent qu'environ 60 à 70% des patients retrouvent une autonomie satisfaisante dans les activités de la vie quotidienne. Ce pourcentage encourage à maintenir les efforts de rééducation sur le long terme [12,15].
Peut-on Prévenir l'Infarctus du territoire de l'artère cérébrale antérieure ?
La prévention de l'infarctus du territoire de l'artère cérébrale antérieure repose sur le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire. Cette approche, recommandée par toutes les autorités de santé, peut réduire significativement le risque d'AVC [1].
Le contrôle de l'hypertension artérielle constitue la mesure préventive la plus efficace. Une tension artérielle maintenue en dessous de 140/90 mmHg (ou 130/80 chez les diabétiques) peut réduire le risque d'AVC de 30 à 40% [1]. Les traitements antihypertenseurs sont donc essentiels.
L'arrêt du tabac représente une autre mesure fondamentale. Le tabagisme multiplie par 2 à 3 le risque d'AVC, et ce risque diminue rapidement après l'arrêt. Dès la première année sans tabac, le risque commence à décroître [1].
Le contrôle du diabète et du cholestérol complète cette approche préventive. Un diabète bien équilibré (HbA1c < 7%) et un LDL-cholestérol maintenu sous les objectifs réduisent considérablement le risque cardiovasculaire [1,4].
L'activité physique régulière mérite une mention particulière. Trente minutes de marche rapide cinq fois par semaine peuvent réduire le risque d'AVC de 25%. Cette recommandation simple mais efficace devrait être suivie par tous [1]. D'ailleurs, il n'est jamais trop tard pour commencer !
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités de santé françaises, notamment la Haute Autorité de Santé (HAS) et Santé Publique France, ont émis des recommandations précises concernant la prise en charge des AVC, incluant l'infarctus du territoire de l'artère cérébrale antérieure [1].
La filière AVC mise en place sur tout le territoire français garantit une prise en charge optimale. Chaque région dispose d'unités neuro-vasculaires (UNV) spécialisées, accessibles 24h/24. Cette organisation permet de réduire les délais de prise en charge, facteur crucial pour le pronostic [1].
Les recommandations insistent sur l'importance de la prévention primaire. Le dépistage systématique de la fibrillation auriculaire chez les personnes de plus de 65 ans fait partie des mesures préconisées. Cette arythmie cardiaque, souvent silencieuse, multiplie par 5 le risque d'AVC [1].
Concernant la rééducation, les recommandations préconisent une approche multidisciplinaire précoce. L'évaluation des troubles de la déglutition doit être systématique dans les premières heures, et la mobilisation doit débuter dès que possible [1].
Les autorités insistent également sur l'éducation thérapeutique du patient et de sa famille. Comprendre sa maladie, reconnaître les signes d'alerte, savoir quand consulter : ces connaissances sont essentielles pour prévenir les récidives [1].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations accompagnent les patients victimes d'AVC et leurs familles. La Fédération Nationale France AVC constitue la principale organisation de patients en France, offrant soutien, information et défense des droits [1].
Cette fédération propose des groupes de parole, des ateliers d'information et un accompagnement dans les démarches administratives. Elle dispose d'antennes locales dans la plupart des départements français, facilitant l'accès aux services [1].
L'Association pour la Recherche sur les AVC (ARVC) finance des projets de recherche et informe le public sur les avancées scientifiques. Elle organise régulièrement des conférences grand public pour faire connaître les innovations thérapeutiques [2,3].
Au niveau local, de nombreuses associations proposent des activités adaptées : ateliers mémoire, groupes de marche, activités artistiques. Ces initiatives favorisent le lien social et participent à la rééducation [12].
Les réseaux sociaux offrent également des espaces d'échange entre patients. Des groupes Facebook dédiés permettent de partager expériences et conseils pratiques. Attention cependant à vérifier la fiabilité des informations échangées [15].
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec les séquelles d'un infarctus du territoire de l'artère cérébrale antérieure nécessite quelques adaptations pratiques que nous souhaitons partager avec vous. Ces conseils, issus de l'expérience clinique, peuvent considérablement améliorer votre quotidien [11,12].
Pour les troubles de la marche, privilégiez des chaussures à semelles antidérapantes et évitez les talons. Un déambulateur peut être utile dans les premiers temps, même si l'objectif reste de s'en passer progressivement. N'hésitez pas à utiliser les rampes et barres d'appui disponibles [5,8].
Concernant l'apathie, maintenez un rythme de vie structuré. Fixez-vous des objectifs simples et réalisables chaque jour. L'entourage joue un rôle crucial en encourageant sans forcer. Parfois, un traitement antidépresseur peut être nécessaire [8].
Pour la conduite, ne reprenez le volant qu'après avis médical favorable. Commencez par de courts trajets familiers et évitez les heures de pointe. Certains équipements peuvent faciliter la conduite : rétroviseurs supplémentaires, commandes adaptées [15].
Maintenez une activité physique adaptée. La marche reste l'exercice de référence, mais la natation ou le vélo d'appartement peuvent être bénéfiques. L'important est la régularité plutôt que l'intensité [1,12].
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous amener à consulter rapidement, que ce soit en urgence ou en consultation programmée. La règle d'or reste : en cas de doute, il vaut mieux consulter pour rien que de passer à côté de quelque chose d'important [1,13].
Consultez immédiatement si vous présentez une aggravation brutale de vos symptômes : faiblesse soudaine, troubles de la parole, maux de tête intenses. Ces signes peuvent témoigner d'une récidive d'AVC ou d'une complication [14,15].
Une fièvre élevée, des difficultés respiratoires ou des douleurs thoraciques nécessitent également une consultation urgente. Ces symptômes peuvent révéler des complications infectieuses ou thrombo-emboliques [11,12].
Pour les consultations programmées, signalez à votre médecin tout changement dans votre état : modification de l'humeur, troubles du sommeil, difficultés nouvelles dans les activités quotidiennes. Ces évolutions peuvent nécessiter des ajustements thérapeutiques [8].
N'oubliez pas les consultations de suivi régulières. Votre médecin traitant doit vous voir au moins tous les 3 à 6 mois pour surveiller les facteurs de risque et adapter les traitements. Ces rendez-vous sont essentiels pour prévenir les récidives [1].
Questions Fréquentes
Puis-je faire du sport après un infarctus de l'artère cérébrale antérieure ?Oui, l'activité physique est même recommandée ! Commencez progressivement par de la marche, puis adaptez selon vos capacités. Un test d'effort peut être utile pour définir vos limites [1,12].
Vais-je récupérer complètement ?
La récupération varie selon chaque patient. Beaucoup retrouvent une autonomie satisfaisante, même si certaines séquelles peuvent persister. La rééducation régulière optimise les chances de récupération [11,12].
Puis-je reprendre le travail ?
Cela dépend de votre métier et de vos séquelles. Beaucoup de patients reprennent une activité, parfois avec des aménagements. La médecine du travail peut vous accompagner dans cette démarche [15].
Les traitements sont-ils à vie ?
Les traitements préventifs (antiagrégants, statines) sont généralement prescrits à long terme pour éviter les récidives. Votre médecin adaptera selon votre situation [1,4].
Puis-je voyager ?
Les voyages sont possibles, mais nécessitent quelques précautions : emporter suffisamment de médicaments, prévoir une assurance adaptée, éviter les longs trajets sans pause [1].
Questions Fréquentes
Puis-je faire du sport après un infarctus de l'artère cérébrale antérieure ?
Oui, l'activité physique est même recommandée ! Commencez progressivement par de la marche, puis adaptez selon vos capacités. Un test d'effort peut être utile pour définir vos limites.
Vais-je récupérer complètement ?
La récupération varie selon chaque patient. Beaucoup retrouvent une autonomie satisfaisante, même si certaines séquelles peuvent persister. La rééducation régulière optimise les chances de récupération.
Puis-je reprendre le travail ?
Cela dépend de votre métier et de vos séquelles. Beaucoup de patients reprennent une activité, parfois avec des aménagements. La médecine du travail peut vous accompagner dans cette démarche.
Les traitements sont-ils à vie ?
Les traitements préventifs (antiagrégants, statines) sont généralement prescrits à long terme pour éviter les récidives. Votre médecin adaptera selon votre situation.
Puis-je voyager ?
Les voyages sont possibles, mais nécessitent quelques précautions : emporter suffisamment de médicaments, prévoir une assurance adaptée, éviter les longs trajets sans pause.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] La prévention des AVC - Ministère de la Santé. sante.gouv.fr. 2024-2025.Lien
- [2] Therapeutic Potential of Mesenchymal Stem Cells in Stroke. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [3] Archives Case Report. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [4] Rosuvastatin (ZD 4522) | HMGCR Inhibitor. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] S Frikha, R Ben Dhia. Accident vasculaire cérébral ischémique de l'artère cérébrale antérieure bilatéral révélé par une tétraparésie: à propos d'un cas.Lien
- [8] CFM Mboumba, JN Mapaga. Troubles psychiatriques révélant un infarctus du territoire de l'artère récurrente de Heubner. 2024.Lien
- [11] R Randrianantoandro, JL Naliniaina. Caractéristiques des infarctus cérébraux cardioemboliques présumés. 2022.Lien
- [12] RR Naliniaina, JL Rakotomanana. Caractéristiques des infarctus cérébraux cardioemboliques présumés en service de neurologie de Befelatanana. 2024.Lien
- [13] Accident vasculaire cérébral ischémique. MSD Manuals.Lien
- [14] Revue générale des accidents vasculaires cérébraux. MSD Manuals.Lien
- [15] Accidents vasculaires cérébraux. Collège des Enseignants de Neurologie.Lien
Publications scientifiques
- [PDF][PDF] Accident vasculaire cérébral ischémique de l'artère cérébrale antérieure bilatéral révélé par une tétraparésie: à propos d'un cas. [PDF]
- Corrélation entre le syndrome de Volkmann néonatal et la survenue d'accident vasculaire cérébral néonatal. Une étude rétrospective (2023)
- … en charge de l'AVC de l'artère choroïdie nne antérieure Décrire les aspects les aspects cliniques et l'évolution des patients atteints d'AVCi dans le territoire de l'AchA … (2023)[PDF]
- Troubles psychiatriques révélant un infarctus du territoire de l'artère récurrente de Heubner: Psychiatric disorders revealing an infarction of the territory of the recurrent … (2024)
- Régression complète d'un syndrome des jambes sans repos grâce à un infarctus sylvien droit superficiel: une nouvelle observation (2023)
Ressources web
- Accident vasculaire cérébral ischémique (msdmanuals.com)
Les symptômes apparaissent soudainement et peuvent inclure une faiblesse musculaire, une paralysie, une sensation anormale ou un manque de sensation d'un côté ...
- Revue générale des accidents vasculaires cérébraux (msdmanuals.com)
Lorsqu'un accident vasculaire cérébral est suspecté, une neuro-imagerie immédiate est nécessaire pour différencier un accident vasculaire cérébral hémorragique ...
- Accidents vasculaires cérébraux (cen-neurologie.fr)
Infarctus cérébraux carotidiens. Les symptômes déficitaires moteurs et sensitifs sont controlatéraux à la lésion cérébrale. Exception : l'occlusion de l'artère ...
- Accident vasculaire cérébral (AVC) (inserm.fr)
13 juin 2017 — Reconnaître les symptômes · une faiblesse musculaire et/ou une paralysie d'un ou plusieurs membres ou du visage, le plus souvent d'un seul côté ...
- Infarctus cérébral : définition, symptômes et ... (deuxiemeavis.fr)
25 avr. 2025 — Comment diagnostiquer un infarctus cérébral ? · Un bilan cardiaque (examen clinique, ECG, échographie cardiaque). · Un bilan vasculaire ( ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
